18/03/2022
La langue française est un roman:

23:23 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
13/03/2022
Entretien sur l'Ame secrète de l'Europe:

Photographie de Ingalill Snit
Luc-Olivier d'Algange
Entretien sur L'Ame secrète de l'Europe
Anna Calosso: On discerne dans presque toutes les pages que vous écrivez une sorte de filigrane sacré, tantôt chrétien, dans Lux Umbra Dei, et tantôt païen, dans Le Songe de Pallas, ou dans vos poèmes du Chant de l'Ame du monde, et parfois l'un et l'autre, comme dans L'Ombre de Venise, qui vient d'être republié, avec de nombreux inédits, dans L'Ame secrète de l'Europe (éditions de L'Harmattan, collection Theôria).
Luc-Olivier d'Algange: Allons en amont... Nous vivons dans un Purgatoire mais le Paradis s'entrevoit par éclats. Dans ces éclats le temps se rassemble puis vole au-dessus de lui-même, dans l'éther où vivent les dieux. Dans la tradition européenne le paganisme et le christianisme s'enchevêtrent, moins en théorie qu'en pratique, dans les rites, les légendes et les œuvres qu'elles soient poétiques, picturales ou architecturales. Est-il même possible, depuis le Moyen-Age, pour ne rien dire de la Renaissance, d'être chrétien sans être quelque peu païen, et à l'inverse ? Souvenons-nous simplement que le Versailles du « Roi Très-Chrétien » fut un temple apollinien.
Les « monothéistes » purs et durs le savent qui considèrent le catholicisme comme « associationniste », autrement dit comme un paganisme, voire comme une mécréance. Allons plus loin... Il me semble qu'il est même possible d'être catholique, ou païen, sans croire, en laissant simplement s'éprouver en nous le sens du surnaturel, du Temps au-delà du temps. Ce qui s'éprouve n'est-il pas plus profond que ce que l'on croit ?
Au demeurant, la croyance, comme l'opinion, sont affaires subjectives, souvent superficielles et étroites. On se demande pourquoi les hommes sont si attachés à leurs croyances: ils aiment l'étroitesse, ils s'y croient à l'abri, - grave illusion. Ils croient pour n'avoir pas à éprouver. La citerne croupissante leur semble préférable à la source vive... Et moins ils éprouvent et plus ils veulent faire croire, imposer leurs croyances qui ne reposent alors que sur leur incommensurable vanité.
La « gnôsis », qui dépasse la « doxa », ne se réduit pas au « gnosticisme », qui serait une autre croyance, mais une nouvelle profondeur, la profondeur de l'immédiat, la profondeur du sensible: telle couleur qui nous vient en transparence, tel silence entre les notes de Debussy ou de Ravel. La pensée ne vaut qu'anagogique, en vol d'oiseau. Certes la pensée s'exerce, mais elle se saisit au vol. Elle est un commerce avec l'impondérable qui nous vient de loin... Ce beau, ce vaste lointain est la profondeur de la présence.
A force de s'identifier à une croyance, la croyance elle-même se perd, devient écorce morte, revendication hargneuse. Cela se voit, hélas, tous les jours. Le ressentiment s'ensuit contre tout ce que nous aimons, la liberté d'allure et de propos, Villon, Rabelais, Musset, la musique, les cheveux au vent... Un grand défi se pose à l'honnête homme: ne pas être gagné lui-même par le ressentiment contre le ressentiment. Pour cela, cependant, il faut bien connaître ses ennemis, et plus encore, ses amis. Honorer ce qui nous est amical. L'air du matin qui nous délivre des songes moroses, les amants heureux de Valery Larbaud, les grains de pollen de Novalis, la bienveillance pleine de courage de Nietzsche, les rameaux, les rameaux d'or...
Toujours garder en mémoire : se garder du pathos et de l'outrance, et de ceux qui les propagent, et être, à cet égard, d'une intransigeance parfaite et limpide... Ne pas céder, tant qu'il est possible, sur nos vertus, nos légendes héritées, d'autant qu'européennes, elles sont arborescente, pleines de rumeurs et légères. Réciter en soi, de temps à autres, quelques noms, Homère, Pindare, Villon, Dante, Rabelais, Montaigne, Hölderlin, Shelley, Nerval…
Ce qui nous en vient n'est pas un dogme, un système, un goût peut-être, un savoir qui est saveur, une possibilité de traverser la vie, moins chagrine, moins vengeresse, moins stupide. Ces noms, comprenons bien, désignent des œuvres, et ces œuvres sont des évènements d'une bien plus grande importance, Horace le savait déjà, que les événements dits historiques ou politiques. Chacun de ces événements de l'âme est un avènement, l'entrée dans un Temps secret qui a tout à nous dire, à chaque instant. Si nous devions formuler un vœu, ou une prière, ce serait: Que chaque instant soit l'éclat de son Paradis !
Anna Calosso: Vos ouvrages récemment parus sont de préoccupations et de tons forts divers. Notes sur l'Eclaircie de l'être est consacré à Heidegger, Intempestiva Sapientia sont des propos, des formes brèves, proches de Joseph Joubert, Apocalypse de la beauté est une méditation sur la philocalie et la lumière émanée des icônes. Quel unité fonde ces diverses approches, s'il en est une ?
Luc-Olivier d'Algange: La réponse la plus simple, ce serait l'auteur. Mais sans doute ne suffit-elle pas pour un auteur auquel il semble assez souvent avoir pratiqué, comme une diététique, voire comme un exercice spirituel, une certaine « impersonnalité active », pour reprendre la formule de Julius Evola, elle-même issue de la philosophie stoïcienne. Au demeurant, je serais enclin à penser que, d'une certaine façon, toute activité créatrice nous impersonnalise dès lors que l'art n'est plus seulement, pour nous, l'expression de notre « moi » mais un véhicule, un vaisseau, un instrument de connaissance.
Enfin, les thèmes que vous indiquez ne sont pas si éloignés qu'il semblerait aux spécialistes de l'un ou de l'autre. C'est bien dans une éclaircie de l'être que surgissent et scintillent les formes brèves de Joseph Joubert. Les épiphanies qu'évoque la Philocalie orthodoxe, sont, elles aussi, surgissement. La beauté, enfin, est notre Haut Désir.
Anna Calosso: Si l'on vous en croit, la beauté mène un combat contre la laideur, la laideur de ce monde, la laideur moderne....
Luc-Olivier d'Algange: Ou peut-être, serait, dans l'autre sens, la laideur qui mène un combat contre la beauté... Il me semble parfois assister au spectacle d'une volonté planificatrice de la laideur, avec ses stratégies, ses machines de guerre, la télévision, l'architecture de masse etc... Il y a dans la beauté comme une ingénue, une inconsciente présence de l'être. La beauté est-elle combative ? Elle est une victoire à chaque fois qu'elle advient. Elle se suffit à elle-même, d'où le sentiment de plénitude qu'elle nous apporte, elle est, comme la rose d'Angélus Silésius, « sans pourquoi ». La laideur, elle, est un mouvement de destruction concerté, elle est le « quoi » du pourquoi, un ressentiment, une représentation; c'est la grimace de la jalousie à laquelle cependant toujours échappe ce qui est.
Le vaste enlaidissement de tout ne doit pas nous dissimuler que la beauté demeure, et l'enlaidissement même, dans sa planification, dans sa volonté, témoigne de la souveraineté de la beauté qui sera humiliée, recouverte, insultée mais jamais défaite. Le brin d'herbe perce le goudron.
On accuse souvent les amants de la beauté d'être des esthètes, et « l'esthète », il va sans dire, dans la bouche de ces moralisateurs, est un méchant homme. Mais est-il un plus généreux acte de bonté que de vouloir répandre la beauté, l'honorer et tenter de faire vivre nos semblables en sa compagnie ? Que serait une bonté qui serait laide ? Nous le savons par les meurtrières utopies, ces maîtresses du kitch. On voudrait alors pouvoir respirer, repousser les fanatiques, les « arriérés de toutes sortes », selon la formule de Rimbaud, les obtus, les puritains, pour élargir l'espace et le temps, laisser venir à nous des confins d'or et d'azur. C'est ainsi que l'idée d'une défense de la beauté redevient pertinente. Elle se fera par touches exquises, par intransigeances transparentes, par nuances, « sur des pattes de colombe », autant dire de la façon la plus aristocratique possible, - ce qui ne veut pas dire que chacun n’y soit pas convié. La beauté est ce qui ne passe pas. Au contraire des mœurs, elle demeure elle-même dans ses manifestations. Le temple de Delphes, les fresques de Piero de la Francesca sont aussi beaux pour nous qu'ils le furent pour leurs contemporains. Voici bien l'approche du Temps au-delà du temps, l'effleurement de son aile...
Anna Calosso: Tel pourrait bien être le cœur de vos écrits, dire le Temps au-delà du temps, dire le cœur du temps, l'éternité de l'Instant, et je songe, en particulier à ce poème, Le Sacre de l'Instant.
Luc-Olivier d'Algange: L'activisme planificateur nous assigne à une temporalité, laquelle nous pousse en avant à toutes fins utiles, mais n'oublions pas qu'en avant, c'est la mort, et non la mort toute nue, vouée aux vautours ou au feu, mais la mort profitable. Cette mort profitable, c'est la vie, toute la vie assignée au temps du travail et de l'usure... Je ne vois guère d'autre objet à la pensée, et précisément à une pensée qui résiste et se rebelle, que d'œuvrer à la révélation, à la réactivation d'autres temporalités secrètes, transversales ou latérales. J'en dis quelques mots dans un essai récent, Les dieux, ceux qui adviennent... Au discours du temps utilitariste, profane et profanateur, du discours qui nous sépare de nous-mêmes et du monde, opposons la fidélité à un autre cours, une rivière enchantée, un Lignon, dont Honoré d'Urfé savait qu'il traverse une géographie sacrée.
Toute géographie, au demeurant, est sacrée, mais nous l'avons oublié. Qui n'a observé que selon les lieux où nous nous trouvons, nos pensées changent de cours ? Une qualité particulière à tel lieu nous imprègne. ce que nous sommes est dans cet accord, dans cet échange magnétique, à la fois intime et impersonnel, par notre façon de nous y mouvoir, de même que la musique, à chaque note, désigne le silence pur où elle se pose, le révélant par ses interstices.
Anna Calosso: Il semblerait que dans votre éloge de l'accord entre l'homme et son paysage, il y eût une implicite critique du « cosmopolitisme », tel, du moins qu'il se revendique parfois aujourd'hui.
Luc-Olivier d'Algange: Votre précision est importante : tel qu'il se revendique aujourd'hui. La critique, implicite ou explicite, en l'occurrence, porte bien davantage sur la globalisation, et la mondialisation, qui ont pour conséquences les communautarismes les plus obtus, les plus incarcérés, que sur le « cosmopolitisme », mot grec qui désigne une pratique spécifiquement européenne. On doute fort que ces grands cosmopolites à leur façon, que furent Fernando Pessoa, Valery Larbaud, Paul Morand, Mircea Eliade, et, plus en amont, Goethe ou Frédéric II de Hohenstaufen, eussent éprouvés la moindre sympathie pour l'actuelle globalisation. Le cosmopolite, l’habitant du cosmos, de l’ordre, est enraciné et peut s'enraciner, et il peut aussi éprouver le sens de l'exil, qu'évoquaient Hölderlin ou, plus proche de nous dans le temps, Dominique de Roux... Le cosmopolite goûte le charme de la découverte, de la mission de reconnaissance. Le globalisé, lui, est partout chez lui dans le nulle part. Le cosmopolitisme appartient, dans son ambiguïté même, à la tradition européenne. Le globalisé n'appartient à rien, sinon aux outrances de sa subjectivité. Dans ce monde déchu, qui est celui de la séparation, du diaballein, la pire séparation est celle qui règne dans le monde globalisé; chacun y étant le geôlier de soi-même. Autant le cosmopolitisme était le luxe de ceux qui s'inscrivent dans un tradere, autant la globalisation est la misère, fût-t-elle cossue et bancaire, des renégats.
Anna Calosso: L'adversaire, si je vous suis, est donc l'uniformisation...
Luc-Olivier d'Algange: oui, elle, et la schématisation, la simplification, la généralité et l'abstraction, choses plus ou moins équivalentes en la circonstance. La liberté n'est possible que dans un monde complexe et même profus, mais d'une profusion, non point numérique mais concrète. Si tout est plat, on nous tire à vue. Il faut, pour être libre, des espaces secrets, des labyrinthes, des passages vers d'autres mondes et d'autres temps. Tanizaki écrivit un Eloge de l'ombre, dont je conseille la lecture. Ceux auxquels on colle volontiers l'étiquette « anarchistes de droite » aiment le secret, les abbayes de Thélème, les Ermitages aux buissons blanc, les « mondes flottants », comme on dit au Japon. Le monde ante-moderne excellait à ces désordres féconds qui obéissaient à un ordre supérieur, invisible. Voyez une cité médiévale, ses recoins, ses surprises, son harmonie qui semble improvisée, voyez encore Venise et comparez les aux productions des architectes et urbanistes modernes conçues rigoureusement pour travailler, vendre et surveiller. Quelques architectes modernes eurent même l'idée de supprimer les rues, où l'on se promène, et de créer un dispositif où les hommes, parqués selon leurs catégories professionnelles, iraient directement de leur appartement à leur lieu de travail, avec pour seules stations intermédiaires le garage collectif et le supermarché. Nous sommes là aux antipodes de ce que Pasolini nommait la société des arcades où les castes se mêlaient dans la recherche des conversations, des saveurs et des plaisirs, dans le goût de l'otium. L'étymologie dit bien que c'est le negotium qui est la négation de l'otium. On voit aussitôt de quel côté est le nihilisme.
Anna Calosso: Le nihilisme est quelque chose qui doit être surmonté nous dit Nietzsche...
Luc-Olivier d'Algange: Surmonté est le mot juste. Tout homme de ce temps est contraint à la traversée du nihilisme. Que voit-il dans ce parcours ? Les murs qui l'enserrent de plus en plus ou la lueur au loin, celle des « aurores » védiques ? La critique de la modernité est souvent perçue comme le fait de « réactionnaires », - mais nombre de ceux que l'on nomme ainsi ne le sont guère. Ce ne sont pas les formes anciennes qu'ils veulent restaurer mais perpétuer les forces, l'imagination créatrice qui les firent naître. Ce qui est tout autre chose.
Anna Calosso: J'hésite enfin à vous poser cette question, un peu trop courue: êtes-vous optimiste ou pessimiste ?
Luc-Olivier d'Algange: La grande espérance, la plus lumineuse, nous vient lorsque tout est à désespérer. Peut-être même y a-t-il quelque chose de providentiel dans le détachement auquel nous sommes obligés, et dont nous serons peut-être les obligés. Une réduction à l'essentiel s'opère, un feu de roue alchimique. Les œuvres qui ne sont plus enseignées publiquement deviennent un secret, dont naît une discipline de l'arcane. La beauté perdue au milieu de la laideur devient éperdue. La destruction des formes visibles nous livre au « séjour auprès de l'invisible invulnérable » pour reprendre la formule de Heidegger. L'hostilité du monde renforce l'amour entre quelques-uns. Les temps prochains seront aux Calenders.

20:34 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
12/03/2022
Le courage d'être heureux selon Joseph Joubert:
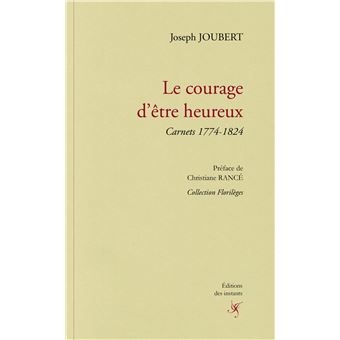
Luc-Olivier d'Algange
Le courage d'être heureux selon Joseph Joubert
Nos temps sont à l'outrance. Les moralisateurs univoques sévissent. En guise de contre-poison, les éditions des Instants nous offrent, sous le titre Le courage d'être heureux, les Carnets 1774-1824 de Joseph Joubert, avec une très-belle préface de Christiane Rancé, - laquelle est la descendante de l'Abbé dont Chateaubriand, qui fut l'ami et le divulgateur de Joseph Joubert, fit un livre.
« La littérature respire mal » disait Julien Gracq de celle de son temps. Dans le nôtre, elle s'essouffle parfois d'indignations, feintes plus ou moins, et de complaisances en de réelles tristesses. Le courage d'être heureux n'est plus guère la chose du monde la mieux partagée.
Ce courage, Joseph Joubert nous l'enseigne, non par des propos édifiants ou des recettes, à la façon navrante du « développement personnel », mais par des exemples, des signes d'intelligence, saisis au vif de l'instant. « Il faut, écrit Joseph Joubert, plusieurs voix ensembles dans une voix pour qu'elle soit belle. Et plusieurs significations dans un mot pour qu'il soit beau ». D'une seule phrase, il nous donne ainsi un art de vivre et un art poétique. Rien, en effet, n'est si monocorde que la tristesse ; et se connaître, se reconnaître, c'est entendre la choeur des voix qui se sont tues mêlé de voix vivantes. Nous connaissons mieux un homme par les inflexions de sa voix que par son visage et mieux encore une œuvre par ses secrets, par ce qu'elle se dispense de nous dire, que par les convictions qu'elle affirme.
La lucidité, pour Joseph Joubert, est une forme supérieure de la bienveillance ; si matinale, si heureuse nous apparaît-t-elle en ces temps fuligineux traversés de cris de vindicte : « Porter en soi et avec soi cette indulgence qui fait fleurir les pensées d'autrui ». Quelles étendues anonymes nous séparent désormais du monde de Joseph Joubert, et par quelles passerelles le rejoindre ? La réponse est toute donnée dans ses pensées cueillies au fil des jours : par la langue française dans son usage le plus précis, le plus nuancé, le plus naturellement élégant.
Dans ces carnets Joseph Joubert nous donne à visiter ses jardins, qui sont de ceux « où le Maître peut se montrer ou se cacher à sa guise ». Son ambition est humble et immense : nous parler comme à des amis, passer les étapes intermédiaires d'un propos pour en éviter le tour didactique qui ferait insulte à notre intelligence, et enfin, laisser vivre dans sa faveur le repos de notre âme, le calme qui est la clef des mystères et des merveilles : « Les âmes en repos sont toutes en harmonie entre elles ».
Ce n'est point sans doute de cette façon, en nos temps spectaculaires, que l'on comprend la gloire (« Néant de la Gloire, dit Joubert, Dieu même est inconnu ») mais plutôt que le resplendissement péremptoire, et parfois accablant, sinon aveuglant, le lecteur trouvera dans ces pensées une autre lumière, une lumière filtrée par les feuillages des peupliers de France, une lumière qui joue au bord des rivières, une lumière spirituelle que l'on ne voit pas, mais qui révèle tout ce qu'elle touche.
Aux antipodes des manuels de « pensées positives», comme aux antipodes du nihilisme qui joue sa partition pour les déçus et les craintifs, et plus loin encore de tous les donneurs de leçon, Joseph Joubert ravive le goût, lequel, par excellence, alerte l'intelligence. Sans goût, l'intelligence - qui veut tant avoir raison qu'elle la perd - est insipide ou monstrueuse, de même que « l'esprit », s'il est malveillant, est le ridicule de celui qui croit en user au dépend des autres.
Joseph Joubert ne veut rien démontrer. Il veille à la fine pointe de la pensée qui vient d'éclore. Le bien lui est léger, et quant à lui marquer sa préférence, il lui convient de ne le faire que légèrement, et d'éviter « la fureur d'endoctriner, et de mêler la bave de son propre esprit à tout ce qu'il enseigne ». Mélancolique à ses heures Joseph Joubert sut, mieux que d'autres , se défendre contre l'aigreur, qui est une faute de goût. S'il faut choisir dans quelque difficile discord, prenons alors pour guide, sans comédie ni tartarinade, la meilleure de nos inclinations naturelles: « Il n'y a de bon dans l'homme que les jeunes sentiments et les vieilles pensées ».
Philosophe, et même métaphysicien, Joseph Joubert l'est au suprême - mais non de cette façon discursive héritée des épigones de la philosophie allemande qui veulent faire des pensées « novatrices » avec de vieux sentiments. Joseph Joubert ne se veut point novateur, ou révolutionnaire, mais juste, si possible, de façon immémoriale. Son ambition est plus grande que de soulever le monde par l'abstraction, et son souci est plus humble : il ne veut point séparer le sensible de l'intelligible.
Souvent comparé aux Moralistes du dix-septième siècle, il se distingue d'eux par la métaphysique. S'il désabuse, comme eux, les hommes de leurs fausses vertus, c'est pour mieux nous inviter à quelque méditation. Frontalier entre deux mondes, comme son ami Chateaubriand, sa nostalgie est discrète et ses pressentiments sans drame. Sur l'orée, il exerce sa vertu majeure, dont il n'attend pas d'être sauvé ni perdu : l'attention.
« Ne confondez pas ce qui est spirituel et ce qui est abstrait » Et ceci encore : « Je n'aime la philosophie (et surtout la métaphysique) ni quadrupède, ni bipède, je la veux ailée et chantante ». L'étymologie est bonne conseillère. Chez Joseph Joubert, tout est pur, c'est à dire feu. Que nous faut-il ? « Du sang dans les veines, mieux du feu, et du feu divin. »
22:05 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
11/03/2022
Note à propos d'un livre de Philippe Barthelet, éditions Pierre-Guillaume de Roux.

Luc-Olivier d'Algange
Fou forêt de Philippe Barthelet
(éditions Pierre-Guillaume de Roux)
Ce qui est ennuyeux dans le monde de la culture tel qu'il se présente actuellement à nos yeux, et à nos oreilles, - pour ne pas dire à notre intelligence, - faculté oubliée ou reléguée de longtemps par les ratiocineurs et les moralisateurs de toute espèce qui ont usurpé le beau nom d'intellectuels que leur attribuaient des adversaires mal avisés, - c'est qu'on y cherche en vain quoique ce soit d'amusant ou de vraiment profond.
Ni la virtuosité joueuse, ni l'aperçu métaphysique ne trouvent grâce chez ces puritains austères. La beauté à fleur de peau comme les beautés intelligibles semblent exclues de ces activités moroses (dites "culturelles") et souvent vindicatives où le moindre semi-cultivé est requis à endosser contre des confrères plus doués et plus libres, l'habit du procureur. L'ensemble répugne et ne manque d'incliner l'homme de goût à n'importe quelles autres fréquentations.
Si bien qu'il est bel et bon de savoir, de temps à autres, et de recevoir cette bonne nouvelle comme un hôte tout autant désiré qu'attendu, que cette zone médiocre où l'on s'ennuie et où l'on travaille, où l'on croit se "cultiver", où l'on traite des "problèmes de l'époque", où l'on est, enfin, si effroyablement sérieux, certains auteurs s'en passent aisément: la nuit et le soleil sont dans leurs phrases, et de folles forêts en surgissent à l'euphonique faveur d'un feu follet.
Fou Forêt de Philippe Barthelet est un de ces livres rares inventés par la désinvolture supérieure qui consiste à parler de l'essentiel.
"Parler du langage, écrit Philippe Barthelet, c'est parler du monde". Voici donc un livre avec lequel le lecteur qui a décidé de ne pas s'ennuyer peut entrer en conversation, comme il entrerait en conversation avec le monde, le cosmos et ses étymologies secrètes que sont les fées et les Muses.
Si pour d'autres, qui sont désormais légion, le monde est un écran, pour Philippe Barthelet, le monde demeure le monde, avec ses rivières, ses arbres, ses oiseaux, et les oeuvres des hommes qui savent les blasonner avec bonheur. La langue française garde cette mémoire seconde, et vivace. Au lieu d'enseigner, ou pire encore, de "communiquer" par elle, l'auteur la prend comme maîtresse, qui enseigne et qui ravit.
La romance de la langue française est un chant continu, comme d'une rivière, que l'on entend mieux loin du bavardage des machines et des hommes. Les Muses sont devenues discrètes, dissimulées, farouches devant les fracassantes convictions des "musophobes", pour reprendre le mot de Milan Kundera, qui arpentent notre terre pour en chasser les merveilles.
Les chapitres dont se composent cet ouvrage nous adviennent comme des rituels légers pour mériter à nouveau, de ces belles Impondérables, une confiance jamais lassée depuis la nuit des temps, et leur intimité profonde, qui nous oblige.
Si nos temps sont infidèles et absurdes, ce n'est point tant par de mauvais penchants gouvernés par des forces drues que par faiblesse grammaticale et pauvreté des mots. La pureté n'est point puriste, encore moins puritaine, elle est, comme le diamant, ce qui laisse voir, dans sa taille, le secret des couleurs de la lumière.
Les Modernes ne semblent tenir à rien, sinon à quelques généralités tyranniques, - mais, à la vérité, c'est que rien ne tient à eux, pas même l'instant où ils se tiennent. Leurs divagations sont tristes et leurs conflits sans honneur. Il s'acharnent avec une âpreté démentielle à fausser les instruments dont ils héritent, pour, égotistes achevés, être sûr de ne rien laisser qui ne soit défaillant ou funeste. Leur temps n'est plus le Temps mais une durée tout amenuisée à quelque finalité précaire, laborieuse ou distractive. Pour combattre ces "musophobes", il ne suffit pas d'emprunter telles convictions, qui leur sont habituellement les plus étrangères ou les plus contraires, à quoi s'emploient, avec une persistance digne d'éloge, les écrivains "réactionnaires". Une physique et une métaphysique sont requises, - à l'oeuvre précisément dans l'ouvrage dont nous parlons.
La plus commune erreur du sérieux est de croire que la fin justifie les moyens; il ne cesse ainsi, par des moyens divers, de nous distraire de ce qui pourrait être une fin adorable si elle n'était éloignée, rendue hors d'atteinte par les moyens qui prétendent y conduire. Ce qui distingue le livre de Philippe Barthelet de ces ouvrages édifiants, qu'ils soient progressistes ou réactionnaires, se tient en la simple raison qu'il est ce qu'il dit.
Ontologique, le moyen, la langue, y est sa fin, dévoilant peu à peu les arcane de l'être et du monde. Nous sommes déjà ce vers quoi nous volons comme les Oiseaux de Farid-Ud-Dîn Attar. La langue française est le Simorgh vers lequel volent ces chroniques françaises.
La sapience n'est pas un but lointain, dont on planifie l'atteinte, mais ce qui est déjà là et que, dans nos agitations, nous troublons ou méconnaissons. L'exercice s'apparente à une oraison de l'attention. Que disons-nous et quelle connaissance nous est donnée par le dire de la chose dite dans ce cheminement amoureux qui va du sens acquis et profane au sens intérieur, étymologique et secret, - là où gisent les images immémoriales et les ressources les plus limpides.
Philippe Barthelet traque, en chasseur subtil ceux qui défigurent la langue française, qui restreignent son usage ou l'ahurissent en réduisant le monde nommé, le seul qui existe pour nous, à des stéréotypes ou des schémas. Confucius plaçait au plus haut, ce qu'il nomme "la science des justes dénominations". Nous apprenons, avec Philippe Barthelet que les dénominations sont justes par ce qu'elles sont fertiles. Elles se refusent à nous laisser dans la représentation que nous avons d'elles. Muses, elles nous ravissent vers des contrées lointaines qui soudain se révèlent être, distantes seulement par l'oubli que nous avions d'elle, notre humble et sainte Patrie.
19:35 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
02/03/2022
Les dieux, ceux qui adviennent:

Luc-Olivier d'Algange
Les dieux, ceux qui adviennent
Définir le paganisme sans se fonder sur le point de vue de ses principaux adversaires n'est pas chose aisée. Depuis un peu plus de deux millénaires, le « païen » existe d'abord comme appellation réprobatrice dans le discours de ses ennemis, de ceux-là même qui se sont évertué à éradiquer ses rites, ses coutumes et ses symboles et à rendre impensables ses idées, sauf à les plier à leurs propres théologies.
Ce qui oppose le païen au monothéiste n'est pas tant ce qui oppose le multiple à l'un, sinon peut-être dans le culte rendu. Sans Aristote ou Platon, la théologie chrétienne eût été une coquille vide (ce qui n’exclut pas le souffle de l’esprit, entendons bien, ces pages ne sont pas d'un “néopaïen” ou d'un adorateur de l'immanence). Toutefois si, par une de ces chances impondérables de l'intelligence qui sont au principe de toutes les œuvres vives, nous parvenions à penser l'Un et le Multiple non comme une opposition, un dualisme, mais comme une diffraction (le Multiple diffracté de l'Un) nous nous approcherions déjà de ce que put être une métaphysique païenne fondée sur le consentement poétique à la multiplicité des aspects du monde.
Ce consentement exige une force d'âme qui semble s'être perdue. La faiblesse, nous le savons depuis Nietzsche, emprunte les voies du ressentiment, de la vengeance et de la technique elle-même, « arraisonnement du monde », selon la formule de Heidegger, qui est la première des formes de l'esprit de vengeance contre la diversité diffractée du monde.
Dans ses formes les plus récentes, le monothéisme le plus agressif, par la terreur, issue de la vengeance, et par l'argent uniformisateur, montre assez qu'il n'est plus du tout une théologie, et moins encore une métaphysique, mais la simple application d'une Loi du ressentiment, contre tout ce qui, pour un esprit libre, est aimable: les cheveux au vent, la musique, l'intelligence librement exercée, et contre l'âme elle-même des individus et des peuples.
En politique internationale, nous assistons à la mise-en-place d'un dispositif où de faux ennemis s'avèrent être de véritables alliés dans la fabrication d'une machine de guerre destinée à faire disparaître la profondeur du temps. Les massacres, les statues détruites, les manuscrits brûlés ne sont que la part visible d'un projet d'aplatissement du réel qui suppose la destruction ou l'oubli du palimpseste du temps.
Dans quel temps vivons-nous ? La question se pose à chacun, et à chaque peuple. Est-ce le temps de l'abolition des temps antérieurs ou le temps de la reconnaissance, avec la décisive nuance de gratitude qui s'attache à ce mot ? Ce que l'on nomme, faute de mieux, le paganisme, renait dans la reconnaissance, qui est à la fois gratitude, mission de reconnaissance, initiation à ces temporalités qui échappent à l'usure et nous donnent la chance, selon la formule d'Hölderlin, d'habiter en poètes un monde dont, ainsi que le rappelle Heidegger, nous ne sommes qu'une part, - avec le ciel, la terre et les dieux.
Le paganisme, s'il fut banni, parfois non sans brutalité, des campagnes et des cités, ne s'en est pas moins perpétué dans le cœur des poètes, c'est dire dans les langues européennes elles-mêmes, lorsqu'elles ne se sont point asservies aux seuls jargons utilitaristes, et nous relient, du seul fait de la grammaire et de l'étymologie, à notre plus lointain passé.
Loin de n'être qu'un folklorisme, une néo-attitude, une déférence muséale, le ressouvenir des dieux fut, en poésie, un rappel de cet autre temps, ce temps sacré, ce temps historial par lequel nous échappons au temps des banques, au temps numérique, au temps administratif.
La parole revient au poème, c'est-à-dire au cœur du réel, hors des abstractions despotiques. Le soleil et le vent, les forêts et la mer, l'amour et l'ivresse sont des déesses et des dieux. Dans ce temps-là, dans ce temps spacieux et ondoyant, l'intériorité ne se distingue pas de l'extériorité, une circulation s'établit, en forme de ruban de Moebius, entre nous et le monde, - circulation, orbe nocturne et solaire, qui interdit que nous puissions vouloir planifier ce qui nous entoure et le soumettre à la seule vision narcissique que nous nous faisons de nous-mêmes.
Le paganisme, à cet égard, est une humilité, un « sens de la terre » pour reprendre la formule de Nietzsche, et cette terre est sous un ciel, qui n'a rien d'abstrait, un ciel qui approfondit nos yeux et nos poumons. Le païen se rend à cette évidence: nous avons des poumons parce qu'il y a de l'air, des yeux parce qu'il y a de la lumière. Notre corps, notre peau, notre cerveau, sont des instruments de perception. Notre subjectivité n'est qu'une réalité seconde, une représentation, un relent.
Demeurer fidèles aux bonheurs qui nous advinrent quand bien même il n'en subsiste que des traces presque indiscernables, runes couvertes de mousse dans la profondeur des forêts; sauvegarder le souvenir, dans le ciel vide, d'une escadre d'oiseaux qu'aruspices de la minute heureuse nous déchiffrâmes; voir les crépuscules, comme dans les tableaux de Caspar David Friedrich, détenir de secret de l'aurore, - telle est, par la longue mémoire qui fait du présent une présence, l'égide protectrice que nous offre la profondeur du temps.
Da-sein, être là, c'est refuser de se laisser chasser de là où nous sommes, physiquement et métaphysiquement, au nom d'une universalité qui est la plus radicale négation de l'Un diffracté. L'atteinte portée à la langue française par les forces conjointes des politiques, du pédagogisme, des animateurs et publicistes divers, est l'essence même, vengeresse, du projet d'aplatissement qui n'a d'autre fin que la disparition même du réel. Cependant, quand bien même uniformiserait-t-on tous les aspects de notre environnement et de nos styles de vie, les dieux demeurent, en puissance, tant que nous pouvons les nommer.
Notre langue irrigue nos pensées, la porte plus loin, gardant le souvenir de la source, lumineuse fraîcheur, jusqu'à l'estuaire où elles s'abandonnent à l'océan du monde et des autres hommes. On chercherait en vain, dans ce monde devenu abstrait, enracinement plus profond ailleurs que dans le cours des phrases, - et mieux encore qu'un enracinement, une source, une ressource de notre intelligence, - de cette intelligence que nous avons avec ce qui nous environne, et qui nous regarde et nous reconnaît.
Nommer les dieux, c'est être d'intelligence, non pas avec l'ennemi, mais dans l'amitié des aspects divers du monde. Ce vent, Eole, ce soleil, Hélios, cet Océan nous parlent, nous regardent, et nous pouvons leur adresser nos louanges, nos imprécations ou nos prières. Les dieux disent, en existant, la relation qui opère entre le monde et nous, entre l'immense et l'infime, entre le mortel et l'immortel. Ainsi, la vision que nous avons du temps ne se réduit pas à la seule temporalité des mortels que nous sommes, et nous pouvons ainsi servir ce qui est plus haut et plus grand que nous; condition nécessaire à toute fondation, à toute civilisation.
Le grand souci politique de toutes les épopées et Chansons de Geste, tient en une définition de la noblesse. Qu'est-ce qu'être noble ? De quelle nature est l'areté homérique ou la vertu héroïque ou chevaleresque des romans arthuriens ? Sa nature est d'être, précisément, la réverbération d'une surnature et l'approche d'une Merveille. Elle est d'être de ce monde sans lui appartenir entièrement; elle est de fonder, en mortel, ce qui doit nous survivre.
Nous, modernes, méconnaissons la chance de recevoir. Nous préférons rompre avec ce qui exigerait de nous une reconnaissance ou une gratitude, une admiration, sans savoir à quel point ces beaux sentiments peuvent être, lorsqu'on s'y abandonne, légers, - légers comme d'une ivresse légère, une dansante dionysie. Sans doute la plus triste, la plus morose des souffrances humaines est-elle cette illusion funeste de n'avoir rien, ni personne, à remercier. Le nihilisme se fonde sur cette arrogante illusion que meut, comme l'automate d'un cauchemar expressionniste, cette volonté de puissance retournée, inversée, et rendue infirme, qu'est la volonté de vengeance, non plus contre des ennemis, ou, comme dans l'Odyssée, d'abusifs prétendants, mais contre la simple dignité des êtres et des choses.
Proches et lointains sont les dieux. Ce lointain si proche, cette proximité si lointaine sont la nature surnaturelle des dieux. Dans la vastitude qui nous surplombe comme dans l'interstice que nous devinons, leur secret est d'advenir, d'être, selon la formule grecque, « ceux qui adviennent », et qui adviennent par notre art et notre ferveur à les nommer.
A écouter Hésiode et Pindare, Homère et Virgile, les dieux qu'ils évoquent et dont ils disent les advenues, les dieux qu'ils invoquent et qu'ils racontent, nous nous apercevons soudain que ces dieux, depuis la nuit des temps de notre mémoire, nous accompagnent, et que nos destinées s'accomplissent sous leurs égides menaçantes ou protectrices.
Intercesseurs du tragique et de la joie, ils sont, approfondissant l'espace et le temps, ombres et lumières entretissées, frontières frémissantes, orées impondérables, et rien, sinon une interdiction que nous faisons à nous-mêmes, valant ignorance, ne nous interdit d'en recevoir, hic et nunc, les messages.
Cette proximité lointaine, ce lointain si proche, cette distance immanente et transcendante, tendue comme un arc entre le temps et l'éternité, définit un rapport au monde où les contraires s'avivent, ourdissent ensemble un grand dessein, lors que les dualismes sont frappés d'inconsistance.
Il est une façon « païenne » d'approcher du vrai, du beau et du bien, ni scolastique, ni systématique. Dans un monde où les dieux sont les résonances du possible, le réel ne se donne point à administrer, à diviser, ou à planifier. On remarquera à quel point, chez les philosophes grecs, qu'ils soient ante ou post- socratiques, ce mode la pensée, l'Opinion, la doxa, si despotique de nos jours, est, sinon absent, du moins immédiatement mis en perspective. L'esprit critique, - qui naît de la philosophie grecque et de nulle autre, fonde, dans le raisonnement, la précellence de l'objectivité.
La doxa corrigée par la gnosis de la philosophie platonicienne et néoplatonicienne, de Plotin, jusqu'à Marsile Ficin ou Pic de la Mirandole succède à la doxa livrée et éprouvée par le paradoxe d'Héraclite ou de Zénon. La pensée grecque, mesurée à l'objectivité des dieux qui nous délivrent de la subjectivité outrancière de la croyance réduite à une monologie, demeure cette flèche paradoxale qui ne devrait jamais toucher sa cible alors même qu'elle la frappe. Les dieux et cette façon grecque de s'entretenir avec les dieux, ne sont pas étrangers à cette pensée spéculative toute d'audace, d'élans et de surprises.
Pour les Grecs, les théophanies ne sont pas des causes ou des conséquences d'une croyance mais une expérience que l'on éprouve, - sauvegardant ainsi le sens étymologique du mot expérience, ex-perii, traversée d'un péril. Ce qui s'éprouve n'est pas affaire d'opinion, de croyance, mais de connaissance. Ces dieux qui nous regardent sans nous juger, qui interviennent de façon contradictoire ou paradoxale dans nos destinées, ces dieux qui nous guident et nous déroutent, nous enchantent ou nous terrifient, prédisposent nos pensées à des vigueurs qui font paraître ineptes ces dualismes si reposants, quel que soit le côté vers lequel ils nous inclinent, pour mieux nous déchoir.
Entourés d'Aphrodite, de Dionysos, d'Apollon, ou d'Athéna, comment pourrions-nous reposer notre pensée dans une représentation, comment pourrions-nous administrer cette représentation et, par elle, vouloir planifier la réalité des hommes et du monde ?
L'opposition de la croyance et du scepticisme, de la nature et de la surnature, du corps et de l'esprit, du sensible et de l'intelligible ( que l'on accuse à tort Platon d'avoir promue, alors qu'il nous dit, entre les deux, non la rupture mais « la gradation infinie »); l'opposition entre le singulier et le collectif, entre le destin individuel et la communauté de destin, - ces oppositions scolastiques, universitaires, puis, hélas, journalistiques, sont devenues si familières aux esprits formés par la dualisme qu'elles sont devenues comme intrinsèques à presque tous les discours idéologiques de notre temps, - alors qu'elles n'eurent, sans doute, pour les Grecs, entourés de la polyphonie concordante des dieux, aucun sens.
Entre l'individualisme de masse et le collectivisme planificateur, une tierce voie demeure possible qu'illustre le voyage odysséen. Cette voie, encore que généralement oubliée, n'a jamais cessé d'être fréquentée. Fénelon, dans son Voyage de Télémaque, y invita celui qui devait devenir notre Roi-Soleil, et Versailles, ce temple apollinien du Roi Très-Chrétien, en témoigne.
Si arrogantes qu'eussent été les prétentions des sectateurs, de ceux qui coupent et qui divisent le temps, de ceux qui eussent voulu nous séparer de notre passé, celui-ci, précisément parce qu’il fut déplacé hors de la temporalité qu'on voulut nous imposer, nous revient, si l'on ose dire, quand il lui plaît.
La formule des physiciens présocratiques, « rien ne se crée, rien ne se perd » se transpose aisément dans l'ordre des idées, au sens où les idées ne sont pas des abstractions, mais des formes, et des formes formatrices. Qu'elles soient hors de la doxa, proscrites, dénigrées, exclues du monde social, voire jugées illégales, ces formes qui nous forment et forment le monde demeurent, fussent-elles inapparentes, car clandestines, et ressurgissent dans l'advenue des dieux qui les figurent.
Là où l'abstraction ne règne plus adviennent les dieux; là où la nature n'est plus un spectacle ou une zone d'exploitation, les épiphanies surgissent, et point n'est nécessaire d'y croire pour les éprouver. Dans un monde peuplé de dieux, la dissociation entre ce qui serait de l'esprit et ce qui serait du corps n'a aucun sens, car c'est de l'âme que nous viennent les dieux, âme humaine dans l'éclat de la prunelle et Ame du monde, - celle qui figure, dans Virgile, sur le bouclier de Vulcain.
Entre le sensible et l'intelligible, entre l'extériorité énigmatique et l'intériorité mystérieuse, les dieux sont intercesseurs. Le propre de leurs messages est qu'ils ne sont jamais entièrement délivrés; ils demeurent en suspens, et attendent de nous un déchiffrement sans fin à la ressemblance de l'attente amoureuse ou du voyage en haute-mer.
La haine du paganisme fut peut-être avant tout une haine de l'Eros, un ressentiment contre la joie. Dans son cours puissant, dévastateur, cette haine de l'Eros est devenue aussi une haine du Logos. Dans la mythologie grecque, il n'est point rare que les déesses se laissent étreindre par des hommes. Mais l'étreinte la plus ardent, la plus nuptiale, est celle qui unit l'Eros et le Logos, et dont naissent les Epopées et les chants. L'inimitié du Mythe et du Logos, sur laquelle insistent parfois Messieurs les professeurs, est des plus relatives: il n'est que de voir l'importance des Mythes platoniciens.
Dans les Hymnes homériques, dans la Théogonie d'Hésiode, dans la poésie de Pindare, le Logos embrasse et s'embrase d'Eros. Au consentement tragique répond le consentement à la joie, à la jouissance. Etre aimé d'une déesse donne une haute idée de l'amour, fort éloigné du puritanisme et de son envers pornographique, - qui ne sont l'un et l'autre que deux aspects de cet utilitarisme moralisateur dans lequel Théophile Gautier, dans son admirable préface à Mademoiselle de Maupin, voyait la pire menace contre l'art, le plaisir, le goût et la civilisation elle-même.
Entre la maussaderie et la dérision hargneuse, les Modernes semblent mal disposés au combat allègre, savant et léger auquel Théophile Gautier nous convie, - où furent cependant engagés, dans un magnifique « tous pour un » des écrivains puisant aux sources les plus hautes, tels que Gérard de Nerval, Marcel Schwob, Pierre Louÿs ou Paul Valéry, - dont la traduction des Géorgiques de Virgile donne à la langue française un autre texte sacré.
Or ce puritanisme, ce moralisme, cette complaisance, voire cette obédience, à l'égard de ce qui veut nous détruire, que sont-ils sinon les écorces mortes d'une détestable fatigue ? Tout en ce monde moderne conjure à nous épuiser, à nous distraire, à nous culpabiliser, à nous anémier, à nous uniformiser et à nous faire oublier l'Aphrodite aux mille parfums.
Repoussé hors du réel, exproprié de nos terres et de nos traditions, chassé de nos paysages et rendus sourds à l'esprit des lieux, au palimpseste des légendes, aux bruissement des sources sacrées, nous sommes devenus ce troupeau aveugle dirigé vers les lotissements de l'abstraction, là où, en place vivre dans la tragédie et dans la joie, nous serons figés en statues de sel devant des écrans auxquels nous servirons d'intercesseurs lucratifs. Ainsi, avec le réel, disparaissent le Mythe et le Logos, et par eux, la voie d'accès avec ce qu'il y a de réel en nous, c'est-à-dire, de souverain et de différencié.
Plus encore que par les religions qui s'y substituèrent (et gardèrent souvent de secrètes révérences à l'égard des symboles plus anciens), la vue-du-monde portée par les dieux antérieurs est niée par le règne de l'abstraction pour lequel il n'est plus de rites opératoires ni de symboles qui relient le visible à l'invisible: abstraction par laquelle le monde est vide de toute présence et de toute puissance qui ne soit humaine et utilisable par l'humain.
Lorsque l'action se réduit à être strictement utilitaire dans un temps linéaire qui est le temps de l'usure, elle cesse d'être en corrélation avec la contemplation. Or ce qui ne se donne pas à contempler disparaît tôt ou tard de notre regard et de la vie elle-même, cette polyphonie de forces concordantes et contradictoires.
Les dieux peuplent les mers, les forêts, les prairies, les clairières, les glaciers, l'abord des rivières, car il y eut des regards d'homme pour s'y attarder, pour les considérer d'un autre œil que celui de la rentabilité. Pour qu'un dieu advienne, il faut que le regard approfondisse en lui le paysage qui sera son voile et son dévoilement. Le dieu, ou la déesse, surgit là où nous l'attendons.
La grande erreur morose, la grande erreur de la lassitude, la grande erreur du renoncement, est de croire que tout a déjà été vécu. Mille nuances sont en attente. Nous ne reviendrons pas aux dieux comme vers un passé, ou pire encore, un Musée; ce sont les dieux qui reviendront en nous, à l'impourvue, - dès lors qu'abandonnant comme de trop humaines vénités, nos trajectoires scolastiques, didactiques, discursives ou linéaires, nous consentirons à laisser nos pensées emprunter la forme des constellations, des concrétions minérales, des fleurs de givre, du vol des hirondelles, de l'étoilement.
Les formes, les dieux, les idées, - au sens étymologique, - sont à la fois une liberté conquise et une limite. Rien cependant n'est pire prison que l'informe, dont nul ne peut s'évader car il n'a pas de frontières. Perdus dans le nulle part, nous sommes livrés sans défenses et sans contredits possible à la servitude et au déterminisme le plus immédiat. Toute liberté exercée suppose la protection d'une forme, d'une idée ou d'un dieu qui libère et définit l'aire où nous pouvons agir. L'utopie de la liberté absolue conduit à la dictature absolue. Défions-nous des « libérateurs » dont le premier projet est de nos inventer, et surtout de nous vendre, de nouvelles servitudes. Ainsi chaque innovation technique se présente comme une liberté nouvelle, de se déplacer, de « communiquer », alors même qu'elle nous ôte une aptitude, nous soumet à son véhicule et nous fait dépendre de son objet.
La limite de la forme est une frontière que nous gardons la liberté de franchir, en toute connaissance de cause, et qui nous garde aussi de nous dissoudre, de nous évanouir, et de perdre ainsi, dans l'indélimité, le sens même de notre souveraineté.
Ces dieux qui demeurent et que, parfois, notre attention ravive dans la profondeur du temps, veillent sur notre civilisation dont ils disent les puissances, les paradoxes et les détours, - et ce Dit, cette Dichtung, nous protège de la société qui travaille à la liquidation, à la table rase, à la solderie de tout et de tous. L'apparence de vérité de la théorie du « choc des civilisations » cède devant l'évidence de cette guerre plus profonde, plus radicale et plus impitoyable qui oppose désormais la société, régie par l'argent, suprême liquidité, et le palimpseste des civilisations.
Qu'attendons-nous ? Dans quels temps attendons-nous ? De quelles attentions honorons-nous le monde, et dans quelles attentions divines, à l'exemple d'Ulysse, sommes-nous ? Lorsque les hommes sont attentifs aux dieux et les dieux attentifs aux hommes, cet autre temps, qui n'est plus le temps de l'usure, se déploie et devient un espace de réminiscences et de pressentiments. Les signes deviennent symboles et rappels. On songe à ce poème platonicien de Théophile de Viau: « Au seul ressouvenir d'avoir couru les eaux/ Nos rapides pensers volent dans les étoiles/Et le moindre instrument qui sert à des vaisseaux/ Nous fait ressouvenir des cordages et des voiles. »
La profondeur n'est pas dans la seule direction du passé; elle environne l'instant d'un beau cosmos miroitant, dans toutes les directions. Lorsque les dieux apparaissent ou interviennent, le temps n'est plus seulement une ligne, qui va du passé vers un futur en abolissant le présent, mais une roue solaire, un feu de roue comme disent les alchimistes, qui changera en or, en ensoleillement intérieur, en épiphanie héliaque du Logos, le plomb du temps accumulé.
La théophanie est l'instant qui fait éclore le cœur du temps. Au temps passé, au temps futur s'ajoutent d'autres temps, latéraux ou transversaux, selon des modalités non plus discursives mais rayonnantes. « La musique creuse le ciel » disait Baudelaire. Les dieux et leurs légendes creusent le temps, - et ce n'est point vers un passé momifié que nous allons mais vers l'eau la plus fraîche, qui sourd des profondeurs, la claire fontaine du temps perdu qui est l'éternité même ainsi que nous le disent la Feuille d'Or d’Hipponion :
« Ceci est l’œuvre de la mémoire, quand tu seras sur le point de mourir.
Tu iras dans la maison bien construite d’Hadès. Il y a une source à droite, et dressée à côté d’elle un blanc cyprès : descendue de là les âmes des morts se rafraîchissent. De cette source ne t’approche surtout pas ! Mais plus avant tu trouveras une eau qui coule du lac de Mnémosyne ; devant elle il y des gardes. Ils te demanderont, en sûr discernement, ce que tu viens chercher dans les ténèbres de l’Hadès obscur : Dis : Je suis fils de Terre et de Ciel étoilé. »
De tels écrits situent ce que nous sommes, le cœur secret de nos songes et de nos actions, dans un présent qui est présence parfaite à ce qu'il y a de plus archaïque, de plus originel. Ces phrases ne se donnent pas à entendre comme un témoignage anthropologique ou historique, mais s'offrent au déchiffrement, à l'herméneutique ardente, amoureuse, comme la trame sur laquelle s'incurvent, ici et maintenant, la conscience de notre finitude et notre espérance d'immortalité. En ce qu'elles sont un péristyle de l'au-delà, et peut-être par cela même, elles peuvent aussi se comprendre comme une vue-du-monde, une légende de nos œuvres ici-bas, de nos songes et de nos combats.
L'autre monde, l'autre temps, dans la vision antique du monde, n'est pas donné, il est conquis. L'éternité est conquise par l'attention, ainsi que la vie elle-même qui ne resplendit jamais aussi bien que lorsque nous savons, avec Platon, que « temps est l'image mobile de l'éternité », et qu'il nous vient ainsi, naturellement et surnaturellement, à servir plus grand que soi.
Chacun perçoit plus ou moins obscurément que deux mondes s'opposent, celui de la réglementation abstraite et celui des libertés réelles. Ces deux mondes s'opposent, au demeurant, en nous tout autant qu'autour de nous. A cet égard, nous sommes, que nous le voulions ou non, doublement impliqués dans leur discord. Le comble de l'abstraction est l'Argent. De même qu'il y a une nature naturante, une idée idéatrice, une forme formatrice ou génétique, il y a cette abstraction abstractive, si l'on ose dire, en ce qu'elle tend à faire de toute chose une quantité abstraite.
Quiconque a vu mourir l'un des siens a vu aussitôt s'affairer autour du défunt un grouillement de banquiers, de notaires et de parasites divers, dont l'Etat. Dans le monde moderne, le disparu n'est pas « fils du Ciel étoilé » selon la formule orphique mais une chose immédiatement monnayable. Rien de bien surprenant, puisque selon l'atroce devise en vigueur, « time is money », la vie elle-même est destinée à être soumise à cette réduction de la qualité à la quantité. Le temps quantifié n'est plus ce « temps perdu », ce temps qui précisément nous reviendra en reconnaissances, en réminiscences, comme le Graal de Wolfram von Eschenbach qui nous enseigne que le Graal perdu est le Graal trouvé, mais un temps détruit.
Au temps détruit, le temps des dieux oppose le temps fécond, printemps de l'âme, temps des advenues, des surgissements ravissants ou terribles, le temps de la tragédie et de la joie.
Cette titanesque machine uniformisatrice que nous voyons à l'œuvre, outre l'esprit de vengeance et de ressentiment, a pour moteur la peur du tragique et le dédain de la joie qui lui est corrélative. Le sentiment tragique de la vie naît de cette certitude que rien, aucune situation, aucune personne, aucun peuple, aucun paysage, aucune œuvre, aucun combat ne sont interchangeables. Leur essence et leur génie fleurissent et meurent avec eux. Rien ne peut les remplacer. Les œuvres peuvent en prolonger la mémoire, en perpétuer les gloires mais rien, à jamais, ne pourra s'y substituer. La joie la plus intense brûle ainsi de la flamme tragique: elle sera à jamais sans ressemblances. Ce constat est si cruel que, pour le fuir, les hommes en vinrent à se vouloir interchangeables dans un monde uniformisé et désirer être ces « derniers des hommes » qu'évoquait Nietzsche.
Or cette utopie funeste, quand bien même la société du contrôle lui donne quelque apparence de succès, n'en demeure pas moins, comme les sociétés disciplinaires du début du siècle précédent, vouée à l'échec (mais après quels ravages !) et d'un échec qui sera plus cruel que la cruauté qu'elle voulut fuir, car le tragique alors lui retombera dessus alors même que toute joie sera éteinte.
Les dieux viennent de la profondeur du temps, ils nous adviennent afin de nous détacher des écorces mortes, des représentations, des ombres sur les murs de la caverne. Une plus haute et plus impondérable fidélité est requise dans leur advenue. Les dieux nous reviennent, intacts, comme au premier matin du monde, lorsque tout est dévasté. Ils nous reviennent afin que nous apprenions à distinguer ce qui passe de ce qui demeure, les formes vides, les écorces mortes et les formes formatrices, les attachements qui asservissent et les fidélités qui libèrent, les choses mortes et les causes créatrices, la source du Léthé et la source de Mnémosyne.
Mnémosyne n'est pas la source de la remémoration morose, du ressassement, des commémorations, de la repentance, ces frelatées friandises modernes. Mnémosyne nous abreuve du souvenir de ce que nous n'avons jamais appris, elle nous relie non à une identité administrative mais à un tradere qui est ressource venue de la nuit des temps.
Ce monde dans lequel nous vivons et qui n'exige rien de nous, sinon la répétition psittaciste de l'opinion dominante et le paiement des factures, est la platitude même, et le « réalisme », dont parfois il se vante, est le plus grand déni possible du réel, en latitudes et longitudes, en hauteur et en profondeur. Là seulement où il y a une hauteur et une profondeur adviennent les dieux qui sont les noms des hauteurs et des profondeurs qui nous regardent.
Il n'est rien qui soit moins « du passé » qu'une épiphanie ou une théophanie puisqu'en elles se rassemblent, en un point d'incandescence, toutes les puissances présentes du présent. Ces forêts, où nous nous égarons, sont pleines de dieux, ce fleuve que nous avons longé en repensant cruellement ou tendrement toute notre vie, certes, est un dieu; toutefois ces dieux ne sont pas seulement, comme le pensaient certains anthropologues, des « représentations des forces de la nature » mais la nature elle-même en tant qu'elle est une réverbération du Logos, un miroir de l’âme et des puissances sympathiques, magnétiques, qui se manifestent, en même temps, en nous et dans le monde.
Qu'ils soient généralement oubliés n'ôte rien à la présence des dieux, lesquels, - contemporains perpétuels d'une philosophie qui pense le monde sans commencement et sans fin, - ne meurent jamais, mais s'éloignent et se rapprochent, et ne s'absentent qu'aux regards de ceux qui vivent dans un temps sans profondeur et dans un espace purement quantitatif. Les dieux, ceux qui adviennent ; rien n'advient jamais que dans le présent. Les dieux sont ce qui soulève, ce qui fait advenir dans le présent (que notre inattention eût distrait) une présence attentive, une présence qui exige d'être dite et chantée, à notre façon, française et européenne, afin qu'elle devienne ou redevienne, une présence au monde, un ensoleillement de l'être.
Extrait de L'Ame secrète de l'Europe, Oeuvres, mythologies, cités emblématiques, éditions de L'Harmattan, collection Théôria.
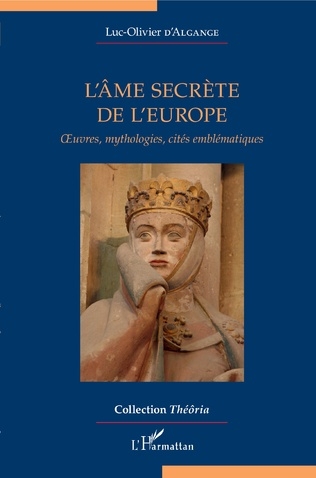
13:40 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
01/03/2022
Lettre sur la pauvreté et l'honneur:
Publiée il y a une vingtaine d’années dans la revue Alexandre, mais toujours, hélas, d’actualité :
Luc-Olivier d'Algange
Lettre sur la pauvreté et l'honneur.
Le Printemps arrive, avec ses arbres en fleurs dont les couleurs tranchent sur le ciel gris, et d'autres contrastes, moins aimables. Certains partent en villégiature, d'autres sont expulsés... Nous vécûmes donc ces temps étranges où la Gauche, devenue la défenderesse exclusive des classes moyennes laissa aux bons soins d'un abbé maurrassien, la mission de revendiquer en faveur des pauvres et de réclamer, d'ailleurs en vain, l'application d'un décret gaulliste concernant la mise à disposition de certains habitations inemployées pour les sans-abri ! Autant l'avouer sans ambages, les récriminations des employés de la S.NC.F, soucieux de mettre leur longue retraite à l'abri du besoin d'une voiture nouveau-modèle, me laissent assez froid. Je pense, avec une compassion qui n'est point exempte d' une conscience politique plus aiguë, à ces hommes et ces femmes qui marchent du matin au soir dans la ville, hagards d'épuisement et de désespoir et qui se trouvent dans cette situation non pour avoir commis des crimes abominables mais par malchance, faiblesse, insouciance, ou éloignement de ces tribus qui dans chaque ville et chaque village font dépendre les sinécures, ou des emplois plus ou moins utiles, de la servilité politicienne ou du népotisme le plus éhonté.
L'honneur politique eût été de prendre parti pour les misérables au lieu de s'empresser à se hausser d'une bourgeoisie moyenne à quelque autre supposée plus « grande ». Mais que pouvions-nous attendre de ces hommes et de ces femmes « de Gauche », oublieux de Péguy, de Proudhon et de Bernanos, mais qui n'en persistaient pas moins à traquer l'intellectuel supposé « de droite », l'antidémocrate affreux, le dandy coupable d'hostilité au progrès et au triomphe de l'homme moyen. L'honneur eût été d'être moins sourcilleux envers les esprits libres et plus exigeant envers soi-même et plus généreux envers les pauvres. Il est vrai que les pauvres, les vrais pauvres n'ont guère le sens de l'histoire. Et lorsque je parle des pauvres, je ne parle point de ceux qui ne sont « pas riches », catégorie vaste et pour ainsi dire universelle, les moins nécessiteux n'étant pas les moins plaintifs et les moins cupides, - mais de ceux qui sont pauvres au point que les « pas riches » en viennent à les considérer comme une race à part, marquée par une sorte de malédiction. L'attitude d'un « pas riche » à l'égard d'un vrai pauvre est quelque chose de terrible ! J'en vois chaque jour de ces hommes (que le travail de leurs parents a sortis de la misère et qui sont assurés d'un emploi et d'une retraite) témoigner d'attitudes infiniment offensantes pour les vrais pauvres.
Dans ce monde « démocratique », dans ce monde saisi par le « progrès », la vénalité est devenue la véritable norme morale. De la sorte, il est naturel que le pauvre soit jugé plus ou moins coupable et que la pauvreté soit considérée comme un châtiment. Etrange focalisation d'un sentiment religieux qui paraît s'être évanoui partout ailleurs ! Désormais, le Bien, le Beau et le Vrai sont mesurables, c'est l'Economie qui nous le dit. Observons le mépris avec lequel sont considérées toutes les activités non-vénales. Entre la condescendance et la haine, la réprobation morale module son adoration de l'Argent-Dieu. Celui qui n'est pas payé, celui qui ne parvient pas à réduire son activité en argent est infâme: telle est la morale moderne, beaucoup plus simple et déterministe que les morales anciennes où intervenaient le Ciel, l'Enfer, le Libre-arbitre, l'Esprit Saint, la Grâce en des entrecroisements complexes que seuls pouvaient désenchevêtrer le Pardon, le souverain Pardon qui restitue aux êtres et aux choses leur simple dignité de créature de Dieu.
Pour le Moderne, tout est simple immédiatement. Le vil est celui qui ne se vend pas et la justice immanente est là pour le châtier, pour faire de lui un « pauvre » avec, s'il le faut le concours objectif d'une société particulièrement habile à faire de la bienfaisance un spectacle. Car l'utilitarisme du moderne ne désarme jamais. Ces pauvres, châtiés par leur incurie, encore faut-t-ils qu'ils servent au spectacle de la bonne conscience que les « pas riches » se donnent à grands frais !
Loin de nous Péguy, et Proudhon, et Bakounine ! Et plus loin de nous encore Villiers de l'Isle-Adam qui eut l'audace magnifique d'opposer aux potentats égalitaires l'aristocratie ultime de celui qui n'a rien. Or, ce qui importe alors, ce qui s'élève dans l'âme comme une promesse immense, ce n'est point de ne rien avoir mais d'être, à la pointe de l'exigence la moins réductible, dans cette excellence du cœur que rien, ni personne ne peut sérieusement contester.
Sans doute faut-il pour pouvoir juger de ces questions de philosophie politique, et sans être suspect de partialité, s'être trouvé alternativement du côté de ceux que jalousent les médiocres et du côté de ceux qu'ils méprisent. On est alors en mesure de comprendre ce qu'est une véritable rébellion contre l'iniquité. Où sont les hommes de Gauche qui se soucient davantage des plus pauvres qu'eux qu'ils ne passent de temps à envier les plus riches ? Sans doute faut-il savoir ne pas s'offusquer du luxe pour être à même de comprendre que la pauvreté n'est pas infâme. L'égalité abstraite n'a aucun sens. Les Droits de l'Homme sont un leurre. Seules importent les jurisprudences. Démosthène la savait déjà: « Or cette force des lois, en quoi consiste-t-elle ? Est-ce à dire qu'elles accourront pour assister celui d'entre vous qui, victime d'une injustice, criera à l'aide ? » Le pauvre dans sa famine et dans sa froidure se soucie bien de savoir qu'il est, en théorie, l'égal du Médiocre qui est assuré de vivre toute sa vie dans le même confort et la même ignorance comme d'une jouissance toute naturelle, de tous ces biens élémentaires dont le pauvre est privé. L'écart entre un simple employé et un homme à la rue est infiniment plus grand que l'écart entre ce même employé et le milliardaire le plus faramineux, car pour la beauté et l'intensité de la vie, la fortune y est pour peu de chose: tout se joue dans la luminosité de l'entendement. C'est l'Intellect, quoiqu'on en dise, qui préside à ces merveilles. Celui qui riche ou médiocre se traîne dans la vie comme un esclave sans cœur et sans colère trouve fort juste qu'il y ait des plus malheureux que lui, surtout s'ils eussent été, ces plus malheureux, en des circonstances moins défavorables, des rares heureux, à faire pâlir de jalousie !
Pour la majorité de nos contemporains, le bonheur d'autrui ne brille point, le bonheur d'autrui n'est pas une lumière désirée. La profondeur du bonheur de l'élu comme la profondeur du malheur du misérable se joignent et s'offrent à la même réprobation, mais le ressentiment prescrit d'œuvrer plus promptement à la disparition de la profondeur du bonheur qu'à celle de la profondeur du malheur. Certes, lorsque l'on voit à quoi s'occupent les hommes et les femmes qui ont échappé, parfois de peu, à la misère, avec quel soin jaloux ils s'en tiennent au moindre effort et à la moindre générosité, avec quel dédain et quelle suspicion ils accueillent les expressions de la beauté et de l'intelligence, il faut bien reconnaître que certains beaux combats sociaux paraissent comme frappés d'inanité. Ainsi serait-ce pour que de tels gens vivent comme ils vivent que d'autres naguère ont haussé parfois leur militantisme jusqu'au sacrifice chevaleresque ? L'ignominie « libérale » n'en demeure pas moins patente et persistante, dans le cœur de quelques-uns, l'Idée qu'une morale purement dispendieuse nous fait une vie plus belle que la morale utilitaire.
La pauvreté et l'honneur, pas davantage que la richesse et l'honneur ne sont exclusives l'une de l'autre. Tous les états sont honorables, mais il existe une façon d'être, à la fois veule et revendicative qui chasse devant soi l'honneur comme pour faire place nette à l'ignominie. Cette ignominie ne cesse de nous enjoindre, par séductions et menaces, à cesser d'être. Ainsi parle l'Ignominie: « Vous qui êtes français, qui entretenez quelque subtil commerce avec les dieux anciens, avec les métaphysiques d'Aristote ou de Platon, avec la Symbolique romane, avec, Dante, avec Baudelaire, avec Valery Larbaud, cessez d'être ! Conformez-vous, c'est-à-dire renoncez à votre forme, à votre ingénuité et à votre science, à vos façons d'êtres rares ou singulières, à vos fêtes et à vos oisivetés. » L'antienne est captée par toute les antennes et reproduite à l'envi. Vos voisins et vos proches s'évertueront à vous faire entendre qu'il fait bon vivre dans un monde sans honneur.
17:25 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
28/02/2022
Raymond Abellio, entre Avant-Garde et Tradition
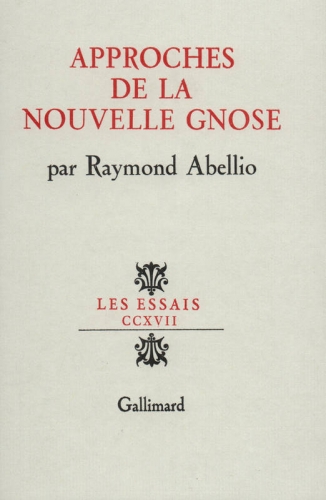
Luc-Olivier d'Algange
Raymond Abellio, entre Avant-garde et Tradition
Pour Raymond Abellio, l’ésotérisme n’est pas seulement l’objet d’une étude érudite ou un sujet de roman mais le principe même de sa création littéraire. Le dessein de l’auteur se confond avec le dessein de l’ésotérisme. L’écriture du roman est elle-même un acte créateur identique, dans son intention et ses conséquences, au Grand-Oeuvre des alchimistes. L’œuvre d’art en général et le roman en particulier ne sont pas seulement des objets destinés à l’appréciation admirative des lecteurs mais des instruments de transfiguration et d’édification de l’homme intérieur.
Au-delà de la diversité de leurs expressions théoriques et de leurs symboles, toutes les oeuvres relevant de l’ésotérisme se fondent sur l’idée que la « Connaissance absolue » est possible et que tout se tient selon les lois de l’interdépendance universelle. Le monde, pour l’ésotériste, est constitué comme un langage et l’homme dispose du pouvoir d’entrer en communion avec le Sens que ce langage prodigue et dont toutes les apparences du monde témoignent, étant elles-même symboles d’une réalité intellectuelle qui les dépasse. Le roman abellien, - dont les personnages éclairent en s’y mouvant les aspects immanents et subtils du monde de même que l’auteur nous éclaire sur l’intériorité des personnages, - procède de cette vision « interdépendante » proche, à certains égards, de celle de Balzac.
Selon Raymond Abellio, par la conscience réflexive que le romancier prend de son art: « les contradictions intimement vécues par lui entre la vérité et la beauté sont prises dans une dialectique ascendante qui est, au double sens du mot, l’édification de l’homme intérieur »1. La définition que Raymond Abellio propose de l’ésotérisme confirme l’unité du dessein de l’auteur: « Qu’est-ce que l’ésotérisme ? C’est l’étude et l’expérimentation des ténèbres intérieures. En quoi ces ténèbres intérieures se posent-elles comme transcendantales, irréductibles aux ténèbres extérieures bien qu’elles soient la condensation lumineuse et paroxystique de celle-ci ? C’est qu’elles ne procèdent pas de la dualitude du monde et de la conscience, relation toute externe, mais d’une corrélation, relation interne, entre ce même monde et une autre conscience dans laquelle ce monde est enfermé et même produit, non seulement figuré mais transfiguré, et qui n’est plus la conscience ordinaire simplement réceptrice des choses et des autruis mais la conscience, en outre, réceptrice de soi, la conscience de la conscience. »2
Une fois établie et comprise, cette interdépendance de l’ésotérisme et de l’art romanesque tel que le conçoit Raymond Abellio, on aperçoit toute la richesse des possibilités ainsi offertes à l’écrivain qui se propose à la fois de « voir de toutes parts » par l’intermédiaire des personnages et de saisir les variations des métamorphoses et des transfigurations de la conscience. Ce dessein de saisir l’ensemble du réel tel qu’il s’entrecroise entre la conscience et le monde confère à l’écrivain le statut d’Auteur,- et à ses écrits le statut d’Oeuvre,- l’auteur oeuvrant à l’accroissement et à l’intensification du Sens, selon l’étymologie même du mot auctoritas : « la vertu qui accroît ». La notion de « travail du texte » ou celle, plus ancienne de « l’art pour l’art » laissent place à l’idée d’une écriture dont le dessein est de transfigurer la conscience et le monde par la vertu nuptiale du Sens qui les unit, semblable au Sel qui, dans l’alchimie, est l’officiant des noces du souffre et du mercure.
Pour Raymond Abellio, l’œuvre digne de ce nom est celle où le pouvoir des mots et la fascination qu’ils peuvent exercer, s’assujettissent à l’autorité du Sens et à la communion qu’elle annonce dans la « conscience de la conscience » enfin délivrée de toutes les représentations subalternes. A propos de cette expression: « conscience de la conscience » inspirée de la phénoménologie de Husserl, Abellio note: « Ce génitif enferme tout le secret de l’ésotérisme. Il faut le considérer dans sa fonction génétique immédiate: par lui une autre conscience est générée. D’où le sens profond de ce que l’on nomme l’initiation. L’initiation est l’éveil de la conscience à sa propre conscience de soi transcendantale. Elle est intériorisation des ténèbres et transmutation radicale de celles-ci en même temps que de l’être tout entier. Elle est récréation du monde par la conscience et en elle. Nous ne tarderons pas à voir que cette définition est singulièrement restrictive et disqualifie les ésotéristes de simple érudition qui font de la science soi-disant secrète le champ d’un divertissement et non d’une expérience vitale. »3
Une gnose romanesque
L’expérience vitale de la création littéraire,- l’écriture étant pour Abellio, avec l’amour, la seule expérience véritablement originelle et ultime,- sera donc le moyen par excellence d’atteindre à cette surconscience, véritable pierre philosophale de l’entendement, dont les couleurs prophétiques se dérobent à toute traduction en langage didactique. Alors que le traité de philosophie montre le chemin parcouru, l’œuvre littéraire, le roman, montrent le chemin lui-même, dont la vertu est davantage de susciter l’expérience spirituelle que de la relater. Le traité didactique représente l’idée ou la vision de l’auteur alors que le roman établit le lecteur dans la pure présence de l’Idée, telle qu’elle advient, à l’état naissant , et comme hors du temps, dans ce geste inaugural qui est le recommencement perpétuel de la conscience: « Tout ce qui est essentiel, n’apparaît que dans la suspension du temps: les états d’intuition, d’inspiration, d’illumination... La littérature serait ainsi une sublimation du langage qui se proposerait de réconcilier noblement les mots et la vie et même de célébrer leurs noces. Le style serait ainsi la fonction amoureuse de l’écriture. »4 Seules ces noces des mots et de la vie, dans l’Hors du Temps, qui est le véritable « or du temps », peuvent nous donner accès à cette innocence de l’entendement où la conscience se révèle à sa propre splendeur, dans cette filiation du reflet au miroir qu’indique le génitif.
La conscience est donnée à la conscience, offerte, advenue, semblable à l’embrasement de l’éternité qui est selon Rimbaud « la mer allée au soleil ». Le reflet bouge dans le temps mais le miroir est éternel. Le temps, selon l’expression platonicienne est « l’image mobile de l’éternité ». Ainsi en est-il de la temporalité dans les romans d’Abellio où l’histoire des personnages et du monde, dans leurs aspects psychologiques ou politiques, s’ordonne à des lois et à des principes éternels dont Abellio va décrire les rapports dans son ouvrage La Structure Absolue, essai de phénoménologie génétique. Toutefois, c’est au roman qu’il appartient de montrer ce que l’essai ne peut que démontrer. En amont du reflet est le miroir et en amont du miroir, et de toute spéculation, est la pure lumière où la conscience advient à la conscience dans un paroxysme de sérénité : « Je pense qu’un auteur n’entreprend d’écrire un essai que lorsque la pensée directrice de celui-ci est déjà toute formée en lui. Il s’agit pour lui d’exposer ce qu’il sait déjà. Au contraire, pour un romancier - tout au moins dans l’expérience que j’en ai, - il s’agit surtout d’éclairer l’avancement, l’évolution philosophique des personnages, et par conséquent, ceux-ci restent problématiques jusqu’au bout: le romancier avance en même temps qu’eux dans leur connaissance - et dans sa propre connaissance de soi. D’où que l’essai soit démonstratif, le roman au contraire « monstratif ». Tout roman philosophique est alors une mise à l’épreuve de la philosophie de l’auteur comme de celle du lecteur. Son intérêt et sa difficulté sont de saisir la vie à l’état naissant, et de proposer au lecteur de renaître à chaque instant avec l’auteur. Dans un essai, la pédagogie de la démonstration ne doit pour ainsi dire rien au vécu réel qui fut celui de l’auteur lorsque l’idée centrale de son livre le visita pour la première fois. Il en est de cette démonstration comme de celle d’un théorème de géométrie qu’un professeur présente au tableau noir à ses élèves: l’enchaînement de cette démonstration a été trouvé après coup, il n’a rien à voir avec cette démarche intellectuelle qui permit un jour, dans un passé plus ou moins lointain, la découverte de ce théorème. Ce n’est même pas du vécu reconstitué (Husserl dirait apprésenté), mais un autre vécu, et tant mieux si le bon élève, retrouvant l’inspiration instantanée de l’inventeur s’écrie: » J’ai compris ! » avant la fin de la démonstration. Le véritable roman métaphysique doit donc essayer de replacer le lecteur dans une situation telle que la conscience de ce dernier y devienne, à tout instant, comme celle du bon élève, aussi opérante que celle de l’auteur ».5
L’esprit indestructible et la Tradition Primordiale
L’ésotérisme,- ce « chemin vers l’intérieur »,- sera donc la science destinée à intensifier jusqu’au paroxysme les données fondamentales de l’art romanesque. A cet égard, Raymond Abellio fait sienne et prolonge l’exigence du Surréalisme, dévoué à la conquête du « point suprême ». Dans un article décisif, intitulé La lampe dans l’Horloge, André Breton précisera le sens d’un engagement ésotérique de la poésie et de la littérature en se référant à Saint-Yves d’Alveydre et à Fulcanelli. A cet occasion, il évoquera, et invoquera, l’existence d’un « esprit indestructible » dont il revendiquera, de surcroît, « les fonctions immémoriales »: « Un rai de lumière subsistait, écrit André Breton, glissant d’un couvercle de sarcophage à une poterie péruvienne, à une tablette de l’île de Pâques, entretenant l’idée que l’esprit qui anima tour à tour ces civilisations échappe en quelque mesure au processus de destruction qui accumule derrière nous ses ruines matérielles ».6 Ce « rai de lumière » n’est autre que la primordialité de la Tradition, point suprême de toutes les civilisations, transcendante unité des religions et de leurs symboles, que l’ésotérisme révèle à l’adepte assez vigilant pour défier les formes et les représentations accoutumées. « Or, écrit Raymond Abellio, dans sa préface à La Structure Absolue: « C’est ce même point idéal où tous les couples d’oppositions cessent d’être perçus contradictoirement que voulaient atteindre les Surréalistes, qui furent les seuls révolutionnaires intégraux de ce siècle. L’activité onirique ou poétique à laquelle ils se confiaient ne pouvaient les y conduire , pour de courts moments, que par une extrême tension de ses puissances. Le moment est venu pour la conscience claire de se tenir en ce point sans effort et sans artifice et d’y transfigurer le rêve et la poésie mêmes. »7
Loin d’entrer en contradiction avec l’ambition poétique du Surréalisme, l’ambition philosophique et romanesque de Raymond Abellio va en précipiter les exigences les plus audacieuses par une ascèse de l’Intellect, faisant l’épreuve de « l’abîme des ténèbres » pour atteindre à « l’abîme de la lumière ». Mais alors que les Surréalistes insistaient sur le rêve, l’écriture automatique et le rimbaldien « dérèglement de tous les sens », Raymond Abellio, sans rien renier de la liberté ainsi acquise à l’égard du rationalisme, va user d’une raison héroïque, pour reprendre le mot de Husserl, c’est-à-dire d’une raison s’interrogeant sur « la raison de la raison ». Pour Raymond Abellio, le rationalisme hérité du XIXe siècle positiviste, que pourfendent les Surréalistes, n’est pas seulement a-poétique, il est aussi le sépulcre de la raison elle-même. Alors que la raison du rationaliste est un carcan d’habitudes et de préjugés, la raison héroïque est une raison prophétique. Loin de s’exclure, l’analogie et la déduction s’entrecroisent en une sagesse annonciatrice qui tient à la fois de la « Nouvelle Kabbale » dont Franz Kafka appelait la venue, et d’un nouveau « Discours de la Méthode ».
En vertu du principe d’interdépendance universelle auquel elle obéit, la logique de l’ésotérisme intègre ainsi dans un même cheminement vers la Connaissance Absolue, les Méditations cartésiennes de Husserl et la numérologie biblique. L’éclectisme n’est qu’apparent. Outre que, selon la formule même de Husserl, souvent citée par Raymond Abellio, « la phénoménologie est une communauté gnostique », le dépassement de la nature et du naturalisme, dans la recherche d’une Connaissance absolue caractérisent également la philosophie de Husserl et l’ésotérisme. Dans Les Idées directrices pour une phénoménologie, Husserl écrit: « Puisque la phénoménologie devra être établie, comme une science de l’essence, une science a priori, ou comme nous le disons aussi, une science eidétique, il sera utile de faire précéder tous nos efforts consacré à la phénoménologie elle-même d’une série de discussions fondamentales sur les essences et la science des essences; nous y défendrons contre le naturalisme, les prérogatives originelles de la connaissance des essences »8.De même que le Surréalisme visait à s’établir au-dessus du réalisme, le roman métaphysique, tel que le conçois Raymond Abellio, va se déployer dans cet au-delà de la raison et de la nature où les explications psychologiques et sociologiques sont subordonnées à d’autres données, métaphysiques et cosmiques. Le cours des astres, et la concordance des nombres exerceront sur les personnages une action dont l’importance ne le cède en rien aux déterminismes profanes qui entraînent le destin des personnages des romans naturalistes. A la « connaissance des essences », que Husserl défend contre le naturalisme philosophique, Raymond Abellio ajoute une gnose romanesque, pour une défense de la métaphysique des personnages contre le naturalisme littéraire.
La première vertu romanesque de l’ésotérisme dans l’œuvre de Raymond Abellio, est ainsi de libérer le récit des contraintes des « sciences humaines » dont les a priori et la logique formelle interdisent au roman d’atteindre à l’intensité et à la plénitude d’une véritable création poétique. La notion de responsabilité des personnages, d’une importance capitale, s’en trouve bouleversée. Dans « la triple et unique passion de l’éthique, de l’esthétique et de la métaphysique », qui anime l’auteur, c’est l’univers dans son ensemble qui répond aux actes et aux pensées des personnages. L’univers est le répons de l’homme et l’homme est le répons de l’univers. Il suffit, dit Raymond Abellio, qu’un homme lève son bras pour changer, fût-ce de façon infime, l’ordre des constellations. L’éthique de la responsabilité personnelle s’ouvre ainsi sur des perspectives esthétiques et morales ouvertes à perte de vue.
L’usage romanesque de ces perspectives ouvertes se laissera d’autant mieux comprendre que nous serons plus familier des théories et des pratiques de l’ésotérisme. L’ésotérisme n’est pas un aspect de l’œuvre d’Abellio mais le tournoyant jeu de reflets qui conditionne tous les aspects de l’œuvre. Ce n’est pas davantage un ésotérisme au sens métaphorique ou dans une acception vague, mais l’ésotérisme dans la pleine et précise acception du terme, avec les arts et les sciences qui le caractérisent: astrologie, alchimie, numérologie, kabbale etc... Si l’ambition de Raymond Abellio est d’apporter une vision neuve, celle-ci toutefois confirme les données fondamentales de la Tradition ésotérique, dite aussi Tradition Primordiale, - cette primordialité se situant hors du temps, au point crucial de la rencontre de l’intelligence humaine et de l’intelligence divine, pôle de la conscience et de l’être.
Une oeuvre traditionnelle et prospective.
L’œuvre de Raymond Abellio, à cet égard, est à la fois traditionnelle et prospective, ainsi que le révèle cette définition de la Tradition primordiale: « La Tradition Primordiale a été donnée aux hommes d’un seul coup tout entière mais voilée. Ou plutôt les hommes qui l’ont reçue, ne disposaient pas encore des moyens intellectuels nécessaires pour la traduire en notions claires. »9 Une étude de l’ésotérisme dans l’œuvre de Raymond Abellio devra donc prendre en compte cette double fidélité de l’auteur à la primordialité de la Tradition et aux moyens intellectuels, aux instruments qui permettront de traduire cette Tradition, d’en révéler, en notions claires, le sens obscur et profond. Loin de se limiter aux ouvrages strictement « ésotériques », ou communément reconnus comme tels, une bibliographie concernant Raymond Abellio et l’ésotérisme devrait s’élargir aux ouvrages que Raymond Abellio utilise comme instruments dans ce processus de révélation progressive. L’ésotérisme pour Raymond Abellio n’est pas un mode de pensée dépassé ou rendu caduque par l’histoire et les « progrès de la science », ni l’expression d’une mentalité « pré-logique », comme disaient naguère les anthropologues, mais une pensée effectivement archaïque, mais au sens d’une pensée originelle, ou « principielle », prédestinée à d’infini renouvellements. Loin de se conformer à une doctrine ou à un système, Raymond Abellio, va faire sienne l’exigence poétique d’une pensée faisant l’épreuve de son origine, afin de mieux comprendre ses fins dernières. Nous retrouvons là cette idée d’Heidegger selon laquelle le secret de l’aube se divulgue dans les fastes du crépuscule.
La dialectique de l’originel et de l’ultime sera, au demeurant, d’une grande importance dans l’œuvre romanesque de Raymond Abellio. L’origine ne peut-être connue que dans l’ultime. Dans La Fosse de Babel ou Visages Immobiles, les personnages féminins que le narrateur nomme les femmes ultimes, et qu’il oppose aux femmes originelles, confèrent seules à leurs amants la vision des origines de l’amour et du désir. De même, les sciences modernes et la phénoménologie husserlienne seront pour Abellio, ces états ultimes de la pensée occidentale où la conscience et la connaissance de l’origine sont encloses comme une inaltérable couleur alchimique. Ce qui, dans l’ordre des civilisations s’achève, par cela même inaugure. La fin descelle le principe.
Tel est exactement le sens du titre et le propos de l’ouvrage La fin de l’ésotérisme. Toute finalité présage un recommencement sur un point, situé encore plus haut, de la spirale prophétique qui est le mouvement même de l’esprit allant à la conquête du secret de ses propres pouvoirs: « C’est à nous, hommes d’aujourd’hui qu’il incombe d’expliciter la tradition en passant d’une simple participation à une vraie connaissance. Ce passage de la mystique à la gnose n’est d’ailleurs pas linéaire mais dialectique. En ce sens, s’il implique une première distinction essentielle entre l’âme et l’esprit, (le premier Adam, selon Saint-Paul, était l’âme vivante, et le dernier sera esprit vivifiant) il en appelle aussitôt une seconde, entre la raison naturelle et la raison transcendantale ou, si l’on veut, entre l’intellect et l’intelligence, le mental et le supra-mental, l’intelligence de la tête et l’intelligence du cœur, pour réunifier les anciens pouvoirs de l’âme et les nouveaux pouvoirs de l’esprit. »10
A la mystique de l’homme intérieur, vivification de l’âme et avivement des symboles qui traduisent son cheminement vers le Soi, succède, selon la dialectique abellienne, la vie en esprit. De même que Platon suppose une Idée des idées, Abellio présume un Symbole des symboles, véritable clef de voûte dont la connaissance, par définition, n’est plus du ressort de la mystique. A la participation mystique à la vie des symboles, que décrivent par exemple les ouvrages de Jung sur l’alchimie ou dont témoignent les proses du Poisson soluble d’André Breton, l’ambition de Raymond Abellio est d’adjoindre ces « nouveaux pouvoirs de l’esprit » qu’instrumente une gnose non moins nouvelle car elle trouve dans la Tradition non point l’a-priori mais la confirmation des théories et des visions conçues par l’auteur, en une expérience intérieure, vivifiée par l’intelligence du cœur.
Un Grand Oeuvre encyclopédique
Au-delà de l’opposition de l’objet et du sujet, du monde et de la conscience, l’ésotérisme, tel qu’en use Raymond Abellio, rejoint l’œuvre de Novalis, qui, elle aussi, fut à la fois traditionnelle et prospective dans sa complexité, où l’ambition encyclopédique et l’exigence poétique s’entrecroisent. Se voulant la plus « intégrante » possible, la pensée, dont l’œuvre est l’aboutissement nécessaire, demeure ouverte à toutes les hypothèses. Les sciences modernes et les sciences traditionnelles, loin de s’exclure, se confrontent et cette confrontation suscite la pensée nouvelle, la « Nouvelle Gnose » dont Raymond Abellio écrit le manifeste. Cette pensée du plus vaste accord est non seulement favorable, comme nous l’avons vu, à l’art romanesque, dont la diversité des motifs et l’ampleur des vues autorisent les créations les moins prévisibles, mais elle est de surcroît fidèle à ce qui fut, de tous temps, le problème central de la philosophie.
Dans son article intitulé, Le Postulat de l’interdépendance universelle, Raymond Abellio propose « l’esquisse d’un programme de méditation »: « Le problème central de la philosophie est-il celui de l’être ou celui de la conscience ou bien encore celui de leurs rapports. C’est la philosophie elle-même qui doit répondre à cette question, et tout ce que l’on peut dire c’est qu’elle doit commencer sans y avoir répondu. De quelque façon qu’elle s’y prenne, la philosophie emprunte forcément trois angles d’attaque:
-
elle doit déterminer ce qui est
-
elle doit dire comment ce qui est vient à la pensée
elle doit chercher enfin pourquoi la pensée donne de la valeur à ce qui est »11.
Loin de croire que les sciences humaines dussent, d’une façon ou d’une autre, se substituer à la philosophie ou à la pensée de l’auteur, en caducisant certaines de ces questions fondamentales, Raymond Abellio s’est au contraire appliqué à faire de son oeuvre, dans tous ses aspects, un moyen de connaissance.
L’Art est l’instrument par excellence de cette conquête héroïque de la connaissance. Yves Albert Dauge, écrit dans un article intitulé, La voie héroïque et gnostique vers le Soi : « Les buts poursuivis par le gnostique sont essentiellement la déification de l’homme, la toute puissance du Je Artifex, la transfiguration du monde et des corps12. » Deux voies s’offrent à l’homme selon qu’il participe d’une mentalité tellurique ou d’une mentalité héroïque: « La Première, écrit Raymond Abellio, fond en effet l’homme dans l’universel et dépossède l’homme de lui-même, la seconde fonde au contraire l’universel dans l’homme et restitue à l’homme toute possession: l’une conduit à l’abîme de la dissolution, l’autre à l’abîme de la communion13. A la mystique de la fusion, Abellio oppose une gnose de la fondation. L’ésotérisme, tel que le conçoit Raymond Abellio, loin de nous perdre, de nous dissoudre dans les fantasmagories de l’inconscient collectif, nous exhorte à la conquête d’une sur-conscience. Détaché de toute mentalité tellurique ou communautaire, l’adepte devient alors, selon le mot de Al-Hallaj, « Un unique pour un Unique ». « Il ne s’agit pas de voir Dieu, il s’agit de l’être »14 écrit Raymond Abellio dans son Journal, rejoignant ainsi Angélus Silésius: « Je dois m’approfondir en Dieu et Dieu en moi, et devenir ce qu’il est: je dois être clarté dans la clarté, je dois être Verbe dans le verbe, Dieu en Dieu ».
Nous mesurons ainsi la distance qui sépare l’ésotérisme selon Abellio, des idées para-religieuses ou des courants de pensées irrationalistes qui n’ont d’ésotériques que les noms dont ils s’affublent et dont les ambitions se limitent à des projets communautaires plus ou moins explicites. Des phénomènes culturels modernes, tels que l’écologisme ou le « New-Age », par la fusion avec la nature qu’ils préconisent et le mépris de l’intelligence abstraite dont ils témoignent, participent de cette mentalité « tellurique » contre laquelle, Raymond Abellio définit précisément le véritable dessein de l’ésotérisme.
La véritable contemplation, pour Raymond Abellio, n’est pas l’abandon de soi mais la conquête du Soi par la connaissance des « essences »,- connaissance qui nous arrache aux apparences et à l’immanence et nous déracine. La Loi de l’esprit est prophétique, et se situe, par cela même, dans un tout autre domaine que les lois de la nature ou de la société. Dans l’introduction au Manifeste de la Nouvelle Gnose, Raymond Abellio écrit : « Un fantôme hante depuis vingt-cinq siècles l’esprit des hommes, le fantôme de la connaissance. En tous temps et en tous lieux, depuis vingt cinq siècles, les diverses communautés humaines, Eglises, nations et mêmes sectes et tribus ont tenté de l’exorciser par les rites ou les codes de leurs gouvernement : philosophies, sciences, religions, mythologies, pour en faire l’instrument zombique de leur pouvoir, et elles ont ainsi prétendus imposer du dehors à tous, indistinctement leurs images de cette connaissance même alors que celle-ci ne peut naître, s’enrichir et survivre qu’au-dedans de l’homme seul »15.
L’œuvre de Raymond Abellio se propose à la fois comme le récit, l’expérimentation et le témoignage de cette Gnose, seul véritable chemin vers l’intérieur. Voie héroïque de l’ésotérisme, que les alchimistes nomment la « voie sèche », par opposition à la « voie humide » des mystiques, la Gnose réalise cette transfiguration réciproque de la conscience et du monde dont l’interdépendance projette l’intelligence au-delà de l’enchaînement des causes et des effets.
La dialectique que propose Abellio est non seulement croisée, mais simultanée. Tout ce qui importe est, pour ainsi dire, « en même temps ». A chaque instant l’homme est le contemporain de la création du monde et du jugement dernier. S’il est possible, en effet, comme l’écrit Raymond Abellio, dans La fin de l’ésotérisme, de « faire de notre pratique de la transfiguration et de la transsubstantiation notre action et notre pensée de tous les instants »16, c’est qu’en effet l’instant est l’éternité même. L’instant est ce qui se tient, stat, immobile, comme une Thulée hyperboréenne, au milieu des flots mouvants qui sans cesse dédisent la réalité, démentent son apparence précédente..
La contemplation du Sens.
« Aeternitas non est temporis successio sine fine, sed nunc stans. L’éternité n’est pas la succession du temps sans fin mais l’instant d’à présent, immobile. D’à présent! Le Temps suspendu ! Toute la question est là. Vivre l’instant et s’y tenir debout » écrit Raymond Abellio dans Visages Immobiles17.
Le temps linéaire est le règne du dédire qui sans cesse défait, déconstruit et dévore ses propres enfants. La Gnose sera ce cheminement de la pensée par lequel il devient possible d’échapper à la perpétuelle déroute pour se recueillir et rassembler ses forces éparses dans la « structure absolue » d’une éternité gemmée. Tel est exactement le sens du Grand Oeuvre alchimique et de la Pierre Philosophale, ce « rubis des Sages » qui dispose non seulement du pouvoir de changer le plomb en or mais encore de transfigurer la conscience humaine et de rédimer le monde.
« Il faut admettre, écrit Raymond Abellio , que l’esprit est toujours originaire, que la matière sort de l’esprit et non l’inverse »18 Ce pourquoi, en effet, l’esprit pouvant connaître l’esprit, rien n’échappe à la saisie du Sens. Le grand-Oeuvre encyclopédique et prophétique de Raymond Abellio se fonde sur une pensée « selon laquelle tout ce qui existe à un sens et la conquête de ce sens. Une sagesse selon laquelle il n’y a au monde aucune absurdité, et, sous les pires discordes apparentes, simplement des complémentarités, ces dernières étant d’ailleurs prises dans une dialectique ascendante vers ce qu’on appelle l’Etre absolu ou encore le Sens, avec des majuscules. Au sens le plus élevé, la connaissance est alors l’intuition, la contemplation du Sens. »19
Nous retrouvons là le principe même de cette herméneutique générale qui caractérise les modes opératoires de toutes les sciences et arts ésotériques. L’intérêt de Raymond Abellio pour l’astrologie, la kabbale ou le Yi-King ne relève en aucune façon d’un quelconque attrait pour l’étrange ou l’obsolète mais, tout au contraire, de cette approche herméneutique qui confère un Sens à toute chose. L’astrologie, la kabbale et le Yi-King sont, avant tout, arts de l’interprétation. Pour l’astrologue, le kabbaliste ou l’homme qui interroge les hexagrammes du Yi-King, rien, en ce monde, n’est disposé selon le hasard. Les vertus divinatoires de ces sciences tiennent moins à d’insolites facultés qu’à la texture même du réel, composé, dans son omniprésence, comme un langage, dont l’interprétation est possible, quoique toujours ouverte et jamais définitive.
Les kabbalistes définissent leur art comme celui de l’interprétation infinie car infinie est la Sagesse de Dieu. De même, la Structure Absolue de la Gnose abellienne ne représente point un savoir total mais une connaissance absolue, ce qui est tout autre chose car l’absolu est le point de départ du Sans-Limite,- l’En-Soph, qui surplombe l’Arbre séphirotique. Les schémas que l’on trouve ici et là dans les ouvrages d’Abellio peuvent, à cet égard, prêter à confusion si l’on y voit la représentation statique d’un système de pensée. La caractéristique majeure de la structure abellienne est d’être en mouvement et de dépasser ainsi l’opposition ordinaire entre structure et genèse.
Structure génétique, tournoyante, la Structure Absolue situe la pensée au cœur d’une infinité de paramètres en mouvement. Il s’agit là, on ne saurait trop y insister, de tout autre chose que d’un système qui s’affirmerait dans l’outrecuidante prétention à détenir la totalité des éléments nécessaires au savoir qu’il se propose. Loin d’être un système destiné à chercher des solutions, la Structure Absolue est, pour l’auteur, et le lecteur, un instrument dont la fonction est de trouver une infinité de situations nouvelles. Ces situations, romanesques, philosophiques, poétiques, seront autant de nouveaux aperçus sur le Sens dont la contemplation est la véritable fin de l’ésotérisme.
Luc-Olivier d’Algange
1. Raymond ABELLIO, Entretiens avec J.P. LOMBARD, éd. Lettres vives, p.36.
2. Raymond ABELLIO, préface à l'ouvrage de P.SERANT, éd. Grasset, pp.17-18.
3. Raymond ABELLIO, préface à l'ouvrage de P.SERANT, éd. Grasset, pp.17-18.
4. Raymond ABELLIO, Entretiens avec J.P. LOMBARD, éd. Lettres vives, pp.12-13.
5. Raymond ABELLIO, Entretiens avec J.P. LOMBARD, éd. Lettres vives, pp.22-23.
6. André BRETON, La Lampe dans l'Horloge, réédité dans le recueil La Clef des Champs, éd. 10/18.
7. Raymond ABELLIO, La Structure Absolue, éd. Gallimard, p.33.
8. HUSSERL, Idées directrices pour une phénoménologie, éd. Gallimard, p.9.
9. Raymond ABELLIO, La Fin de l'ésotérisme, éd. Flammarion, p.12.
10. Raymond ABELLIO, La Fin de l'ésotérisme, éd. Flammarion, p.13.
11. Raymond ABELLIO, Le Postulat de l'Interdépendance Universelle, Article reproduit dans le Cahier de l'Herne-Raymond Abellio,p.23.
12. Yves-Albert Dauge, La Voie héroïque et gnostique vers le Soi, Article publié dans le Cahier de l'Herne-Raymond Abellio,p.48.
13. Raymond ABELLIO, La Structure Absolue, éd. Gallimard, p.42.
14. Raymond ABELLIO, Dans une âme et un corps,éd. Gallimard,p.83
15. Raymond ABELLIO, Manifeste de la Nouvelle Gnose, éd. Gallimard, p.27
16. Raymond ABELLIO, La Fin de l'ésotérisme, éd. Flammarion, p.195.
17. Raymond ABELLIO, Visages Immobiles, éd. Gallimard, p.75.
18. Raymond ABELLIO, La Fin de l'ésotérisme, éd. Flammarion, p.77.
19. Raymond ABELLIO, cité par Y.A Dauge dans le Cahier de l'Herne Raymond Abellio,p.63
Extrait d'un hommage de Jean Parvulesco à Raymond Abellio
"Aussi doit-on finir par accepter que l'oeuvre de Raymond Abellio romancier d'une certaine fin de l'Occident, d'une certaine clôture du cycle occidental actuellement en train d'entrer dans la nuit de son achèvement final, ne vaut surtout pas d'être lue, approchée à la lumière des événements dont elle prétend s'être fait l'écho en consignation, mais à la seule lumière secrète d'une âme dans sa procession cosmologique finale. Et nous comprendrons ainsi que ce ne sont guère la traversée cathare, et quelque peu métapsychique, des entrismes trotskistes surexités, affolés par la montée spectrale de la nouvelle guerre civile européenne en 1934, ni les ventilations parisiennes d'on ne se souvient même plus quel Pacte Synarchique, ni même la mise-à-mort rituelle de notre grand et cher Eugène Deloncle, qui peuvent donner une réponse à la démarche la plus intérieure de l'oeuvre de Raymond Abellio, mais les Ennéades de Plotin, les songeries astrales, aussi nocturnes que lumineuses, d'un Jamblique, d'un Porphyre. Et que, tous comptes faits, de n'est pas même moi, trop retenu comme je me trouve sur les barricades d'autres grandes batailles en cours, qui eus dû être chargé d'instruire la dernière légitimation occidentale de cette oeuvre si grande en son secret cosmologique, mais sans doute un Luc-Olivier d'Algange, responsable, lui, de l'actuel renouvellement de néo-platonicianisme européen, de l'émergence de la nouvelle lumière gnostique renaissante aujourd'hui en Occident. Et tout ceci dit, il me souvient de la lettre que le jeune Pascal Jardin envoyait en 1978, à Raymond Abellio, pour lui dire que sur vos hauteurs vous n'attendez plus la caution de personne."
Jean Parvulesco, 1986.
20:13 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
27/02/2022
Deux lettres de Raymond Abellio:
Vence, le 5 février 1986
Cher Luc-Olivier d'Algange,
La revue Pictura et votre lettre m'ont été retransmises à Vence, où je passe durant l'hiver, la majeure partie de mon temps. Merci pour l'une et l'autre et tous mes compliments pour votre article sur les néoplatoniciens: vous y abordez de grands et multiples sujets, dans une parfaite clarté, ce qui n'est pas si simple, et j'y ai retrouvé avec bonheur nombre de thèmes qui me passionnent et dont je serais heureux de parler avec vous. Car nous pouvons, si vous le désirez, nous rencontrer, soit ici, soit à Paris, soit à Toulouse où je serai, en principe, au début du mois de mai.
N'ayant reçu Pictura qu'hier soir, je n'ai pu lire que votre article dont je ne vois pas encore comment il s'intègre au reste de la revue, mais peut-être cet éclectisme est-il voulu. Dites-moi ce qu'est Pictura.
Vous donner un texte m'est plus difficile que vous rencontrer; je travaille en ce moment à un essai qui me prend tout mon temps et me fatigue beaucoup. A mon âge, il est à peu près impossible de mener deux choses de front. Mais j'ai avec moi un petit groupe d'amis bien plus compétent en matière de Kabbale et de Yi-king, par exemple. Je pourrais les mettre en rapport avec vous.
Soyez assuré en tous cas du vif plaisir que j'ai à vous lire, et, en attendant de faire votre connaissance, croyez-moi, je vous prie, bien sympathiquement vôtre.
Raymond Abellio.
*
Vence, le 27 février 1986
Cher Luc-Olivier d'Algange
Un grand merci pour votre envoi (lettre et article destiné à Question de). Question de est une revue que je connais bien et qui, en gros, m'a toujours soutenu. Robert Amadou, qui y écrit, est mon ami. Je n'en dirai pas autant de l'Université en général, à l'exception de non-conformistes comme François George, qui dirige la revue Liberté de l'Esprit, fort éclectique, il est vrai, - mais il faut être agrégé de philosophie pour être admis dans le milieu professoral, et le groupe d'influence qui s'est créé autour de Foucault, Barthes, Derrida, Lyotard, est encore tout puissant, et l'accès à la collection La Bibliothèque des Idées, chez Gallimard, est devenu impossible, je pense, à qui n'est pas "du métier". La parution de la "Structure Absolue" n'y fut possible que grâce aux efforts d'un ami politique, Robert Carlier, qui sut convaincre Michel Deguy. Il y fallut quand même des mois de palabres.
Je serai à Toulouse le 29 avril pour une conférence à l'Hôtel d'Assezat, sous l'égide de l'Académie des Jeux Floraux et resterai dans ma bonne ville natale (qui m'a remarquablement ignorée jusqu'ici) jusqu'au 3 mai. Nous pouvons nous rencontrer avant, à Paris ou à Vence, si vous le désirez, mais ce séjour à Toulouse nous donnera toute liberté.
A bientôt donc, et toujours bien sympathiquement vôtre
Raymond Abellio.
09:03 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
26/02/2022
Les Alchimistes:

Luc-Olivier d'Algange
Les Alchimistes de Jean Biès
Jean Biès est de ces écrivains français qui, le cas n'est pas si fréquent, sont les auteurs d'une œuvre. Poète, romancier, essayiste, Jean Biès est aussi l'auteur d'un ouvrage décisif intitulé Les Alchimistes. D'emblée son livre se distingue par l'exactitude des références, la rigueur doctrinale et la beauté du style. Si le monde est bien, comme nous l'enseignent les Théologiens du Moyen-Age, la « rhétorique de Dieu », on ne saurait trop se réjouir de voir la beauté, par l'exactitude grammaticale, répondre à la vérité de la doctrine. A ce titre l'œuvre de Jean Biès est éminemment platonicienne: elle démontre, par son existence, que le Beau est la splendeur du Vrai.
L'ouvrage est un des rares à prendre en compte tous les aspects de l'Alchimie, tant dans sa réalité historique que constitutive ou structurale. L'Alchimie est un art, un jeu, une science, une poétique et une gnose. Elle est également une médecine, magistralement illustrée, entre autre, par Paracelse, une cosmologie, fondée sur la correspondance du microcosme et du macrocosme (dont témoigne la fameuse Table d'Emeraude) et une science héraldique des « signatures ».
A travers la métamorphose des éléments, dont la splendeur se multiplie en images d'une grande richesse poétique et iconographique, l'alchimiste déchiffre les apparences où il retrouve l'empreinte visible d'un sceau invisible. La méditation alchimique n'oppose pas l'intelligible et le sensible, l'invisible et le visible, l'esprit et la matière, l'être et le devenir. Elle ne perçoit point dans ces contraires des ennemis irréductibles. Le monde, qui se déploie dans la diversité des apparences, lui apparaît comme un don du Verbe. Dans les détails les plus infimes et les plus grandioses du monde sensible, son art lui enseigne à reconnaître les signes et les intersignes. Dans les métamorphoses du devenir, l'alchimiste perçoit la permanence des cycles ; dans l'immobilité désirée et attendue de l'Inconditionné, qui n'est autre que la Pierre philosophale, elle devine la possibilité universelle et les variations infinies dont est faite la trame du monde.
L'Alchimie mérite bien cette appellation de Philosophie, que certains universitaires imbus de « modernité » lui refusent, ne serait-ce que par les transitions qu'elle favorise entre les pensées habituellement considérées comme rivales, ou antagonistes, de Pythagore, d'Empédocle, d’Héraclite, de Parménide et de Platon. Dans la perspective alchimique, en effet, le sens héraclitéen du devenir loin d'infirmer la théorie parménidienne de l'être, la corrobore. De même que la vision poétique et dramatique d'Empédocle, loin d'exclure la mathématique de Pythagore s'accorde en elle comme s'accorde, dans la flambée de l'athanor, le Mercure et le Souffre, par l'ambassade du Sel. Pour qui retient la leçon des alchimistes, ces « philosophes par le feu », pour celui qui n'oppose point péremptoirement au Mystère ses certitudes et ses convictions, toutes les joutes philosophiques sont nuptiales et la dissociation des éléments n'est que le prélude à leur harmonie.
Alchimiste lui-même dans son enquête sur l'Alchimie, Jean Biès se tient exactement sur l'orée qui distingue et unit la nature et la Surnature. Le symbolisme alchimique, en récusant la notion moderne d'une séparation radicale du monde matériel et du monde spirituel, révèle les vertus paradoxales du monde. « Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu », cette formule de la liturgie orthodoxe convient parfaitement à l'alchimiste dont l'audace est le principe même d'une humilité essentielle. Bien davantage qu'à Prométhée, qui tant fascina les philosophes de la modernité, c'est à Hermès et au Christ que vont les fidélités philosophales. Prométhée, comme Icare, se rend coupable de démesure. Or l'hybris est le premier péril et la première tentation dont l'alchimiste doit se défendre. Son œuvre n'est point subversive, ni titanesque, mais harmonieuse et miséricordieuse.
Cette harmonie et cette miséricorde se manifesteront dans la beauté versicolore du voyage. Les couleurs et les symboles sont à la fois intérieurs et extérieurs. Entre le monde et l'entendement humain, l'art hermétique présume une synchronicité possible.
Science des qualités et des nuances, des variations et de l'interprétation, l'Alchimie, loin d'être l'ancêtre balbutiante de la chimie telle qu'elle se précisa au dix-neuvième siècle, fut une connaissance (pour une part perdue, et pour une autre, non encore advenue) de l'interdépendance de l'expérimentateur, de la chose expérimentée et de l'expérience elle-même. Le couronnement de l'œuvre est la transfiguration de l'Adepte. L'instrument de la connaissance a pour dessein de modifier, en même temps, et de façon essentielle, la matière et l'entendement humain qui œuvre sur elle. A ce titre, les alchimistes devancent l'exigence de la phénoménologie et de l'épistémologie et l'on s'étonne, en effet, que leurs œuvres soient exclues du « corpus » des actuelles pensées prospectives. Il est vrai que l'Alchimie inquiète, que ses œuvres paraissent insaisissables et qu'elle exige de ses chercheurs comme de ses adeptes, et même de ses simples historiographes, certaines des vertus éminentes du navigateur.
Pour consentir à s'aventurer dans ce monde de métaphores scintillantes et houleuses, il faut avoir l'âme odysséenne. « L'erreur enseigne ce qu'il ne faut pas faire, écrit Jean Biès, l'errance apprend ce qui est à faire: il est bon d'aller s'informer auprès des Maîtres. L'alchimiste apparaît alors dans son manteau de voyage, coiffé d'un grand chapeau souvent orné de la coquille de monseigneur saint Jacques de Galice, muni d'un bâton de marche, accompagné d'un chien. Dans le décor sauvage qui l'entoure on le devine étranger à toute société. » La pérégrination alchimique est, là aussi, à la fois en-dedans et au-dehors de l'entendement humain. Les alchimistes furent de grands voyageurs. Ils eurent l'audace, en des temps où les distances étaient plus éprouvantes et plus réelles, le monde n'ayant pas encore été rabougri par les techniques de déplacement, d'affronter les incertitudes de toute véritable tribulation, - mais ils furent aussi, et surtout, des voyageurs intérieurs, à la ressemblance du Heinrich von Ofterdigen de Novalis.
Quête initiatique, découverte du monde imaginal, approche de l'Ame du monde, telle est l'Alchimie à laquelle nous invite l'ouvrage de Jean Biès. L'Ame du monde se révèle dans les métamorphoses de la matière ordonnée aux Symboles visibles-invisibles qui s'y déploient comme la roue solaire du Paon. Rien n'importe que ce moment, où l'entendement humain enfin délivré du Règne de la Quantité, de la pensée calculante et des normes profanes de l'indéfiniment reproductible, reconquiert la plénitude intérieure. Or, - et c'est bien là le sens de l'humilité que tous les traités d'alchimie prescrivent aux adeptes, - cette plénitude n'est point notre propriété humaine. Elle nous est, quoiqu'infiniment proche et offerte, étrangère. Elle n'est point dans l'outrecuidance de la subjectivité livrée à la démesure, mais dans la subtilité de ce qui advient, de ce qui transparaît précisément pour nous enseigner le secret de la transparence. Elle est, cette présence cachée, dans l'extinction du moi.
La rouge aurore du rubis philosophal flamboie à l'instant précis de cette extinction. L'Œuvre est réalisée lorsque tout ce qui fait notre moi est frappé d'inconsistance, littéralement brûlé comme par le Miroir de Nigromontanus qu'évoque Ernst Jünger dans Les Falaises de Marbre.
« Ce démembrement du moi, cette mort du moi, écrit Jean Biès, c'est ce que signifie déjà le travail devant l'athanor, exigeant une vigilance épuisante ». L'âme emprisonnée exige d'être désincarcérée, comme un « iota » de la lumière incréée, dissimulé sous la compacité des apparences ou dans l'illusion des fausses lumières. L'ouvrage de Jean Biès, qui est à la fois histoire (au sens d'enquête), légende, au sens de ce qui doit être lu, et herméneutique créatrice, au sens de ce qui doit être interprété et non seulement expliqué, s'inscrit, on l'aura compris, dans une tradition pour laquelle, selon de mot de Villiers de L'Isle-Adam, la lumière des siècles est plus profonde que le prétendu « siècle des Lumières ».
Se développant selon les lois de l'arborescence, le discours alchimique exige l'attention à la plus infime radicelle, en même temps que la vue d'ensemble. le propre du moderne est d'avoir perdu cette vertu d'attention. Sa fascination pour la quantité, le calculable, a pour origine et pour complice cette inattention qui, dans son ignorance du monde des qualités, sépare l'âme humaine de l'Ame du monde, si bien que l'une s'étiole et se durcit et que l'autre devient lointaine et indiscernable. Ce livre de Jean Biès vient, à la suite de ses précédents ouvrages, raviver notre attention, et, si nous en sommes dignes, nous ouvrir la voie à la connaissance de l'esprit de l'Alchimie qui viendra couronner nos retrouvailles tant attendues avec l'Ame du monde, sophia pérenne et divine présence: « Se faufilant à pas feutrés, écrit Jean Biès, entre désastres et dérisions, effondrements et massacres, traversées du déserts et marées équinoxiales de la barbarie, l'esprit de l'alchimie, sous les traits joyeux d'Hermès, est bien de retour parmi nous, même si peu d'entre nous le savent. Descendant à travers les airs qui avaient oublié de lui l'empreinte de ses ailes, le dieu rieur parvient sur une terre exténuée, s'aventure au clair-obscur des recompositions incertaines d'aurores s'essayant à naître, et danse par avance dans le secret des cœurs l'ivresse rutilante de l'Or ».
Les Alchimistes, Jean Biès, éditions Philippe Lebaud
23:16 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
19/02/2022
Heures de syrtes et de feu, poème:

Luc-Olivier d'Algange
Heures de syrtes et de feu...
Heures de syrtes et de feu, heures aimées…
Des univers y battent leurs feuilles sous la pluie si claire,
Laudes écrites contre la brume et dans le marbre de l’air.
Quelle enfance en poussière dans le sommeil léger ? Les regards
Mystérieusement se rencontrèrent dans l’intimité du monde,
Et cet être du vent sur le dos des tempêtes nous emporte
Vers l’exquise incertitude qui nous laisse dans l’abandon
Comme une barque tardive, vaguement oscillante
Sous la blancheur du ciel, nous laisse être
Avec le seul souvenir des temps où nous n’étions rien,
Sinon cette ombre du chant qui nous précède, cette ombre
D’un temps où fleurissent les patries des terres dorées
Dites, de degré en degré, jusqu’aux fortins paradisiaque !
La nostalgie change les proportions du monde.
Depuis des temps immémoriaux, la nuit est mauve.
Les nuages se sont habitués aux cadrans des Jardins.
Notre tourment s’achève avec les grands vaisseaux du siècle
Qui pavoisent… La sagesse n’est point jalouse, mais éblouie.
Elle est l’hôte de l’heure déployée, de l’heure ardente,
De l’heure frémissante sous le joug des anciennes nuées…
Nous serons en elle, à jamais, et pour elle, et contre le monde !
Six feuilles entrelacées en épine dans l’incohérence des mots
Suffisent à notre bonheur, à notre gloire ! Six feuilles nervurées
D’un sang qui déchiffre les clartés de l’ombre
Lorsque nous marchons sur le profil de l’aube …
Ce furent ces aventures dites, où le double du firmament
S’abolit dans la nuit de l’azur, dans la ténèbre qui sauve la raison,
La seule qui nous dise la courbe claire de la musique, des navires…
Ainsi j’éveille doucement ce sommeil, je l’éveille de lui-même
Comme une lueur, comme un combat de pierres noires sur les rives nues.
Cela demeure, et ne nous quitte jamais. Cela demeure
Dans le passage du soleil comme l’apocalypse joyeuse
Des chants d’oiseaux au matin, dans l’entrelacs des six feuilles
Brodées d’absolutions et de chimères, mais seules vraies
Dans le bien qui nous est offert, dans la beauté de l’œuvre
Qui tient en elle la beauté du monde, tenue comme six feuilles
Du sommeil polaire entre les doigts, six feuilles insondables
Qui tressaillent des battements de la terre, où nous étions
De passage.
L’âme endure ces roseraies de tonnerre ! L’âme ne se lasse
D’être au seuil de l’effroi et de l’extase. Il n’y a que la bassesse qui se lasse,
L’infidèle à toute beauté, l’incessante traitresse aux oracles obscurs :
Les seuls qui vaillent. L’âme endure le sel de Typhon et la transparence
Qui brûle. Elle endure les abysses du bonheur, et les lentes processions
Vers la Somme incompréhensible des hauteurs. Elle endure,
Infaillible, et se forge, se gemme, sous le feu sifflant de la Sapience.
L’âme endure les désastres, mais devant l’âme, les désastres se courbent
Comme l’orgueil du vent sur la mer. De tant de siècles stellaires
Nous gardons mémoire, de tant de siècles de ravages : ils se courberont
Sur notre sein comme un jour se love dans le regard, comme une treille
Promise à d’autres ivresses inconnues s’établit dans le règne
D’un palais rouge crétois, comme encore ce qui passe dans ce qui demeure,
A l’infime : là où ce jour qui est nuit traverse le temps comme une vague ;
Nous y serons, à jamais, dans cette présence-là, sable fin et grandes aurores…
L’âme endure et l’espace des formes, et le soleil tournant
Qui démantèle le monde et le déploie comme une corolle
Eclose sous la caresse. Tant de violences l’âme endure,
Et tant de douceurs : comment y survivre, sinon dans l’Eclat ?
Luisent six feuilles entrelacées dans la pénombre qu’elles animent
Pointent six feuilles : le monde s’y tient.
Six feuilles de Sybilles. De quel idiome, leurs nervures ? Il y eut
Ce mot comme une croix dans le ciel, cette marche vers la puissance
Que nomment les Parques, ce monologue sans fin dans la nuit
Qu’interroge le regard. Il y eut ces mots que ne disent ni la ruse
Ni le chancellement de l’existence dans la seconde aimée, rougeoyante
Comme d’elle-même devenue ce chiffre ordonné à la victoire !
Et cette bienheureuse doctrine des fougères, cette beauté infligée
Au théâtre sombre des heures, ce moment noir aux atours scintillants
De l’espace et du temps que nos prunelles, lumières gisantes ajournent
Pour de chant qu’il nous reste à dire… Six feuilles disparues, mais unies ;
Six feuilles dessinées sur l’arrière-pays où conduisent les routes colorées…
Six feuilles de vallées et d’étoiles. La terre vibrante comme un rubis
S’effondrait dans le vent du coucher comme un incendie, une ombre
Neuve à l’abordage du Soir où le sommeil dessine ses nervures, où l’attente
Dresse ses chapiteaux d’orage, où viennent se heurter les jardins et les guerres.
Cette folie était royale. Elle inondait nos larmes de lumière jaune. Elle élevait
Jusqu’au centre du monde ces routes, ces armées, ces noces prodigieuses.
Six feuilles d’or, six feuilles gravées par le feu dans l’air immobile,
Six feuilles, et voici que le jeu céleste obéit à nos cils, rumeurs donnée
Aux gorges vertes des aruspices. Les derniers empires vivent de cette clarté,
De cette sagesse claire. Les derniers empires appareillent au levant
Que détruisent les souvenir d’avoir aimé. Les derniers empires, les premiers,
Tombés sous la coupe transversale des règnes, en proie à leurs incertitudes,
Telles des strophes, des prairies renoncées au dieu inconnu…
Ces empires, sous l’aile double qui porte le mystère des vignes
Et des peuples affligés au nom des choses dernières ; ces empires
Qu’aucune trace sur les vagues à travers le temps, qu’aucune grandeur
Dans la genèse muette ne saurait dire, comme dans la gorge
Emprisonnée de ténèbres, le pôle de la voix s’exténue… Ces empires
Qui tiennent dans l’irisation de la goutte de rosée,
Mais que le monde, machine perpétuelle, ne contient ;
Ces empires de métamorphose et d’automne sans lune ; ces empires
Tropicaux et hyperboréens ; ces empires de baies rougissantes
Sur les mains ; ces empires qui passent doucement comme des songes,
Qui attendent avec des signes incertains ce point du jour suspendu
Au-dessus des forêts ; ces empires où l’obscur repos se mêle aux crinières
Foisonnantes des dionysies ; ces empires construits et détruits ; ces empires
Harassés, où des lumières siciliennes consentent à leurs dernières chances,
Il n’est pas un seul de leurs signes, un seul de leurs cris
Qui ne tiennent sur le Finistère de l’une des six feuilles que je dis.
L’intensité allège l’esprit. Point de fardeau qu’elle n’élève
Jusqu’à la plus haute branche du frêne du monde, où six feuilles frémissent.
Le vol prophétique clôt le crépuscule, et les ailes frôlent les feuilles ;
Les dieux irréversibles sont loin. Flèches ou flammes ? Qui devine ?
Encore d’autres violences, d’autres terreurs. Ne cesse le monde
Dans cette eau trouée par la bataille du jour : une colonne de gloire
Vers la profondeur ! Les dieux sont loin, mais je les nomme.
Quelque liturgie sabéenne cours dans la rumeur de mon sang.
Astarté fige le noir de ses roses d’ombre dans le détail de son tombeau.
Vive et tardive ! Des formes dansent sur les flots : elles se nomment Idées.
Le deuil ne trahit point la légende. L’intensité ne se dédit point :
Elle succombe à son propre bonheur et nous n’avons nul mal à en dire !
La première feuille fait signe dans l’orage. Proche, si proche, de son propre feu.
Le dieu de ses nervures hante la tristesse et le silence du serment :
Chaque fidélité dite témoigne de l’infidélité du monde.
La seconde feuille n’est point l’inconsolable : le Chœur est avec elle,
Et les voyages sur la mer calmée. Cette lueur de l’envers qui redime
La douceur de l’avers, et la protège comme le bouclier de Vulcain,
Garde son blé en herbe. Mais la troisième feuille est comblée.
Sur elle la pluie ruisselle. La quatrième n’est point apostrophée par l’abîme.
La cinquième se tient entre une fille nue et l’étourdissante mémoire du monde.
La sixième, enfin, serait un mirage si le mirage n’était le monde.
Six feuilles mes Amis, pour ce long voyage… Six feuilles incorruptibles,
Six feuilles entrelacées sur les genoux, nouées
Dans la nuit turbulente, six feuilles vides comme le chagrin,
Et coupantes, six feuilles comme six flammes. L’une tient en elle
La mer qui va, l’autre le ciel qui tourne, l’autre encore la pensée qui domine,
L’autre une voix d’enfant, et l’autre encore ne tient que la brûlure de l’Ether…
De longtemps j’imaginais que la vie magnifique était écrite sur la sixième.
Funeste erreur : tout reste à dire. Soldat mérovingien, je tombe
Aux genoux d’Isis, s’il me plaît de nommer, comme en songe,
Cette présence immense. A la plus légère, mon destin ! Qu’il vague !
Elle se reconnaîtra, la rebelle au règne de Caliban, la jamais lasse
Pour bien et le vrai ; et que la beauté couronne
Comme un hiver d’Orient, le pâle azur !
Pour elle, ces feuilles de mon poème, ces ailes sixtes sises
Entre la perfection de l’aube et le sommeil de la terre.
19:05 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
17/02/2022
Revue Liber:
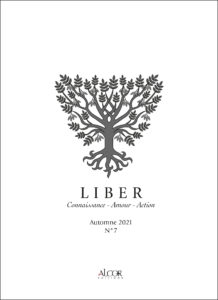
Editions Alcor, 1, rue Ramatuelle - 13OO7 Marseille
19:08 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
14/02/2022
Entre la Mort et le Diable:
Luc-Olivier d'Algange
Entre la Mort et le Diable
Les temps hélas ne sont plus à la maïeutique ou à l'aporie mais au slogan et au mot d'ordre. Les conquêtes de la modernité se confondent de plus en plus avec celles de la publicité. Le propre du règne de la quantité est d'interdire toute nuance. A l'heureuse diversité humaine, à l'enchanteresse complexité des êtres et des choses entre-tissées, aux variations musicales des astres, des sentiments et des songes, le monde moderne substitue l'uniformité, le schéma dictatorial, les simplifications démesurées. Les idéologues de la modernité se targuent d'être les inventeurs ou les parangons de la liberté individuelle, alors même qu'ils empierrent à sa source toute possibilité d'être libre et assujettissent la personne au rôle d'unité interchangeable au sein du collectivisme le plus radical et le plus intransigeant de toute l'histoire humaine.
Parler d'un fondamentalisme moderne relèverait ainsi non d'une contradiction mais d'un pléonasme. Le fondamentalisme est moderne, par définition historique, et la modernité est fondamentaliste par nature. Par son refus de l'interprétation, de la traduction et de la transmission, par son acharnement à absolutiser le relatif et à vouloir universaliser le particulier, par son souci exclusif de la forme et de l'apparence, la modernité se confond avec le fondamentalisme religieux qu'elle prétend combattre. Il n'y a rien espérer du heurt des fondamentalismes qui s'engendrent les uns les autres, sinon un plus grand assombrissement de l'âme humaine. Celui qui divise, le Diable, triomphe dans ces prétendus combats entre le Bien et le Mal.
Le fondamentalisme est-il le fils de la modernité ou bien est-ce la modernité qui serait fille du fondamentalisme ? Les deux phénomènes apparaissent si inextricables qu'il est presque impossible de les distinguer en tant que cause ou effet. Ce dont ils témoignent également, c'est du refus, ou de la parodie, de la Tradition. Le refus de la Tradition se traduit immédiatement par le refus de l'art de l'interprétation, de l'herméneutique. Là où l'art de l'interprétation se retire, la place est laissée à la modernité et aux fondamentalismes, aux opinions et aux convictions sommaires, à l'idolâtrie des mots, à la précellence de l'activisme sur la contemplation et à cette futilité foncière qui attache plus d'importance à l'apparence, au signe extérieur, au vêtement, qu'à l'âme et à l'esprit. Observons que les prétendues oppositions entre le fondamentalisme et la modernité se jouent autour de questions corporelles et vestimentaires. La nature des couvre-chefs, la longueur des poils, les activités biologiques du corps humain deviennent le centre de toutes les préoccupations, avec la notion d'appartenance qui enchaîne les pensées de celui qu'elles subjuguent à des limites, des conditions dont il ignore qu'elles ne sont que les empreintes d'un sceau invisible.
Lorsque l'empreinte usurpe le rôle du sceau, lorsque l'apparence se veut l'essence de l'apparaître, lorsque l'appartenance veut prendre la place de ce à quoi elle appartient et qui dépasse toute condition ; lors qu'enfin l'existence humaine n'est plus qu'une fuite en avant vers la Mort, la subversion est établie et peu importe alors qu'elle prenne le visage parodique du fondamentalisme ou celui, caricatural, de la modernité. Notre époque nous a réservé le piège particulièrement perfide de la fausse alternative dont les mâchoires sont désormais prêtes à se refermer. Entre la modernité fondamentaliste et le fondamentalisme moderne, la marge de manœuvre, pour le moins, est étroite. Cette étroitesse est notre destin, comme le chemin escarpé qui conduit le Chevalier de Dürer vers la Jérusalem Céleste, entre la Mort et le Diable.
*
Entre une littérature pompeuse et hystérique dans la bien-pensance et une autre laborieusement primesautière, je ne trouve plus guère parmi les auteurs récents cette quête ardente et légère à contredire l'idée reçue: « le bonheur ne laisse pas de traces ». Les Modernes ont le culte du malheur, et lorsqu'ils y dérogent, ils se dévouent aux narcotiques. Notre temps est un temps d'angoissés fastidieux et d'endormis. Le discernement et le bon goût s'y font rares autant que la vivacité et la grandeur. Je garde, non la nostalgie, mais le souvenir de grandeurs heureuses. Ce souvenir des vastitudes légères, au seul nom d’une déesse phénicienne, est en lui-même un grand bonheur qui rend plus précieux encore l'instant présent. Quelques philosophes voulurent désenchanter le monde pour l'établir dans la raison comme si les rimes et les raisons ne participaient point essentiellement de l'enchantement du monde. D'une chose dépourvue de sens, on dit qu'elle est « sans rimes ni raison ». La raison elle-même n'est point sans rimes. La prosodie ordonne l'entendement. C'est ainsi que le désenchantement du monde prédispose non à la précellence de la raison sur « la folle du logis » mais à un nihilisme irrationnel et déraisonnable dont les œuvres triomphent dans les pouvoirs de destruction de la modernité titanesque; un monde désenchanté est, certes, un monde sans dieux (ou, si l'on y tient, un monde « libéré » des dieux), il n'est pas un monde libéré des Titans. Le rationalisme utilitaire est désormais dans ses conséquences chimiques, nucléaires, cybernétiques, génétiques et économiques si riche de déraisons qu'il faut apprendre à distinguer le rationaliste de l'homme raisonnable.
La prose du rationaliste apparaît de plus en plus comme un discours courant au néant, alors que la prosodie de l'homme raisonnable nous ramène à ce qui revient, garde mémoire de l'intelligence classique, du rythme et de la rime; et ne conçoit point de projet sans un art de la remémoration. « L'homme de l'avenir est celui qui garde la mémoire la plus longue » écrivait Nietzsche. L'homme raisonnable est celui que l'on peut raisonner, au contraire du rationaliste qui croit être lui-même le mouvement en marche de la Raison. La distinction du fondamentalisme et de la Tradition se trouve en cette occurrence. Le rationaliste est le fondamentaliste de la raison et il est à l'homme raisonnable, à l'homme qui entend raison ce que le fanatique est à l'homme de la Tradition. Une raison sans rime ne vaut pas mieux qu'une rime sans raison. La pure fascination des images et des phonèmes, ce que les cuistres naguère nommaient les « signifiances », et qu'ils prétendirent dans leurs avant-gardes, promouvoir au détriment des significations jugées par eux trop « platoniciennes », le monde de la « communication de masse » nous y précipita avant même que ces prétendues avant-gardes eussent l'heur de formuler théoriquement ce désastre.
De même que le fanatique exacerbe l'expression de sa foi, car, au fond, il n'y croit plus, le rationaliste se fait militant de la raison à défaut de l'exercer. Ce que sa raison pourrait lui faire comprendre, et dont il s'effraye, sa pusillanimité le recouvre d'une pétition de principe. Sa plaidoirie incessante en faveur de la raison le dispense d'en user (comme le fanatique, son ennemi et son frère, se dispense d'interpréter et de comprendre la Loi qu'il proclame). Tout au service de la démesure, le monde qu'il dispose pour nous, sous les atours pompeux de l'Histoire se faisant et se défaisant, ne rime strictement à rien et rien ne lui convient mieux que la formule shakespearienne: « une histoire pleine de bruit et de fureur, racontée par un idiot, et à laquelle on ne comprend rien. »
*
Il est de bon ton parmi ceux qui écrivent de dénigrer les mots, de s'en prendre, par impuissance ou dépit, au langage lui-même. Les uns se lamentent de n'être point peintres ou musiciens, les autres disent préférer le « langage du corps » à celui des mots, jugé trompeur. Sauf à y voir les affres d'un amour malheureux, comment ne pas douter de la sincérité de ces récriminations ? Si ces auteurs désabusés préfèrent tant et si bien la peinture ou la musique, que ne se font-ils peintres et musiciens ? La liberté la plus absolue nous est laissée de choisir pour matière première de nos œuvres, les sons, les lignes, les couleurs ou les mots. Il n'est pas même interdit de varier les approches.
L'écriture est d'essence silencieuse. Autant doit-on ne pas croire, ou tenir pour de simples imbéciles, les écrivains qui disent préférer la musique ou la peinture (le propos vaut également pour les hommes politiques qui nous vantent qu'ils eussent préféré être des écrivains) autant il faut croire sur parole les écrivains qui disent aimer par-dessus tout le silence. Non seulement parce qu'il est bon d'aimer le silence (l'amour du silence n'étant point un amour sans retour), non seulement car le silence est un havre de paix et de bonheur dans les bruitages et jacasseries permanents du monde moderne, non seulement car une page écrite ne fait pas de bruit, qu'elle attend dans son silence le silence du lecteur, l'écrivain est prédestiné à être l'ami du silence comme furent Amis de Dieu les mystiques rhénans, par des affinités premières souvent reconnues entre le signe écrit et le silence.
Rien ne fait mieux silence que le signe écrit. On peut se taire autant qu'on veut, demeure la rumeur du souffle où la parole est retenue. Le monde est un immense bruissement. Il bruit heureusement dans les feuillages, dans la mer, les voix amies. Il bruit odieusement sur les routes encombrées de voitures, dans les foules et les musiques d'ambiance des supermarchés. L'écrivain connaît le silence. Il entretient avec lui une amitié intense et durable dont son œuvre témoigne. Faire silence, c'est bien le contraire de cesser d'écrire. L'écriture atteste le silence. S'il n'y avait point d'écriture, le silence serait un leurre, un mensonge, une utopie, un impossible vœu de l'esprit. Les premières runes gravées sur la pierre inventèrent le silence en des temps où le silence n'était pas encore nécessaire à la survie de notre âme et de notre esprit. Lorsque le vacarme triomphe sur tous les fronts, l'écriture devient l'ultime place-forte du silence. En écrivant, je fais ce silence qui se rebelle et résiste.
Il arrive souvent que les écrivains soient, lorsqu'ils sont en confiance, de brillants causeurs, mais le bavard ne se fait que rarement écrivain: il éprouve trop la dépendance pour l'oreille attentive et l’œil appréciateur. La page écrite est le légitime chant du silence. Célébrer le silence en écrivant n'est pas un paradoxe comme le croient les esprits confus mais le mouvement le plus naturel qui soit, le plus vrai, le mieux en accord avec sa forme et son objet. Ecrire le silence, j'oserai dire que cela coule de source. La source de l'écriture est le silence, et cette mer où elle va se perdre est le silence que les lecteurs feront en eux-mêmes pour s'ouvrir à ce plus vaste silence que l'écriture fonde et sauvegarde.
Les journalistes disent de certains livres qu'ils font du bruit, voulant sans doute suggérer par là qu'ils vont à la rencontre d'un large public ou suscitent des controverses. Sans doute veulent-ils ainsi ramener l'activité de l'auteur dans l'ordre subalterne de leurs propres agissements. Non ! Les livres ne font pas de bruits. Ils font du silence. Il se peut que l'on fasse du bruit autour d'eux. Mais une ligne de partage infranchissable demeure entre l’œuvre, qui est silence, et la rumeur circonstancielle. Le bruit ne peut rien à l'encontre, ni en faveur, de l'essentiel silence.
*
Quelques-uns m'accusent de « nier le progrès »: belle absurdité ! A prendre le « progrès » en bloc, à le constater, à l'affirmer, comment ne pas voir que le « progrès » technologique accompagne le progrès du meurtre de masse tout comme le progrès de la médecine accompagne le progrès des armes bactériologiques ? Sans oublier le progrès des techniques de communication, corollaire des progrès des techniques de contrôle et de surveillance. Ma diatribe contre ces tenants du « bilan globalement positif » que sont les progressistes qui ne veulent voir dans les changements du monde que les aspects qui leur conviennent, ou peuvent décemment être revendiqués, et demeurent aveugles à tout le reste, est un exercice de lucidité. L'objet de ma critique est moins la technique en soi que cette énorme, ubuesque et désastreuse faculté d'aveuglement. Je vois les progressistes luttant contre le fanatisme et le fondamentalisme comme la peste luttant contre la variole. Ceux-ci ne veulent pas interpréter ni comprendre les textes dont ils se réclament, ceux-là ne veulent pas voir le monde qu'ils nous font. La symétrie est parfaite. Ces frères ennemis sont destinés à dominer le siècle qui vient pour le plus grand malheur des esprits libres. Il ne suffit pas de vouloir être libre, il faut être conscient de sa liberté spirituelle. Cette conscience, toutes les traditions nous l'enseignent, est un exercice.
La défaite programmée de l'enseignement, par exemple, est inscrite dans le vocabulaire. Ce qui aura été fait par les professeurs, intercesseurs des styles et des savoirs, sera défait par les enseignants, techniciens en pédagogies. Le terme d'enseignant venu remplacer celui de professeur et, pire encore, (Léon Bloy ou Villiers de L'Isle-Adam n'eussent osé l'imaginer à titre satyrique !) l'expression faramineuse de « public scolaire » prétendant à désigner ce que l'on nommait naguère encore les élèves, les plus grandes latitudes sont laissées désormais à la démagogie et à la soumission. L'acharnement des « pédagogistes » contre le cours magistral, autrement dit contre le discours de la maîtrise et de la compétence qui requiert le silence de la part de ceux qui écoutent, au profit d'une « interaction » entre l'enseignant et son « public », la volonté obsessionnelle de « connecter » ce public (ou peut-être vaudrait-il mieux dire cette clientèle) à la Toile informatique avant même qu'il eût acquis les moindres facultés de critique et de discernement, le dédain affiché pour la culture de son pays, furent autant de procédés, à peine inavoués, pour défaire le style et la pensée. Nous en sommes là, avec les conséquences désastreuses que l'on connaît. Les jeunes gens invités à exprimer leurs « opinions », pour « inter-réagir » avec les ex-professeurs devenus enseignants, sorte de techniciens de surface des entendements gourds, n'ayant d'autre référence que la télévision et pour seul adage moral: « Je suis ce que j'achète », déchus du rôle d'élève, que l'on dresse, que l'on élève, à celui de public, que l'on méprise et trompe, ne cessent de réclamer des « savoirs utiles », - le monde les ayant convaincu que le latin et le grec, la langue française, les œuvres, les philosophies sont éminemment inutiles. Ne tardant pas à s'apercevoir que les pauvres bribes de langues « vivantes », de science, d'histoire et de géographie qu'ils apprennent ne leur serviront guère davantage, leur croissante désaffection pour l'enseignement en général accompagne en toute logique la lassitude et la désespérance des « enseignants ».
Ce qui se joue entre un professeur et un élève est d'une toute autre nature que celle qui s'établit entre un enseignant et son public. L' « enseignant », au sens strict, est un homme en train d'enseigner: définition pour le moins minimaliste. Ceux à qui il enseigne sont un « public », définition non moins minimaliste d'un ensemble d' « écoutants » ! Qu'il y eût quelque chose à enseigner, qu'il y eût un dessein à cette pratique fort ancienne, rien ne saurait être plus étranger à ces définitions minimalistes. Comment ne pas voir, au demeurant, que le rapport enseignant- « public scolaire » n'est que le prélude à la conformation au seul rapport licite dans le monde de la Marchandise: vendeur-client ? Je n'en veux pour preuve que ces terrifiants « stages de pédagogie » où de jeunes enseignants sont livrés à des « autoscopies » selon les recettes du « marketing ». Il ne s'agit plus d'apprendre pour enseigner, il s'agit d'apprendre à enseigner dans un pédagogisme autarcique, pour ne pas dire autiste, où la méthode prime sur la connaissance. Le but est clairement avoué: il s'agit d'abord de convaincre les enseignants qu'ils ne doivent plus professer, et encore moins cultiver l'ambition d'être les serviteurs ou les ambassadeurs d’une haute culture française et européenne, mais de se vendre, en usant des stratagèmes et du bagou commercial à mesure que leur sera ôtée toute autorité.
L'école « ouverte sur la vie » est d'abord l'école ouverte sur le commerce, obéissant à la logique du commerce, avec mallettes pédagogiques, logiciels d'éducation civique au service des industriels du dentifrice ou du yaourt. Croit-on que l'on jugera encore bon au rapport fructueux enseignant-client l'étude des œuvres d’Homère, de Sénèque, de Rabelais, de Montaigne ou de Pascal ? La stratégie mise en œuvre contre l'existence même du professeur, contre la relation professeur-élève, survivance de la relation traditionnelle du Maître et du disciple, a précisément pour objet de faire disparaître de la conscience commune ces auteurs et ces œuvres. Contre les corrupteurs de la jeunesse, la modernité propose la dose fatale de ciguë cybernétique. Les nouveaux programmes seront purifiés de toute archaïsme, tels que les lettres classiques, l'histoire nationale, les œuvres littéraires et philosophiques, ils devront, selon la providentielle « Loi du Progrès » céder la place à des matières énigmatiques que l'on pourra jauger également n'importe où. Il ne sera plus question pour un jeune Français de recevoir un enseignement de jeune Français mais de passer des épreuves prouvant sa performance dans un monde planétairement unifié, c'est-à-dire dans un monde inexistant.
A quelles étranges convictions nous préparent ces mentalités forgées dans le « devoir de mémoire » et dans l'ignorance de l'Histoire et le dédain de la philosophie politique, les fondamentalistes que l'on voit surgir ici et là en donnent quelque idée. Les journalistes se lamentent de l'échec de l'intégration: ils devraient, plus en amont, s'interroger sur l'échec de cela même en quoi il faudrait s'intégrer. Les clones à casquette qui propagent leurs incivilités en banlieue, et sur les plateaux de télévision, sont en réalité éminemment « intégrés », non à la tradition du pays dont ils profitent mais à sa dernière mouture moderne. Ils ne sont pas d'un autre monde, ou d'un autre temps mais le pur reflet de ce monde et de ce temps. Les plus violents semblent, par leurs provocations, appeler la contrainte salvatrice, le Maître en style et en dignité, qui les dressera. Le paradoxe de l'idéologie démocratique est d'avoir supprimé toute hiérarchie dans la seule institution où celle-ci est non seulement nécessaire mais légitime. La hiérarchie que tout bon démocrate tolère dans une entreprise de restauration rapide ou de publicité, la hiérarchie que l'on adule dans les Stades et dans le Marché du Spectacle, le seul lieu où chacun s'acharne à la combattre est l'Enseignement, dont le propre, en vertu du principe de l'inégalité protectrice, est précisément d'être hiérarchique. On tolère la soumission à des fins de production économique mais on récuse l'inégalité protectrice, la hiérarchie donatrice et la supériorité généreuse qui sont les conditions même de l'éducation. Tant que cette contradiction ne sera pas méditée, je crains fort que l'Education nationale ne s'étiole, de désastre et désastre, dans l'indifférence générale. Or, qu’opposer à ce fondamentalisme moderne ? Quelques livres, le plus simplement du monde, de Léon Bloy !
*
Après tant de récits tournés vers la physiologie et les humeurs de leurs auteurs ou « auteures » (selon l'orthographe ahurissante en vigueur dans certains magazines féminins), après tant d'essais de sociologues (dont le propre est d'être toujours d'une génération en retard sur les événements), voici bien un livre d'actualité, un livre écrit au vif de nos peines et de nos espérances ! On pourrait penser que Les Funérailles du Naturalisme, de Léon Bloy, s'inscrivent dans une époque révolue et ne sont destinées qu'à l'attention vacillante de spécialistes en histoire littéraire. Il n'en est rien: la véhémence coruscante de l'essai de Léon Bloy, son faste coléreux, ses fulgurations tantôt meurtries, tantôt miséricordieuses nous semblent, à les lire aujourd'hui, beaucoup plus pertinentes qu'elles ne le furent à l'heure de leur publication. Quelques auteurs disposent de ce privilège, on pourrait presque dire de cette grâce, de gagner en justesse avec le temps. La vérité qui gît au cœur de leur secrète et jalouse pratique de l'écriture, pour user de la formule de Mallarmé, se révèle par le passage du temps, comme si les années étaient des voiles, une à une ôtées, jusqu'à l'instant crucial où la vérité brille enfin de tous ses feux.
La vérité, la vérité resplendissante et glorieuse, est l'objet de la grande sollicitude de Léon Bloy. Au Pauvre, qui ne brigue aucune situation sociale, il ne reste rien que la vérité et le style. Ce vrai et ce beau, apanages du Pauvre, le désignent à une fonction héroïque et sacerdotale. « Il importe écrit Léon Bloy dans son Journal, que la vérité soit dans la Gloire ». La bataille de Léon Bloy contre le Naturalisme est d'autant plus d'actualité que le Naturalisme, qui n'était qu'un mouvement littéraire prépondérant, a désormais triomphé sur tous les fronts. La philosophie, les sciences humaines et politiques, l'éthique elle-même (notion vague au demeurant qui se rapporte aujourd'hui à des comités plus ou moins fantômes défendant, fort mal, des principes inconsistants) se sont toutes vendues, en leurs formulations majoritaires, aux douteuses raisons du Naturalisme. Quand bien même ils s'opposent, pour une galerie de plus en plus indifférente, les partisans de l'inné et de l'acquis, du déterminisme héréditaire ou du « behaviourisme » obéissent à une même logique naturaliste où le sens de la Surnature, l'éclat de la transcendance et la simple liberté de l'imagination n'ont plus aucune place. La « télé-réalité », ce comble abominable du Naturalisme, eut au moins l'avantage de mettre en évidence que la mise en scène de l'observation directe de la réalité nous éloigne à l'extrême du vrai. En lançant au visage de ses contemporains la vérité contre l'idolâtrie de la nature, la métaphysique et la théologie contre l'adulation de la « physis » et du « corps », Léon Bloy nous adresse son impérieuse mise en demeure au fondamentalisme moderne
A la lecture des Funérailles du Naturalisme, ce ne sont point tant les auteurs des Soirées de Meudon qui sont taillés en pièce, que notre temps, que Léon Bloy pressentit, avec ses parodies de valeurs: le « progrès » comme erzatz de la divine Providence, le corps à survie prolongée comme substitut au Mystère de l'Incarnation et l'Economie comme intérimaire durant cette période pénombreuse où le Verbe s'absente et se retire pour ainsi dire dans l'hors d'atteinte, - que les kabbalistes nomment le Tsimtsum.
A l'absente communion correspond ainsi la « Communication de Masse », de même qu'au disparu libre-arbitre théologique, le libre choix du consommateur. Dans l'univers de la parodie l'ordre règne avec la plus extrême rigueur. Ce qui pouvait ainsi paraître en son temps comme une querelle strictement littéraire, une tempête dans un verre d'eau, est devenu une orageuse revanche. La somptuosité du verbe de Léon Bloy, son rire d'ami, rédiment nos désabusements en les ordonnant à la noblesse de l'intelligence et au dénuement de la beauté. Léon Bloy ne veut point seulement nous amuser ou nous convaincre: il nous fait l'insigne honneur de nous vouloir récipiendaires d'une chevalerie de résistance à l'ignominie. Léon Bloy n'était pas exactement un « démocrate » au sens moderne: il n'en persiste pas moins, et par cela même, à faire de ses lecteurs les Egaux de ces rares heureux qui se nomment Barbey d'Aurevilly ou Villiers de L'Isle-Adam. Léon Bloy nous parle comme au-dessus des gouffres, - d'où les résonances étranges de sa voix, mais sa vérité bat en nous comme notre propre veine jugulaire.
Dans la critique littéraire telle qu'elle va, rien ne vaut une mauvaise critique pour nous inciter à lire un livre. Certains éreintages valent de prestigieuses recommandations. C'est en lisant des critiques envieux, ou faisant étalage de leur ignorance que j'ai découvert les meilleurs d'entre mes contemporains et les plus profonds d’entre les anciens, dont Léon Bloy. Une mauvaise bonne critique nuit plus sûrement à la destinée d'un ouvrage qu'une bonne mauvaise critique. Les éloges et les compliments d'un imbécile accablent un auteur plus lourdement que la mauvaise foi dépréciatrice d'un homme intelligent. L'éloge laisse croire que celui qui nous le tresse est plus ou moins notre égal, à tout le moins qu'il appartient à notre famille d'esprits. On présume, dans l'éloge, ce que Proust nommait une « consanguinité des esprits » et l'on se trouve parfois en droit de craindre que la niaiserie du loué soit proportionnelle à celle du laudateur. Cette prévention, souvent injuste, nous est épargnée par l'éreinteur que l'on peut déjà espérer dissemblable de celui qu'il éreinte. Quoique cet espoir soit parfois déçu, il est raisonnable de s'y attacher et la discipline qui consiste à lire les critiques a contrario, comme une image en creux des qualités de l'ouvrage exécuté donne, surtout de nos jours, d'assez bons résultats. Les livres jugés élitistes, littéraires, incompréhensibles, immoraux, réactionnaires, baroques ou hermétiques, ou d'avoir pour auteur des dandies ou des mal-pensants ont ainsi toutes les chances d'être lisibles. La platitude du critique, sa démagogie, nous renseignent sur la profondeur et la loyauté de l'auteur mieux que ne le ferait une évidente hagiographie. Dans la confusion et le mensonge du temps, nous trouvons notre chemin par des signes retournés. Ce phénomène est à ajouter à la typologie du monde moderne comme antiphrase.
*
Parmi les innombrables lieux-communs que les Français répètent à l'envi (selon une propension constante qui donna déjà à Flaubert et Léon Bloy l'occasion de prouver leurs talents d'analystes) l'un des plus courus est de dire qu'il n'y a plus d'écrivains français. Ceux qui vont répétant ce lieu-commun dans leurs colonnes, sur leurs ondes ou leurs dîners eussent-ils été des deux ou trois milles lecteurs de Stendhal ou de Flaubert, de Montherlant, de Valéry ou d'Aragon aux temps où leurs livres furent publiés pour la première fois ? Il est permis d'en douter. De ceux-là qui ne sont toujours pas des lecteurs de Léon Paul Fargue, de Valery Larbaud, d'André Suarès ou d'Albert Caraco, on peut suspecter que des auteurs d'égal talent, écrivant leurs œuvres aujourd'hui se situeront également hors du champ restreint de leur attention, - à moins qu'ils ne les accueillissent avec le même dédain ou la même hostilité qui saluèrent autrefois l'apparition de La Chartreuse de Parme ou de Salambô ! S'ajoute à cela le formatage de la critique aux critères du roman néo-naturaliste américain. Toute création littéraire échappant aux sacro-saintes règles du personnage crédible, du lieu attractif et de l'intrigue ficelée (selon des normes empruntées au cinématographe) leur apparaît désormais incongrue ou incompréhensible. Ce que les critiques de nos journaux nomment un « bon roman » est presque toujours une matière lourde, « scénarisable » et appartenant à un genre étranger à la tradition française qui préfère, pour tout dire, les formes plus incertaines, plus aventureuses de la chronique ou des mémoires dans le style de Saint-Simon, de la fantaisie à la Cyrano de Bergerac, des formes brèves pascaliennes, de l'essai au sens de Montaigne ou de Valéry, du récit poétique et métaphysique, à l'exemple de Nerval ou d'Antonin Artaud. Aux laborieuses ficelles romanesques le génie français préfère la fulguration de la phrase.
Au contraire de la littérature qui emprunte au cinéma et s'évertue à reconstituer l'illusion d'une représentation objective, la littérature française cultive ce goût de la promptitude qui veut saisir d'un trait une vérité et une beauté qui n'appartiennent ni à la subjectivité psychanalytique, ni à l'objectivité sociologique. Le mépris affiché par Valéry et André Breton pour « la marquise sortit à cinq heures » est à peu près universellement partagé par les écrivains français qu'ennuie la construction laborieuse d'une histoire et qui attendent du langage de plus subtiles et de plus intenses merveilles. Si l'écrivain français consent à inventer des personnages, à les inscrire dans un lieu et dans un temps, il ne se contentera point d'en décrire les parcours, les joies et les drames, il voudra, comme Balzac, qu'ils soient les clefs d'une réalité cachée, d'une métaphysique. Baudelaire rappelle que l’œuvre de Balzac fut bien davantage visionnaire que réaliste. Stendhal lui-même, si vif et si délié, passe les deux tiers de ses romans en digressions et en méditations auxquelles un éditeur moderne, (de cette race d'illettrés teigneux qui sévissent aujourd'hui en lieu et place des sympathiques vieux dandies aux lunettes cerclés d'or) n'eût manqué de lui demander de renoncer.
Pour tout dire, les écrivains français ne sont pas des écrivains de « genres ». Leur vérité ne vaut que si elle est portée immédiatement sur chaque phrase, comme un éclat sur l'écume. Nous sommes trop impatients pour essayer de faire croire à ce qui n'existe pas ! Ce qui existe suffit à notre vertige. L'horizon que circonscrit notre regard se diapre de tant de prodiges, les intersignes entre les mondes intérieurs et extérieurs nous semblent si clairs et si pressants que nous ne pouvons mieux faire que d'en célébrer les touches et les timbres. Chaque phrase est un royaume et doit porter en elle, comme une clarté assagie ou coléreuse, le sens absolu de la parole, l'irrécusable témoignage de la présence de l'auteur à sa propre pensée et au monde qui la suscite. Ni les idées générales, ni les observations menues ne nous satisfont. Nous laissons aux sociologues et aux écrivains réalistes ces pauvres représentations du réel. C'est le heurt entre notre réalité et l'irréalité du monde qui nous requiert, c'est encore le combat nuptial entre la nature et la surnature... Notre hâte à nous saisir du vif de l'instant et du Verbe est trop grande pour que nous acceptions de nous distraire de l'essentiel, de nous dissiper en constructions qui n'auront d'autres ambitions que de faire passer le temps ou donner, à piètre prix, une bonne conscience à nos contemporains. Le temps qui passe et les consciences bonnes ou mauvaises n'ont nul besoin de nos efforts de scribe. Les phrases qui s'inscrivent dans nos cœurs, qui éveillent notre mémoire accomplissent leurs destinées dans cet au-delà qui est le véritable cœur du monde. Elles ne sont point des outils, elles sont des talismans. La résistance, pour métaphysique qu'elle soit dans ses origines et dans ses fins, n'en emprunte pas moins à la magie quelques-unes de ses ressources indubitables.
*
Il ne convient pas d'en vouloir excessivement à la société, au « Système » comme on dit. Nous sommes les artisans, sinon de notre bonheur, à tout le moins de notre résistance au malheur. Pour être heureux, il faut prendre de grands risques d'être malheureux. Le bonheur est la conquête d'une audace. L'infortune grimace à ceux dont l'audace défaille: ils quittent le cercle des fidélités juvéniles et vont se perdre dans les pénombres de la vie domestique et de la carrière. Ce furent de jeunes gens avec lesquels nous aimions traverser de capiteuses nuits d'été sur les terrasses et quelques années ont suffi à les rendre lourds, méfiants, égoïstes. Ce qu'ils eurent de léger, de gracieux et de fantasque a laissé place au ressassement du quotidien. Le pire est qu'ils ne peuvent s'empêcher d'en vouloir à ceux que l'esprit d'enfance continue à porter au-devant des idées, des charmes, des songes et des principes. Ayant perdus toute éloquence admirative, ils ne s'animent plus que par ressentiment ou par médisance. Leur individualisme bourgeois les incline à se jalouser et se haïr entre eux avec une prévisibilité qui serait comique si elle n'était si fastidieuse. En moins de temps qu'il ne m'en fallut pour écrire quelques essais, ils se sont repliés dans les prérogatives jalouses de la médiocrité, au point de ne plus valoir, ni être, à leurs propres yeux que par leur pouvoir d'achat. Ne croyant plus en l'être, en l'ensoleillement intérieur de l'être, ils ne sont plus que ce qu'ils achètent. Pour eux, l'habit est le moine. Tous leurs efforts, parfois considérables, consisteront à acquérir les signes extérieurs de richesse qui rédimeront leur pauvreté intérieure. Ces adversaires bourgeois de l'autorité spirituelle subiront le dictat de la mode, de la voiture et du gadget avec une docilité qui n'aura d'égale que leur vanité à se dire égaux entre eux, tout en cherchant ridiculement à se surpasser par l'avoir. Leur antipathie pour l'autorité, leur prétention à s'en être affranchi est exactement proportionnelle à leur servitude effective. Ils adopteront sans même s'en apercevoir, et par un réflexe pour ainsi dire pavlovien, le fanatisme en vigueur dans leur contrée et dans leur temps, tout en continuant à se dire héritiers des « Lumières » !
On oublie trop que les Encyclopédistes, dont se réclame abusivement une bourgeoisie défaite et puritaine, furent des hommes de l'Ancien Régime. Formé par l'enseignement catholique et le style aristocratique, sans doute eussent-ils considéré avec un certain déplaisir leurs lointains émules ignares, bornés et vulgaires, - bourgeois, au sens flaubertien. L'enténèbrement de ces dernières décennies aura au moins l'avantage de nous rendre plus proches des clartés anciennes. Lorsque les barbares déferlent, nous comprenons mieux la parenté essentielle des civilisations; à travers la diversité des styles, nous reconnaissons l'unité du principe. Nous comprenons alors que nos querelles étaient superficielles. Face au néant dévorant du monde moderne: « Voltaire et Maistre, même combat ! ». L'occasion nous serait ainsi donnée de corriger à notre usage actuel Maistre par Voltaire et Voltaire par Maistre. D'autres inscriptions au pochoir me tentent, tels que « René Guénon, Cézanne même combat ! » ou encore, pour les happy few: « Nabokov, Proclus même combat ! ». La résistance métaphysique contre le monde moderne se fera non par opposition frontale mais selon la logique des guérillas. Il en fut question déjà en 1978, dans la revue Cée. Les squadristes eckhartiens et nietzschéens viendront à brûle-pourpoint au renfort des sections spéciales John Coltrane, elles-même inspirées par les méditations héraldiques ourdies dans nos jüngériens ermitages aux buissons blancs.
Journal Mai 2014 (extrait)
Derniers livres parus:
Le Déchiffrement du monde, la gnose poétique d'Ernst Jünger, éditions de L'Harmattan, collection Théôria, 2017
L'Ame secrète de l'Europe, Oeuvres, mythologies, cités emblématiques, éditions de l'Harmattan, collection Théôria, 2020.
22:03 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
12/02/2022
Fernando Pessoa, un cartulaire héraldique:

Luc-Olivier d’Algange
Un cartulaire héraldique
A André Coyné
L'idée d'Empire domine l'œuvre diverse de Fernando Pessoa. Le désir d'embrasser la multiplicité, de ressaisir les innombrables aspects de l'âme, d'être, enfin soi-même, le masque de toute vie et de toute chose, de s'en approprier l'essence par les communions et les ruses du personnage,- tout cela témoigne d'un dessein littéraire qui commence avant la page écrite et s'achève après elle, en des oeuvres vives, ardentes et impressenties, que l'on peut dire philosophales. De l'Alchimie et, d'une manière plus générale, de la tradition hermétique et néoplatonicienne occultée par le triomphe des théories matérialistes, les poètes demeurent, en Europe, les ultimes ambassadeurs. L'œuvre de Pessoa ne fait pas exception à cette règle méconnue qui associe la grandeur poétique, l'audace visionnaire et la fidélité à la plus lointaine tradition.
Alors que la science profane travaille par déductions sur le mécanisme et les quantités du monde sensible, la science hermétique œuvre, par l'analogie, au sacrement des qualités et des essences. L'une s'interroge sur le comment, l'autre donne réponse au pourquoi. La différence est capitale, et ce n'est pas le hasard si tant de poètes modernes, enclins à la spéculation, retrouvèrent, dans la tradition hermétique, les grandes lignes de leur dessein poétique.
« Avec l'aide et l'assistance de Dieu, écrivit Pic de la Mirandole, l'Alchimie met en lumière toutes les énergies cachées de par le vaste monde. Comme le vigneron greffe le cep sur l'orme et sur l'espalier, le mage, l'Alchimiste sait unir et pour ainsi dire marier terre et ciel, énergies inférieures et énergies supérieures ». Cette coïncidence des contraires, qui dépasse également l'opposition philosophique du réalisme et du nominalisme, il est facile de comprendre en quoi elle séduisit Fernando Pessoa. La hiérogamie cosmique, le dépassement du dualisme en des noces miroitantes, impériales, apparente ici la nostalgie de la conquête et le pressentiment des retrouvailles, la poésie et l'Empire. Par le Grand-Oeuvre solaire, le regret de l'Age d'Or devient l'annonce du Retour, l'adepte se substituant au temps, et disposant du pouvoir de transfigurer la nature :« L'eau céleste et indestructible, écrit Bernard Gorceix, le feu intangible de l'empyrée, se trouvent finalement unis, par le ciel cristallin, par la sphère des astres, par la flore, la faune, par les pierres et les mines, à l'eau corporelle, lentement distillée et volatilisée, pour l'édification de ces cieux nouveaux et de cette terre nouvelle dont rêve l'Alchimiste. » Il ne s'agit donc pas seulement de repérer dans les poèmes de Pessoa des images alchimiques mais bien de montrer que le principe de l'œuvre, en ses ramifications hétéronymiques, s'identifie à la genèse et à l'accomplissement d'un secret d'or impérial, « identique à l'or de la nature, non seulement comme effet mais aussi comme cause ».
« De même, écrit Pessoa, que l'intelligence dialectique, que l'on nomme raison, régente et ordonne tous les éléments de la connaissance scientifique, de même, l'intelligence analogique, qui n'a aucun nom particulier, régente et ordonne tous les éléments de la connaissance ésotérique. La perfection de l'œuvre matérielle est un tout parfaitement constitué, dans lequel chaque partie a sa place et concourt selon son mode et son grade à la formation de ce tout; la perfection de l'œuvre spirituelle est l'exacte correspondance entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'âme et le corps. » Le Grand-Œuvre consiste alors à trouver, dans le temps, par la science analogique des astres et de la lumière, l'angle prophétique s'ouvrant sur l'au-delà du temps, qui est le cœur du temps, tel l'instant, île de cristal se tenant immobile dans la déroute universelle, sous la voûte ordonnatrice du ciel, graal-miroir.
Ainsi, par fidélité au dieu dorique de la lumière, l'alchimiste défie le règne de Kronos, afin de vaincre la durée profane et l'histoire elle-même, par le sens semblable à une lance de feu qui l'interrompt et la transcende pour la très-grande gloire de l'Esprit dont il est dit dans L'Apocalypse d'Hermès (traité anonyme du dix-septième siècle) : « Il vole vers le ciel par le monde intermédiaire. Nuage qui monte vers l'aurore, il introduit dans l'eau son feu qui brûle, dans le ciel il a sa terre clarifiée. »
Sans doute sommes nous fondés à voir dans l'intelligence analogique qui, précise Pessoa, « n'a aucun nom particulier » une exigence de la poésie en tant que moyen de connaissance et imagination créatrice, pour reprendre l'expression rendue célèbre par les magistrales études de Henry Corbin sur Ibn'Arabi, Sohravardî ou Ruzbehân de Shîraz. L'imagination créatrice, on le sait, est cet espace médiateur entre le sensible et l'intelligible, entre la multiple splendeur du monde sensible et l'unificente clarté des Idées, où s'inscrivent les signes, les symboles, les silhouettes ou les icônes de la sagesse divine. Car l'Idée est avant tout une chose vue dans le matin profond et les promesses de l'intelligence « qui n'a encore aucun nom particulier »; elle advient comme un scintillement sur la surface des eaux, comme une vision que l'on reconnaît, l'expérience visionnaire n'étant rien d'autre que le moment de la plus haute intensité, dans l'épopée de la réminiscence.
A l'exemple des poète-philosophes néoplatoniciens, tels que Jamblique ou l'Empereur Julien, Fernando Pessoa ne juge pas exclusives l'une de l'autre la réflexion philosophique et l'expérience visionnaire. Tout au contraire, il entreprend d'éclairer l'une par l'autre afin de retrouver, en amont, l'expérience originelle de la pensée, l'ingénuité primitive de l'accord parfait, d'une sagesse qui, dans sa plénitude, renonce à s'affirmer pour telle : « Lorsque viendra le Printemps, écrit Alberto Caiero, si je suis déjà mort, les fleurs fleuriront de la même façon, et les arbres ne seront pas moins verts qu'au Printemps passé. »
De l'arbre généalogique des hétéronymes de Fernando Pessoa, Alberto Caiero serait en quelque sorte le tronc. De lui se réclament l'érudit et subtil Ricardo Reis et le sauvage et futuriste Alvaro de Campos. D'Alberto Caeiro à Alvaro de Campos, la distance est la même que celle qui sépare Héraclite et Proclus, le présocratique et le néoplatonicien,- le « découvreur de la nature » et le chantre de la violence « ultimiste », gnostique païen aspirant sans doute à la même « innocence des sens », pour reprendre l'expression de Nietzsche, mais devant, pour l'atteindre, passer par toutes les outrances de la révolte, de l'imprécation et de l'apostasie. En ce sens Alvaro de Campos est plus proche de nous. Son inquiétude et son tumulte sont davantage à notre ressemblance que la sérénité de Caiero, infiniment désirée mais perdue comme sont perdus pour nous, « affreusement perdus », l'Age d'Or dont parlait Hésiode et la silencieuse enfance, et l'Empire, cet idéal androgyne.
L'Idée d'Empire, en ouvrant une troisième voie entre l'isolement égotiste et le nivellement collectif, ressuscite aussi une certaine forme d'espoir « métapolitique ». Diversité ordonnée, hiérarchie au sens étymologique du terme, fondant le principe de l'Autorité sur le sacré et non plus sur le pouvoir temporel, l'Empire dont rêve Pessoa est à la ressemblance du beau cosmos miroitant, de cette « terre clarifiée ». Obscurcie par ses parodies successives, l'Idée d'Empire est devenue aujourd'hui presque incompréhensible. « Tout Empire qui n'est pas fondé sur un impérialisme spirituel est un cadavre régnant, une mort sur un trône » écrit Fernando Pessoa. Il importe ici de retrouver le sens du discernement et ne plus confondre totalité et totalitarisme, unité et uniformité, autorité et pouvoir, gloire et réussite, métaphysique et idéologie, intransigeance et fanatisme, principes et valeurs.
Alors que les valeurs et les idéologies concernent, selon la formule de Raymond Abellio « l'espèce humaine en tant qu'espèce, dans son ensemble ou ses sous-ensembles », les principes concernent l'être humain dans sa solitude et dans sa communion. Les valeurs relèvent d'une appartenance grégaire et utilitaire. Les principes obéissent à l'unique souveraineté de l'Esprit et témoignent d'une vocation héroïque, ascétique ou contemplative : « En créant notre propre civilisation spirituelle, écrit Pessoa, nous subjuguerons tous les peuples; car il n'y a pas de résistance possible contre les forces de l'Esprit et des arts, surtout lorsqu'ils sont organisés, fortifiés par des âmes de généraux de l'Esprit. »
Comment définir exactement cet impérialisme ? Pessoa propose la formule: « Un impérialisme de poètes ». En effet, écrit-il, « l'impérialisme des poètes dure et domine; celui des politiciens passe et s'oublie s'il n'est rappelé par le chant des poètes. » L'avenir du Portugal, et, par voie de conséquence, de l'Europe, sortie enfin de la pénombre de son activisme somnambulique, est déjà écrit pour qui sait lire dans les strophes de Bandarra. Cet avenir, explique Pessoa, c'est d'être tout: « Ne tolérons pas qu'un seul dieu reste à l'extérieur de nous-mêmes. Absorbons tous les dieux ! Nous avons déjà conquis la Mer; il ne nous reste qu'à conquérir le Ciel en laissant la Terre aux autres... Etre tout, de toutes les manières, parce que la vérité ne peut exister dans la carence. Créons ainsi le Paganisme Supérieur, le Polythéïsme Suprême ! »
La rimbaldienne « alchimie du Verbe » la quête de « l'étincelle d'or de la lumière nature » s'anime ainsi d'une impérieuse exigence d'étendre le domaine du sens. Vasco de Gamma des mers et des cieux intérieur, Pessoa ne cherche point à se perdre dans les abysses de l'indéterminé ou de l'absurde, mais de conquérir. En son dessein cosmogonique et impérial, il suit l'orientation du Soleil-Logos. De même que Sohravardî voulut réactualiser la sagesse zoroastrienne de l'ancienne Perse tout en demeurant fidèle à la plus subtile herméneutique abrahamique, Pessoa nous promet le retour de Dom Sébastien, un matin de brouillard, précédant le triomphe du Cinquième Empire : « Par matin, précise Pessoa, il faut entendre le commencement de quelque chose de nouveau,- époque, phase ou quelque chose de similaire. Par brouillard, il faut entendre que le Désiré reviendra caché et que personne ne s'apercevra de son arrivée et de sa présence. »
Le retour au « paganisme » que suggérait Alvaro de Campos pour en finir avec le matérialisme « qui exprime une sensibilité étroite, une conception esthétique réduite, puisqu'il ne vit pas la vie des choses sur le plan supérieur » n'est en rien un refus de la transcendance mais un appel aux vastes polyphonies de l'Ame du monde, écharpe d'Iris et messagère des dieux : « Inventons, écrit Pessoa, un Impérialisme Androgyne réunissant qualités masculines et féminines; un impérialisme nourri de toutes les subtilités féminines et de toutes les forces de structuration masculines. Réalisons Apollon spirituellement. Non pas une fusion du christianisme et du paganisme, mais une évasion du christianisme, une simple et stricte transcendantalisation du paganisme, une reconstruction transcendantale de l'esprit païen."
« Une reconstruction transcendantale de l'esprit païen ». La formule qui n'est paradoxale qu'en apparence mérite d'être méditée. Elle nous reporte directement à cette période faste du néoplatonisme païen qui, de Plotin à Damascius, œuvre comme l'écrit Antoine Faivre « à poser une procession intégrale, une transcendance intransigeante, alliée à une immanence mystique ». Et cela tout en opérant la convergence des Arts sacrés et des religions du Mystère. Il ne s'agit donc nullement ici d'une régression vers une religiosité naturaliste, ou panthéïste, mais, tout au contraire, de l'édification, selon les hiérarchies platoniciennes d'une véritable métaphysique établissant clairement la distinction entre la nature et la Surnature. Mais là encore distinction ne signifie point séparation. La dualitude est nuptiale; et si le soleil que l'on célèbre n'est point le soleil physique mais, à travers lui le soleil métaphysique du sens, du Logos, alors l'ascendance matutinale de l'astre est l'image de l'exhaussement de la conscience humaine hors de sa gangue naturelle, son élévation glorieuse, impériale. Le projet de reconstruction de Fernando Pessoa s'éclaire ainsi des subtiles couleurs du monde antérieur.
Messages, cartulaire héraldique du drapeau portugais, égrène, pour reprendre l'expression de Armand Guibert « un rosaire où s'enchaînent les grains du Merveilleux: le roi Jean Premier, fondateur de la dynastie des Aviz y est adoubé Maître du Temple; Dona Filipa de Lancastre, son épouse, saluée Princesse du Saint-Graal; apostrophant le Saint-Connétable Nun'Alvarès, le poète évoque Excalibur, épée à l'onction sainte, que le roi Arthur te donna. » L'anamnésis, le ressouvenir de la Parole Délaissée est la seule promesse.
Dernier ouvrage paru: L'Ame secrète de l'Europe, éditions de L'Harmattan, collection Théôria.
22:32 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
05/02/2022
La théocosmogonie de Malcolm de Chazal :

Luc-Olivier d'Algange
La théocosmogonie de Malcolm de Chazal
Certains livres ne sont pas seulement des œuvres, et moins encore des travaux littéraires, mais des événements de l’Ame. La date où ils apparaissent, la révélation dont ils émanent, appartient, plus encore qu’à l’histoire où ils s’inscrivent, à une hiéro-histoire, qui, dans un renversement de clartés, devient visible dans la nuit même qui nous gouverne.
Ce livre de Malcolm de Chazal, Aggenèse, - paru aux éditions Arma Artis, - est une entrée dans la nuit, dans ce « noir invisible » où gisent les couleurs secrètes du monde. « Et je continuais, écrit Malcolm de Chazal, presque moribond de désincarnation la Route du Noir dans le paysage ensoleillé des Salines parmi les cocotiers, les acacias, dans l’herbe tremblante de lumière… ». L’entrée dans la nuit n’est pas un consentement aux ténèbres, ni la seule considération de l’ombre, mais éveil de la pensée antérieure, de la mémoire profonde. La théocosmogonie, qu’illustre l’œuvre de Malcolm de Chazal, est amoureuse tout autant que métaphysique ; sa dualitude est embrassement et embrasement. Dieu, dans cette cosmogonie, est « NOON et ALLA » dans leurs « étreintes ». L’espace et le temps sont inspir et expir. La corolle du jour éclose dans la nuit est « bouquet de flamboiements ».
Après la pensée mythique de Pétrusmok et le flot de correspondances et d’analogie de Sens Plastique et de La Vie Filtrée, Malcolm de Chazal entre ici dans la vastitude et la profondeur de la nuit divine. Voir et penser le monde à partir de la nuit divine, en amont de toutes les représentations que nous nous faisons collectivement et individuellement de nous-mêmes, par-delà les idéologies, les religions exotériques, les sciences, c’est laisser venir à nous, à travers nous, une puissance, un Verbe antérieur : « Ce Verbe est infini tant que le poète s’effacera suffisamment pour être uniquement l’objet qu’il traduit et dépouillera son moi au point de devenir la chose qu’il dit ».
Cette impersonnalité active est libération au sens le plus haut ; non pas cette illusion de l’individu irrélié, mais liberté conquise sur le grief, l’utilitarisme, le ressentiment qui président à l’utilisation technique du monde,- cette vengeance de ceux qui ne savent pas le contempler. Le « Vaste » de la théocosmogonie de Malcolm de Chazal, ces latitudes et ces longitudes reconquises, cette attention au plus lointain à l’intérieur du plus immédiat, cette plongée dans la nuit invisible à partir de laquelle le monde immanent scintille et s’irise, - telle est l’aventure, non pas décrite mais récitée, chantée, en poèmes, aperçus et litanies dans cette Aggenèse qui échappe à tous les genres littéraire car elle les précède, non comme un objet mais comme un visage qui nous regarde : « Ce qui fait la couleur / C’est la pensée / Pensée de franciscea / Pensée de l’œillet / Pensée de la rose et du lys / Sur le visage, c’est l’expression. »
Dans le monde de Malcolm de Chazal, les pierres parlent des civilisations englouties pour en dire les mystères et les fraîcheurs, et les fleurs nous regardent. Le temps n’est plus à faire des expériences avec les êtres et les choses mais d’entrer en relation avec eux, comme la couleur entre en relation avec la nuit, comme la musique entre en relation avec le silence. Rien n’est plus versicolore que ce grand traité d’entrée dans l’invisible et dans la nuit, là où attendent les ensoleillements de l’être : « La lumière vint / Du ventre du Noir ». Lumière génésique, confondue à la pensée qui la cherche, aurora consurgens de la conscience.
La pensée nocturne et la clarté révélée sont d’une même source. Un même éros cosmogonique présage à leurs accomplissements : « A deux corps pour une même extase / A deux cœurs pour un même amour / A deux extases pour un même Dieu. » La dualitude révèle par intégration de l’Un et dans l’Un le mystère d’une trinité non plus abstraite ou simplement dogmatique mais incarnée dans « l’Homme-Lumière ». La terre est céleste et le ciel est un jardin qui tourne et se renverse : « Tu es la source / De tout ce qui est / De tout ce qui se vit / Se goûte / Se pense / Ou se caresse. »
L’œuvre de Malcolm de Chazal nous offre à ce rappel, à ce ressouvenir. La vie ne vaut d’être vécue que si elle est un cheminement vers le Miracle, - qui veille telle une lumière incréée au fond de la pupille : « Et ma fleur est pleine / De pupilles/ C’est tout l’invisible en elle / Le Noir la pénètre / La lumière inversée. »
Cette allée ouverte par les mots, par l’écriture immanente-transcendante de Malcolm de Chazal, est, au sens premier, une théorie du Graal : cette coupe qui, renversée, est le ciel même qui nous protège de sa nuit et favorise l’éclosion, la renaissance immortalisante de la fleur symbole du regard, de la pensée éclose, et, si l’on ose dire, symbole d’elle-même dans son advenue voyante : « Et voici ce moment du temps / Incarcéré dans une couleur / Voici l’espace de voir / Intégré à une forme / Deux images : visible et invisible / Et c’est la fleur. »
L’exercice spirituel, pour Malcolm de Chazal, n’est pas austère, quand bien même il provient d’une exigence radicale, car ce qu’il déploie, par la double lumière de l’Un, n’est autre que l’arc-en-ciel : « Signe de matière / Aux côtés nuital et de Jour / NOON et ALLA : La double lumière en Un / Que lie le jaune incandescent. »
Nous ne pensons pas encore ; nous ne parlons pas encore. Une puissance est retenue, détenue dans l’archéon, au plus lointain, dans la nuit antérieure. Pour advenir à la pensée, la pensée doit nous advenir dans l’oubli de ce que nous croyons être, de nos évaluations, de nos estimations, de nos calculs, de nos planifications, de nos « savoirs » qui se sont détournés de la sapience. Or pour atteindre ce point où la pensée et la parole naissent l’une de l’autre, en présence réelle, il faut entrer dans le Verbe qui est à la fois proche et lointain, hors d’atteinte et substantiel : « Verbe tu es lié à la substance : Comme l’ombre à la lumière… / Voici le grand secret : l’indivisibilité du moi et des choses / Une même pâte / Une même vie. »
Le secret de l’archéon le plus lointain, perdu, comme la « Parole Perdue » des Alchimistes dans l’Atalante Fugitive de la nuit des temps, est aussi au plus près dans la substance même, et dans « l’herbe tremblante de lumière ». Le Là-bas est l’Ici-même, le visible et l’invisible tournoient et fleurissent dans le Verbe nocturne : « Car le monde Là-Bas / Est Renversement pensée-image / De ce monde ci / Comme Renversement / De lumière / Retournement du Visible et de l’Invisible. »
Nous comprenons alors, lisant Malcolm de Chazal, que c’est l’invisible qui, advenant à l’envers du visible en révèle l’avers en resplendissements sensibles. L’Homme-Lumière qu’évoque Malcolm de Chazal, a pour vocation de révéler, par son cheminement entre l’archéon et l’eschaton le ressac de la mémoire vive. Ce Là-bas qui, torrentueusement, revient dans l’Ici-même, dans la prophétie de l’Ici-même : « Là-bas l’homme sera Toute Mémoire / Et imaginer sera faire sa vie. » Le ressouvenir est imagination créatrice : « La Mémoire sera le rappel de l’Eden… / L’Image Originelle reviendra / Peu à peu en nous / Et embellira le monde projeté. »
L’Aggenèse de Malcolm de Chazal est ainsi, à la suite de la Divine Comédie de Dante, une méditation sur la Paradis. Comment sortir de l’enfer du ressentiment et du purgatoire de la représentation ? A quel appel répondrons-nous ? C’est aux signes infimes comme les herbes tremblantes de nous le dire, afin de réinventer, au-delà de l’agonie du Dédire quotidien, le Dit qui parle vif au secret du cœur : « O Toi qui agonise, le Paradis t’attend ».
Malcolm de Chazal, Aggenèse, tome I, Editions Arma Artis 2014.
22:46 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
03/02/2022
Relisons Donoso Cortès, version francaise et version traduite en espagnol:

Luc-Olivier d’Algange
Relisons Donoso Cortès
« Ce qu’ont d’extraordinaire et de monstrueux toutes les erreurs sociales, dérive de ce qu’ont d’extraordinaire les erreurs religieuses qui les expliquent et desquelles elles procèdent. »
Donoso Cortès
« Le renversement des rapports normaux entre les principes et leurs applications, ou même parfois, dans les cas les plus extrêmes ; la négation pure et simple de tout principe transcendant ; c’est dans tous les cas la substitution de la physique à la métaphysique, en entendant ces mots dans leur sens rigoureusement étymologique, ou, en d’autres termes, ce qu’on peut appeler le naturalisme… »
René Guénon
Pour Donoso Cortès, il n’est point d’erreur politique qui ne soit d’abord une erreur religieuse et métaphysique. Ce qui nous livre à l’errance, ce qui nous éloigne de nous-mêmes, ce qui nous invite au reniement, au désastre, à la calomnie, au mensonge, à la déroute et à la bêtise, est toujours ce qui nous éloigne de Dieu, c’est à dire du silence.
Ce silence est quelque peu mystérieux. Il est ce dont procède la parole, cette fine pointe où la parole se délivre du bavardage ; espace infini où la parole retourne à l’oubli. Il est aussi vain de s’insurger contre le langage humain que de croire en son omnipotence. « La première façon de sortir du mensonge, écrit Philippe Barthelet, et la plus offensive – car il s’agit bien d’une guerre intérieure, d’une guerre sainte qu’il nous faut livrer -, est de faire silence. L’ordre grammatical est ici le reflet inversé de l’ordre ontologique, car c’est véritablement le silence qui nous fait ; et c’est le silence qui nous fait parler, véritablement, selon la vérité, et toute parole vraie est à la lettre superflue, elle coule du dehors, déborde, elle n’est là que pour confirmer ».
La Lettre au Cardinal Fornari réfute cette première et fatale erreur moderne qui consiste à penser que la Religion, la politique et la philosophie sont des domaines séparés, autonomes, qui vagueraient en d’impondérables mondes à leurs occupations respectives aussi étanches les unes aux autres que des spécialités universitaires, avec leurs jargons, leurs fins particulières et insolites. Pour Donoso Cortès, non seulement la Religion n’est pas absente de la politique ou de la philosophie mais celles-ci sont toujours religieuses, l’ordre grammatical s’ordonnant à l’ordre ontologique, même et surtout lorsqu’elles s’évertuent à nier ou à défaire la Religion.
Les aperçus de Donoso Cortès sont de ceux, fort rares, qui gagnent en pertinence à mesure que le temps nous éloigne de leur formulation. Mieux qu’en 1848, par exemple, date de son Discours sur la dictature, nous pouvons vérifier et approfondir sa pensée et prendre la mesure de la titanesque erreur religieuse qu’est le matérialisme, cette adoration de la physis, dont sont issus la démocratie, en tant que dictature du nombre, et les diverses formes de totalitarisme, en tant qu’accomplissements de la « promesse » démocratique dans l’utopie d’une socialisation extrême, fusionnelle, des rapports humains, où la raison ni les principes ne tiennent plus aucune place. « On pourrait constater, d’une façon très générale, écrivait René Guénon, que l’apparition de doctrines naturalistes ou antimétaphysiques se produit lorsque l’élément qui représente le pouvoir temporel prend, dans une civilisation, la prédominance sur celui qui représente l’autorité spirituelle »
« Désormais, plus aucun Allemand ne sera seul », cette phrase prononcée par Hitler à sa prise de pouvoir par les urnes semblait à Henry de Montherlant la plus effrayante qui soit sous l’apparence d’un bon-sentiment anodin. Phrase terrible, en effet, laissant transparaître la volonté d’établir un monde d’où la solitude, la contemplation, la distance, et le silence, et les profondes raisons d’être du silence, seraient bannis au nom de la « volonté commune », d’une adoration panthéiste de la nature. Or, que nous dit Donoso Cortès dans sa Lettre au Cardinal Fornari ? « La raison est aristocratique alors que la volonté est démocratique ». Le totalitarisme est l’accomplissement, la réalisation de cette erreur religieuse que constitue la démocratie, en tant que socialisation extrême, outrancière, des rapports humains. Le culte de la matière et la haine de la forme, l’adoration de la fusion immanente et la détestation de la distinction, le sacre de la volonté et la l’excommunication de la raison, en tant qu’instrument de connaissance métaphysique : telles sont les conséquences de cette erreur religieuse qui voudrait se faire passer pour une vérité anticléricale, - mais à cet aval désastreux et inhumain correspond un amont dont il n’est pas inutile de tenter l’analyse en usant de la méthode même de Donoso Cortès.
En effet, la « matière » telle que la conçoivent les matérialistes, n’existe pas. Elle est cette abstraction « ourouborique », totale, dont le communisme fera sa mystique. Pour le matérialiste, qu’il soit controuvé ou naïf, « tout est matière ». C’est dire que pour lui la matière est l’autre nom du « tout ». Il n’est rien en dehors d’elle et tout ce qui procède d’elle, le langage, la forme, est encore englobé par elle, ou dévoré, comme la filiation de Chronos. Ce « partout » qui n’est nulle part n’est donc pas une invention nouvelle : c’est le panthéisme : « Pour ce qui est du communisme, écrit Donoso Cortès, il me semble évident qu’il procède des hérésies panthéistes et de l’ensemble de celles qui leur sont apparentées. Quand tout est Dieu et que Dieu est tout, Dieu est, d’abord, démocratie et multitude ; les individus, atomes divins et rien de plus, sortent du tout, qui perpétuellement les engendre, pour retourner au tout, qui perpétuellement les absorbe. Dans ce système, ce qui n’est pas le tout n’est pas Dieu, même s’il participe de la divinité ; et ce qui n’est pas Dieu n’est rien, car il n’y a rien en dehors de Dieu, qui est tout. »
L’analyse de Donoso Cortès, loin de valoir seulement pour les sociétés étatiques, d’inspiration marxiste, vaut également pour toutes les sociétés à dominante matérialiste, aussi libérales ou « libertariennes » qu’elles se veuillent. Le mot « matérialisme » lui-même, car les mots, sinon l’usage que l’on en fait, sont innocents et ne mentent pas, divulgue sa nature religieuse ; c’est bien le culte de la « Magna Mater », l’immanence déifiée et devenue abstraction. Car la « matière » du matérialiste, et c’est là où se précise, en amont, l’erreur religieuse, n’est jamais présente. De ce moment où j’écris ces lignes, la « matière », telle que la conçoit le matérialiste, est absente. Certes, je vois la table sur laquelle est posée la feuille de papier, j’aperçois par la fenêtre l’arbre dépouillé de ses feuillages dans la paysage hivernal, je vois et je perçois un nombre infini de choses que je nomme et que je reconnais par leur forme et leur usage, mais la « matière » je ne la vois ni ne la perçois pour la simple raison que la matière est abstraite dans ce « partout » qui n’est « nulle part », alors que la forme est concrète.
La matière du matérialiste est ce « tout » devant quoi les hommes doivent se taire et obéir, en croyant se glorifier, alors que les formes sont ce qui nous parle par les noms que nous lui donnons, par l’usage que nous en faisons, par cet entretien infini entre ce qui est en nous et en dehors de nous dont elles sont le principe. La « matière » qui veut être « tout », la « matière » qui n’est point une voix dans un concert de voix de l’âme et de l’Esprit, n’est rien ; et ce « rien » est d’autant plus despotique qu’il n’a pour raison d’être que la négation de la raison et de l’être. Rien de bien surprenant alors, et les craintes de Donoso Cortès se trouvent justifiées par-delà tous les cauchemars, à ce que le matérialisme eût agrandi, jusqu’au vertige, les minimes failles des erreurs religieuses antérieures, au point de laisser les hommes seuls face au néant d’une idolâtrie jalouse.
On se souvient des premières phrases de l’admirable essai de Mighel de Unamuno, Le Sentiment tragique de la vie : « Homo sum ; nihil humanum a me alienum puto, dit le comique latin. Et moi je dirai mieux : nullum hominem a me alienum puto. Car l’adjectif humanus m’est aussi suspect que le substantif abstrait humanitas, l’humanité. Ni l’humain, ni l’humanité ; ni l’adjectif simple ni le substantif abstrait, mais le substantif concret : l’homme. L’homme en chair et en os, celui qui naît, souffre et meurt – surtout meurt - celui qui mange, boit, joue, dort, pense, aime ; l’homme qu’on voit et qu’on entend, le frère, le vrai frère » . De même, le propre de la « matière » du matérialiste, ce « rien » arrogant qui prétend à être « tout », cette abstraction vengeresse, comme toutes les abstractions, sera de nous ôter à la nature éternelle des formes, de nous précipiter dans un monde sans hiérarchie, sans distinctions, sans ferveur et sans pardon, un monde irréel, porté seulement par le frêle esquif de la « morale autonome », sur une houle chaotique et désespérante, antérieure au Verbe.
Définir le matérialisme comme un « progrès » par rapport à la Théologie médiévale, donne au mot « progrès » un sens particulier, dont Jean Cocteau eut l’intuition lorsqu’il écrivit que « le progrès n’est peut-être que le progrès d’une erreur ». Les Modernes répètent volontiers la formule « l’erreur est humaine » en oubliant son pendant « mais la persévérance dans l’erreur est diabolique ». Or, si le « progrès » est bien le progrès d’une erreur, on ne saurait nier sa persévérance. Le progrès serait ainsi une persévérante erreur. Il peut être difficile d’en remonter le cours, mais point impossible, en s’en tenant à l’enseignement de quelques bons maîtres (tels Joseph de Maistre, Donoso Cortès ou René Guénon) ; enseignement qui débute par l’exercice aristocratique et métaphysique de la raison et la résistance à la volonté. :« Avec le catholicisme, écrit Donoso Cortès dans une lettre au directeur de l’Heraldo, datée du 15 Avril 1852, il n’est pas de phénomène qui n’entre dans l’ordre hiérarchique des phénomènes, ni de chose. La raison cesse d’être le rationalisme, soit un fanal qui bien que n’étant pas incréé éclaire sans que personne l’ait allumé, pour être la raison, c’est-à-dire un merveilleux luminaire concentrant en lui et projetant au-dehors la lumière éclatante du dogme, pur reflet de Dieu, qui est lumière éternelle et incréée. »
C’est en ravivant la raison contre le rationalisme, c’est-à-dire en oeuvrant à la recouvrance de la logique contre l’opinion, qu’une chance nous sera offerte de vivre notre destin non plus comme « le chien mort au fil de l’eau » dont parle Léon Bloy mais comme des hommes libres qui suscitent des formes précises dont l’ordonnance définit l’espace de la pensée,- et de cette forme supérieure de pensée qu’est la contemplation.
Donoso Cortès nous donne ainsi à comprendre que ce n’est point à la politique de réformer la métaphysique (tentation prométhéenne qui n’est point dépourvue de panache mais qui méconnaît la relation d’effet et de cause, et la flèche du temps, - la conséquence ne pouvant agir sur la cause) mais à la métaphysique d’opérer à une « refondation » et, pour ainsi dire, à une justification du politique. De même qu’il n’y a pas de morale autonome, l’hétéronomie étant la condition de toute morale qui n’est pas seulement le constat d’un état de fait, il ne saurait y avoir de politique digne de ce nom qui ne soit légitimée par une exigence supérieure à la fois à celle du bien commun et à celle du « bien individuel ». Le « commun » ni l’ « individuel », ni leur compromis, ne suffisent : ce ne sont que des retraits, voire des retraites, comme on le dirait d’une armée vaincue, devant la vérité plus exigeante que ne le veulent la « nature » ou la « matière ».
Ernst Jünger distingue, à juste titre, « Einzelne » et « individuum », autrement dit, l’individu en tant qu’unique et l’individu en tant qu’unité interchangeable. « Einzelne » renvoie à l’individu caractérisé, qui se différencie des autres par le faisceau de ses traditions, de ses appartenances, de ses souvenirs, de ses audaces et de sa liberté conquise, alors qu’individuum se rapporte à ce qui est équivalent, égal, dépourvu de toute réalité traditionnelle. « Einzelne » est l’Unique, mais cet unique porte en lui une multiplicité de possibles alors que l’individuum est seul mais à l’intérieur d’une multiplicité de « semblables » étrangers les uns aux autres. Le « Einzelne » appartient au règne de la forme, qui suppose une relation avec d’autres formes, alors que l’individuum appartient au règne de la matière, aussi abstrait et absent de la réalité humaine que la matière est abstraite et absente du monde. Le « Einzelne » croit à ses devoirs autant que l’individuum à des droits.
Donoso Cortès, de même , renvoie dos à dos, comme le feront après lui Jünger ou Bernanos, un libéralisme qui ne se fonderait que sur les individus déracinés, indifférenciés, égaux en droits mais rivaux en affaires, et le communisme ; l’un et l’autre lui apparaissant comme un renoncement à la souveraineté, une subjugation à cette erreur religieuse panthéiste, à cette manie de la socialisation extrême des rapports humains qui interdit tout cheminement intérieur, voire, à plus ou moins long terme, tout usage de la raison et de la parole ( il suffit hélas, pour s’en convaincre, d’écouter parler nos jeunes gens, nos journalistes, voire nos « intellectuels ») : « Pour ce qui est du parlementarisme, du libéralisme et du rationalisme, écrit Donoso Cortès, je crois du premier qu’il est la négation du gouvernement, du deuxième qu’il est la négation de la liberté, et du troisième qu’il est l’affirmation de la folie. »
Le droit pour Donoso Cortès ne saurait être que divin. Que le droit soit divin, c’est là une idée qui semblera d’emblée révoltante au Moderne alors même qu’il consent à toutes les usurpations, à tous les bricolages juridiques, à toutes les instrumentalisations du droit sous condition qu’ils fussent « humains ». Les plus lucides ou les plus cyniques, reconnaissent dans le droit la consécration d’un rapport de force, la légitimation d’une volonté, sans voir que cette prétendue « délivrance du droit divin » n’est autre qu’une soumission religieuse à la force, une sacralisation de la volonté commune dont le propre est de tout subir et de ne pouvoir agir sur rien. Ce qui distingue le droit divin du droit humain, n’est autre que la pérennité et l’universalité. Pour que les hommes ne soient pas livrés aux aléas de leurs goûts et de leurs dégoûts, de leurs humeurs, de leurs obsessions changeantes, il leur faut reconnaître une Loi et un Droit fondé sur la raison, et non sur le rationalisme, sur la bonté et la miséricorde et non sur les « bons sentiments ». Rien, en dernière analyse ne s’oppose véritablement au droit divin, à cette exigence qui tend vers l’universel sans pourtant jamais prétendre le détenir dans l’immanence, que le relativisme qui autorise tout et n’importe quoi.
Les hommes, avant que ne s’instaure le politiquement correct, avaient un nom pour ce relativisme, ils le nommaient barbarie. Appellation pertinente rappelant que la barbarie est bredouillement, atteinte portée au vocable et à la grammaire, déficience agressive du langage, accusation permanente, vacarme et confusion. A l’inverse, le droit divin est ce pur silence où se recueillent la Clémence et le Pardon.
•
VOLVAMOS A LEER A DONOSO CORTÉS
“Lo estupendo y monstruoso de todos estos errores sociales proviene de lo estupendo de los errores religiosos en que tienen su explicación y su origen”.
Donoso Cortés - Carta al cardenal Fornari.
Para Donoso Cortés, no hay error político que no sea primero un error religioso y metafísico. Lo que nos lleva a la errancia, lo que nos aleja de nosotros mismos, lo que nos invita a la negación, al desastre, a la calumnia, a la mentira, a la derrota y a la estupidez, es siempre lo que nos aleja de Dios, es decir, del silencio.
Ese silencio es un poco misterioso. Es aquello de lo que procede la palabra, esa delgada punta donde la palabra se libera del parloteo; espacio infinito donde la palabra vuelve al olvido. Es tan vano rebelarse contra el lenguaje humano como creer en su omnipotencia. “La primera forma de salir de la mentira, escribe Philippe Barthelet, —y la más ofensiva, porque es en realidad una guerra interna, una guerra santa que debemos librar, es permanecer en silencio. El orden gramatical es aquí el reflejo invertido del orden ontológico, ya que es verdaderamente el silencio el que nos hace; y es el silencio el que nos hace hablar, verdaderamente, según la verdad, y toda palabra verdadera es literalmente superflua, fluye desde el exterior, se desborda, sólo está allí para confirmar”.
La Carta al Cardenal Fornari refuta ese primer y fatal error moderno que consiste en pensar que la Religión, la Política y la Filosofía son dominios separados, autónomos, que andarían vagando por mundos imponderables con sus ocupaciones respectivas tan impermeables entre sí como las especialidades universitarias, con su jerga, sus fines particulares e insólitos. Para Donoso Cortés, no sólo la Religión no está ausente de la política o de la filosofía, sino que éstas son siempre religiosas, ordenándose el orden gramatical al orden ontológico, incluso y sobre todo cuando se esfuerzan por negar o derrotar la Religión.
UN AUTOR SIEMPRE ACTUAL
Las ideas de conjunto de Donoso Cortés se cuentan entre ésas, muy escasas, que se vuelven más relevantes a medida que el tiempo nos aleja de su formulación. Mejor que en 1848, por ejemplo, cuando pronunció su Discurso sobre la Dictadura, podemos verificar y profundizar su pensamiento, y tomar la medida del titánico error religioso que es el materialismo, esa adoración de la fisis, de la que surgieron la democracia, como dictadura del número, y las diversas formas de totalitarismo, como cumplimiento de la “promesa” democrática en la utopía de una socialización extrema, fusional, de las relaciones humanas, donde ni la razón ni los principios tienen ya cabida. “Se podría constatar —escribió René Guénon—, de un modo muy general, que la aparición de doctrinas naturalistas o anti metafísicas se produce cuando el elemento que representa el poder temporal llega a predominar, en una civilización, sobre el que representa la autoridad espiritual”.
“A partir de ahora, ningún alemán estará solo”, esta frase, pronunciada por Hitler cuando tomó el poder gracias a las urnas, le pareció a Henry de Montherlant la más aterradora de todas bajo la apariencia de un buen sentimiento anodino. Terrible frase, de hecho, que revela la voluntad de establecer un mundo del que la soledad, la contemplación, la distancia y el silencio, y las profundas razones del silencio, serían desterradas en nombre de la “voluntad común”, de una adoración panteísta de la naturaleza. Ahora bien, ¿qué nos dice Donoso Cortés en su Carta al cardenal Fornari? “La razón es aristocrática mientras que la voluntad es democrática”.
El totalitarismo es el cumplimiento, la realización de ese error religioso que constituye la democracia, en tanto que socialización extrema, exasperada, de las relaciones humanas. El culto a la materia y el odio a la forma, la adoración de la fusión inmanente y el odio de la distinción, la coronación de la voluntad y la excomunión de la razón como instrumento de conocimiento metafísico: éstas son las consecuencias de ese error religioso que querría hacerse pasar por una verdad anticlerical —pero a esa desastrosa e inhumana corriente río abajo corresponde una corriente río arriba que no es inútil intentar analizar sirviéndonos del método mismo de Donoso Cortés.
LA MATERIA NO EXISTE
En efecto, la “materia”, tal como la conciben los materialistas, no existe. Es esa abstracción “urubórica” total, con la que el comunismo hará su mística. Para el materialista, sea ingenuo o no, “todo es materia”. Es decir que para él la materia es el otro nombre del “todo”. Nada existe fuera de ella y todo lo que procede de ella, el lenguaje, la forma, sigue estando englobado en ella, o devorado por ella, como la filiación de Cronos.
Ese “todo” que no está en ninguna parte no es un invento nuevo: es el panteísmo: “Por lo que hace al comunismo —escribe Donoso Cortés—, me parece evidente su procedencia de las herejías panteístas, y de todas las otras con ellas emparentadas. Cuando todo es Dios y Dios es todo, Dios es, sobre todo, democracia y muchedumbre: los individuos, átomos divinos y nada más, salen del todo que perpetuamente los engendra, para volver al todo que perpetuamente los absorbe. En este sistema, lo que no es el todo, no es Dios , aunque participe de la divinidad; y lo que no es Dios, no es nada, porque nada hay fuera de Dios, que es todo”.
Los hombres, antes de la instauración de lo políticamente correcto, tenían un nombre para ese relativismo: lo llamaban barbarie. Apelación adecuada que trae a la mente que la barbarie es farfulleo, atentado contra el vocablo y la gramática, deficiencia agresiva del lenguaje, acusación permanente, estrépito y confusión.
El análisis de Donoso Cortés, lejos de ser válido sólo para las sociedades estatales de inspiración marxista, es igualmente válido para todas las sociedades de carácter predominantemente materialista, por muy liberales o “libertarias” que pretendan ser. La palabra “materialismo” en sí misma —porque las palabras, si no lo es el uso que se hace de ellas, son inocentes y no mienten— revela su naturaleza religiosa; se trata, en efecto, del culto de la Magna Mater, la inmanencia deificada convertida en abstracción. Ya que la “materia” del materialista, y ahí es donde el error religioso se manifiesta río abajo, nunca está presente.
En el momento en que escribo estas líneas, la “materia”, tal como la concibe el materialista, está ausente. Por cierto, veo la mesa sobre la que está puesta la hoja de papel, veo por la ventana el árbol despojado de su follaje en el paisaje invernal, veo y percibo una infinidad de cosas que nombro y reconozco por su forma y su uso, pero a “la materia” no la veo ni la percibo, por la sencilla razón de que la materia es algo abstracto en ese “todo” que está en “ningún lugar”, mientras que la forma es algo concreto.
La materia del materialista es ese “todo” ante el cual los hombres deben callar y obedecer, creyendo que se glorifican a sí mismos, mientras que las formas son lo que nos habla por los nombres que les damos, por el uso que hacemos de ellas, por esa conversación infinita entre lo que está dentro de nosotros y lo que está fuera de nosotros de la cual ellas son el principio. La “materia” que quiere ser “todo”, la “materia” que no es una voz en un concierto de voces del alma y del Espíritu, no es nada; y esa “nada” es tanto más despótica cuanto que su única razón de ser es la negación de la razón y del ser. No es de extrañar entonces, y los temores de Donoso Cortés se justifican más allá de todas las pesadillas, que el materialismo haya ampliado, hasta el vértigo, los defectos menores de los errores religiosos que lo precedieron, hasta el punto de dejar a los hombres solos ante la nada de una idolatría celosa.
¿EL “PROGRESO” ES TAN SÓLO EL PROGRESO DE UN ERROR?
Recordamos las primeras frases del admirable ensayo de Miguel de Unamuno, El sentimiento trágico de la vida: “Homo sum; nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo abstracto humanitas, la humanidad. Ni lo humano ni la humanidad, ni el adjetivo simple, ni el adjetivo sustantivado, sino el sustantivo concreto: el hombre. El hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere —sobre todo muere—, el que come y bebe y juega y duerme y piensa y quiere, el hombre que se ve y a quien se oye, el hermano, el verdadero hermano”.
De la misma manera, la característica de la “materia” del materialista, esa “nada” arrogante que pretende ser “todo”, esa abstracción vengativa, como todas las abstracciones, consistirá en sacarnos de la naturaleza eterna de las formas, para precipitarnos en un mundo sin jerarquía, sin distinciones, sin fervor y sin perdón, un mundo irreal, sostenido únicamente por el frágil patrón de la “moral autónoma”, en un oleaje caótico y desesperante, anterior al Verbo.
Definir el materialismo como un “progreso” en relación con la Teología Medieval, le confiere a la palabra “progreso” un significado particular, que Jean Cocteau intuyó cuando escribió que “el progreso es, quizás, tan sólo el progreso de un error”. Los Modernos repiten de buena gana la fórmula “el error es humano”, olvidando su contrapartida: “pero perseverar en el error es diabólico”. Ahora bien, si el “progreso” es en realidad el progreso de un error, no se puede negar su perseverancia. El progreso sería, entonces, un perseverante error.
Es reavivando la razón contra el racionalismo, es decir, trabajando para recuperar la lógica contra la opinión, que se nos dará una oportunidad para vivir nuestro destino no ya como “el perro muerto arrastrado por la corriente” del que habla León Bloy, sino como hombres libres que suscitan formas precisas cuyo orden define el espacio del pensamiento —y de esa forma superior del pensamiento que es la contemplación.
Puede ser difícil remontar la corriente, pero no imposible, si nos apegamos a la enseñanza de algunos buenos maestros (como Joseph de Maistre, Donoso Cortés o René Guénon); una enseñanza que comienza con el ejercicio aristocrático y metafísico de la razón y la resistencia a la voluntad. “Con el Catolicismo —escribió Donoso Cortés en una carta al editor de El Heraldo, fechada el 15 de abril de 1852— no hay fenómeno que no entre en el orden jerárquico de los fenómenos , ni cosa que no entre en el orden jerárquico de las cosas. La razón deja de ser el racionalismo (es decir, un fanal que no siendo increado, alumbra sin ser encendido por nadie) para ser la razón, es decir, un maravilloso luminar, que concentra en sí y dilata fuera de sí la luz espléndida del dogma, purísimo reflejo de Dios, que es luz eterna e increada”.
Donoso Cortés nos hace comprender así que no es tarea de la política reformar la metafísica (tentación prometeica que no carece de brillo pero que ignora la relación entre el efecto y la causa, y la flecha del tiempo —ya que la consecuencia no puede actuar sobre la causa) sino que la metafísica tiene que lograr una “refundación” y, por así decir, una justificación de lo político. Así como no hay una moral autónoma, puesto que la heteronomía es la condición de toda moral que no es únicamente la constatación de un estado de hecho, no puede haber política digna de ese nombre que no esté legitimada por una exigencia superior tanto a la del bien común como a la del “bien individual”. Ni lo “común” ni lo “individual”, ni su compromiso son suficientes: son sólo retiradas, incluso un toque de retreta, como se diría de un ejército derrotado, ante una verdad más exigente de lo que la “naturaleza” o la “materia” pueden admitir.
EL ÚNICO DERECHO POSIBLE ES EL DERECHO DIVINO
Ernst Jünger distingue acertadamente entre “Einzelne” y “individuum”, es decir, el individuo como único y el individuo como unidad intercambiable. “Einzelne” se refiere al individuo caracterizado, que se diferencia de los demás por el conjunto de tradiciones, afiliaciones, recuerdos, audacias y por su libertad conquistada, mientras que “individuum” se refiere a lo que es equivalente, igual, desprovisto de toda realidad tradicional. “Einzelne” es el Único, pero ese único lleva dentro de sí una multiplicidad de posibilidades, mientras que el “individuum” está solo, pero dentro de una multiplicidad de “similares” extraños los unos a los otros. El “Einzelne” pertenece al reino de la forma, lo que presupone una relación con otras formas, mientras que el “individuum” pertenece al reino de la materia, tan abstracta y ausente de la realidad humana como la materia es abstracta y está ausente del mundo. El “Einzelne” cree en sus deberes tanto como el “individuum” cree en derechos.
Donoso Cortés, asimismo, como lo harán Jünger o Bernanos después de él, no les da la razón ni a un liberalismo que se basaría sólo en individuos desarraigados, indiferenciados, iguales en derechos pero rivales en negocios, ni al comunismo; apareciéndole ambos como una renuncia a la soberanía, un sometimiento a ese error religioso panteísta, a esa manía de socialización extrema de las relaciones humanas que prohíbe cualquier progreso interior, o incluso, a más o menos largo plazo, cualquier uso de la razón y del discurso (basta, desgraciadamente, para convencerse de ello con escuchar a nuestros jóvenes, a nuestros periodistas, incluso a nuestros “intelectuales”): “Por lo que hace al parlamentarismo , al liberalismo y al racionalismo, escribe Donoso Cortés, creo, del primero, que es la negación del gobierno; del segundo, que es la negación de la libertad; y del tercero, que es la afirmación de la locura”.
La ley para Donoso Cortés sólo puede ser divina. El hecho de que la ley sea divina es una idea que, en principio, le parecerá escandalosa al mundo moderno, aunque consienta en todas las usurpaciones, en todos los retoques legales, en todas las instrumentalizaciones del derecho, siempre y cuando los derechos sean “humanos”. Los más lúcidos o los más cínicos reconocen en la ley la consagración de un equilibrio de fuerzas, la legitimación de una voluntad, sin ver que esa supuesta “liberación del derecho divino” no es otra cosa que una sumisión religiosa a la fuerza, una sacralización de la voluntad común, cuya característica es padecerlo todo y no poder influir en nada.
Lo que distingue a la ley divina de la ley humana no es otra cosa que la perennidad y la universalidad. Para que los hombres no queden librados a los caprichos de sus gustos y rechazos, de sus estados de ánimo, de sus obsesiones cambiantes, deben reconocer una Ley y un Derecho basados en la razón, y no en el racionalismo, en la bondad y la misericordia y no en los “buenos sentimientos”. Nada, en definitiva, se opone verdaderamente a la ley divina, a esa exigencia que tiende a lo universal sin pretender nunca poseerlo en la inmanencia, sino es el relativismo que autoriza todo y cualquier cosa.
Antes del establecimiento de lo políticamente correcto, los hombres tenían un nombre para ese relativismo: lo llamaban barbarie. Palabra adecuada que nos recuerda que la barbarie es farfulleo, atentado contra el vocablo y la gramática, deficiencia agresiva del lenguaje, acusación permanente, estrépito y confusión. Por el contrario, el derecho divino es ese puro silencio donde se refugian la Clemencia y el Perdón.
Traducción, con la autorización del autor, de Miguel Ángel Frontán
23:26 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
02/02/2022
L'Envers de la vague, notes sur l'oeuvre de Julien Gracq:

Luc-Olivier d’Algange
L'Envers de la vague
Notes sur l'œuvre de Julien Gracq
« Couchés au raz de l'eau, ils voyaient accourir de l'horizon le poids régulier des vagues, et dans un capiteux vertige il leur semblait que tombât tout entier sur leurs épaules et dût les écraser - avant de faire au-dessous d'eux un flux de silence et de douceur qui les élevait paresseusement sur un dos liquide , avec une sensation exquise de légèreté »
Julien Gracq, Au Château d'Argol
La solennité quelque peu funéraire des récits de Julien Gracq s'ouvre, pour certains d'entre nous, sur un printemps sacré.
Si la phrase de Gracq porte son charroi de métaphores crépusculaires et automnales; si la note lancinante d'une sorte de désespoir universel, comme la froidure d'une goutte de poison, ne cesse, au milieu du faste même, de faire entendre son consentement à la déréliction; si le désengagement, l'exil, le retrait, voire, pour user d'un mot naguère quelque peu galvaudé, le « pessimisme » semblent donner le ton à l'attente et au tragique qui blasonnent son œuvre, - ces majestueuses mises au tombeau d'un monde n'en demeurent pas moins traversées de pressentiments et ne rendent jamais leurs dernières armes au nihilisme ou au désenchantement.
Ce sont d'abord les paysages et leurs saisons, le palimpseste du merveilleux géographique, la puissance métaphorisante, soulevante, de la nature elle-même qui nous apparaissent comme d'impérieuses requêtes, comme des portes battantes. Ce monde déserté de toute activité humaine, figé dans une arrière-saison éternisée, cet abandon, loin d'éteindre la beauté du monde en révèle les puissances jusqu'alors dédaignées. Ce qui meurt dans les romans de Julien Gracq, ce qui s'éteint, ce qui s'étiole n'est jamais que l'industrie humaine. Les personnages se trouvent jetés dans l'immensité d'une oisiveté, d'une attente qui seuls, en dignité, sont destinés à survivre à la vanité des commerces humains. La chapelle des abîmes d'Au Château d'Argol, les « journées glissantes, fuyantes de l'arrière-saison » d’Un Beau Ténébreux, définissent d'emblée le domaine que l'œuvre ne cessera de parcourir, un domaine où le Temps hiératique règne sans disputes sur les temporalités subalternes, où la société ne survit plus que par d'anciens apparats, où toute appartenance ne vaut et ne brille que de son obsolescence dans un monde d'après la fin.
Du Surréalisme, Julien Gracq ne retiendra ni l'automatisme, ni l'idéologie révolutionnaire, mais peut-être une subversion plus radicale: le refus catégorique et fondateur d'une humanité réduite aux seules raisons du travail et de la consommation. Si loin qu'il soit des enseignements de l'humanisme classique ou des Lumières, ce refus n'en fonde pas moins une façon d'être humain, un humanisme par-delà l'humanisme, relié aux puissances ouraniennes et telluriques, aux éclatantes preuves de l'être. La « liberté grande » sera d'abord, pour Julien Gracq la liberté d'être, le rayonnement de l'être dans la contemplation. Aussi délaissées que soient les grèves, elles s'ouvrent sur un « Grand Oui » et demeurent étrangères au nihilisme et à la « littérature du non », autrement dit à la littérature du travail, du soupçon et du ressentiment. La subversion, pour Julien Gracq, est affirmative; elle est une approbation à la beauté des choses laissées à elles-mêmes, comme engourdies, abandonnées, mais qui s'offrent, dans ce délaissement, à une vérité plus profonde: « J'ai vécu de peu de choses comme de ces quelques ruelles vides et béantes en plein midi qui s'ensauvageaient sans bruit dans un parfum de sève et de bête libre, leurs maison évacuées comme un raz de marée sous l'écume des feuilles. »
Le refus de Julien Gracq, où scintillent les dernières armes jamais rendues avant la mort, est bien le contraire du « non »: « Ce qui me plaît chez Breton, écrit Julien Gracq, ce qui me plaît dans un autre ordre chez René Char, c'est ce ton resté majeur d'une poésie qui se dispense d'abord de toute excuse, qui n'a pas à se justifier d'être, étant précisément et tout d'abord ce par quoi toutes choses sont justifiées. » Seules méritent que l'on s'y attarde les œuvres qui ne s'excusent pas d'être, qui consentent à la précellence du mouvement dont elles naissent, qui témoignent de cette « participation » de l'homme au monde par l'intermédiaire du Logos, soleil secret de toutes choses manifestées, « sentiment perdu d'une sève humaine accordée en profondeur aux saisons, aux rythmes de la planète, sève qui nous irrigue et nous recharge de vitalité, et par laquelle, davantage peut-être que par la pointe de la lucidité la plus éveillée, nous communiquons entre nous. »
Restituer à la littérature sa respiration, cette alternance de contemplation et d'action, n'est-ce pas retrouver le sens même, par étymologie réactivée, du mot grec désignant l'écrivain: syngrapheus, qui signifie littéralement, « écrire avec » ? Ecrire non point seul face au monde, ou seul dans le « travail du texte » mais écrire en laissant le monde s'écrire à travers nos mots et nos phrases qui, au demeurant, font aussi partie du monde, comme une pincée de cendres, un givre, un pollen.
Suivre selon le mot de Victor Hugo, « la pente de la rêverie », c'est écrire avec l'être: « Dans la rêverie, il y a le sentiment d'y être tout à fait, et même beaucoup plus que d'habitude. Pour ma part je la définirais certainement - plutôt qu'un laisser-aller - un état de tension accrue, le sentiment d'une circulation brusquement stimulée des formes et des idées, qui jouent mieux, qui s'accrochent plus heureusement les unes aux autres, facilitent le jeu des correspondances ». Syngrapheus est l'écrivain qui accorde à ce qui survient, à l'imprévisible, sa part royale; il est aussi celui qui s'y accorde, qui ne dédaigne point la « leçon de choses » que le réel, et plus particulièrement dans les zones frontalières entre la veille et le sommeil, prodigue avec une inépuisable générosité.
Julien Gracq se rapproche ainsi de nous en s'éloignant. Ce goût du lointain, qui caractérise son œuvre, s'est éloigné de notre temps qui affectionne les rapprochements, la maitrise de l'espace, le village planétaire, les communications instantanées. Mais ce lointain, ce lointain vertigineux, ce lointain d'abysses ou de hautes frondaisons, ce lointain de landes, de lointain de précipices, ce lointain disponible jusqu'à l'effroi, ce lointain voilé, ce lointain antique et alcyonien qui suscite ces « sensations purement spaciales logées au cœur de la poitrine », par « sa foncière allergie au réalisme », sa profusion de forêt mythologique, que semblent avoir fréquenté également Shakespeare et Perrault, ce lointain, par un sentiment d'imminence propre à la guerre, présente et voilée dans presque tous ses récits, nous détache des soucis économiques et domestiques pour nous précipiter dans la pure présence des choses menacées de nous quitter à chaque instant. Ce lointain redevient une nostalgie, un appel, une présence ardente.
Ces « grèves désolées », ces rivages hantés, ces ruines dont les crêtes semblent percer l'atmosphère pour atteindre à un éther immémorial nous apparaissent comme une vocation: elles rendent présentes à notre conscience (qui cesse alors d'être seulement conscience des choses représentées) un monde, que, nous autres modernes, ne percevions plus, une géographie mystérieuse, une géo-poétique, si l'on ose le néologisme, qui, pour s'être tue durant des générations, nous revient comme un chant de la terre, un langage profus, un entretien lourd de beauté à la fois concrètes et spectrales.
Dans sa hâte, dans son volontarisme obtus, le moderne ne voit rien. Il passe à côté des êtres et des choses, glisse sur les surfaces. Cependant l'oeil garde mémoire, - une sorte de mémoire héraldique, ancestrale, et les récits de Julien Gracq semblent témoigner de cette mémoire seconde, de cette réalité d'autant plus dense qu'ordinairement dédaignée. « Reste cependant, écrit Bernard Noël, à l'intérieur même de l'œil, un rond de ténèbres, oui, ce moyeu de nuit autour duquel il voit. Pupille, le puit noir, tour d'ombre renversée vers quelque ciel de tête. » Ces grandes houles de ténèbres concrètes, cette vaste nuit renversée déferlent à travers le monde, filtrent une lumière hors du temps, une lumière d'en haut, une lumière de vitrail... Cette requête du cosmos nous précipite dans un outre-monde dont seul nous sépare, selon le mot de Henry Miller, un « cauchemar climatisé ». Ce heurt des ténèbres er de la lumière rougeoie. Ce heurt est de feu et de sang. La nature servie par une prose qui consent à la lenteur révèle sa vérité; elle est le Graal, la coupe du ciel renversée sur nos têtes ! L'écriture accordée à ce drame de ciel, de mer, de forêts et de vent devient alors elle-même la rencontre d'Amfortas et de Parsifal: « Et, passant outre à une sacrilège équivalence, comme dans le délire d'une infâme inspiration, il était clair que l'artiste, que sa main inégalable n'avait pu trahir, avait tiré du sang même d'Amfortas, qui tachait les dalles de ses flaques lourdes, la matière rutilante qui ruisselait dans la Graal, et que c'était de sa blessure même que jaillissaient de toutes parts les rayons d'un feu impossible à tarir... ».
« Le monde de Julien Gracq, écrit Maurice Blanchot, est un monde de qualités, c'est-à-dire magique. Lui-même par la bouche de son héros: le Beau Ténébreux (deux adjectifs) reconnait dans la terre une réalité fermée dont il espère mettre en mouvement, par une espèce d'acuponcture tellurique, les centre nerveux, des points d'attaches à la vie ». Les réserves dont Maurice Blanchot, par ailleurs, témoignera à l'égard de Gracq (auxquelles répondront les réticences de Gracq à l'égard de Blanchot), tiennent tout autant à une question de style qu'au dessein même de l'œuvre. Sans voir directement, entre Gracq et Blanchot, l'affrontement de deux vues du monde irréconciliables, force est de reconnaître que Blanchot (héritier de Maurras pour le style et de Kafka pour la pensée) se trouve du côté d'une décantation classique, d'une clarté des lignes, - dussent-elles ouvrir les croisées à des vertiges métaphysique ! - alors que Julien Gracq, plutôt celte que roman ( avec de certaines inclinations romantiques et wagnériennes) s'acharne à forer et à forger la langue française dans le sens d'un continuum que l'incandescence de la vision soude en un métal baroque non dépourvu de volutes et d'efflorescences, mais dures, parfois, et tranchantes. Autant Blanchot répugne aux adjectifs, qu'il n'est loin de tenir de superflus, autant Gracq construit sa phrase pour les accueillir. Les adjectifs ne viennent pas, dans l'œuvre de Gracq, à la rescousse de la structure ou de l'idée, mais, outrepassant en importance les noms et les verbes, apparaissent comme l'essentiel de la chose à dire.
« La langue française, écrit Blanchot, où les adjectifs ne sont pas à leur aise, signifierait non seulement la volonté de bannir l'accident et de s'en tenir à ce qui compte, mais aussi la possibilité d'atteindre la vérité des choses en dehors des circonstances qui nous la révèle. » L'observation pertinente frôle ici, comme chez Maurras, un jugement de valeur plus général, et peut-être abusivement général. Le génie de la langue française n'est-il pas assez grand pour s'exercer avec un égal bonheur dans la maxime sèche de Vauvenargues, dans la profusion coruscante de Rabelais, les énigmes aigües de Mallarmé, les cabrioles félines de Colette ou les suavités violentes de Barrès, - où les adjectifs ne semblent point si déplacés ? Mais peut-être la question est-elle bien plus philosophique qu'esthétique ? Blanchot n'eût sans doute pas contredit à ce philosophe de l'altérité pure qui écrivait: « Médire de la technique au nom de la poésie de la nature est une barbarie ». Dans cette perspective, une défiance morale, sinon moralisatrice, est sans doute possible à l'égard de l'œuvre de Julien Gracq, défiance pour les sortilèges pour les enchantements jugés coupables de dissoudre la conscience humaine... Sinon que depuis Au Château d'Argol, Un Beau Ténébreux, Le Rivage des Syrtes, les temps ont changés et que les sortilèges obscurs, les noirs ensorcellements qui menacent l'intégrité de la conscience humaine, les fascinations funestes où la raison périclite, où la barbarie redevient possible, se trouvent bien davantage dans les modernes techniques de communication, de contrôle et de destruction que dans la contemplation des forêts bretonnes, des « nuits talismaniques » ou des écumes sur les grèves.
Le monde vivant, le monde tellurique et météorologique ayant été déserté, ce n'est plus devant son règne jadis peuplé de dieux que cède la conscience humaine, si jamais elle céda, mais bien dans ce vide crée par son absence. « Là où il n'y a plus de dieux, disait Novalis, règnent les spectres. » Autrement dit l'abstraction, la planification et les « réalités virtuelles ». Si bien que le mot d'ordre classique (« Déteste les adjectif et chéri la raison »), ne vaut plus dans un monde où les pires déroutes de la raison sont la conséquence de la raison, où le « technocosme » est devenu un sortilège, une féérie dérisoire, certes, mais dont on ne peut d'évader, où le vide des qualités, corrélatif d'un appauvrissement du langage, est lui-même devenu une immense métaphore obstinée.
La « dissolution brumeuse et géante » évoquée par Julien Gracq est tout autant une expérience qu'une mise-en-demeure. Par ce monde arraché, in extremis, aux planificateurs, par ce monde effondré qui nous laisse face au retentissement de l'effondrement, nous nous trouvons désillusionnés d'une raison qui ne s'interroge plus sur sa raison d'être, d'une civilisation lisse et fuyante, qui nous maintient sans cesse en-deçà de nos plus hautes possibilités. Dans l'œuvre de Julien Gracq, nous voyons ce monde se défaire, mais cette défaite qui nous emporte comme un ressac nous révèle l'envers de la vague, l'envers du langage, la vérité étymologique, la réverbération antérieure aux mots et aux choses. La puissance de cette réverbération est une menace, mais une menace salvatrice.
•
Deux ouvrages de Luc-Olivier d'Algange, parus dans la collection Théôria, aux éditions de L'Harmattan abordent certains thèmes évoqués dans l'article ci-dessus: Le Déchiffrement du monde, la gnose poétique d'Ernst Jünger, L'Ame secrète de l'Europe.
00:20 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
01/02/2022
Milosz ou la Profondeur du Temps:

Luc-Olivier d'Algange
Milosz ou la Profondeur du Temps
A propos des Arcanes d’O.V de L. Milosz, éditions Arma Artis, 2016
Si le propre des grands poètes est de demeurer longtemps méconnus avant de nous advenir en gloires et ensoleillements sans doute est-ce qu'ils entretiennent avec la profondeur du temps une relation privilégiée. Leurs œuvres venues de profond et de loin tardent à nous parvenir. Elles sont ce « Printemps revenu de ses lointains voyages », - revenu vers nous avec sa provende d'essences, d'ombres bleues, de pressentiments.
Toute œuvre est recommencement, ou, plus exactement, procession vers un recommencement qui est le sens théologique du pardon. Tout revient pour recommencer, pour effacer, dans une lumière de printemps, les offenses et les noirceurs de l'hiver de l'âme. « Une étoile existe plus haut que tout le reste, écrit Paracelse, celle-ci est l'étoile de l'Apocalypse... Il y a encore une étoile, l'imagination, qui donne naissance à une nouvelle étoile et à un nouveau ciel ».
Etre poète, pour Milosz, ce n'est pas user des mots à des fins de conviction, d'information, ni même d'expression, - au sens où l'expression serait seulement le témoin d'une subjectivité humaine, c'est entrer autrement dans le Temps, c'est laisser entrer en soi le Temps autrement, c'est d'être d'un autre temps qui n'est pas du passé mais d'une autre qualité ou possibilité du Temps, - un Grand Temps, un temps sacré, un temps profond.
Ce temps n'est pas un temps linéaire, le temps de la succession, le temps historique mais le temps métahistorique, s'inscrivant dans une hiéro-histoire: c'est là tout le propos des Arcanes de Milosz. Ce savoir ne sera pas conquête arrogante, mais retour en nous de l'humilité, non pas savoir qui planifie, qui arraisonne le monde par outrecuidance, par outrance, mais retour à la simple dignité des êtres et des choses, des pierres, des feuillages, des océans, des oiseaux.
Pour atteindre « le lieu seul situé », le poète doit vaincre, écrit Milosz, « cet immense cerveau délirant de Lucifer où l'opération de la pensée est unique et sans fin, partant du doute pour aboutir à rien». Cette victoire suppose un combat, mais un combat qui a pour sens, pour orient, pour aurore, la contemplation même. « Tant de mains pour transformer le monde, écrit Julien Gracq, et si peu de regards pour le contempler ».
Le combat commencera donc dans le regard, par l'éveil de l'œil du cœur qui est le véritable œil de l'esprit. Contre « l'immense cerveau délirant », ce technocosme qu'est devenu le monde moderne, contre ce nihilisme masqué d'utilitarisme qui part du doute pour aboutir à rien, un recours demeure possible dont le secret, la raison d'être, repose, pour Milosz, dans le secret même de la langue française, dans ses arcanes étymologiques, dans le cours souterrain de sa rhétorique profonde.
« Le cerveau, écrit Milosz, est le satellite du cœur ». Ce cœur, « lieu seul situé », n'est pas seulement le siège des sentiments humains mais le cœur du monde, le cœur du Temps. C'est dire en même temps, par la verticale de l'inspiration poétique et métaphysique, sa profondeur la plus abyssale et sa hauteur la plus limpide. Pour Milosz, l'intelligence n'est pas cette faculté que l'on pourrait quantifier ou utiliser mais l'instrument de perception de l'invisible, plus exactement, la balance intérieure du visible et de l'invisible, le médiateur qui donne le la entre le monde sensible et le monde intelligible.
Certains hommes, plus que d'autres, par l'appartenance à une caste intérieure, sont prédisposés à entrer en relation avec le monde intermédiaire, là où apparaissent les Anges, les visions, les dieux. Ce mundus imaginalis, ce monde imaginal, fut la véritable patrie de Milosz comme elle fut celle de Gérard de Nerval ou de Ruzbéhân de Shîraz. Ce monde visionnaire n'a rien d'abstrus, de subjectif ni d'irréel. Il est, pour reprendre le paradoxe lumineux d'Henry Corbin « un suprasensible concret », - non pas la réalité, qui n'est jamais qu'une représentation, mais le réel, ensoleillé ou ténébreux, le réel en tant que mystère, source d'effroi, d'étonnement ou de ravissements sans fins.
« Des îles de la Séparation, écrit Milosz, de l'empire des profondeurs, entends monter la voix des harpes de soleil. Sur nos têtes coule paix. Le lieu où nous sommes, Malchut, est le milieu de la hauteur ». A chaque instant, ainsi, dans l'œuvre de Milosz, la saisissante beauté, la sapience, non pas abstraite mais éprouvée dans une âme et un corps, dans le balancier de la lancinante nostalgie et du pressentiment ardent: « L'espace, essaim d'abeilles sacrées, vole vers l'Adramand, d'extatiques odeurs. Le lieu où nous sommes, Malchut, est le milieu de la hauteur. »
Long est le chemin vers ce que Milosz nommera « la vie délivrée ». Dans ce monde sublunaire, la première condition est de servitude, la première réalité carcérale. Dans un monde d'esclaves sans maîtres, toute servitude devient sa propre fin, repliée sur elle-même et sans révolte possible. L'homme hylique s'effraie de l'œuvre-au-noir qu'il lui faudrait traverser pour atteindre à la transparence légère de l'œuvre-au-blanc, puis à l'ensoleillement salvateur de l'œuvre-au-rouge. Le chemin philosophal requiert une vertu héroïque. On songe à la célèbre gravure de Dürer, ce chevalier qui, entre la mort qui le menace et le diable qui le nargue, chemine calme et droit vers la Jérusalem céleste.
« Je regarde, écrit Milosz, et que vois-je ? La pureté surnage, le blanc et le bleu surnagent. L'esprit de jalousie, le maître de pollution, l'huile de rongement aveugle, lacrymale, plombée, dans la région basse est tombé. Lumière d'or chantée, tu te délivres. Viens épouse, venez enfants, nous allons vivre ! » A ce beau pressentiment répond, dans le même poème la voix de Béatrice: « Montjoie Saint-Denis, maître ! Les nôtres, rapides, rapides, ensoleillés ! Au maître des obscurs on fera rendre gorge. Vous George, Michel, claires têtes, saintes tempêtes d'ailes éployées, et toi si blanc d'amour sous l'argent et le lin... »
La sagesse ne vient pas aux tièdes ni aux craintifs, non plus qu'aux forts qui s'enorgueillissent de leur force mais aux fragiles audacieux, aux ingénus demeurés fidèles au printemps revenu.
L'œuvre de Milosz est une œuvre immense, - de poète, de romancier, de dramaturge, de métaphysicien, de visionnaire. Qu'elle soit encore si peu connue et reconnue est un sinistre signe des temps. Cependant, peut-être est-il un signe dans le désastre où nous sommes qui sera de nous contraindre à retourner à l'essentiel. Tout ce dont il n'est plus question dans ce monde quantifié, livré aux barbares, vit en secret dans l'œuvre de Milosz, dans ses rimes heureuses et ses raisons offertes au mystère, dans une suavité, parfois, qui n'est pas douceâtre mais une force qui nous exile du monde en revenant en nous, en réminiscences, comme le triple mouvement de la vague.
Etre véritablement au monde, c'est comprendre que nous n'y sommes pas entièrement ni exclusivement. Un retrait demeure, une distance, un exil, qui est le donné fondamental de l'expérience humaine, - le mot expérience étant à prendre ici au sens étymologique, ex-perii, traversée d'un danger.
Toute l'œuvre de Milosz s’oriente ainsi, à travers les épreuves, les dangers et les gloires, vers un idéal chevaleresque qui, par-delà les formes diverses où il s'aventure, demeure la trame de ses pensées et de ses œuvres. « L'homme n'est rien, l'œuvre est tout » écrivait son ami Carlos Larronde. L'Ordre chevaleresque auquel aspirait Milosz, et dont il ne trouve sans doute pas, dans une époque déjà presque aussi confuse que la nôtre, la forme parfaitement accomplie, fut d'abord la reconnaissance qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous fait tel que nous sommes, et qu'un combat est nécessaire pour retrouver , à travers cette évidence, « la simple dignité des êtres et des choses » qu'évoquait Maurras.
Contraires à l'œuvre et à la prière, de titanesques forces sont au travail pour nous distraire et nous soumettre. L'idéal guerroyant, chevaleresque, opposera au coup de force permanent du monde moderne, non pas une force contraire, qui serait son image inversée et sa caricature, mais une persistante douceur et d'infinies nuances.
La vaste méditation de Henry Corbin sur la chevalerie héroïque et la chevalerie spirituelle éclaire le cheminement de Milosz. Pour aller, vers, je cite, « l'enseignement de l'heure ensoleillée des nuits du divin », il faut partir et accomplir sa destinée jusqu'à cette frontière incertaine, cette orée tremblante où l'homme que nous étions, blessé de désillusions, devient Noble Voyageur.
L'idéal chevaleresque du Noble Voyageur témoigne de cette double requête: partir, s'éloigner du mensonge des représentations et des signes réduits à eux-mêmes pour revenir « au langage pur des temps de fidélité et de connaissance ». Etre Noble Voyageur, selon Milosz, c'est savoir que la connaissance n'est pas une construction abstraite mais le retour en nous de la Parole Perdue, - celle qui, ainsi que le savaient les platoniciens de d'Athènes, de Florence, d'Ispahan ou de Cambridge, nous advient sur les ailes de l'anamnésis. « Le langage retrouvé de la vérité, écrit Milosz, n'a rien de nouveau à offrir; Il réveille seulement le souvenir dans la mémoire de l'homme qui prie. Sens-tu se réveiller en toi, le plus ancien de tes souvenirs ? »
Le Noble Voyageur s'éloigne pour revenir. Il quitte la lettre pour cheminer vers l'aurore du sens, - qui viendra, en rosées alchimiques, se reposer sur la lettre pour l'enluminer. « Le monde, disaient les théologiens du Moyen-Age, est l'enluminure de l'écriture de Dieu ». Le voyage initiatique, la quête du Graal, qui n'est autre que la coupe du ciel retournée sur nos têtes, débute par l'expérience du trouble, de l'inquiétude, du vertige: « J'ai porté sur ma poitrine, écrit Milosz, le poids de la nuit, mon front a distillé une sueur de mur. J'ai tourné la roue d'épouvante de ceux qui partent et de ceux qui reviennent. Il ne reste de moi en maint endroit qu'un cercle d'or tombé dans une poignée de poussière. »
Que les yeux se ferment sur un monde et s'ouvrent sur un autre, qui est mystérieusement le même, tel sera le secret inconnu de lui-même, jusqu'à l'advenue, jusqu'à la révélation, du Noble Voyageur. La sapience perdue est la « vérité silencieuse » de la plus « humble chose», le réel est la Merveille au regard de celui qui le laisse advenir en lui. Le voyage, c'est de fermer et d'ouvrir les yeux. « J'ai fermé ma vue et mon cœur, écrit Milosz, les voici réconfortés. Que je les ouvre maintenant. A toute cette chose dans la lumière. A ce blé de soleils. Avec quel bruissement de visions, il coule dans le tamis de la pensée ».
Milosz fut poète, poète absolu serait-on tenté de dire, voulant restaurer dans un monde profané ces épiphanies que désigne « le lieu seul situé », l'Ici qui est l'acte d'être et non plus seulement l'être à l'infinitif de l'ontologie classique. Fermant les yeux, il entre dans ce que Philon d'Alexandrie, nomme Le Logos intérieur. « C'est ainsi, écrit Milosz, que je pénétrai dans la grotte du secret langage; et ayant été saisi par la pierre et aspiré par le métal, je dus refaire les mille chemins de la captivité à la délivrance. Et me trouvant aux confins de la lumière, debout sur toutes les îles de la nuit, je répétais, de naufrage et naufrage, ce mot le plus terrible de tous: Ici. »
Comment être là, comment saisir dans une présence qui ne serait plus une représentation « l'or fluide et joyeux » de la réminiscence. Afin d'y atteindre, il faut être protégé, et c'est là précisément le sens de l’idéal chevaleresque de Milosz par lequel il incombe au poète d'être le protecteur de la beauté et de la vérité la plus fragile.
Cette vérité, pour Milosz, n'est pas un dogme ou un système mais la chose la plus impondérable. C'est l'ondée par exemple: « Elle vient, elle est tombée, et tout le royaume de l'amour sent la fleur d'eau. Le jeune abeille, fille du soleil, vole à la découverte dans le mystère des vergers. » Sur les ailes de la réminiscence arcadienne, la vérité légère, est, selon la formule de Joë Bousquet, « traduite du silence ».
Le propre de la poésie est d'honorer le silence, - ce silence qui est en amont, antérieur, ce silence d'or qui tisse de ses fils toute musique, ce silence que les Muses savent écouter et qu'elles transmettent à leurs interprètes afin de faire entendre la vox cordis, la voix du cœur, qui vient de la profondeur du Temps.
14:47 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
31/01/2022
Luc-Olivier d'Algange: Léon Bloy, l'intempestif, version française et version traduite en espagnol :

Luc-Olivier d’Algange
Léon Bloy l'Intempestif
« Il est indispensable que la Vérité soit dans la Gloire. »
Léon Bloy
A mesure que les années passent, avec une feinte ressemblance dans leur cours de plus en plus désastreux depuis la première parution du Journal de Léon Bloy, l'écart n'a cessé de se creuser entre ceux qui entendent cette parole furibonde et ceux qui n'y entendent rien. Certes, on ne saurait s'attendre à ce que les rééditions des œuvres de Léon Bloy fussent accueillies comme des événements ou des révélations par un milieu « culturel » qui ne cesse de donner les preuves de sa soumission à l'Opinion, de son aveuglement et de son mépris pour toute forme de pensée originale. Une sourde hostilité est la règle et je lisais encore des jours-ci un folliculaire récriminant contre « le douloureux labyrinthe narcissique » que serait à ses yeux le Journal de Léon Bloy. Certes, labyrinthiques et préoccupés de l'Auteur, tous les journaux le sont par définition, mais au contraire du fastidieux et potinier Journal de Léautaud, devant lequel maints critiques modernes pratiquèrent une ostensible génuflexion, le Journal de Bloy est d'une vivacité électrique. L'humour ravageur, les flambées de colère, les fulgurantes intuitions mystiques, un style d'une densité et d'une musicalité prodigieuse font de ce Journal un chef d'œuvre de la forme brève, aphoristique ou illuminative. Que lui vaut donc cette disgrâce où nous le voyons ? Sans doute la pensée qui s'y affirme et s'y précise sous la forme d'une critique radicale du monde moderne, dans la lignée de Barbey d'Aurevilly et de Villiers de L'Isle-Adam.
« Tout ce qui est moderne est du démon », écrit Léon Bloy, le 7 Août 1910. C'était, il nous semble, bien avant les guerres mondiales, les bombes atomiques et les catastrophes nucléaires, les camps de concentration, les manipulations génétiques et le totalitarisme cybernétique. En 1910, Léon Bloy pouvait passer pour un extravagant; désormais ses aperçus, comme ceux du génial Villiers de L’Isle-Adam des Contes Cruels, sont d'une pertinence troublante. L'écart se creuse, et il se creuse bien, entre ceux qui somnolent à côté de leur temps et ne comprennent rien à ses épreuves et à ses horreurs, et ceux-là qui, à l'exemple de Léon Bloy vivent au cœur de leur temps si exactement qu'ils touchent ce point de non-retour où le temps est compris, jugé et dépassé. Léon Bloy écrit dans l'attente de l'Apocalypse. Tous ces événements, singuliers ou caractéristiques qui adviennent dans une temporalité en apparence profane, Léon Bloy les analyse dans une perspective sacrée. L'histoire visible, que Léon Bloy est loin de méconnaître, n'est pour lui que l'écho d'une histoire invisible. « Tout n'est qu'apparence, tout n'est que symbole, écrit Léon Bloy. Nous sommes des dormants qui crient dans leur sommeil. Nous ne pouvons jamais savoir si telle chose qui nous afflige n'est pas le principe de notre joie ultérieure. »
Cette perspective symbolique est la plus étrangère qui soit à la mentalité moderne. Pour le Moderne, le temps et l'histoire se réduisent à ce qu'ils paraissent être. Pour Bloy, le temps n'est, comme pour Platon et la Théologie médiévale, que « l'image mobile de l'éternité » et l'histoire délivre un message qu'il appartient à l'écrivain-prophète de déchiffrer et de divulguer à ses semblables. Pour Léon Bloy, le Journal, loin de se borner à la description psychologique de son auteur a pour dessein de consigner les « signes » et les « intersignes » de l'histoire visible et invisible afin de favoriser le retour du temps dans la structure souveraine de l'éternité.
Pour Léon Bloy, qui se définit lui-même comme « un esprit intuitif et d'aperception lointaine, par conséquent toujours aspiré en deçà ou au-delà du temps », la fonction de l'auteur écrivant son journal n'est pas de se soumettre à l'aléa de la temporalité, du passager ou du fugitif, mais tout au contraire « d'envelopper d'un regard unique la multitude infinie des gestes concomitants de la Providence ». Le Journal, - tout en marquant le pas, en laissant retentir en soi, et dans l'âme du lecteur ami, la souffrance ou la joie, plus rare, de chaque jour, les « nouveautés » menues ou grandioses du monde, ne s'inscrit pas moins dans une rébellion contre le fragmentaire, le relatif ou l'éphémère. Ce Journal, et c'est en quoi il décontenance un lecteur moderne, n'a d'autre dessein que de déchiffrer la grammaire de Dieu.
Là où le Moderne ne distingue que des vocables sans suite, de purs signes arbitraires, Léon Bloy devine une cohérence éblouissante, et, par certains égards, vertigineuse et terrifiante. Léon Bloy n'est pas de ces dévots qui trouvent dans la foi et dans l'Eglise de quoi se rassurer. Ces dévots modernes, bourgeois au sens flaubertien, Léon Bloy les fustige ainsi que la « société sans grandeur ni force » dont ils sont les défenseurs. Il est fort improbable, quoiqu'en disent les journaleux peu informés qui voient en Bloy un « intégriste », que l'auteur du Désespéré et de La Femme Pauvre se fût retrouvé du côté de nos actuels, trop actuels « défenseurs des valeurs », moralisateurs sans envergure ni générosité,- et par voie de conséquence, sans le moindre sens de la rébellion. Or s'il est un mot qui qualifie avec précision la tournure d'esprit de cet homme de Tradition, c'est rebelle !
Pour Léon Bloy, quel que soit par moment son harassement, le combat n'est pas fini, il y retourne, chaque jour est le moment décisif d'une guerre sainte. Léon Bloy est un moine-soldat qui va son chemin d'écrivain, non sans donner ici et là quelques coups de massue, pour reprendre la formule évolienne. Ainsi le sport, objet, depuis peu, d'un nouveau culte national est-il, pour Léon Bloy « le moyen le plus sûr de produire une génération d'infirmes et de crétins malfaisants ». Quant à la Démocratie, bien vantée, elle lui suggère cette réflexion : « Un des inconvénients les moins observés du suffrage universel, c'est de contraindre des citoyens en putréfaction à sortir de leurs sépulcres pour élire ou pour être élus. » Cette outrance verbale dissimule souvent une intuition. Tout, dans ce monde planifié, ne conjure-t-il pas à faire de nous une race de morts-vivants, réduits à la survie, dans une radicale dépossession spirituelle. Que sont les Modernes devant leurs écrans ? Quel songe de mort les hante ? Les rêveries du Moderne ne sont-elles pas avant tout macabres ? Non, la religion de Léon Bloy n'est pas faite pour les « tièdes ». C'est une religion pour ceux qui ressentent les grandes froidures et qui attendent l'embrasement des âmes et des esprits. Le modèle littéraire de Léon Bloy ce sont les langues de feu de la Pentecôte.
Léon Bloy s'est nommé lui-même « Le Pèlerin de l'Absolu ». Chaque jour qui advient, et que l'auteur traverse comme une nouvelle épreuve où se forge son courage et son style, le rapproche du moment crucial où apparaîtront dans une lumière parfaite la concordance de l'histoire visible et de l'histoire invisible. Cette quête que Léon Bloy partage avec Joseph de Maistre et Balzac le conduit à une vision du monde littéralement liturgique. L'histoire de l'univers, comme celle de l'auteur esseulé dans son malheur et dans son combat, est « un immense Texte liturgique. » Les Symboles, ces « hiéroglyphes divins », corroborent la réalité où ils s'inscrivent, de même que les actes humains sont « la syntaxe infinie d'un livre insoupçonné et plein de mystères. »
Cette vision symbolique et théologique du monde en tant que Mystère limpide, c'est à dire offert à l'illumination (« l'illumination, lieu d'embarquement de tout enseignement théologique et mystique ») est à la fois la cause majeure de l'éloignement de l'œuvre de Léon Bloy et le principe de sa proximité extrême. Pour le moderne, la « folie » de Léon Bloy n'est pas dans sa véhémence, ni dans son lyrisme polémique, mais bien dans cette vision métaphysique et surnaturelle des destinées humaines et universelles. Pour Léon Bloy, qui n'est point hégélien, et qui va jusqu'à taquiner Villiers pour son hégélianisme « magique », les contraires s'embrassent et s'étreignent avec fougue. La nature porte la marque de la Surnature, mais par un vide qui serait l'empreinte du Sceau. De même, l'extrême pauvreté engendre le style le plus fastueux. C'est précisément car l'écrivain est pauvre que son style doit témoigner de la plus exubérante richesse. La pauvreté matérielle est ce vide qui laisse sa place à la dispendieuse nature poétique. Car la pauvreté, pour Bloy, n'est pas le fait du hasard, elle est la preuve d'une élection, elle est le signe visible d'un privilège invisible qu'il appartient à l'Auteur de célébrer somptueusement. La richesse verbale de Léon Bloy est toute entière un hommage à la pauvreté, à sa profondeur lumineuse, à la grâce qu'elle fait à la générosité de se manifester. Celui qui donne se sauve. Le mendiant peut donc, à bon droit être « ingrat ». Son ingratitude rédime celui qui pourrait s'en offenser. Mais qu'est-ce qu'un pauvre, dans la perspective métaphysique ? C'est avant tout celui qui récuse par avance toute vénalité. Or qu'est-ce que le monde moderne si ce n'est un monde qui fait de la vénalité même un principe moral, une cause efficiente du Bien et « des biens » ? Pour le Moderne, celui qui parvient à se vendre prouve son utilité dans la société et donc sa valeur morale. Celui qui ne parvient pas, ou, pire, qui ne veut pas se vendre est immoral.
Contre ce sinistre état de fait, qui pervertit l'esprit humain, l'œuvre de Léon Bloy dresse un grandiose et intarissable réquisitoire. Or, c'est bien ce réquisitoire que les Modernes ne veulent pas entendre et qu'ils cherchent à minimiser en le réduisant à la « singularité » de l'auteur. Certes Léon Bloy est singulier, mais c'est d'abord parce qu'il se veut religieusement « un Unique pour un Unique ». La situation dans laquelle il se trouve enchaîné n'en est pas moins réelle et la description qu'il en donne particulièrement pertinente en ces temps où face à la marchandise mondiale le Pauvre est devenu encore beaucoup plus radicalement pauvre qu'il ne l'était au dix-neuvième siècle. La morale désormais se confond avec le Marché, et l'on pourrait presque dire que, pour le Moderne libéral, la notion d'immoralité et celle de non-rentabilité ne font plus qu'une. Refuser ce règne de l'économie, c'est à coup sûr être ou devenir pauvre et accueillir en soi les gloires du Saint-Esprit, dont la nature dispensatrice, effusive et lumineuse ne connaît point de limite.
Contre le monde moderne, Léon Bloy ne convoque point des utopies sociales, ni même un retour au « religieux » ou à quelque manifestation « révolutionnaire » ou « contre-révolutionnaire » de la puissance temporelle. Contre ce monde, « qui est du démon », Léon Bloy évoque le Saint-Esprit, au point que certains critiques ont cru voir en lui un de ces mystiques du « troisième Règne », qui prophétisent après le règne du Père, et le règne du Fils, la venue d'un règne du Saint-Esprit coïncidant avec un retour de l'Age d'Or. Lorsqu'un véritable écrivain s'empare d'une vision dont la justesse foudroie, peu importent les terminologies. Sa vision le précède, elle n'en précède que mieux les interprétations historiographiques. « Aussi longtemps que le Surnaturel n'apparaîtra pas manifestement, incontestablement, délicieusement, il n'y aura rien de fait. »

Léon Bloy, el Extemporáneo
“Es indispensable que la Verdad esté en la Gloria.” Léon Bloy.
“Todo lo moderno pertenece al demonio”, escribe Léon Bloy el 7 de agosto de 1910. Fue, según nos parece, mucho antes de las guerras mundiales, las bombas atómicas y las catástrofes nucleares, los campos de concentración, las manipulaciones genéticas y el totalitarismo cibernético. En 1910, a Léon Bloy se lo podía tomar por un extravagante; hoy en día sus vislumbres, como los del genial Villiers de L’Isle-Adam de los Cuentos crueles, son de una pertinencia turbadora. Aumenta, y cada vez más, la distancia entre los que dormitan al margen de su época y no comprenden nada de las pruebas y los horrores a los que nos somete, y los que, a ejemplo de Léon Bloy, viven tan precisamente en el centro mismo de su época que alcanzan ese punto de no retorno en el que se la comprende, se la juzga y se la supera. Léon Bloy escribe a la espera del Apocalipsis. Todos esos acontecimientos, singulares o característicos, que se producen en una temporalidad aparentemente profana, Léon Bloy los analiza en una perspectiva sagrada. La historia visible, que Léon Bloy está lejos de desconocer, sólo es para él el eco de una historia invisible.
“Todo es pura apariencia, todo es puro símbolo”, escribe Léon Bloy. “Somos durmientes que gritan durante el sueño. Nunca podemos sabes si algo que nos aflige no es el principio de nuestra dicha ulterior.”
Esta perspectiva simbólica es la más ajena posible a la mentalidad moderna. Para el Moderno, el tiempo y la historia se reducen a lo que parecen ser. Para Bloy, el tiempo sólo es, como para Platón y la teología medieval, “la imagen móvil de la eternidad”, y la historia comunica un mensaje que al escritor-profeta le toca descifrar y divulgar entre sus semejantes. Para Léon Bloy, el Diario, lejos de limitarse a la descripción psicológica de su autor, tiene por objetivo el de dejar registrados los “signos” y los “intersignos” de la historia visible e invisible, a fin de favorecer el retorno del tiempo en la estructura soberana de la eternidad.
Para Léon Bloy, que se define a sí mismo como “un espíritu intuitivo y de apercepción lejana, y, por consiguiente, siempre arrastrado más acá o más allá del tiempo”, la función del autor al escribir su diario no es la de someterse a la temporalidad fugitiva sino, muy por el contrario, la de “abarcar con una mirada única la multitud infinita de los gestos concomitantes de la Providencia”. El Diario —al mismo tiempo que marca el paso, dejando resonar en sí mismo, y en el alma del lector amigo, el sufrimiento o la dicha, menos frecuente, de cada día, las “novedades” modestas o grandiosas del mundo— no deja de inscribirse en una rebelión contra lo fragmentario, lo relativo o lo efímero. Este Diario, que en esto desconcierta a un lector moderno, no tiene otra finalidad que la de descifrar la gramática de Dios.
Allí donde el Moderno sólo distingue vocablos inconexos, puros signos arbitrarios, Léon Bloy intuye una coherencia deslumbrante y, en ciertos aspectos, vertiginosa y aterradora. Léon Bloy no es uno de esos devotos que encuentran en la fe y en la iglesia con qué tranquilizarse. A esos devotos modernos, burgueses en el sentido de Flaubert, Léon Bloy los fustiga al igual que a la “sociedad sin grandeza ni fuerza” que defienden. Es altamente improbable, digan lo que digan los periodistuchos poco informados que ven en Bloy a un “integrista”, que el autor de El desesperado y de La mujer pobre hubiese estado en el mismo campo de nuestros actuales, demasiado actuales “defensores de los valores”, moralizadores sin envergadura ni generosidad —y, por consiguiente, sin el menor sentido de la rebelión. Ahora bien, si hay una palabra que define con precisión la mentalidad de este hombre de Tradición, esta palabra es “rebelde”.
Para Léon Bloy, por más extenuado que esté por momentos, el combate no ha terminado, vuelve a él, cada día es el momento decisivo de una guerra santa. Léon Bloy es un monje soldado que sigue su camino de escritor, no sin dar acá y allá algunos mazazos, para emplear la expresión de Julius Evola. Así es como el deporte, objeto, desde hace poco, de un nuevo culto nacional, es para Léon Bloy “el medio más seguro de producir una generación de inválidos y de cretinos dañinos”. En cuanto a la Democracia, tan ensalzada, le sugiere esta reflexión: “Uno de los inconvenientes menos observados del sufragio universal es el hecho de obligar a ciudadanos en estado de putrefacción a salir de su sepulcros para elegir o ser elegidos”. Esta desmesura verbal a menudo disimula una intuición. ¿Acaso no conspira todo, en este mundo planificado, para hacer de nosotros una raza de muertos vivos, reducidos a sobrevivir en una radical desposesión espiritual? ¿Qué son los Modernos delante de sus pantallas? ¿Qué sueño de muerte los posee? ¿Las Ensoñaciones del Moderno no son, ante todo, macabras? No, la religión de Léon Bloy no está hecha para los “tibios”. Es una religión para quienes sienten los grandes fríos y esperan el incendio de las almas y los espíritus. El modelo literario de Léon Bloy son las lenguas de fuego de Pentecostés.
Léon Bloy se llamó a sí mismo “El Peregrino del Absoluto”. Cada día que llega, y que el autor atraviesa como una nueva prueba en que se templan su coraje y su estilo, lo acerca al momento crucial en que aparecerán con perfecta claridad la concordancia entre la historia visible y la historia invisible. Esta búsqueda, que Léon Bloy comparte con Joseph de Maistre y Balzac, lo conduce a una visión del mundo literalmente litúrgica. La historia del universo, tanto como la del autor aislado en su desdicha y en su combate, es “un inmenso Texto litúrgico”. Los Símbolos, esos “jeroglíficos divinos”, corroboran la realidad en que se inscriben, así como los actos humanos son “la sintaxis infinita de un libro insospechado y lleno de misterios”.
Esta visión simbólica y teológica del mundo como Misterio límpido, es decir, alcanzable por la iluminación (“la iluminación, punto de embarque de toda enseñanza teológica y mística”), es, al mismo tiempo, la causa principal de lo alejado de la obra de Léon Bloy y el principio de su cercanía extrema. Para el moderno, la “locura” de Léon Bloy no reside en su vehemencia ni en su lirismo polémico, sino precisamente en esta visión metafísica y sobrenatural de los destinos humanos y universales. Para Léon Bloy, que no es en absoluto hegeliano, y que hasta llega a burlarse de Villiers de l’Isle-Adam por su hegelianismo “mágico”, los contrarios se abrazan y se estrechan con ardor. La naturaleza tiene la impronta de la Sobrenaturaleza, pero por medio de un vacío que fuese la marca del Sello. De igual modo, la extrema pobreza engendra el estilo más fastuoso. Es precisamente porque el escritor es pobre por lo que su estilo debe dar testimonio de la riqueza más exuberante. La pobreza material es el vacío que le cede el lugar a la dispendiosa naturaleza poética. Ya que la pobreza, para Bloy, no es el resultado del azar: es la prueba de una elección, es el signo visible de un privilegio invisible que le incumbe al Autor celebrar suntuosamente.
La riqueza verbal de Léon Bloy es toda ella un homenaje a la pobreza, a su profundidad luminosa, al favor que le hace a la generosidad permitiéndole manifestarse. El que da, se salva. El mendigo puede entonces, con toda razón, ser “ingrato”. Su ingratitud redime al que podría tomarla como una ofensa. Pero ¿qué es un pobre, en la perspectiva metafísica? Es, ante todo, aquél que rechaza de antemano toda venalidad. Ahora bien, ¿qué es el mundo moderno sino un mundo que hace de la venalidad misma un principio moral, una causa eficiente del Bien y de “los bienes”? Para el Moderno, el que logra venderse prueba su utilidad en la sociedad y, por lo tanto, su valor moral. El que no logra o, peor aún, no quiere venderse, es inmoral.
Contra esta siniestra situación de hecho, que pervierte el espíritu humano, la obra de Léon Bloy lanza una grandiosa e inagotable acusación. Ahora bien, es precisamente esta acusación lo que los Modernos no quieren oír y tratan de minimizar, reduciéndola a la “singularidad” del autor. Por cierto, Léon Bloy es singular, pero esto es, en primer término, porque elige ser, religiosamente, “un Único para un Único”. La situación en que se encuentra encadenado no es por esto menos real, y la descripción que da de ella es particularmente pertinente en estos tiempos en que, ante la mercancía mundial, el Pobre se ha vuelto aún mucho más radicalmente pobre de lo que lo era en el siglo XIX. La moral, ahora, se confunde con el Mercado, y casi podríamos decir que, para el Moderno liberal, la noción de inmoralidad y la de no rentabilidad no son más que una y la misma. Rechazar este reino de la economía es, con toda seguridad, ser o volverse pobre, y acoger en uno mismo las glorias del Espíritu Santo, cuya naturaleza dispensadora, efusiva y luminosa no conoce límite alguno.
Contra el mundo moderno, Léon Bloy no llama a ninguna utopía social, ni siquiera a un regreso a lo “religioso” o a alguna manifestación “revolucionaria” o “contrarrevolucionaria” del poder temporal. Contra este mundo, “que pertenece al demonio”, Léon Bloy invoca al Espíritu Santo, hasta el punto de que algunos críticos han creído ver en él a uno de esos místicos del “Tercer Reino” que profetizan, para después del Reino del Padre y del Reino del Hijo, el advenimiento de un reino del Espíritu Santo que coincidirá con un retorno a la Edad de Oro. Cuando un auténtico escritor se apodera de una visión de exactitud fulminante, poco importan las terminologías. Su visión le precede y, por lo mismo, mejor aún precede a las interpretaciones historiográficas. “Mientras lo Sobrenatural no se muestre de modo manifiesto, indiscutible, delicioso, nada estará hecho.”
Traducción de Carlos Cámara y Miguel Ángel Frontán.
00:07 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
26/01/2022
Pierre Boutang et la "vox cordis", l'art de la traduction:

Luc-Olivier d'Algange
Pierre Boutang et la vox cordis
Note sur l'art de la traduction
« Ainsi chaque réel poème a pour invisible
réserve, ce que le Moyen-Age nommait
vox cordis, une voix du cœur. »
Pierre BOUTANG
Il est de coutume de juger l'œuvre de Pierre Boutang, pour l'en louer ou l'en blâmer, peu importe, à l'aune de sa fidélité à Charles Maurras. Pierre Boutang ne cessa jamais, à l'inverse de tant d'autres, de mentalité honteuse ou renégate, de témoigner d'une fidélité essentielle à l'égard de l'auteur (enseveli sous l'opprobre, le mépris et l'indifférence) de L'Avenir de l'Intelligence. Etre fidèle à Charles Maurras, ce ne fut certes point, pour Pierre Boutang, s'obstiner, à l'exemple de quelques acariâtres, sur les vues partielles défendues par le Maître de Martigues dans tel ou tel éditorial malencontreux, mais bien accomplir cet acte de remémoration et de gratitude par lequel le disciple établit l'autorité du Maître dans son essence, sans pour autant éprouver la tentation « psittaciste », sans âme, qui accable l'oeuvre sous le poids de la lettre morte. Villiers de l'Isle-Adam dans un conte intitulé Les Plagiaires de la foudre traite la question sous forme de parabole.
Rien n'est moins aimable que le reniement. Déprécier le passé du monde, de son pays, ou ne fût-ce que de sa propre existence est, selon Nietzsche, le signe propre du nihilisme. Celui qui renie son passé ne fonde point le nouveau mais l'abolit. L'idée même d'un « couronnement des formes », d'un accomplissement du destin, d'une réalisation, au sens métaphysique, voire initiatique du terme, suppose que l'âme humaine, l’amoureuse amie de Mnémosyme, eût construit, pierre à pierre, et avec déférence, un édifice du Souvenir. Etre fidèle, ce n'est point idolâtrer le passé, c'est veiller sur la flamme, dispensatrice à la fois de chaleur et de lumière, afin qu'elle ne s'éteigne. Témoigner d'une fidélité essentielle, n’est-ce point comprendre alors la différence entre le Maître qui nous fait disciple et le Maître qui nous fait esclave ? Etre fidèle, n’est-ce point atteindre à cette liberté essentielle, caractère dominant de l'auteur Pierre Boutang : liberté qui est le « privilège immémorial de la franchise », signe de l'attachement de l'auteur à son Pays qui lui permet d'être lui-même, sans pour autant être « maurrassien » à la façon des épigones et des obtus? Ces nuances échapperont aux esprits mécaniques. Pierre Boutang sut rendre possible une telle méditation sur le Logos et la nécessaire convenance du monde au langage qui l'élucide et l'enchante et, par voie de conséquence, témoigner de la tradition, et de l'art du traducteur, qui présument l'autorité du sens.
Dès lors que l'on ne cède point à la superstition ou à l'idolâtrie du texte réduit à sa propre immanence, comme il était d'obligation naguère dans les sectes de la critique « matérialiste », il devient légitime de s'interroger sur les fonctions, non plus de l' « écriture » mais de l'auteur. Les fonctions de l'auteur sont de l'ordre de son magistère. Dans la perspective métaphysique ou plus exactement théologique, qui ne cessa jamais d'être celle de Pierre Boutang, même au cœur le plus ardent de son combat politique, l'œuvre est un moyen de connaissance et de justice. Si la fonction dévolue à quelques écrivains est de distraire, à d'autres, moins enviables, de relever la bonne conscience défaillante de leurs lecteurs, à d'autres encore plus simplement de « passer le temps », comme si temps n'accomplissait pas cette fonction de son propre chef, les fonctions de l'œuvre de Pierre Boutang sont infiniment plus complexes et d'une portée si grande que nous parions volontiers qu'elles ne commencent qu'à peine à être évaluées.
Pierre Boutang, « logocrate », monarchiste, philosophe et traducteur, fit donc de chacune de ses « vertus » au sens antique, une « fonction », au sens sacerdotal. Etre monarchiste loin d'être seulement l'expression d'une conviction, ce fut, pour lui, une poétique et une rhétorique, au sens noble, médiéval et théologique, c'est à dire la façon, également grammaticale et étymologique tout autant qu'architecturale et musicale, de comprendre l'ordre humain et l'ordre du monde en concordance avec l'ordre divin. Alors que le « monarchisme » de beaucoup d'autres n'est qu'une façon retorse d'avouer leurs nostalgies d'un monde réduit précisément aux valeurs de la « troisième fonction », au sens dumézilien, « travail, famille, patrie », c'est-à-dire aux « valeurs » bourgeoises dans toute leur horreur, à quoi s'ajoute le goût obscur pour la défaite, la contrition, et une forme vaniteuse d'irresponsabilité, pour Pierre Boutang être fidèle au Roi, ce fut d'abord se souvenir que la France, par provenance, et osons le croire par destination, est un Royaume, et que la « République » ( dont il est permis à présent de préférer l'aristocratisme jacobin, d'allure encore vaguement stendhalienne, à l'actuel totalitarisme démocratique) est elle- même faite avec ce Royaume dont elle décapita les symboles.
Etre monarchiste, pour Pierre Boutang, ce fut comprendre, par delà les considérations « positivistes » (inspirées d'Auguste Comte, d'Anatole France ou de Renan) de Maurras, que l'ordre politique et terrestre n'est digne d'être respecté que s'il reçoit humblement l'empreinte de l'Ordre du Ciel. La fonction d'Auteur monarchique que Pierre Boutang fut, avec Henry Montaigu, un des très rares à hausser à l'exigible dignité chevaleresque, annonce ainsi sa fonction de philosophe, c'est-à-dire d'amoureux de la sagesse. Car si l'Ordre est vénérable, en ce qu'il témoigne du permanent, et s'il est préférable a priori à la subversion, désastreuse par nature, il n'en demeure pas moins que l’auteur des Abeilles de Delphes, dans la fameuse querelle sur le « coup de force » qui eût libéré Socrate de ses geôliers, eût été enclin à passer outre aux recommandations légalistes de Socrate pour le sauver. L'Ordre est sacré, certes, mais encore faut-il qu'il ne contredise point le cri du coeur qui, en certaines circonstances, nous en révèle la nature parodique. Dans la honte et l'horreur où nous plonge le désastre du monde moderne, le grand péril est de céder à n'importe quelle « réaction », de nous contenter d'un « ersatz ». Mieux vaut approfondir en soi l'absence du Royaume, de l'Ordre, du Sacré que d'en faire un simulacre. Les temps modernes sont aux faux-semblants. Des fausses légions romaines de Hitler aux châteaux en carton-pâte des parcs d'attraction d'Outre-Atlantique venus s'installer chez nous, la ligne constante du monde moderne est de substituer le faux spectaculaire à « la simple dignité des êtres et des choses ».
Amoureux de la sagesse, le philosophe est aussi amoureux du langage qui porte en lui, comme un secret et comme une évidence, les normes de la sagesse. Le pouvoir du Logos accroît notre liberté et notre autorité. L'oeuvre de Pierre Boutang se laisse lire comme une méditation sur le Logos incarné. Etre auteur, c'est remplir ces « fonctions » de l'auctoritas non sans un certain détachement, accomplir son destin, faire son oeuvre, être à la hauteur de cette « disposition providentielle » dont la surnature nous privilégie et dont tout combat humain n'est que la remémoration ou le remerciement.
Les talents ne sont pas donnés en vain et comme les hommes plus généreux sont aussi les plus prompts à révéler leurs talents, il est compréhensible que l'écart se creuse entre les hommes et entre leurs oeuvres. Mais cette inégalité est avant tout, pour reprendre le mot de Maurras, une « inégalité protectrice ». La méditation sur la Monarchie, sur le pouvoir du Logos et sur la rhétorique de Dieu que Pierre Boutang poursuit à travers son oeuvre ne sera point sans redonner, au grand scandale des bien-pensants, un sens profond, et dirions-nous profondément chrétien, - au mot hiérarchie. Parmi les rares écrits anglais trouvant grâce aux yeux de Maurras figurait le Colloque entre Monos et Una d'Edgar Poe qui comporte, il est vrai l'une des critiques métaphysiques les mieux formulées de l'idéologie démocratique: « Entre autres idées bizarres, celle de l'égalité universelle avait gagné du terrain, et à la face de l'Analogie et de Dieu, en dépit de la voix haute et salutaire des lois de gradation qui pénètrent si vivement toutes choses sur la Terre et dans le Ciel, des efforts insensés furent faits pour établir une Démocratie universelle. » Nous comprenons, alors que ce qui distingue les hommes en accord avec les profondeurs du temps et les « derniers des hommes » au sens nietzschéen, « ceux qui clignent des yeux », n’est autre que le sens des gradations.
Ce sens des gradations qui est d'abord résistance à la planification sera aussi une clef pour comprendre la pensée platonicienne de la Forme et du Logos dont Pierre Boutang ravive les prestiges et approfondit les possibilités. Il existe une façon matutinale d'être platonicien, de faire de la pensée un chant de gratitude dans le « matin profond », et cette « façon », cette poétique, en référence à l'étymologie du faire poétique, nous délivre de ce « dualisme morose » où certains voulurent enfermer l'oeuvre de Platon et de ces disciples. De même que Pierre Boutang eût été tenté de sortir Socrate de sa geôle, il saura prendre les mesures nécessaires pour sortir Platon de sa prison exégétique où, non sans les commodités propres aux prisons « modernes », Platon se trouve réduit à une triste « perpétuité ». L'oeuvre de Pierre Boutang réfute ainsi un nombre considérable de banalités fallacieuses. A commencer par la plus insistante de toutes qui consiste pour le premier venu à prétendre au « renversement du platonisme ». La belle affaire que de « renverser » : de quoi satisfaire à la fois au goût moderne de la subversion et à l'indéracinable vanité humaine. Pierre Boutang, en renouant avec une subtilité herméneutique perdue, fut sans doute, avec Henry Corbin et George Steiner, celui des philosophes qui nous offrit l'ultime chance de comprendre, avant la liquidation générale de tout, que ce platonisme « renversé » par une prétention qui se voudrait nietzschéenne (alors qu’elle n'est que bonhomesque) est une caricature.
Poursuivant avec audace et humilité la méditation européenne sur la Forme et le Logos sans faire système ni doxa de ce qui ne s'y prête point, Pierre Boutang exige de son lecteur cette témérité et cette déférence qui, selon la formule d'Hölderlin, fondent « ce qui demeure ». Les philosophes modernes, loin d'avoir renversé le platonisme se sont contentés d'en fermer l'accès, d'en rendre l'approche impraticable par des approximations et des sophismes. Ainsi en est-il de la confusion assez systématiquement entretenue entre l'opposition et la distinction. Platon distingue le monde des Idées et le monde sensible, il ne les oppose point ni ne les sépare. Platon distingue car distinguer est le propre de la connaissance et l'art du poète comme du métaphysicien. De même que le musicien distinguera le timbre, le rythme et la mélodie, sans davantage concevoir qu'on dût les séparer, Platon distingue les idées et les réalités sensibles comme Julius Evola, l'un de ses lointains disciples, distinguera la forme de la matière. Platon lui-même parle des « gradations infinies » qui unissent les mondes que l'exigence de la connaissance distingue. Il y a dans l'insistance des Modernes à « renverser le platonisme » une volonté déterminée de ne pas comprendre la Forme, le Logos et l'Un qui fondent la métaphysique et l'ontologie européennes. Le grand mérite de Pierre Boutang sera de renouer la « catena aurea », qui nous unit à Platon, Parménide, Aristote et à la Théologie médiévale après laquelle une grande part de l'ingéniosité humaine consistera à déraisonner de façon de plus en plus utilitaire.
L'Idea, la Forme, au sens platonicien, ne se réfute qu'au profit d'un nouvel obscurantisme, peut-être le pire de tous, qui délie, scinde, déconstruit ; d'une relativisation générale qui, récusant la notion d'interdépendance universelle n'est plus qu'une méthode pour nier tout sens et toute orientation. Si nous ne pouvons nier la Forme, et que toutes les choses ont une forme qui correspond à un modèle, il demeure possible de contester ce que l'on suppose être l'intention de la métaphysique, qui est d'affirmer la précellence de l'Un et de l'Eternel sur le multiple et le fugace. Or le monde moderne a ceci d'étonnant qu'il choisit ses chantres parmi les hommes qui éprouvent le plus vive aversion pour la communion des esprits. Nier l'éternité, le Logos, l'Un, c'est rendre impossible la communion des esprits, c'est rejeter dans une multiplicité aléatoire un message réduit à sa propre immanence et vouée à ne « signifier » fugacement que dans un temps ou dans un lieu donné. Sous couvert de dénoncer toute hiérarchie, y compris celle qui, par gradations infinies embrasse toute chose dans un même amour (ou dans une même logique) et de refuser toute autorité (y compris celle qui est contre le pouvoir, dont la nature est d'abuser, le seul recours de la liberté), le Moderne invente un monde où la communion cède définitivement à la fascination, où les signes et les symboles réduits à eux-mêmes deviennent idoles et où la solitude, - n'étant plus glorifiée par l'unificence de Dieu - n'est plus que l'esseulement de l'insolite, de l'unité interchangeable, propre à cet individualisme de masse qui parachève les ambitions les plus folles du totalitarisme.
Ce n'est pas le caractère le moins diabolique de ce siècle étrange que d'avoir généralisé la « communication » tout en ôtant aux hommes la possibilité de la communion. Exception lumineuse, la rencontre de Pierre Boutang et de George Steiner, fut bien davantage qu'un heureux hasard médiatique. Pour peu que l'on cultive quelque peu, à l'exemple du bon maître d'Engadine, le goût de la généalogie des idées, l'importance de la théorie de la traduction, aussi bien dans l’œuvre de Boutang que de Steiner, ne manquera pas d'apparaître dans sa perspective métaphysique. La riposte à Derrida et à quelques autres, qui persistent à refuser le sens comme une déplorable « survivance platonicienne », vient ainsi étayer dans notre pensée l'Art poétique de Pierre Boutang, comme de juste dédié à Steiner, et qui est d'abord un traité de la traduction.
Que la traduction soit possible, nous dit Steiner, prouve l'existence du sens. Non point d'un « sens » comme épiphénomène, prolongement du « fonctionnement du texte » mais comme origine, voire comme Mystère, dont il reviendra à l'Art poétique de manifester la présence réelle. L'insistance du Moderne à nier la possibilité ou la légitimité de la traduction, toute traduction s'avérant pour lui inadéquate ou délictueuse, n'est rien moins qu'innocente ; à suivre le raisonnement de Steiner et celui de Boutang, si nous pouvons traduire, toute la doxa moderne et matérialiste se trouve récusée. Si le sens existe, s'il se manifeste en « présence réelle », ainsi que l'établit la simple possibilité de la traduction, l'intelligence même du mouvement renoue avec l'herméneutique, et, par voie de conséquence, avec la tradition.
Ce qui peut être traduit, cette possibilité universelle du sens, tel est le fondement de l'herméneutique et de la tradition. Interpréter, traduire, transmettre, telles sont, pour l'homme traditionnel, les fonctions essentielles de l'entendement humain, et l'aventure par excellence, dont la navigation d'Ulysse est la métaphore immense. Ce qui peut être traduit navigue sur le vaisseau du langage dont les cordes, les voiles et le bois sont la grammaire. L'herméneute est celui qui fait sienne cette beauté maritime, qui veille sur les variations météorologiques révélées par les souffles et les couleurs. Celui qui aborde un poème avec un cœur moins aventureux demeurera en deçà de l'honneur que la Providence lui fait d'une telle rencontre. Comme dans toutes les circonstances majeures de l'existence, tout se joue dans la déférence. S'orienter dans les ténèbres des signes réduits à eux-mêmes, jusqu'au matin, tel sera le courage du traducteur.
Avant de traduire d'une langue à une autre, dans ce monde « d'après Babel » où nous sommes précipités de naissance, le traducteur traduit du silence qui est en amont de l'oeuvre. Toute traduction est ainsi non seulement herméneutique, elle est aussi gnostique, à la condition de comprendre que le mot gnose ne renvoie pas ici aux théogonies des sectes d'Alexandrie qui voyaient en la création l'oeuvre du démon, mais à la connaissance, la gnosis que Platon distingue de l'opinion, de la doxa. Ce que le Moderne nie en niant la possibilité de la traduction, n'est rien d'autre que la tradition avec ses ramifications et ses arborescences. Enfermer chaque langue dans la prison de ses mécanismes, et chaque auteur dans le cachot de sa subjectivité intransmissible, soumettre les idées, les métaphysiques, les symboles et les mythes à des circonstances sociologiques, en un mot, expliquer le supérieur par l'inférieur, au point de ôter à l'esprit toute réalité, telle est l'ambition du Moderne qui ne peut établir son règne totalitaire qu'à ce prix. C'est à ce titre que l'on cherche, depuis plusieurs décennies, à nous faire croire que Platon, Dante, Shakespeare nous sont devenus incompréhensibles afin qu'ils le deviennent et que nous soit ôté ce lien aux gloires et aux autorités d'antan où nous puisons la force de résister aux offenses et aux pouvoirs d'aujourd'hui.
Ne voir que le mécanisme des êtres, des oeuvres et des choses, c'est hâter le moment où tous les êtres, toutes les oeuvres et toutes les choses seront entièrement livrés à un mécanisme. A l'analyse et à l'explication où le Moderne accomplit sa vocation titanique, Pierre Boutang oppose l'interprétation et la compréhension des gradations. A travers ses traductions de l'Ecclésiaste, de Sophocle, de Shelley ou de Rilke, Pierre Boutang fait l'expérience, non de mécanismes mais « d'une poésie secrètement unique dont il est naturel ou surnaturel qu'elle passe toute entière, non sans métamorphose, dans d'autres langues humaines parce qu'elle est la langue des dieux. Et puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, il faut que ce soit parce qu'elle est poésie et non prose. »
Le rapport essentiel qui rend possible ce périple odysséen ne sera donc pas celui qui s'établit, ou manque à s'établir, entre le poète traduit et le poète traducteur, ou entre la langue d'origine et la langue destinée mais, plus profondément, entre le poème et l'Auteur « L'être du poème à traduire, écrit Pierre Boutang, n'est de personne, il est comme le poème, présent dans sa langue - au point décisif de l'expérience. » Cette affirmation suffit à elle seule à marquer le différend qui oppose Pierre Boutang à la presque totalité des critiques qui furent ses contemporains. Loin de lancer devant soi l'être du poème ou quelque audacieuse et peut-être salvatrice hypothèse ontologique, la critique moderne fit de son mieux pour dénier à la poésie tout être, voire toute existence, à la rendre dépendante, non seulement de l'humain mais d'un humain défini selon des critères strictement déterministes.
Qu'il y eût un être du poème et donc, de la part du poète, comme du traducteur, la possibilité d'une gnose et d'une ontologie poétique, c'est bien là une hypothèse qui, non seulement ne fut pas envisagée mais dont il parut nécessaire, pour d'évidentes raisons d'orthopraxie matérialiste, d'exclure toute approche possible. Telle fut la sereine fulgurance de Pierre Boutang, en concordance avec sa fidélité, de nous faire comprendre que le poète est à la poésie ce que l'homme est à Dieu, le plus simplement du monde « un éclair dans un éclair » selon la formule étonnante d'Angélus Silésius. « Le traducteur auprès de cet être, écrit Pierre Boutang, ne diffère pas foncièrement du poète, lui-même effacé par son ouvrage. » Le tout est d'entendre ce qui est dit. A peine sommes-nous présents à notre esprit que nous devenons l'infini à nous-mêmes. Les vertus réfléchissantes de notre spéculation que la vérité métaphysique embrase, comme un soleil la surface des eaux, s'incarnent dans le chant. Dans les éclats illustres de cette transcendance immanente, nous abandonnons l'illusion dérisoire d'un poème issu de l'humain pour rejoindre l'élan de l'hypothèse audacieuse, odysséenne, d'une poésie reçue des dieux ou de Dieu.
Certes, l'être simple du poème, en tant que pure transcendance, est au-delà de la subjectivité et de l'objectivité, de même qu'il ignore l'opposition coutumière entre l'intérieur et l'extérieur. Toutefois, la façon la moins malencontreuse d'aborder le poème est encore de commencer par lui reconnaître cette grande vertu d'objectivité, où le Moi s'efface, et qui est le propre des natures héroïques et sacerdotales. L'oeuvre de Pierre Boutang et de Henry Montaigu se rejoignent là encore pour reconnaître dans cette vertu une prédestination surnaturelle de la langue française dont Boutang souligne « l'universalité et la vocation à traduire les proses de Babel et à les attirer sur un terrain commun ». Une fois dépassées les contingences, par l'immensité des désastres qui survinrent, l’ « action française » ne saurait plus être qu'une action du Logos français, une action oblative, c'est-à-dire une prière du coeur d'où naissent surnaturellement les prosodies de Scève, de Nerval ou d'Apollinaire. Pierre Boutang en témoigne: « La langue française ne devrait d'abord établir ses titres et son privilège que dans la traduction du poème et de tout ce qui demeure d'héroïque et de divin dans l'existence des hommes de toute origine ». L'universalité métaphysique non seulement ne dénie pas cette « disposition providentielle », elle en accomplit la vocation profonde.
23:00 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
Entretien pour la revue "Symbole":

Luc-Olivier d'Algange
Entretien pour la revue Symbole
Depuis une vingtaine d’années, vous avez publié plusieurs ouvrages et collaboré à de nombreuses revues. Vous n’êtes pas romancier, ni historien, ni essayiste – du moins au sens intellectuel et universitaire que ce mot a pris dans la production éditoriale ; plutôt poète et métaphysicien, ce qui est peut-être la même chose… Comment qualifier la nature de votre démarche d’écrivain, entre « littérature » et « gnose » (tous les mots sont piégés) ?
Luc-Olivier d'Algange: C’est le paradoxe éminent du langage d’être à la fois un piège et une possibilité de délivrance, un objet de fascination et un principe de communion. Nous sommes condamnés à nous débattre dans les rets du discours, non sans, de temps à autre, l’espoir d’un Grand-Large de poésie et de métaphysique. Entre la lettre morte et l’esprit qui vivifie, entre la citerne croupissante et l’eau vive, la différence est inaperçue, et généralement presque imperceptible. C’est elle pourtant qui distingue et qui sauve. Pour les esprits peu informés, sinon malintentionnés ou malappris, la « gnose » se réduit aux divagations de quelques extravagantes sectes alexandrines et quiconque use du mot doit donc être relégué parmi les hérésiarques. C’est oublier que la gnose est d’abord connaissance, et que le refus de toute connaissance est une autre hérésie : celle des « gnosimaques » qu’évoquent les traités de théologie.
Remarquons, en passant, que les Modernes s’en laissent, à l’excès, imposer par les mots, comme par les apparences. Le mot, qui ne prend sens que dans la phrase – qui elle-même ne prend sens que dans l’œuvre – agit sur eux à la façon d’un sigle, d’un « logo » publicitaire. Or le « logo » est l’exact inverse du logos, autrement dit de la logique ; et ce fut l’immense mérite de René Guénon de nous avoir rappelé, par l’exemple, qu’être métaphysicien, c’est aussi être logicien : c’est-à-dire donner aux mots un sens, non point immanent et immédiat, mais, si j’ose dire, transcendant et « réfracté ». Ce que résume parfaitement cette phrase de Saint Augustin, que j’aime à citer : « Nous qui savons ce que vous pensez, nous ne pouvons ignorer comment et en quel sens vous dites ces choses. » Le bon usage de la gnose serait ainsi de consentir à se laisser instruire, fût-ce par des réponses à des questions qui ne furent pas encore posées. Là se joue exactement la différence entre la certitude et la vérité, et plus encore entre l’administration de la « vérité », qui n’est plus alors qu’une certitude, humaine, trop humaine, et la quête de la vérité, le voyage vers les Îles vertes, vers le Graal.
J’userai donc du terme de gnose – même si je préfère ceux de « Sapience » et d’« herméneutique » – en dépit des équivoques et des hostilités qu’il suscite, en ce sens strictement platonicien qui distingue la gnôsis de la doxa, moins d’ailleurs pour les opposer que pour les hiérarchiser. De même que Platon n’oppose pas le sensible et l’intelligible, mais les distingue, en les unissant par, je cite, une gradation infinie, la doxa, la croyance, dans une perspective traditionnelle, ne s’oppose pas davantage à la gnôsis que la périphérie d’un cercle ne s’oppose à son centre. La gnose est un art de l’interprétation, autrement dit un voyage odysséen dont l’horizon est le Retour. L’herméneutique, loin de s’opposer à la lettre la sauve et la couronne. En ce sens, le gnostique, l’herméneute, est plus fidèle à la lettre que le littéraliste, qui en use à des fins politiques, dans une « praxis » publicitaire parfaitement accordée à l’absence d’esprit du monde moderne.
L’équivoque du mot « littérature » est du même ordre ; il y aurait ainsi une littérature « littéraliste », réduite au « travail du texte » et une littérature, si l’on ose dire, « contre-littéraliste », mais dont le « contre » est, pour ainsi dire, transmué en un « avec » – ce que suggère l’étymologie grecque du mot qui désigne l’écrivain, syngrapheus : « écrire avec ». L’écrivain, au sens non plus littéraliste ou nihiliste, serait alors celui qui écrit avec le visible et l’invisible, celui qui ne désespère pas des mots galvaudés et profanés ; qui entrevoit, dans l’air mouvementé de ses phrases, une chance de témoigner en faveur du Beau, du Bien et du Vrai. Mais les plus grandes incertitudes sont ici requises en même temps que les belles espérances. La gnose ne saurait être péremptoire ; elle s’achemine vers la vérité plus qu’elle ne la détient. Certes, comme le Sîmorgh de l’admirable récit d’Attâr, elle est déjà ce vers quoi elle vole, mais les œuvres sont encore les moments, les étapes, les « stations », de sa divine ignorance.
À cette gnose accordée à l’humilité, s’oppose peut-être une gnose arrogante, une gnose fallacieuse, mais celle-ci n’est autre que la technique moderne, qui juge de tout par l’utilité, et dont nul ne sut mieux décrire les ingéniosités controuvées que Villiers de L’Isle-Adam dans ses Contes Cruels. Le propre de cette gnose arrogante est comme le remarquait aussi Hannah Arendt, de nous « exproprier » du réel, c’est-à-dire de la contemplation et de l’œuvre, pour nous réduire à l’animalité sophistiquée du travail et de la consommation. Telle est la gnose qu’il faut combattre, mais par les armes de la gnose lumineuse, de la science du cœur. Avec, en fine pointe qui éclaire tout, la phrase de Saint Augustin. C’est, au fond, la question de la confiance. Ne point juger les choses de l’extérieur, en inférant de la forme, de l’apparence, ce qui est, comme le souligne Philippe Barthelet, le propre du Diable, mais à partir du cœur, à partir d’une sapience déjà acquise de toute éternité et qu’il suffit de retrouver, en toute innocence. Mais ce n’est pas en nous-mêmes que nous retrouverons cette sapience, mais en ceux à qui nous l’aurons fait partager ; qui pour nous, et mieux que nous, en témoigneront. La vérité est toujours « en communion ». La parole n’est pas dans la bouche de celui qui parle, ni dans l’oreille de celui qui entend, mais entre eux, dans cette espace auroral, incandescent, où quelques preuves de la Toute-Possibilité nous sont offertes.
Il est clair que vos référents, votre écriture, et si l’on peut dire, votre « humeur », sont profondément occidentaux et chrétiens. Or les éléments propres à la Tradition Occidentale semblent aujourd’hui en plein reflux face à la déferlante mondiale d’une « spiritualité » marquée par un orientalisme assez douteux au plan doctrinal, ou par un syncrétisme New Age encore plus frelaté ! Comment déblayer aujourd’hui les voies d’accès à notre propre patrimoine spirituel ?
Luc-Olivier d'Algange: Croire au libre-arbitre, selon une inclination précisément occidentale et catholique, à laquelle s’oppose aussi bien le déterminisme que le fatalisme, c’est comprendre que nous sommes, sans cesse et en toute chose, confrontés à un en-deçà et un au-delà. Loin d’être binaires ou latérales, les idées sont verticales et hiérarchiques, avec des nuances d’infini – ou d’infinies nuances. La sociologie et la philosophie moderne excellent à nous réduire à des choix fallacieux : individualisme ou communautarisme, universalité ou enracinement, c’est oublier tout simplement qu’il existe une universalité de l’en-deçà, et une universalité de l’au-delà – celle-là même dont nous entretient magistralement René Guénon. L’universalité de l’en deçà est fondée sur le syncrétisme, la confusion des genres, l’amalgame empoisonné, la fantasmagorie totalitaire du « village planétaire », et se déploie en « orientalomanies » qui, non sans une certaine arrogance colonialiste, s’en vont piller de vénérables traditions étrangères, pour y trouver des « thérapies alternatives », un vague jargon et des « méthodes » pour « redynamiser » des cadres stressés. Le « New Age » se reconnaît à son idiome, ses anglicismes, sa mollesse intellectuelle, son côté « parc d’attraction » et son goût de la promiscuité. Tout y a été filtré par l’ignorance et les traditions évoquées y sont représentées comme le sont les châteaux médiévaux à Disney World. Le Moderne est fasciné par l’archaïque, par l’originel, mais cette fascination est, pour lui, une véritable régression, une déchéance en-deçà de la raison, une barbarie toute clinquante de « technologies nouvelles », une superstition odieuse et ridicule à laquelle le terme d’obscurantiste convient assez bien et même beaucoup mieux qu’à l’usage que l’on en fît naguère. L’obscurantisme restait à inventer : c’est chose faite.
On ne peut qu’être agacé par ce mépris de toute étude patiente, de toute discipline réelle, cette outrecuidance d’ignorantins qui « zappent » entre le bouddhisme, le taoïsme, les Védas, le chamanisme, alors que les nerfs leur manquent pour lire Platon ou Saint Augustin et qu’ils demeurent aveugles et sourds dans une cathédrale ! Certes, la Tradition, au sens du tradere, suppose que l’on puisse passer d’une langue à une autre, mais encore faut-il partir de quelque part. Or, si quelques aperçus de l’Universel me sont donnés, c’est précisément par la fidélité aux ressources de ma langue, par les symboles qui tout d’abord s’offrirent à moi, de cette façon ingénue que résume la phrase de Descartes : « Ma religion est celle de mon Roi et de ma nourrisse. »
Ce qui est donné n’est point si méprisable. Nietzsche disait que le propre du nihiliste est de haïr son passé. Pour ma part, j’aime naturellement et naïvement ce qui me fut donné, et je ne puis me défendre du sentiment d’avoir reçu bien plus que je ne puis donner. Le Moderne, quant à lui, semble animé par une aversion extrême à l’égard de ce qui est et de ce qu’il est. D’où ces ritournelles de repentances, de contritions malvenues ; d’où la haine de soi, la fuite dans l’exotisme, qui prédilectionne ce qu’il ne peut comprendre au détriment d’un héritage prodigieux qui se propose à lui dans son propre pays et dans sa propre langue. L’idéal du moderne est touristique ; c’est de n’être nulle part chez lui et de n’être jamais là tout en étant ailleurs. Toutes les technologies modernes servent à ce dessein ; nous arracher à notre être-là, nous diffuser dans le néant afin d’échapper à la difficulté d’être.
Il n’en demeure pas moins qu’étant occidentaux et chrétiens, et même, plus exactement, Français et catholiques, maintes voies nous sont offertes de recevoir de l’Orient des lumières qui ne sont ni artificieuses ni vaines. Gérard de Nerval et René Guénon, Henry Montaigu et Henry Bosco, laissent advenir l’Orient, en reçoivent des nuances pour mieux comprendre leurs propres symboles – ce qui, dans leurs propres symboles, témoigne de l’universalité métaphysique. Mais qu’aurais-je compris de Sohravardî, ou de Ruzbehân de Shîraz sans la lecture de Plotin ? Comment mieux saisir le sens de la Futûwah, de la chevalerie soufie, qu’à partir de la pensée romane et occitannienne des Fidèles d’Amour ? Et c’est encore la « déité » eckhartienne qui nous donne une chance de saisir la « non-dualité » védantique. René Guénon, enfin, s’il faut le rappeler, est un écrivain français et c’est à travers le prisme de la langue française qu’il nous donne à penser le sens de l’Universalité. Comme le montre magistralement l’œuvre de Jean Biès, un entretien infini est possible entre l’Orient et l’Occident, mais encore faut-il qu’il y ait un « de part et d’autre », encore faut-il être quelque part, avoir quelque chose à dire, et à traduire, dans une langue profondément reliée à ses arcanes, ses étymologies, ses profondeurs et ses raisons d’être, une langue qui soit un monde, un « cosmos », où la totalité du monde peut venir miroiter, se faire lumière et splendeur, une langue de sourcier, éprises de ses courants souterrains, qui resurgissent à l’improviste dans la simplicité d’un paysage à la ressemblance de notre âme. Que faire, me demandez-vous, pour retrouver les voies d’accès à notre propre patrimoine spirituel ? Retrouver, peut-être, une innocence, une gratitude, par le ressouvenir du bruissement des peupliers.
On note souvent, en vous lisant, à quel point la modernité – la laideur et la lourdeur de ses productions – semble vous peser ; « le monde moderne change l’or en plomb », écrivez-vous dans le livre que vous avez de publié aux éditions Les Deux Océans, L’Étincelle d’Or. En quoi la modernité est-elle – plus que jamais ? – une « contre-civilisation » ? Quelle analyse faites-vous de l’évolution de ses « méfaits » mis en exergue notamment par Guénon – y a-t-il par exemple, selon vous, des compensations à l’aggravation de certaines de ses tendances ? Enfin, comment vivre et œuvrer, là au milieu, en état de résistance constante ?
Luc-Olivier d'Algange: « La laideur et la lourdeur » : tout est dit. On peut, certes, tenter de dessiller le Moderne sur cette époque « formidable », tenter de lui montrer que tout y fonctionne par antiphrase ; que la liberté qu’on lui vante pour sa conquête est celle dont on le prive, lui expliquer que les adeptes de la « Déesse Raison » firent la preuve de leur bonne foi en réinventant, de façon citoyenne, la cannibalisme et les sacrifices humains. On peut s’épuiser en démonstrations, en explications sur les idoles sanglantes de la modernité, l’entendement demeure sourd et aveugle. Le propre du Moderne est de ne rien voir, en dehors de son univers domestique et privé. Que lui importent les têtes au bout des piques s’il se persuade qu’elles sont à l’origine de son confort présent ! Le Moderne pratique le chauvinisme temporel : cette époque est meilleure que les autres, car il s’y trouve, elle est son écrin. L’esclave sans maître est le joyau. La croyance est alors plus forte que toute vérité. Ceux qui regimbent à la propagande sont des plus rares. Ayant renoncé à la vanité de se croire plus intelligents que leurs ancêtres, ils sont sauvés par le goût, par une préférence pour la légèreté, pour l’honneur, et peut-être, pour une certaine forme de solitude, mais d’une solitude oublieuse de soi-même. « Cet homme, écrivait La Rouchefoucauld, n’a pas assez d’étoffe pour être bon ». Le Moderne fait grand étalage de sa bonté, de sa sentimentalité, mais l’étoffe lui manque, sa méchanceté se confond avec sa bêtise. Hannah Arendt parlait à juste titre de la « banalité du Mal ». La civilité, sans quoi il n’est pas de civilisation, est elle aussi une question de goût et d’étoffe.
Le Moderne, plus « réaliste » remplace tout cela par l’idéologie, par la certitude d’incarner le « Bien », ce qui lui fait une âme étroite et un cœur endurci. L’homme de la Tradition – lorsque cette Tradition n’est pas devenue pour lui une autre idéologie – est plus ondoyant, plus incertain : il chemine vers la vérité et son combat contre le Mal est d’abord un combat contre lui-même, cette grande guerre sainte qui doit nous arracher à la lourdeur, nous inviter aux « randonnées célestes » dont parle les taoïstes. Le Mal n’est que l’absence du Bien ; il s’agit donc d’être présent, de consentir à la présence, à la solennité légère du passé, non pour y revenir ou le « restaurer » – comme le disait Gustave Thibon : « on ne greffe pas une tête sur une voiture » –, mais par déférence – qui est encore une question de bon goût. En exergue à son Histoire secrète de l’Aquitaine, Henry Montaigu citait Joseph Joubert : « Le léger domine le lourd. Quand la lumière domine l’ombre, quand le fin domine l’épais, quand le clair domine l’obscur, quand l’esprit domine les corps, l’intelligence la matière, alors le beau domine le difforme et le bien domine le mal. »
Comment vivre et œuvrer ? Je vous avoue que, chaque jour, je me pose la question, chaque jour je tente d’y trouver une réponse. Les stoïciens nous disent : « Fais en sorte que ce sur quoi tu ne peux rien ne puisse rien sur toi ». Mais avons-nous encore le caractère assez bien trempé pour cette morale hautaine ? Chaque jour ce sont des coups de massue et des coups d’épingle. Tout, dans ce monde nous insulte, nous outrage, nous humilie. Il nous reste cependant une sorte d’insouciance, de désinvolture, qui est peut-être la part la plus précieuse, dans l’ordre du combat, de notre héritage, ou un secret d’espérance que disent les poètes : « De nouveau la plénitude des temps… Midis étourdis où couraient les ombres… »
L’Étincelle d’Or est une série de méditations sur la Science d’Hermès. Cette idée que l’herméneutique en tant que « reconnaissance et résurrection du Sens » est, écrivez-vous, « ce qui vivifie l’esprit sous les cendres de la lettre morte des religions réduites à leurs aspects purement extérieurs » est-elle une façon de rappeler que l’homme est, par nature, capax dei – et que l’Esprit souffle où Il veut sur les braises de cette conscience spirituelle enténébrée dans la « nuit apocalyptique » qu’évoque Jean Biès ?
Luc-Olivier d'Algange: « L’Esprit souffle où Il veut ». C’est une vérité que nous oublions et retrouvons sans cesse. Elle est, cette vérité, dans nos entendements obscurcis, comme « un commencement sans fin ». Tout nous subjugue à l’oublier et tout nous rappelle à elle, qui surgit à l’improviste : et soudain le souffle de l’Esprit anime le monde. Si le Moderne n’est pas plus méchant homme que ses prédécesseurs, si toutefois il lui manque bien souvent l’étoffe pour être bon, c’est encore son inattention qui l’écarte de sa propre vérité, et de la nature divine de cette vérité. Il me semble qu’entre leurs oreillettes et leurs écrans, leurs idéologies et leurs certitudes, les Modernes s’évertuent à ne rien voir, à ne rien entendre, à passer à côté de tout ce qui importe, tant dans l’ordre du sensible que de l’intelligible. Les ténèbres du temps, qui temporisent, et dont les inconséquences, hélas, tirent à conséquence, me semblent moins le fait d’une absence de foi, de croyance, que d’un déclin de l’attention. Le Moderne regorge de croyances, c’est une foire de certitudes infondées. Il croit en l’Homme, en l’Avenir, au Progrès, en la Démocratie, et en tout ce qu’on voudra écrire en majuscule, mais qu’en est-il de l’attention, qui hausse la température du temps, qui porte l’heure à l’incandescence, qui révèle les « signatures », les empreintes du sceau invisible ? L’Esprit souffle où il veut… N’est-ce point à dire que nous avons désormais davantage besoin de l’attention que de la croyance, n’est-ce point à dire qu’il faut tout ôter à la certitude pour tout restituer à la vérité ?
La théologie lorsqu’elle se tient se tient malheureusement en-deçà de la « métaphysique » – au sens précis que René Guénon donne au mot –, lorsqu’elle est encline à « l’exotérisme dominateur », pour reprendre la formule de Jean Tourniac, cette théologie partielle et partiale, oublieuse bien souvent des textes dont elle se réclame, semble condamnée à étayer la croyance, à vouloir démontrer « l’existence de Dieu » et s’emprisonne ainsi dans le syllogisme. Que vaut l’existence de ce qu’il faudrait démontrer ? L’existence n’appartient-elle pas à l’évidence ? N’est-ce point l’existence qui prouve Dieu ? Est-ce à notre pauvre raison de prouver l’existence de Dieu ? N’est-ce point, par ailleurs, pure idolâtrie que de réduire Dieu à un « existant » ou à un « étant », fût-t-il un « Étant suprême » ? Si Dieu est la « cause causatrice », s’il est en amont de tout ce qui existe et de tout ce qui est, c’est à partir d’une métaphysique de l’Être à l’impératif que nous pourrons dissiper les ténèbres de l’entendement : Être non pas au substantif – l’étant – ni même à l’infinitif – l’être de l’ontologie parménidienne –, mais l’être à l’impératif, Esto ! : « Que la lumière soit ! ». L’Esprit souffle au-delà de l’Être et du non-être, Il est cette possibilité universelle qui, en toute chose visible et invisible s’offre à notre attention, qui retourne les apparences des mondes, en leur vérité écumante, en leur beauté « de Foudre et de Vent ».
Vous rappelez que l’Alchimie est une science à la fois royale et sacerdotale, issue de la Tradition Primordiale. Au-delà de toutes les erreurs de perspective et d’interprétation dont elle peut faire l’objet, n’est-ce pas aujourd’hui la confrontation à la beauté – celle du poème, de l’œuvre d’art ou de la nature – qui peut jouer le rôle de puissance d’effraction et d’éveil ?
Luc-Olivier d'Algange: La beauté est le « château tournoyant », elle est ce qui résiste. « Splendeur du vrai », écrivait Platon ; ne nous étonnons pas que les Modernes s’acharnent contre elle. Dans tout l’espace du visible, ce qui est moderne se reconnaît infailliblement par la laideur. Qu’on ne vienne pas nous opposer les productions des esthètes modernes, colonnes de Buren ou gratte-ciel miroitants ! Regardons simplement nos villes, comparons les cœurs de ville médiévaux et leurs alentours récents. Regardons ces espaces désorientés, littéralement désastrés… Dans son évidence première, la modernité est un raz-de-marée de laideur dont les marées noires sur les plages bretonnes sont la métaphore parfaite. La beauté de l’art et la beauté de la nature sont une seule et même beauté. La beauté est cette instance où l’art et la nature cessent de s’opposer. Ainsi de l’architecture traditionnelle dont le propre est de s’intégrer dans le paysage, d’en prolonger le mystère. La phrase du poète prolonge le geste de la nature. Chaque temple est la réverbération du ciel. Le paradoxe d’Oscar Wilde, selon lequel « ce n’est pas l’art qui imite la nature mais la nature qui imite l’art », nous fait entrevoir, dans une perspective platonicienne, cette gradation entre le sensible et l’intelligible. La nature et le poème sont également créations du Verbe.
« Les symboles et les mythes, écrit René Guénon, n’ont jamais eu pour rôle de représenter le mouvement des astres, mais la vérité est qu’on y trouve souvent des figures inspirées de celui-ci et destinées à exprimer analogiquement tout autre chose, parce que les lois de ce mouvement traduisent physiquement les principes métaphysiques dont elles dépendent. » Aperçu capital, à partir duquel nous comprenons que la beauté, qu’elle soit de l’art ou de la nature, témoigne d’une vérité plus haute ; que la beauté est ce qui nous rejoint, qu’elle est cette réalité pontificale, cette « passerelle du vent », comme disent les Japonais, qui nous fait signe de l’autre côté des apparences, de l’autre côté des temps. D’où l’importance de l’attention, de l’herméneutique, qui ne doit pas être seulement une herméneutique des textes sacrés, mais aussi une herméneutique du monde, du cosmos. Revenons encore à René Guénon : « Le Verbe, le Logos, est à la fois Pensée et Parole : en soi, Il est l’Intellect divin, qui est le lieu des possibles ; par rapport à nous, Il se manifeste et s’exprime par la Création, où se réalisent dans l’existence actuelle certains de ces mêmes possibles qui, en tant qu’essences, sont contenus en lui de toute éternité. La Création est l’œuvre du Verbe ; elle est aussi, et par là même, sa manifestation, son affirmation extérieure ; et c’est pourquoi le monde est comme un langage divin à ceux qui savent le comprendre. »
« Entrer dans le secret alchimique, écrivez-vous, c’est entrer, par la contemplation, dans la réalité métaphysique du symbole », pour peu que s’opère cette conversion du regard à la lumière, que vous évoquez par ailleurs et contre quoi tout conspire. Dans quelle mesure l’accès à cette « connaissance visionnaire » est-elle une quête – et donc un combat – dont la compréhension du langage symbolique serait à la fois le moyen et la fin ?
Luc-Olivier d'Algange: La quête est un combat. Cette dimension héroïque est accentuée encore par le caractère des temps qui sont les nôtres, temps de distractions, de confusion, de vacarme, de dissipation. Les heures calmes et studieuses nous sont comptées. Tout conjure à l’activisme le plus inepte, au brouillage, à la crétinisation. Les intellectuels eux-mêmes sont devenus les pires ennemis de l’Intellect. L’œuvre alchimique s’oppose de toute sa fragilité au « désœuvre » du monde moderne, qui change l’or en plomb. Apathique ou agitée, distraite ou travailleuse, la modernité est « désoeuvrante ». Ces heures glorieuses, ces heures rayonnantes, ces heures d’éternité et de communion qui nous sont offertes par la beauté du monde, dans la clairière de l’être, elle s’acharne à en faire, dans une perspective strictement utilitaire et fiduciaire, un abominable compte à rebours. Le langage symbolique nous restitue à ce qui, dans le temps, témoigne de l’éternité – qui donne au combat, à la quête, cette légèreté heureuse, qui, parfois, nous rend victorieux de nos propres faiblesses.
Quel est le rôle du poète dans ce combat, quel peut-il être dans un monde où l’écrit semble submergé ?
Luc-Olivier d'Algange: L’écrit est submergé par le fracas médiatique, mais il est aussi submergé par lui-même. La démocratie a substitué la censure par noyade à la censure par coupure. Tout est fabriqué pour nous persuader que les mots ne veulent plus rien dire. Les discours journalistiques, universitaires, politiques, publicitaires sont les écorces mortes du Sens, à quoi s’ajoute encore le bavardage commun, particulièrement autistique. L’art même de la conversation est un art oublié… Le poète ne peut se fonder que sur un paradoxe d’espérance : tout est gagné lorsque tout semble perdu. La profanation du Logos est parvenue à une telle arrogance offensive que le simple usage de la langue française, dans son mouvement naturel suffit à nous distinguer, à nous sauver. Croyons davantage au génie de notre langue qu’en nos propres talents ! Croyons aux bonheurs de notre langue, à ce qu’elle nous inspire, à l’héraldique des mots, aux palimpsestes merveilleux !
Vous revenez à diverses reprises, dans ces méditations, sur l’importance du secret, dont la « haine » est caractéristique de l’esprit moderne. C’est parce qu’elle est marquée du sceau du secret, rayonnante d’une réalité blasonnée, que la langue alchimique, affirmez-vous, pourrait devenir « l’ultime gardienne de l’être devant le néant dévorant du monde moderne qui s’est choisi pour Père, l’Économie, pour Fils, la Technique, et pour Saint-Esprit, la Marchandise ! » Autrement dit le langage du symbole est celui de la liberté absolue et le lieu de tous les possibles ?
Luc-Olivier d'Algange: La haine du secret – et donc du sacré –, dont René Guénon nous dit qu’elle est l’un des « Signes des Temps », est sans doute la première des haines modernes. Ce monde transparent que rêve le Moderne est un monde sous contrôle, un monde dont la liberté a été parfaitement éradiquée. Le totalitarisme du monde des esclaves sans maîtres tolère tout sauf ce qui semble échapper au monde social, au grégarisme, aux collectivismes, à la platitude. Toute l’énergie du monde moderne consiste à nous réduire à un seul état d’être, le plus bas. Pour le Moderne, la vie intérieure est une offense. Elle est une offense, car elle relie ce monde-ci à un autre monde, car elle instaure une verticalité, car elle discerne au-delà des servitudes, du déterminisme, une liberté absolue. La haine du secret est l’envers de la haine de la liberté. La liberté qui n’est autre que l’effusion lumineuse et versicolore du Saint-Esprit. Le déchiffrement du langage des symboles est une attente du « sens secret », une advenue du « suprasensible », autrement dit, des possibles déployés en corolles – et l’on devrait ici parler du symbolisme floral, mais aussi de la « langue des oiseaux », langue angélique, où l’ici-bas rime avec l’au-delà, en nous ressouvenant de la parabole évangélique des « oiseaux du ciel » venant se poser sur les branches de l’Arbre – symbole, selon la formule de René Guénon, « de l’axe passant par le centre de chaque état d’être et reliant tous les états entre eux. »

Dernier livre paru: L'Ame secrète de l'Europe, Oeuvres, mythologies, cités emblématiques, éditions de L'Harmattan, collection Théôria.
17:47 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
22/01/2022
Note sur l'au-delà et l'en-deçà:

Luc-Olivier d'Algange
Note sur l'au-delà et l'en-deçà
A la magistrale typologie du monde moderne comme Règne de la Quantité, que nous devons à René Guénon, les périodes les plus récentes, dont nous eûmes le privilège assez sinistre d'être les contemporains, nous inclinent à ajouter cette caractéristique mineure, mais persistante que, faute de mieux, nous nommerons l'antiphrase.
L'antiphrase, dont nous parlons ici, n'est pas l'ironie espiègle de Novalis ou de Schlegel, et pas davantage le sarcasme voltairien, dans la mesure où, gardant par devers elle sa duplice malignité, elle se donne, et se laisse recevoir, presque sans exceptions, comme une pure vérité.
Que le monde moderne soit de plus en plus antiphrastique, après avoir été périphrastique ( en faisant, par exemple, insulte suprême, des pauvres, des « économiquement faibles ») que ses discours soient, dans leur immense majorité de l'ordre du Dédire, du renversement ou de la subversion d'une vérité ou d'un principe, il suffit pour s'en convaincre d'observer avec quelle ardeur les apologistes du monde moderne (ces « intellectuel » qui nient l'existence de l'Intellect) s'acharnent à nous vanter les vertus même dont ils nous privent.
Alors que jamais, dans toute l'histoire de l'humanité, les individus ne furent l'objet d'un contrôle aussi rigoureux, que jamais leurs libertés d'être et de penser ne furent soumises à d'aussi tyranniques restrictions, le monde moderne, par la voix de ses publicistes stipendiés, ne cesse de nous chanter les gloires de l'individu et de la liberté. L'égalité qu'il nous vante comme sa conquête est contredite par les plus cruelles iniquités, de même que son prétendu « hédonisme » l'est par la laideur croissante de nos cités, et par la nature, de plus en plus impitoyablement disciplinaire et morose de ses travaux comme de ses distractions.
Ce que le monde moderne prétendit nous offrir en échange de notre renoncement au sacré, nous est ainsi ôté comme par surcroît. Dans cette ironie sinistre, bien rares sont ceux qui reconnaissent la marque de l'Adversaire, de celui qui divise et qui leurre. Goethe dans le premier Faust, nous montre que son personnage est d'abord une dupe. Ce que le Diable offre en échange de l'âme immortelle est une illusion. Ce que le monde moderne prétend offrir à notre impatience, à notre paresse, à notre cupidité et à notre veulerie, en échange de la répudiation de nos vertus chevaleresques et contemplatives, n'existe pas.
La vanité qu'il flatte nous livre aux plus terribles humiliations, les facilités qu'il nous fait miroiter nous exposent aux épreuves, la diversité qu'il nous promet nous ramène à la plus sinistre uniformité. Les sociétés à prétentions individualistes s'avèrent ainsi abominablement massifiées, de même que les sociétés à prétentions collectivistes isolèrent l'individu dans un esseulement dérélictoire, sous la surveillance des autres. Il en va de même de la promesse d'universalité, dont les Modernes dans le sillage de la philosophie « des Lumières », se firent un étendard. Les œuvres de cette universalité moderne, nous la voyons; ce sont les guerres ethniques, le fanatisme des tribus et des clans, la commercialisation de la mort violente, l'effroi qui agrège l'individu privé de sens, aux premières et plus artificieuse « communautés » qui s'offrent à le protéger, à lui donner l'illusion de la cohésion intérieure qui lui fait défaut.
L'antiphrase moderne s'étend à tous les domaines. Les machines qui devaient accroître notre indépendance nous enchaînent, la fameuse « communication » moderne nous isole derrière nos écrans et ce ne sont plus les hommes qui s'entretiennent entre eux par l'entremise des machines mais les machines qui s'entretiennent entre elles par l'entremise des hommes qui n'ont plus rien à se dire.
Ce village planétaire où les hommes devaient vivre en paix, ressemble de plus en plus à une banlieue planétaire où l'uniformité des mœurs et des styles exacerbe encore les méfiances et les inimitiés. Si l'égalitarisme moderne sut, en effet, faire disparaître toutes les institutions fondées sur l'inégalité protectrice, la générosité du Maître envers le disciple, le sentiment de déférence à l'égard des plus anciens et des plus sages, il donna aussi toute licence au pouvoir, et particulièrement au pouvoir de l'argent, dont aucune autorité ne limite plus, désormais, les abus.
Les Modernes semblent cependant avoir la plus grande peine à s'avouer dupés et persistent, non sans accabler les époques révolues de calamités imaginaires, à trouver, contre toute raison, leur époque préférable à toutes les autres, sans douter parce qu'ils s'y trouvent et que, ne pouvant s'en échapper, ils aiment ainsi à dorer leurs chaînes.
Naguère encore, les hommes vouaient un amour exclusif à leur pays, étendant, comme Maurice Barrès, leur culte du Moi à une sorte de culte du Nous, et de vénération des ancêtres et du terroir. Le culte du Moi du Moderne, tel que nous le voyons aujourd'hui se réduit à l'identification avec la durée de son corps, avec la fraction du temps où il se trouve. Chauvin de sa temporalité, de son Moi réduit à la durée de son corps, le Moderne semble croire en une universalité purement immanente: notion elle-aussi éminemment antiphrastique car l'Universel, étant, par définition, de l'ordre de la métaphysique, et d'elle seule, il ne saurait être, dans le registre de l'immanence que l'expression d'une volonté d'uniformisation. Les sciences politiques, dès lors qu'elles méconnaissent la perspective métaphysique, se bornent ainsi à opposer le pareil au même, à nous induire dans l'erreur de leurs fausses alternatives qui opposent les idéologies de la communauté à celles de l'individu, alors qu'il n'est pire collectivisme que l'individualisme de masse, ni de pire solitude que celle de l'homme réduit à une collectivité purement immanente.
Or, l'individu n'est rien, ou presque rien, mais ce « presque rien » se situe à l'intersection d'un au-delà et d'un en-deçà. L'individu n'est presque rien, car le peu qu'il puisse être, il le doit à son héritage, sa lignée, les traditions de son pays, et par dessus tout, à la rivière scintillante de sa langue. Les hommes n'échappent à l'informe, à la confusion, au chaos que par ce qui les distingue les uns des autres, les langues, les religions, les civilisations et les styles. Ces distinctions, quoiqu'à une échelle beaucoup plus grande, sont, comme les individus, la proie du Temps. Elles se situent dans le passage, la transition, la nuance et l'éphémère: elles sont des tracés de lumière qui s'évanouissent entre les apparences.
L'individu n'est rien, et si l'on peut dire qu'il n'est presque rien, ce presque tient tout entier en ce qu'il reçoit et qu'il lui appartient de traduire et de transmettre. De même que le langage ne se situe ni dans la bouche de celui qui parle, ni dans l'oreille de celui l'entend, mais dans un mystérieux entre deux, l'individu se tient à la lisière du moins et du plus, d'un accroissement, d'une glorification, voire d'une déification, ou d'un déclin, d'une déchéance, d'un obscurcissement. Mais tel fut, de tout temps, l'enseignement de la Tradition que pour être plus, il faut consentir à être moins. A l'outrecuidance du Moderne, à son inépuisable vanité, nous devons la destruction et la profanation des savantes humilités qui jadis, permettaient aux hommes, par l'étude patiente, l'ascèse, ou le simple exercice quotidien de la magnanimité, d'échapper à l'infantilisme et à la bestialité qui sont le propre de l'en-deçà de l'individualisme.
Dépourvus de la perspective verticale, métaphysique, hiérarchique, incapables de discerner l'en-deçà de l'au-delà de l'individu, les Modernes ne discernent pas davantage la confusion de la synthèse qu'ils ne distinguent le totalitarisme de la souveraineté. Il est tout aussi impossible de fonder une cité sur l'individu que sur sa négation: nier le « presque rien » ne saurait être une affirmation fondatrice. L'essentiel de la question qui nous intéresse ici semble avoir été posée par Hölderlin: « Le langage le plus dangereux de tous les biens, a été donné à l'homme afin qu'il puisse témoigner avoir hérité ce qu'il est. »
L'au-delà et l'en-deçà de l'individualisme renvoie à l'idée que nous nous faisons de l'au-delà et l'en-deçà du langage. L'en-deçà du langage n'est pas un mystère, ni même une énigme. Il est cet abandon de la forme qui aboutit à la confusion des formes, au conformisme uniformisateur. Celui qui ne sait plus nommer les êtres et les choses, les sentiments, les idées et leurs nuances, s'abstrait du monde et s'incarcère lui-même dans sa propre subjectivité, jusqu'à la démence. Infantile et bestiale la modernité apparaît non seulement, selon le mot de Bernanos, comme « une gigantesque conjuration contre toute forme de vie intérieure », mais aussi comme une conjuration contre le Verbe.
Qu'avons-nous que nous n'ayons point reçu ? Toute la modernité semble arc-boutée contre cette question augustinienne. La grande passion de l'homme moderne est de n'être redevable à rien ni à personne. Après s'être révolté contre tous les signes extérieurs de l'Autorité et de la générosité, il était fatal qu'il en vint à exercer son ressentiment contre le langage lui-même, dont la grammaire et l'étymologie lui rappellent à chaque instant l'origine bafouée, l'ordre du monde et la souveraineté du Verbe et de l'Esprit. Ce langage qui, selon la formule d'Hölderlin, à été « donné à l'homme », les Modernes n'eurent de cesse de l'humilier, de le profaner, de l'enlaidir jusqu'à obscurcir l'entendement humain, l'asservir à la pure fascination des images, à l'immédiateté toute-puissante de ce qui ne peut être interprété.
Alors que l'herméneutique traditionnelle était un exercice de patience et de déférence, une attente contemplative et une prière devant le mystère des signes, l'outrecuidance moderne s'ingénie à la « déconstruction » et à la « démystification » de ce qu'il s'est rendu incapable de comprendre. Des textes, qu'ils soient sacrés ou profanes, le Moderne ne veut entendre ce qu'ils disent, et ses gloses savantes sont toute acharnées à démonter ce qu'il croit être des mécanismes. Ces négateurs de la Vérité ne trouvent pas davantage de vérité dans ces textes qu'ils dissèquent que le déconstructeur d'un clavecin ne trouvera l'essence de la musique dans l'instrument qu'il aura réduit en pièces détachées.
Savantasse ou vulgaire, la négation du Verbe tient tout entière dans le refus de considérer l'individu ou le langage dans la perspective de leur au-delà. A ces propagateurs du cri, de la vocifération ou de l'hébétude, les Théologiens du Moyen-âge, qu'il importerait de relire avant que leurs œuvres ne fussent définitivement hors d'atteinte, oppose l'idée du monde comme rhétorique ou grammaire de Dieu. Au vacarme silencieux comme la mort de l'en-deçà du langage, la Théologie médiévale oppose le silence lumineux de la vox cordis, de la voix du cœur. La véritable universalité n'est pas dans l'uniformité, dans le syncrétisme des rites et des styles, mais en amont des formes, dans le sceau invisible dont les signes dont nous usons sont les empreintes visibles. Toute grande poésie, toute grande musique, toute métaphysique digne de ce nom porte en elle le mystère de ce lumineux silence antérieur de la vox cordis. Par le désir de son au-delà, l'individu s'approche de ce silence antérieur qui n'est autre que la communion, alors que cédant à son en-deçà il se livre à la fascination des écorces mortes.
Ce que les Théologiens nomment le libre-arbitre tient en cette alternative de la communion et de la fascination: ce pourquoi notre langage est bien, comme le disait Hölderlin, « le plus dangereux des biens ». Entre la fascination des signes réduits à eux-mêmes, qui divisent et qui accusent sans cesse, dans l'outrecuidance des subjectivités fanatisées et la Mort d'une uniformisation qu'ourdissent les adeptes d'une mondialisation, dérisoirement nommée « village planétaire », qui n'est autre que de la puissance pure livrée à elle-même dans le déni de toute autorité, l'individu paraît voué à la perte, s'il ne consent à répondre à l'appel de la voix du cœur, s'il n'oriente à l'exemple du chevalier de Dürer, sa monture vers la cité céleste, vers le château tournoyant, vers le Graal.
Les philosophes néoplatoniciens, dont les ultimes surgeons fleurirent dans les œuvres des poètes, Shelley et Hugo von Hofmannsthal faisant écho à Plotin et à Proclus, décrivent le cheminement de l'âme, la pérégrination odysséenne, à la fois comme une aventure interprétative, une herméneutique, et comme une procession ascendante vers l'Un.
A la fois spéculative et visionnaire, la philosophie néoplatonicienne, ascétique et lyrique, décrit, mieux de toute autre, ce passage si périlleux de l'en-çà vers l'au-delà. L'extinction du Moi qu'elle pressent est à la fois l'aboutissement et le préalable de la Sagesse. L'Universalité qu'elle présume exige, pour être réalisée, l'exercice de la patience et la fidélité aux formes données. Point de science des états multiples de l'Etre sans un art de la gradation. Entre les ténèbres de l'uniformité, et le resplendissement de l'Unificence, entre l'indéfini de la confusion et le « sans-Limite », les philosophies néoplatonicienne décrivent un graduel de l'attestation de l'Unique.
Le Traité de l'Incarnation de la Simorgh, de Sohravardi, distingue ainsi cinq degrés. Le premier degré, correspondant à l'exotérisme dominateur, consistant à dire « Il n'y a de Dieu que ce Dieu » Le second, correspondant à l'expérience œcuménique, disant « IL n'y a de Lui que Lui », le troisième, correspondant à l'expérience mystique, consistant à dire « Il n'y a de Toi que Toi ».
Au-delà de ce groupe, écrit Sohravardî, il y en a un quatrième, plus élevé encore, qui dit ceci: « quiconque s'adresse à quelqu'un d'autre à la seconde personne (en lui disant tu) le tient encore séparé de soi et donne ainsi une réalité positive à la dualité. Or, la dualité est loin du monde de l'Unité. Alors ils s'occultent et s'effacent en eux-mêmes dans l'épiphanie divine, et leur attestation de l'Unique consiste à dire " il n'y a de Moi que Moi" Quant aux plus avancés d'entre eux, en expérience intérieure, ils disent Egoïté, tuïté, ipséïté tout cela ne sont que des points de vue qui se surajoutent à l'essence éternelle de l'Unique. Les trois mots (lui, toi, je) ils les submergent dans l'océan de l'effacement. »
Hélas, à cette gradation vers le haut, que propose Sohravardî, qui commence avec Dieu et s'achève sans le Sans-Limite, le monde moderne, propose une gradation vers le bas, ou, plus exactement, selon la formule de Léon Bloy, une ruée vers la bas où le culte de l'indistinction se confond avec cet en-deçà du langage dont le premier signe est l'empire croissant de la laideur, et d'une laideur qui, faute de points de comparaison, n'est plus reconnue comme telle. Un relativisme général s'instaure qui nous invite à quitter nos demeures, à renier nos styles, nos arts, nos formes, nos qualités, à profaner nos lieux saints et nos sites sacrés, à oublier nos prières, à déserter les châteaux de l'âme. L'idéologie du « pareil au même » seconde ce relativisme en nous persuadant de l'inutilité, voire de l'immoralité de tout héritage et de toute fidélité. Si, pour l'homme de cœur, ses semblables ne se réduisent pas à la forme qu'ils servent, à la religion qu'ils honorent, pour l'uniformisateur moderne, en revanche, tous les hommes se réduisent, ou doivent se réduire, à une réalité zoologique, à l'espèce humaine, telle que la définit l'idéologie évolutionniste, la volonté rationnelle hégélienne ou les lois du Marché. Dès lors, les destinées des hommes libres, des fidèles, de ceux que les Modernes nomment, non sans condescendance, les « archaïques », sont pour le moins aléatoires.
Qu'opposer à cet « idéal » Moderne qui veut arracher à tous et à chacun sa part de secret ? Comment garder mémoire des formes anciennes humiliées par l'arrogance progressiste ? Comment ne pas être les otages de ses propres refus ni les esclaves de ses propres consentements. Quelles sont les conditions nécessaires au dépassement heureux du monde conditionné ? Comment orienter notre volonté sans succomber à la démesure de la volonté ? Comment être soi-même sans n'être que soi-même ? Comment apprendre ce que nous savons déjà ? Comment faire advenir ce qui est de toute éternité ?
La Tradition, à la fois transmission et traduction, témoignant par les Symboles du silence antérieur, de ce cœur de silence que le Verbe accomplit, ne nous offre rien moins que le monde, comme une partition infinie à déchiffrer, à condition de ne pas oublier que nous faisons partie du chiffre, de ne pas être face aux êtres et aux choses, dans l'illusion du Moi comme des expérimentateurs, mais passagers, intercesseurs, dans cette relation sensible et intelligible que l'on nomme la Communion, qui nous délivre de l'espace-temps qui nous emprisonne.
L'au-delà et l'en-deçà de l'individualisme, l'au-delà et l'en-deçà du langage humain, l'au-delà et l'en-deçà de la religion, l'au-delà et l'en-deçà les formes revoient ainsi à un au-delà et à un en deçà du temps. En-deçà du temps est l'idolâtrie du hic et nunc, l'atomisation de la durée dans le monde virtuel, la fascination des images réduites à elles-mêmes, l'oubli des fêtes et des rites qui ordonnent la temporalité, définissent les rapports et les proportions, orientent les heures, qui sont étymologiquement, des prières. Mais au-delà du temps est ce qui qualifie le temps, l'instant éternel, l'omniprésence du Verbe. Qu'en est-il alors de l'homme attentif selon Saint-Augustin: « Ce que mes Ecritures disent, je le dis, entend-il Dieu lui révéler. Mais les Ecritures parlent dans le temps, tandis que le temps n'affecte pas mon Verbe, qui est éternel, mon égal dans les siècles des siècles. Les choses que tu vois, grâce à mon esprit, je les vois, de même que je prononce les paroles que tu prononces grâce à mon Esprit. Mais tandis que tu vois toutes ces choses dans le temps, ce n'est pas dans le temps que je les vois. Et tandis que tu prononces ces paroles dans le temps, ce n'est pas dans le temps que je les prononce. »
Dernier livre paru: L'Ame secrète de l'Europe, Oeuvres, mythologies, cités emblémantiques, éditions de L'Harmattan, collection Théôria.
17:29 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook



