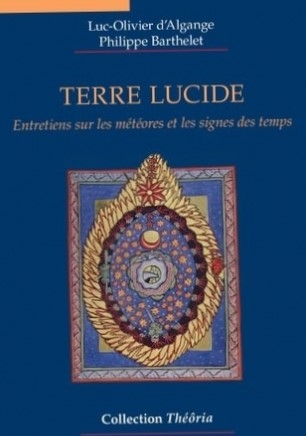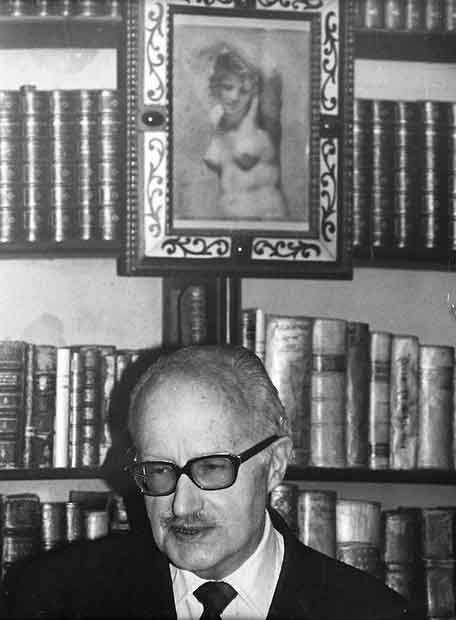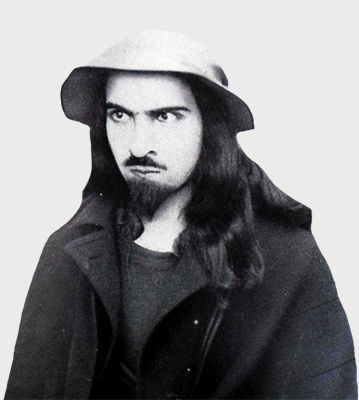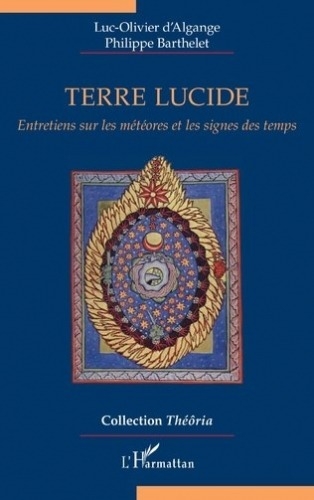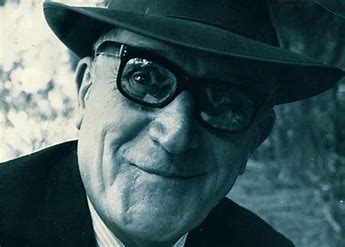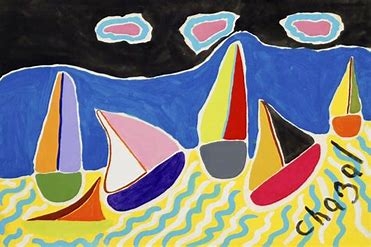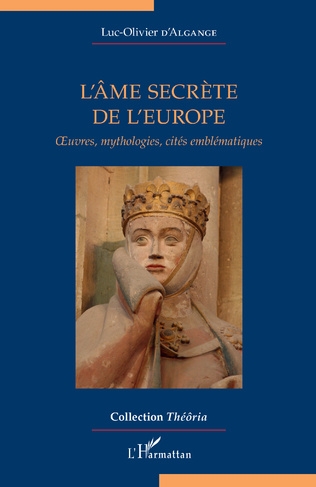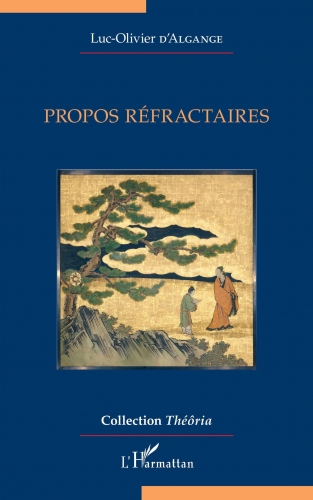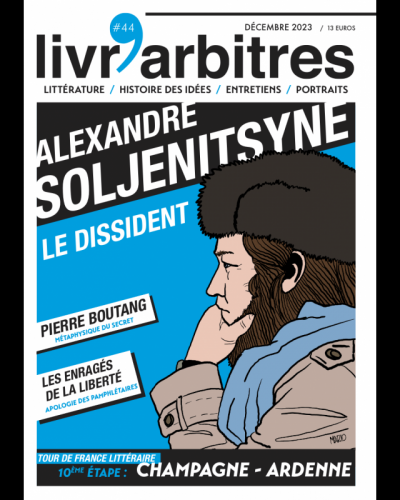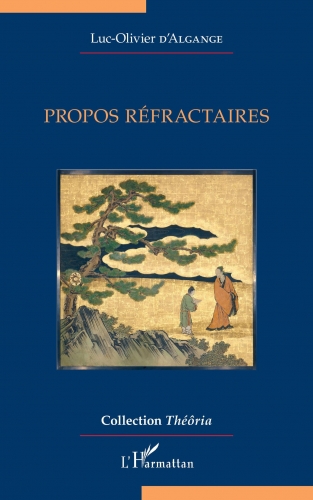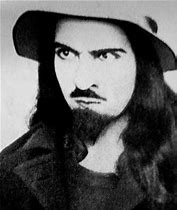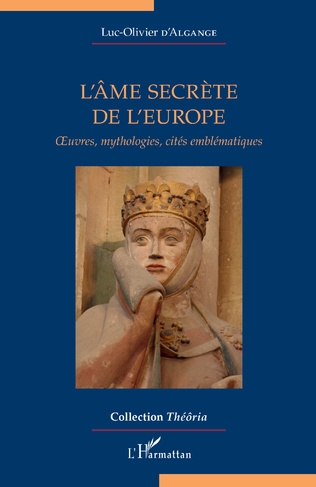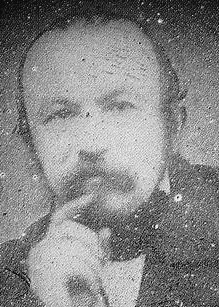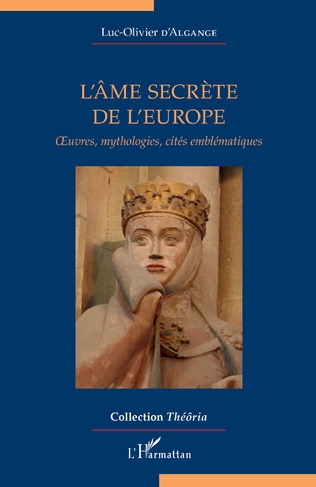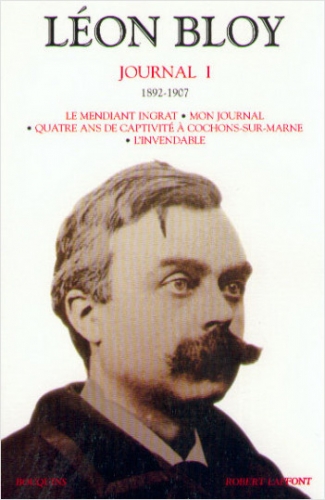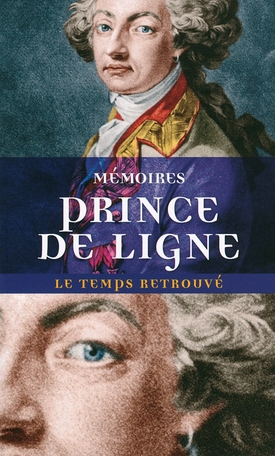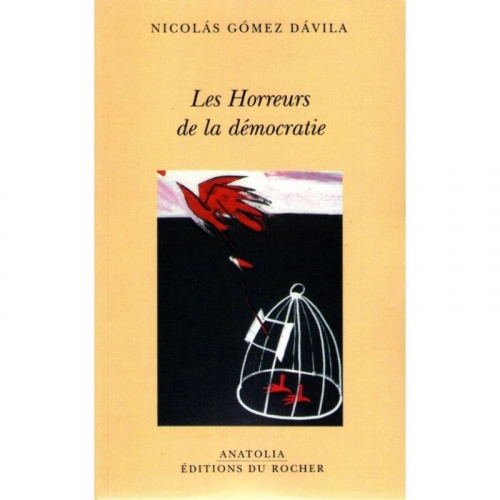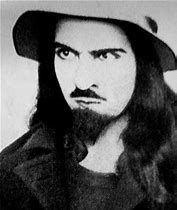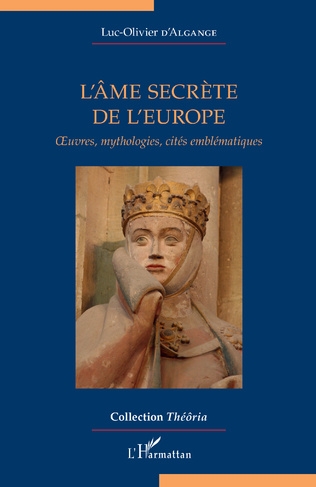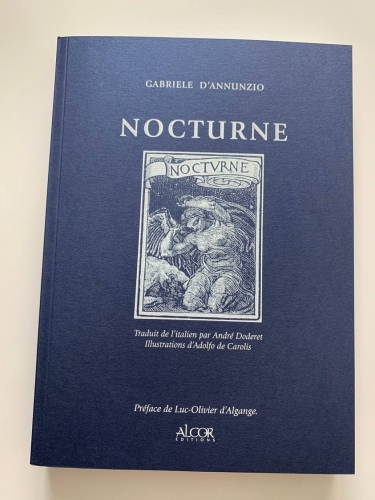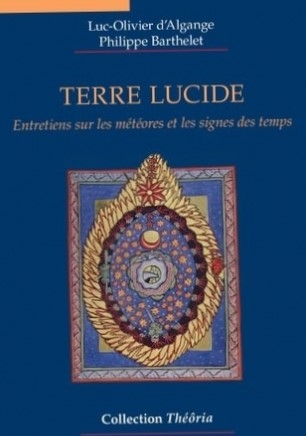
Philippe Barthelet, Luc-Olivier d'Algange
Entretiens sur les météores et les signes des temps
PREMIER ENTRETIEN :
C’était à Paris, non loin de la Bourse, dans une brasserie pleine de lustres et de cristaux, où les tabliers blancs des garçons, leurs serviettes amidonnées, les têtes dorées des bouteilles de champagne empilées dans la glace d’une vasque d’argent sur le comptoir, faisaient chercher malgré soi, sur les banquettes voisines et dans les miroirs alentour, la silhouette frileuse de Marcel Proust, seul et curieux devant son œuf à la coque et ses mouillettes ou bien le rire bedonnant de Léon Daudet, attablé la serviette au col devant des escargots, la bouteille d’anjou-villages dûment fleurdelysée à portée de la main dans le seau couvert de buée.
L’un des commensaux, sans doute parce qu’il était en retard, n’en finissait pas de s’émerveiller de la relativité du temps :
- Imaginer un temps où toutes les choses sont à la même date est une illusion de professeur, c’est-à-dire une imbécillité d’étudiant monté en graine… Qui déciderait si nous sommes ici au début du XXIe siècle ou plutôt à celui du XXe ? Si le « temps est gentilhomme », comme disent les Italiens, il peut bien ménager à qui les perçoit ces coïncidences intemporelles…
- Cher ami, repartit son compagnon, encore un effort, comme dirait le divin marquis… Que si il tempo è galentuomo, sa galanterie ne s’arrêtera pas en si bon chemin, et peut encore nous remonter d’un siècle… Imaginez-vous dans la première année du règne de « Napoléon, empereur de la République », pendant cet été où l’on rêvait encore à l’invasion de l’Angleterre… Toutes les pensées allaient au camp de Boulogne ; ici, la Bourse, dont nous apercevons les colonnes en nous penchant, n’existait pas encore : on l’avait installée dans le ci-devant basilique Notre-Dame des Victoires. Tout le monde n’avait pas encore eu le temps de lire le Génie du christianisme…
- Ces propos sur la comète, repartit le retardataire, d’autres que nous les ont tenus à ce moment-là : ils sont un exemple bien intimidant. Je veux parler des trois interlocuteurs des Soirées de Saint-Pétersbourg, le Comte, le Sénateur et le Chevalier. Si parva licet prenons-les comme modèles, le temps d’une conversation. Nous laisserons le troisième siège, que l’on n’espère pas trop périlleux, à l’ami de passage qui voudra bien tenir sa partie dans notre conversation, s’il vient ; à défaut de la Néva, la Seine n’est pas trop loin et surtout, nous avons mieux que le Pierre Ier de Falconet : le cavalier royal de la place des Victoires.
- Prenons garde que le cheval de Louis XIV, au contraire de celui du Czar, n’a pas besoin d’un serpent pour se cabrer : on oublie toujours le serpent d’airain au pied du cheval, le comte de Maistre lui-même semble ne pas l’avoir vu. Alexander Blok prophétisait quant à lui la victoire du serpent…
- Convenons donc de tout cela, et que notre brasserie parisienne fait une acceptable terrasse pétersbourgeoise. Et partons donc de Joseph de Maistre, et de ce qui est sans doute le schibboleth de toute son œuvre - comme sans doute de tout effort véridique de déchiffrement des temps nouveaux nés de 1789 - : que ce qu’il faut faire c’est non pas une révolution contraire, mais le contraire de la révolution : devons-nous dire de la même façon, en transposant à peine, que ce qu’il faut écrire c’est non pas de la littérature contraire mais le contraire de la littérature ?
Philippe Barthelet :
- Les inventeurs de la « littérature », du mot et de la chose, les soi-disant « philosophes » du XVIIIe siècle, il faudrait les appeler une secte, ce qu’ils étaient. L’étymologie du mot est bifide, et cumule les disgrâces : « sector » (de sequor ), suivre et « seco », couper. On erre en troupeau. La littérature, par la volonté de ses inventeurs, est une coupure, une rupture (une roture, c’est le même mot) d’avec ce qui nourrit et vivifie – d’avec l’origine. D’où ce gigantesque oubli de l’âme du monde pour finir par ne plus connaître que les moindres replis de la conscience individuelle. On passe ainsi d’Homère à Henry James, lequel est sans aucun doute un horloger d’une prodigieuse minutie, mais enfin il faut bien convenir que c’est une minutie stérile… (les biographes d’Henry James supposent d’ailleurs qu’il n’avait aucune expérience de la chair, ce qui, eu égard à son œuvre et, comment dire, à l’intention de celle-ci, n’est peut-être pas sans écho ni importance). Vous me direz que nous sommes désormais très loin de ces joyaux inféconds, et que nous avons chu depuis belle – ou laide – lurette dans les limbes de l’infra-psychologie. Julien Gracq, pour l’opposer au sentiment cosmique des romantiques allemands, déplorait le côté « fleur coupée » du roman psychologique à la française : la fleur coupée peut faire illusion quelque temps, dans un vase ; mais elle devient vite fleur fanée, puis encore plus vite fleur pourrie. Nous en sommes là : au fumier, lequel, malgré toutes ses prétentions exagératrices, et d’un ennui accablant…
Luc-Olivier d’Algange :
- L’oubli de l’âme du monde, de la source vive, nous condamne à vivre dans le délétère des citernes croupissantes. La secte immense, - et je rejoins ici ce que vous nous disiez à propos de l’identité foncière du sectaire et du démagogue, - la secte globalisée, « universelle », se paye de mots, élève les mots en abstractions vengeresses pour obstruer le ciel. Jadis Dieu était le Verbe ; désormais les mots sont divinisés, on sacrifie et se sacrifie pour eux, on cède à leur force d’expropriation. C’est avec des mots que l’on nous chasse et que l’on nous tue. Nous étions là, entre la courbe du ciel et celle de la terre, entre l’angélus et les rumeurs du vent, entre le fleurissement de la terre et celui des Idées, dans la haute et profonde légitimité du silence, dans un vaste assentiment aux êtres et aux choses, dans la louange et la gratitude, et voici que nous sommes dans le nulle part, expropriés, et contraints à guerroyer avec des armes qui ne sont point les nôtres : il n’y a plus que des mots pour lutter contre les mots idolâtrés – à la façon dont Paracelse recommande l’usage du venin.
Vous nous disiez aussi tout le mal que vous pensiez de la « reconstruction » programmée des Tuileries, hyperbole de l’adoration moderne pour l’antiquaille, pour la manie rénovatrice, pour ce folklore inepte de salle des ventes qui ont, pour aboutissement logique les « parcs d’attraction » (mieux vaudrait dire de répulsion !). Ces choses dépourvues de sens, coupées, gagneraient peut-être à être ruinées par le temps, qui honore autant qu’il détruit, à disparaître enfin, à redevenir idées, au lieu d’être ravalées, et ravalées au rang de décors pour touristes, au point que l’on en vient presque à comprendre, mais sans vraiment les croire, ces futuristes italiens qui, gorgés de cocaïne, en arpentant les riches tapis de leurs hôtels de luxe, rêvaient de nous débarrasser de ce fatras ! La reconstruction est le pendant de la « déconstruction » chère à la critique universitaire qui ne fut jamais rien d’autre qu’une ruse consistant à traiter les œuvres de telle sorte à n’en rien recevoir ; autrement dit à changer l’or en plomb, dans une alchimie à rebours, l’œuvre en « texte » dont on dépouille administrativement les procédés et les rhétoriques. D’où l’importance d’opposer l’œuvre au travail, l’otium à toute activité utile, c’est-à-dire asservie.
Si l’œuvre est une relation avec tout ce qui est, le texte est une expérience à l’intérieur de ce qui n’est pas, du néant. À cet égard, le mérite d’Henry James est d’avoir fait, en matière de psychologie, le tour de la question, si bien qu’il rend par avance obsolètes les romans « psychologiques » qui lui succèderont et feront ainsi figure de trottinettes après l’invention de la Bentley ! Raison de plus pour se désintéresser de la psychologie. Les hommes sont universellement mus par l’amour, le ressentiment, le désir de reconnaissance : la belle affaire ! Mais seul est intéressant ce qui les différencie, ce qu’ils explorent. L’instrument importe moins que la musique. Il faudra bien un jour cesser de détailler ce qui est semblable pour s’intéresser au dissemblable, où gît le véritable secret de la ressemblance avec nous-mêmes ; autrement dit, avec le « Soi » dont parle Ramana Maharshi. Ce qui différencie les hommes, ce qui les rend aimables n’a rien d’individuel : ce sont les langues, les religions, les civilisations. L’œcuménisme est à la mode mais c’est aux disputes théologiques que l’humanité (mais j’ose à peine employer le mot !) doit d’avoir été moins bête qu’elle ne l’eût été ou qu’elle ne l’est actuellement. L’universalité métaphysique, ésotérique, ne dissout ni ne dissipe les différences exotériques mais leur donne une signification heureuse, non sans circonscrire cette signification à un espace précis, infranchissable, sinon au péril d’outrecuider. C’est en ce sens que l’on peut dire que le contraire de la littérature, qui est l’ésotérique, le chemin intérieur de la littérature, contient la littérature, que le cœur, dans son possible, est plus vaste que la périphérie, que toute intériorité est comme le disait Novalis « extériorité véritable ».
Philippe Barthelet :
- Novalis nous a rappelé que le chemin véritable conduit vers l’intérieur. C’est une évidence à la fois topologique et physiologique ; une autre de ces évidences enfantines (au sens où Novalis définissait les enfants comme « des êtres antiques », où l’antiquité est tout ce qu’il y a d’intemporel nourricier dans le temps) a été proférée quelques années plus tard par Victor Hugo, dans la préface de ses Odes et Ballades : « La poésie est tout ce qu’il y a d’intime dans tout ». Ayant dit cela il avait tout dit, il ne lui restait plus qu’à épiloguer pendant soixante ans. Je hasarderais, pour user d’une opposition facile mais tout de même significative, que la « littérature » est au rebours tout ce qu’il y a d’extime en tout (si l’on me passe ce latinisme en l’occurrence bien utile). La « littérature » caresse cette utopie délirante, tentatrice à beaucoup d’égards, d’une vérité de l’homme objective (pour reprendre un adjectif qui fit fureur au temps de la tyrannie intellectuelle du marxisme) ; autrement dit, elle postule cette idée folle (et certes reposante, follement reposante) que la vérité de l’homme est extérieure à l’homme… Que si « le royaume des cieux est au-dedans de vous », le royaume de la terre est au-dehors de l’homme… c’est-à-dire nulle part, comme la Pologne du Père Ubu. À dire vrai il n’y a pas de psychologie, ou plutôt la psychologie devient un mensonge dès lors qu’elle s’érige en science séparée… Prenez par exemple les romans de Johan Bojer, que l’on a présenté comme le « Zola norvégien » : absurdité de l’étiquette, puisqu’il est précisément tout le contraire de Zola : s’il décrit minutieusement, comme lui, la vie quotidienne des petites gens, il échappe absolument à tout « naturalisme » : il ne farde rien des étroitesses, des petitesses, des noirceurs de ceux qu’il dépeint, mais il les présente de telle façon qu’il leur confère une grandeur cosmique : il ne connaît d’autre psychologie que celle de l’âme du monde, et tous ces pauvres hères qui ne sont chez Zola que des pantins répugnants, jouets des phantasmes et des obsessions de l’écrivain – du « littérateur » - acquièrent chez lui une dignité, une noblesse - c’est-à-dire une réalité non seulement « littéraire », on s’en moque bien, mais une réalité humaine - une réalité tout court. On sent que Bojer ne ment pas, et que Platon n’aurait pas à le mettre à la porte de sa République… Au rebours des paysans de Zola, qui sont des monstres – et les doubles ténébreux de l’écrivain – ses « Gens de la côte » sont naturellement nobles, instinctivement accordés au temps qu’il fait ; ils sont nobles par ce qu’ils sont, tout simplement, et que leur être est indiscutable, comme le soleil, l’arbre, la nuit. Sans remonter en Norvège – mais c’est la France qui découvrit Bojer – on pourrait dire cela aussi de Ramuz. Comme par hasard, les héros de l’un comme de l’autre sont pour la plupart des taciturnes ; or la psychologie moderne parle, et fait parler ; elle prétend que la vérité de l’homme est dans ce qu’il dit – toujours ce mouvement vers l’extérieur…
Luc-Olivier d’Algange :
- Il est parfaitement dans l’ordre des choses que le « naturalisme », en tant que mouvement littéraire, soit le plus éloigné de la nature, le plus « extérieur », comme le réalisme est éloigné de la réalité, comme la création l’est des « créatifs ». Éloigné, extérieur – et l’on pourrait dire hostile, comme l’individualisme de masse est hostile à cet « unique intime en chacun » que cherchaient Novalis et ses amis. Être libre extrêmement et sans illusions, sans idées générales, sur la liberté, telle fut sans doute la belle gageure des premiers romantiques allemands qui donnèrent de la nature une tout autre image que celle qui devait prévaloir avec les naturalistes : image enfantine et antique, mythologique et pythagoricienne, ingénue et savante.
C’est, je crois Jean Renoir qui disait qu’il ne fallait pas filmer la vie mais faire des films vivants ; la vie n’étant jamais en face, mais toujours à l’intérieur.
Pour odieux que soit le culte moderne de la nature, qui aboutit à une conception zoologique de l’espèce humaine, qui se voue à une conception non plus naturante, ni même naturée, mais représentée, telle un ombre parmi les ombres mouvantes au fond de notre caverne technologique ; et pour aimable que soit, par contraste, l’artifice des jardins à la française et de la bonne éducation, il n’en demeure pas moins que l’écrivain qui ne s’illusionne pas sur la réalité de l’extime, si épris qu’il soit du baroque ou du trompe-l’œil (et aussi « wildien » ou « nabokovien » qu’il se veuille), demeure, par la qualité et l’orientation de son attention non moins que par ce qui l’anime, en étroite relation avec la nature, avec les mystères et les fastes légendaires de la nature.
Je repense à ce que vous nous disiez, à propos de Cocteau et de ce fond de chasse sauvage qui frémit dans la France classique, cette proximité avec ce qui brille et ce qui brûle. Là encore la beauté et la plénitude sont données de surcroît, la nature étant offerte à l’art et l’art à la nature, comme dans l’entrelacs des figures scythes ou persanes. De même, le Bernin, ce comble d’artifice, rejoint, par ses excès mêmes, les efflorescences surabondantes de la nature. La métaphore, qui stylise ce que les critiques nomment, souvent péjorativement, l’écriture artiste, est au principe même des phénomènes naturels, où les plantes se déguisent en animaux et inversement, où les tournesols empruntent au soleil vers lequel ils se tournent sa forme rayonnante.
Au naturalisme de Zola s’oppose le naturalisme de Fabre et de Linné qui enchanta Jünger que l’on persiste à nous présenter comme un « esthète ». La nature métaphorise et se métamorphose par nature. Et elle écrit. Novalis parle de l’écriture des pierres, des branches, des feuilles, des cristaux de neige. Sitôt que l’on cesse de se laisser abuser par l’illusion de l’extériorité, écrire devient comme un prolongement du geste silencieux de la création. Nous lisons, nous déchiffrons le nuage et la pierre. En écrivant, nous continuons la lecture du monde à partir de son âme. Nous inventons des dieux qui sont les métaphores d’une réalité qui est en même intérieure et extérieure, nous suivons le bon vouloir du dieu tisserand qui entrecroise le fil de trame et le fil rapporté. De tous les objets qui sortent des mains humaines, les livres sont les plus proches de la nature, avec leurs feuilles et leurs signes, leur mémoire inscrite, feuilletée, leur temporalité devenue concrète. Nous écrivons dans le temps qui passe, et parfois pour passer le temps ; et ce temps demeure, comme dans la nature, en traces visibles et plus ou moins déchiffrables. L’art de l’écrivain entre alors en concordance avec la botanique, la géologie. Les arbres tombent en poussière ou se pétrifient, sont dévorés par les termites ou deviennent des livres. En écrivant nous perpétuons la nature, mais encore faut-il être assez naturellement métaphysiciens, c’est-à-dire orientés (comme la chenille l’est par son devenir-papillon, pour reprendre une métaphore de Rozanov) vers cet autre-monde qui n’est pas séparé de ce monde-ci mais distinct, mais relié par des gradations infinies. Le supra-sensible n’est jamais que la plus haute branche du sensible. Dès lors que l’âme du monde les unit, comme le sel des alchimistes unit le soufre et le mercure, le sensible et l’intelligible cessent d’être ces mondes séparés, hostiles. Le surnaturel est naturellement le cœur de la nature, la métaphysique couronne la physique. Ce qui apparaît d’évidence dans la littérature antique ou médiévale.
La psychologie moderne feint d’oublier tout ce qui nous apparente au monde. Elle feint de croire (ou croit, ce qui est pire) que nous pouvons être un objet d’étude. Moralement, cela ne vaut pas mieux que la vivisection ou les expériences des médecins fous dans les camps de concentration. Quiconque vous aborde en psychologue est un ennemi, et l’on peut être aussi, à soi-même, son pire ennemi. La psychologie, en littérature, c’est une façon de se voir déjà mort, mais sans renaissance immortalisante. Le dard du scorpion se retourne contre lui-même. L’écriture, disait Cocteau est du dessin dénoué et renoué. Ainsi l’écriture peut délier ; elle peut être aussi le collet qui nous étrangle. Si elle nous délie, elle délie notre âme de la croyance absurde de n’être pas un éclat (aussi insaisissable que la lumière qui bouge entre les feuillages) de l’âme du monde.
Philippe Barthelet :
- Vos remarques me rappellent la sinistre définition de Bichat, sur quoi repose toute la médecine moderne : “La vie est l’ensemble des forces qui résistent à la mort”. Aveu terrible : c’est la mort qui définit la vie, qui est première - et dernière ; et la vie n’est que ce qui lui oppose une résistance par nature provisoire. Le provisoirement vivant est du mort par destination, du mort anticipé - et d’ailleurs l’examen médical par excellence n’est-il pas l’autopsie ? Quand Léon Daudet, qui savait de quoi il retournait pour avoir étudié lui-même la médecine, appelait les médecins des “morticoles”, la vérité qu’il énonce en un mot va bien au-delà de la simple satire. La mort (de l’homme) est sans doute le vrai nom de l’objectivité dont la science moderne s’est fait un palladium (et, après elle, les idéologies qui se donnaient pour des sciences, comme le marxisme). Les fameuses questions que pose Kant (“Que puis-je connaître ? Que dois-je faire ? Que m’est-il permis d’espérer ?”), c’est par un coup de force à la fois métaphysique et grammatical qu’il en fait les annonciatrices de sa question fondamentale : “Qu’est-ce que l’homme ?” où tout à coup il passe de la première à la troisième personne du singulier, comme si cette substitution de personne était légitime, comme si elle était même possible... Cette simple petite question qui semble si pédagogique, pour tout dire si ennuyeusement anodine, en vérité ouvre la boîte de Pandore des temps modernes : elle résonne comme un écho inversé, sur le mode interrogatif, ironique (mais d’une ironie archangélique, plus luciférienne que kantienne...) de la réponse, de la seule définition qui tienne et qui a été donnée une fois pour toutes et pour tous les temps par le dernier prophète du Christ, le procurateur Pilate : Ecce Homo, “Voici l’Homme”. L’Homme, la seule fois d’ailleurs où la majuscule est admissible, est devenu depuis le jour de sa Passion l’un des noms du Christ. C’est Dieu Lui-même et Lui seul qui se charge de la définition de l’homme. Chercher l’homme en dehors de Lui, c’est-à-dire en Lui tournant le dos par présupposé de méthode, c’est ouvrir la porte au néant. Le fameux “humanisme” des Lumières aboutit à toutes les atrocités possibles dont les deux derniers siècles ont été saturés : Maurice Clavel avait très bien vu que le prétendu “pouvoir de l’homme” que l’on exalte se révèle très vite et fatalement pouvoir de l’homme sur l’homme... L’homme définissable, l’homme objectif c’est l’homme mort, le cadavre posé sur le marbre devant le docteur Tulp, qui le lacère pour les besoins de sa leçon d’anatomie... Encore une fois, curieuse perspective méthodologique : l’anatomie du vivant s’apprend par la dissection des cadavres... Je songe encore à cet adage de l’ancien droit, qui pour la science moderne doit s’entendre à la lettre : le mort saisit le vif...
L’automne où nous entrons est singulièrement triste et gris ; on a justement l’impression que c’est l’âme du monde qui est souffrante, décolorée, atteinte de mille façons invisibles et que tous, sans le comprendre le plus souvent, nous en souffrons… « Saison mentale », ô Apollinaire, pour le pire, comme si le ciel des météores devenait fou à proportion de la folie intime que l’on veut à toutes forces nous imposer…
Permettez-moi de revenir à cette remarque capitale que vous venez de faire : sur le supra-sensible qui est la plus haute branche du sensible. Il me souvient des diatribes de Zarathoustra contre les prédicateurs d’arrière-mondes, diatribes, au reste, plus antiprotestantes que véritablement antichrétiennes ; et à mon étonnement d’adolescent encore tout imbibé de nietzschéisme, découvrant dans la Somme contre les Gentils l’affirmation de cette tranquille évidence : Præter hunc mundum non est aliud, au-delà de ce monde il n’y en a pas d’autre. Voilà, par la plume du Docteur Angélique, la simple et véritable doctrine de l’Église…
Le grand secret de toute poésie, qui peut enivrer les poètes jusqu’à l’enthousiasme – la possession par un dieu - , lequel ne va pas sans un péril immense, et toute la poésie des temps modernes en est le martyrologe – le grand secret de toute poésie, retrouvé aussi bien par Novalis que par Hölderlin, comme s’il appartenait à l’Allemagne de nous sauver de la « littérature », avant d’ailleurs de nous perdre avec la « philosophie »… - ce grand secret, qui a l’enfantine simplicité de l’évidence, c’est que « l’autre monde » et ce monde-ci ne sont qu’un, reliés par les gradations infinies qu’évoque Edgar Poe dans son Colloque de Monos et Una ; c’est l’échelle de Jacob, ou encore l’arc-en-ciel, « arche d’alliance » ou écharpe d’Iris, la messagère des dieux…
C’est l’intuition cardinale de Baudelaire : les correspondances, clef de la réalité, qui fondent aussi bien la lecture (avec ses différents degrés d’intellection, telle qu’on la pratiquait au moyen-âge) que la science héraldique : chaque chose est au-delà de soi, le signe et la figure de quelque chose d’un autre ordre, et c’est cette annonciation d’un autre ordre – d’un plus hault sens – qui donne à chaque chose l’essentiel de sa réalité ; sans quoi les choses, comme dirait Rostand, « ne seraient que ce qu’elles sont » : ne seraient plus que leur écorce ; leur abstraction, leur prose : ce qui est précisément le cas des choses modernes, lesquelles, comme par hasard, ne peuvent trouver place dans le blason. L’annonciation d’un autre ordre, c’est tout bonnement la définition du symbole, et pour bien comprendre l’enjeu, comme diraient nos contemporains, de cette question, il faut redire cette définition en quelque sorte physiologique de Léon Bloy que « c’est dans l’exacte mesure où un être est symbolique qu’il est vivant ».
Sur la plus haute branche, un rossignol chantait…
Luc-Olivier d’Algange :
- Si nous perdons l’âme du monde, ou, plus exactement, si l’âme du monde est perdue pour nous (« Aurélia était perdue pour moi » écrit Gérard de Nerval), nous perdons en même temps notre âme, et le monde. Un monde sans âme, définition la plus laconique et peut-être la plus juste du monde moderne, est un monde qui n’est pas. Si l’âme du monde est perdue pour nous, nous perdons tout : le sensible et l’intelligible, le royaume de la nature et le royaume plus vaste de Dieu, ce qui nous distingue et ce qui nous unit, l’immobilité et le mouvement.
Évoquant l’Âme du monde, Platon parle d’une « sorte de substance intermédiaire comprenant la nature du Même et celle de l’Autre » et dépasse ainsi ce que nous percevons ordinairement des Éléates et des « héraclitéens ». En perdant l’Âme du monde, nous perdons à la fois l’être et le devenir. Ceux qui veulent, nietzschéens improvisés tels M. Onfray, « renverser le platonisme », non sans prétendre se mesurer avec saint Thomas d’Aquin, ne renversent que leurs propres constructions et semblent avoir oublié de lire Platon : « S’il n’y a qu’immobilité, écrit Platon, il n’y a d’intellect nulle part, en aucun sujet, pour aucun sujet (…) Par contre, si nous acceptons de mettre en tout, la translation et le mouvement, ce sera encore pour supprimer ce même intellect au rang des êtres. » L’âme, ce qui anime, est ce mouvement qui sans cesse renouvelle la parenté du Même et de l’Autre, de l’être et du devenir. La « déconstruction » de l’Âme du monde coïncide avec le triomphe de l’explication mécaniste, elle–même principe de « l’homme-machine », désacralisé et « démystifié », dont tous les actes se trouvent alors explicables par la sociologie, la biochimie ou la génétique. Le sens commun le plus élémentaire, « l’enfantine simplicité de l’évidence », nous instruit déjà de la différence entre l’animé et l’inanimé ; différence qui n’a peut-être jamais été aussi perceptible qu’aujourd’hui ; car si, pour Hugo, « tout a une âme », si, pour Nerval « un pur esprit s’accroît sous l’écorce des pierres », en revanche, entre l’homme et le robot demeure cette distinction décisive, métaphysique, que le monde moderne tend à abolir, et qu’il nous révèle précisément en voulant l’abolir. Ces hybridations cauchemardesques que les Tribulat Bonhomet modernes expérimentent, par les nanotechnologies, entre la cybernétique et la vie confirment aussi cet autre trait de génie de Platon qui affirme, contre Parménide, qu’il y a bien un « être du non-être ». Or, nous y voici : l’homme-machine dans un monde-machine ; ce qui prouve assez que tout ce que l’homme conçoit, il le réalise, fût-ce à l’intérieur de « l’être du non-être ». M. de La Mettrie voyait l’homme comme une machine, prédisposant ainsi la machine à se substituer à l’homme. Il ne restait plus à Mary Shelley, douée d’une belle intuition, qu’à décrire le Prométhée moderne sous les aspects du docteur Frankenstein, qui est le véritable mythe de notre temps, son « idéal », son aspiration fondamentale à fabriquer de la vie avec de la mort, c’est-à-dire à inventer une vie morte, atroce caricature de la renaissance immortalisante.
À tant vouloir se « libérer » de Platon et de la Théologie médiévale, les modernes ne semblent plus disposer des instruments intellectuels qui leur permettraient de comprendre ce qu’il en est du « non-être » où ils s’agitent et s’évertuent, si bien que les uns demeurent « parménidiens » ( mais de caricature, il va sans dire), enfermés qu’ils sont dans leurs « identités » et que d’autres, les « festifs » dont se moque Philippe Muray, se veulent « héraclitéens », dans un individualisme de masse, un relativisme dogmatique (« rien n’est vrai, tout est relatif ») qui tendent au pire grégarisme. Les « réactionnaires » et les « post-modernes » s’opposent dans un théâtre où le divin brille par son absence. Mais qu’en est-il de ce qui brille dans l’absence ?
On en vient à croire que ceux qui nous annoncent la fin du monde sont d’incurables optimistes. La fin du monde, et non seulement la fin d’un monde, est derrière nous. Nous n’existons plus que dans la rémanence de ce qui fut ; et celle-ci commence à s’évaporer. Derrière ces décors, ces silhouettes, ces fantômes scintille le beau néant, l’éblouissement de la fin qui annule tout commencement. Le monde s’est entièrement dédit ; et ce dédire est « défaire », défaite et défection. Nous sommes vaincus, les fils ne tiennent plus à la trame mais virevoltent au hasard. Cette fin du monde, au demeurant, n’est pas un mal. La conséquence du mal échappe au Mal. Ce monde, emprisonné à l’intérieur de « l’être du non-être » n’est qu’un immense « faire-semblant » inconscient, pas même une supercherie ou une usurpation : un théâtre d’ombres. Cette fin du monde, on pourrait presque la dater, si donner une date à l’intérieur d’un temps aboli pouvait avoir un sens. Il y eut bien ce moment où le monde existait encore dans une haute dimension tragique et ce moment où il n’existe plus. Notre cas de figure est des plus étranges, car presque tous nos contemporains sont nés dans ce monde qui n’existait plus, autrement dit dans le néant, qui est, pour citer une de vos expressions, « la parodie du vide, lequel est un autre nom de Dieu ».
Philippe Barthelet :
- L’optimisme que vous nous offrez, le seul recevable qui est ontologique (Deo optimo maximo, et comment l’essence du Bien pourrait-elle être autre chose que le meilleur ?) tient tout dans votre remarque capitale : « la conséquence du mal échappe au Mal ». Autrement dit, le Prince de ce monde, qui comme tout prince appelle un surnom, pourrait être surnommé l’Inconséquent… (Définition là encore purement ontologique, Dieu nous garde de conjecturer sur la psychologie satanique…) Il est fatalement inconséquent, par définition même, et cette impuissance finale l’enrage… D’où tant de proverbes (« le diable porte pierre ») et de contes où le diable se révèle, bien contre son gré, l’ouvrier et l’auxiliaire de Dieu…
Tribulat Bonhomet, disciple rationaliste (et français) du Dr Frankenstein, siège aujourd’hui en tant que « sage » dans les divers « comités d’éthique » qui ont remplacé, sur le mode collectif, nos anciens directeurs de conscience. C’est un lointain neveu du Dr Faust, dont, faut-il le dire, les exaltations et rêveries préscientifiques l’impatientent un peu. Son postulat, qu’il a fait passé pour une évidence, laquelle est aujourd’hui la mieux reçue, aussi bien dans les académies que dans les magazines, est que le vivant n’est que l’étape préparatoire au technologique, qu’il n’existe qu’en fonction des prothèses dont on le perfectionnera pour donner enfin naissance au véritable homme-machine, selon une assomption mécanique de l’humain dont n’aurait osé rêver M. de La Mettrie. L’homme biologique n’est que le brouillon de cette merveille déjà dans les cornues. Il s’agit bien de « fabriquer de la vie avec de la mort », comme vous le dites ; ce qui nous ramène curieusement à la définition de Bichat – la vie comme mort anticipée, la vie étalonnée à la mort. Philippe Muray nous rappellerait peut-être que Bichat et Frankenstein étaient condisciples à la faculté…
Des générations d’apprentis bacheliers ont ânonné comme une évidence – encore une - , comme un requisit de la démarche scientifique, c’est-à-dire comme une condition du Progrès, l’allégation de Max Weber sur la science moderne qui doit « désenchanter le monde ». On n’a pas pris garde que ce parti-pris de désenchantement n’était rien d’autre que la négation – en pensée et en acte – de l’âme du monde ; autrement dit un suicide, ce que les plus lucides parmi les écologistes commencent à entrapercevoir. Le 4 juillet dernier, jour comme on sait de leur fête nationale, les Américains ont percuté une comète avec un de leurs engins. On en a énormément parlé, pour s’en réjouir presque toujours. Voilà un bon indice pour mesurer le degré d’irréalité où nous sommes parvenus : combien d’hommes ont ressenti cette prétendue « prouesse technologique » pour ce qu’elle était : un attentat misérable, non tant contre le cosmos que contre l’intelligence du cosmos, un enfantillage odieux et la preuve la plus atterrante de notre aveuglement et de notre débilité ? Et combien, parmi ceux qui l’auront ressenti, auront eu le courage de le dire – sauf à passer pour d’aimables excentriques ?
Luc-Olivier d’Algange :
- « Enfantillage odieux », - l’expression recouvre parfaitement tout ce que le monde moderne tient pour important et pour sérieux, tout ce qui exalte son lyrisme et son ingéniosité. Parmi ces enfantillages, l’un des plus récents a été de fabriquer un robot sur le modèle du cafard ! L’article de Science et Vie qui relate cette glorieuse incongruité précise que ce cafard-robot possède, je cite, « la faculté d’interagir avec les cafards vivants et même de devenir leur leader ». Nous ne nous offusquerons pas, pour cette fois, de l’anglicisme…
Le génie de Villiers de L’Isle-Adam est d’avoir pressenti, par d’infimes détails, non seulement la logique moderne mais encore son style, sa bouffonnerie sinistre, son mélange de comique accablant et d’horreur latérale. Ce robot-cafard est, en soi, une métaphore admirable de notre temps ; il me fait penser à cette autre invention bonhomesque : le poulet génétiquement modifié pour être sans plumes et nous épargner par conséquent l’effort d’avoir à le plumer. On songe bien sûr au « bipède sans plumes » des philosophes et à l’avenir possible d’un humanisme au service d’une humanité déjà plumée. Ce que René Guénon, en métaphysicien, nomma le Règne de la Quantité, nous pourrons, en poètes, le nommer le Règne du cafard-robot et du poulet sans plumes. Notre avenir est bien tracé dans le néant, à moins de partager l’optimisme des punks qui vociféraient des « no future » sur leurs comptines électrifiées. Tout y conjure : nous serons dirigés par un cafard géant, maître d’une armée de cafards contrôlant et surveillant tout, le propre du cafard étant de cafarder.
Le plus terrible, comme vous le remarquez, n’est pas la chose en soi mais l’inconsciente inconséquence avec laquelle elle est accueillie. Tout se passe comme si de rien n’était, par inadvertance comme dans un mauvais rêve. L’ouvrier de l’homme-machine est le trafiquant d’organes, on ne fabrique de la vie avec de la mort que parce que l’on sait fabriquer de la mort avec de la vie de façon industrielle. La modernité activiste débute avec les tanneries de peaux de Vendéens sous la Révolution française et ne laissa point, de décennies en décennies, d’être plus abominablement inventive. Et il reste des Modernes pour tenter de nous effrayer avec le Moyen-Âge… Vous avez remarqué l’insistance des ordinateurs à nous souhaiter la bienvenue. Il y a quelque chose d’effrayant dans la politesse des machines, surtout en des temps où les humains rivalisent entre eux en goujaterie. Bienvenue donc, dans ce monde qui « bouge », qui évolue, qui se modifie sans entraves…
Donc le contraire de la littérature, comme un appel à un « contre-monde » à ce monde. Un contre-monde non comme une batterie d’artillerie face à une autre mais comme « l’ombre bleue des amandiers » dont parlait André Suarès, cette ombre bleue qui nous éveille du mauvais rêve, en tombant, par les interstices de la terre, dans la crypte du Temple détruit.
Le « contre » cesserait ainsi de sembler en appeler à je ne sais quelle vaine dialectique mais indiquerait un « retrait », un recours au « Logos intérieur », une architecture souterraine, alors qu’en surface, il n’y a plus rien. Comment dédire ce qui déjà s’est dédit ? Comment défaire la défaite ? L’ontologie de ce contraire de la littérature expérimenterait ainsi par son « retrait » ce que Heidegger nommait « l’ expulsion-répulsante du néant ». Elle redonnerait à ce qui n’est pas l’éclat aveuglant de ce qui n’est pas et à ce qui est la ténèbre douce où pointe l’étincelle incréée, le « iota » de lumière qui demeure en nous alors que nous n’existons plus.
Philippe Barthelet :
- Ce cafard-robot mérite d’être notre totem. Je songeais d’ailleurs, en feuilletant les « grands écrivains » qu’on propose maintenant à notre admiration, que nous étions passés de la « littérature pour mulots » - celle que Dominique de Roux trouvait chez Maurice Genevoix à la littérature pour cafards ; ne manquait, pour être très exact, que la touche technocybernétique que vous ajoutez. Cafard-robot, donc, prouesse et enseigne des fameuses « nanotechnologies », dont on n’attend rien de moins que le salut solitaire du nouvel homme ; « nanotechnologies » qu’il faut sans doute entendre, avec l’aphérèse de l’o initial, comme un perfectionnement de l’onanisme. Sous le totem de l’insecte, le cafard est à la fois celui qui rapporte, qui dénonce - qui cafarde ; celui qui prend les apparences de la religion pour mieux duper ses victimes et enfin, le climat psychologique d’affaissement, de lâcheté, de veulerie qui est la forme ordinaire de la « déprime » dont nos contemporains ne sortent pas - et peut-être dont ils ne veulent pas sortir. Selon les grimoires, le mot vient de l’arabe « kafir », traître à la vraie foi, lui-même emprunté à l’hébreu « cafar », renier. Les cafards, ou cafres, sont les infidèles. Comme les mots disent tout, si l’on prend la peine de les écouter, on notera que dans l’ancienne langue « cafarder » se disait pour parler beaucoup, et à tort et à travers. Assez bonne définition de la littérature parvenue à son stade terminal.
Luc-Olivier d’Algange :
- L’enfant qui pleure dans les ruines est l’âme qui nous sauve : elle qui nous appelle à la sauver est notre salut, notre âme. Cette âme est séparée de nous par des éons, par des siècles de siècles, par la nuit des temps, par des déluges infinis… Et cependant cet « hors d’atteinte » scintille dans la proximité extrême, sur le duvet d’une feuille ou dans l’onde lumineuse d’une pupille : cette ténèbre voyante ! La crypte du temple détruit est partout où la prière se recueille pour se déployer, - et à chaque instant. Telle est la sapience, qui affleure, la sagesse à fleur de peau, non l’abstraction mais la sainteté qui possède le don d’ubiquité, à la fois absente et présente, cachée et révélée, qui, selon la formule d’Héraclite, « nous fait signe ».
Je repense souvent à ce qu’écrivait Léon Bloy, lui aussi en révolte contre les « binaires » : « Le temps n’existant pas pour Dieu, l’inexplicable victoire de la Marne a pu être décidée par la prière très-humble d’une petite fille qui ne naîtra pas avant deux siècles ». On peut ainsi espérer qu’une prière viendra pour nous aussi, dans deux siècles ou dans deux millénaires ; on peut croire que cette prière déjà nous sauve, que sans elle nous serions réduits au silence. Maistre nous apprend que l’injustice n’est jamais que provisoire et ne se perpétue que par notre ignorance. Il n’est point question ici de bons sentiments, mais seulement de bonne foi et de réalité. L’injustice est impossible : le repons surgit là où notre intelligence seule ne peut l’attendre. En témoigne l’œuvre et le destin impondérable de Sœur Yvonne-Aimée de Malestroit, si haute dans la douceur de son sacrifice que l’espace et le temps furent pour elle, et par elle, et pour de nobles causes, frappés d’inconsistance. C’est ne rien comprendre au sens des mots que de ne pas voir que la nature n’est qu’une dimension de la surnature, de même que l’espace et le temps ne sont que des éléments de la grammaire de Dieu, que Dieu peut joindre et disjoindre à sa guise.
Il est à craindre que ces dernières décennies ne furent pas sans contribuer grandement à nous faire oublier que le christianisme n’est pas seulement une morale vaguement « conviviale » ou « humaniste » mais aussi, mais surtout, une métaphysique et une poétique. Les gnosimaques modernes ne haïssent tant ce qu’ils nomment la « gnose » (où ils confondent tout et son contraire, Marcion, le New-Age, René Guénon et Henry Montaigu) que parce qu’ils ont abandonné la sapience chrétienne au milieu des ruines, et leur haine n’est autre que le masque de leur mauvaise conscience à l’égard de cette sapience, de cette âme enfantine perdue et délaissée.
Si, pour Umberto Eco, la « gnose » est, je cite, « le fascisme éternel », si, pour les nostalgiques du maréchal Pétain, elle est une variation du « complot judéo-maçonnique », pourquoi ne pas tenter de la comprendre, à rebours de ces « binaires », tout simplement comme la Parole Perdue ? Non certes la parole de Marcion, qui tente vainement d’arracher le Christ à la royauté davidique, ou celle des puritains de toutes obédiences, qui méprisent l’héritage grec, mais bien la parole perdue (car elle est perdue hélas !) de saint Augustin, de Jean Scot Érigène, de saint Bernard de Clairvaux, d’Hugues de Saint-Victor, de Jean de Salisbury, d’Angèle de Foligno ou de Maître Eckhart…La véritable gnose n’est pas outrecuidance, mais humilité. Ce n’est pas le savoir péremptoire du chrétien qui parle « en tant que » chrétien, du chrétien soucieux de sa « spécificité » chrétienne, mais l’humble sapience du Bien et du Vrai qui, je cite Scot Érigène, « surpasse la perception de tout esprit et de toute raison ».
Les moralisateurs modernes, eux, rivalisent à parler de « l’Autre ». C’est à qui sera le plus fort dans « le respect de l’Autre ». Concours d’« altérophiles » ! Mais qu’en est-il de leur propre cœur ? Qu’est-ce que le respect de l’Autre sans la connaissance qui nous rend identiques à lui, sans l’amour qui de cet Autre fait un Même ? Ce « respect » est une grimaçante caricature d’amour à quoi il faut opposer non une contre-caricature, comme le font certains intégristes, perdus en des combats subalternes, mais le contraire d’une caricature. Ce contraire-là donne tout son poids, toute sa vérité, à la voix seule, et même esseulée. Les Évangiles sont le récit d’une révolte contre l’esprit grégaire. Quel est le sens de la Passion du Christ si une seule voix ne peut contredire toutes les voix et tous les silences ?
Philippe Barthelet :
- Le point commun de la droite et de la gauche intellectuelle, c’est cette complicité objective et à beaucoup d’égards, spéculative, au sens étymologique : c’est un double miroir, et l’une renvoie à l’autre sans fin, puisque chacune ne se justifie que par son opposition à son opposée. Cette complicité de fait est beaucoup plus importante que leurs très contingentes divergences d’opinion. Elles s’entendent sur le fond pour exclure, et pis : décréter d’inexistence tout ce qui ne se passe pas entre elles : le théâtre de leur mascarade est le théâtre du monde, c’est même le monde tout court, rien n’existe en dehors du champ clos de leur parade d’affrontement. Il suffit de voir avec quelle unanimité instinctive la droite et la gauche se retrouvent pour condamner, par exemple, « la gnose » : il me souvient à ce propos d’un livre d’entretiens avec divers auteurs catholiques, venant de tous les points de l’éventail, de la gauche la plus conciliaire à la droite la plus intégriste. Tout en apparence les opposait, sauf un point, sur lequel ils se retrouvaient tacitement comme un seul homme : la dénonciation de l’entreprise « gnostique » de René Guénon. Guénon est à cet égard une pierre de touche merveilleuse qui, en abolissant les fausses querelles et les débats en trompe-l’œil, nous fait gagner beaucoup de temps…
Si je puis ajouter mon expérience toute chaude : un journal catholique m’a censuré au motif que je voulais parler des Saints de l’Islam d’Émile Dermenghem : j’aurais dû savoir qu’il n’y a pas de saints en dehors de l’Église – et que l’Islam est la cité du diable… On pense avec soulagement au vers de Péguy : « Moi qui ne suis pas un saint, dit Dieu »…
Quant au « respect de l’Autre », qui pour nos grandes consciences est le dernier mot de la morale sociale, il n’éveille en moi qu’un souvenir, plutôt fâcheux : l’Autre, pour les auteurs ascétiques de jadis, c’était le nom de l’Adversaire, celui qu’on ne voulait pas nommer. Nos grandes consciences ne croient donc pas si bien dire. Le langage est toujours étymologique : il dit toujours la vérité, même à notre insu – surtout, peut-être, à notre insu. Nos moindres paroles sont des aveux ; des paroles manquées, l’équivalent des « actes manqués », c’est-à-dire comme on sait parfaitement réussis, du Dr Freud…
Luc-Olivier d’Algange :
- Le comique (de répétition) est à l’œuvre dans les débats entre la Droite et la Gauche. On songe aux « petiboutistes » et aux « groboutistes » des voyages de Gulliver, qui disputaient de la façon d’attaquer l’œuf à la coque. Faut-il diminuer le chômage pour augmenter la consommation ou augmenter la consommation pour diminuer le chômage ? Le dilemme est peu cornélien et possède la tristesse qui caractérise le fond du comique.
Il faut croire que la « folie » d’Artaud se confond avec la plus brûlante lucidité lorsqu’il nous parle d’envoûtements. Comment expliquer sinon que cette merveilleuse disposition de la rencontre du monde avec l’entendement humain, avec ses preuves innombrables et étincelantes d’amour humain et divin, soit réduite à ces tristes mascarades ? Qu’en est-il de ce monde de forêts, de sources, de cathédrales, ce monde où la beauté s’enchevêtre à la beauté sur la terre et dans le ciel ? Notre monde, divisé en une Droite et une Gauche, qui n’ont plus rien à voir avec les colonnes de Rigueur et de Clémence de l’arbre séphirotique, apparaît de plus en plus comme un traquenard. Et la Droite et la Gauche sont également adroites (en usant de leurs extrêmes réciproques comme repoussoirs) à s’associer en une tenaille propre à broyer toute pensée. Toute pensée débute là où les opinions se déprennent. Mais elles s’accrochent, comme des pièges à loups.
Cioran, dans cette préface fameuse où il passe à côté de Joseph de Maistre, veut nous donner un « plaidoyer pour l’hérésie ». Mais c’est faute d’avoir compris la nuance maistrienne dont procède notre entretien. Or, j’y reviens, cette nuance, jugée spécieuse par certains, est avant tout logique. « Non une révolution contraire, mais le contraire d’une révolution ». Si donc, dans cette proposition on substitue le mot « négation », ou le mot « caricature » au mot « révolution », la logique de la phrase de Maistre éclaire la notion même d’hérésie. À la négation s’oppose non une négation contraire mais le contraire d’une négation, autrement dit une affirmation. De même nous faut-il opposer à la caricature du religieux non une caricature contraire (comme le fait par exemple Michel Onfray) mais le contraire d’une caricature. L’hérésie est moins une « déviance » qu’une caricature.
Les « gnosimaques », littéralement les « ennemis des connaissances », sont hérétiques en ce qu’ils caricaturent, dans un ordre inférieur, la nature inconnaissable de la Vérité. Ils ne consentent pas à la docte ignorance ; ils déclarent d’emblée ne pas vouloir savoir. On pourrait ainsi dire, non sans pertinence étymologique, que les gnosimaques sont des agnostiques péremptoires. L’hérésie gnosimaque, « l’exotérisme dominateur », pour reprendre la formule de Jean Tourniac, suppose un asservissement de la métaphysique, une instrumentalisation de la Théologie, une subjugation de l’autorité par le pouvoir qui veut interdire l’accès à la perspective intérieure, ésotérique, « bâtinienne ».
Le combat n’est pas d’aujourd’hui. Les hérétiques dominants imposent leur hérésie en se prévalant du nombre, de la quantité, de la force brute. De même, les spiritualistes « new-age » veulent faire servir leur « spiritualité » au mieux-être de la société ou de l’individu, comme si l’Esprit devait être à notre service, et non le contraire ! Lorsque la métaphysique n’est plus que la valeur ajoutée, la plus-value de l’économie générale du monde, elle n’est plus rien. Les Modernes sont perpétuellement à la recherche de recettes pour mieux « fonctionner », comme ils disent. Mais c’est la navigation qui est nécessaire, et non la vie, comme semble répondre le proverbe latin. Nous ne naviguons pas pour mieux vivre, mais nous vivons pour naviguer. La sainteté est universelle ou elle n’est pas. Ne la concevoir que reliée à une appartenance spécifiante, c’est précisément nier sa catholicité, au sens premier d’universalité. Les Saints de l’Islam, qui furent grandement persécutés par leurs gnosimaniaques, témoignèrent, en toute connaissance de cause, de la sainteté universelle qui sait distinguer l’eau de l’aiguière, pour reprendre la métaphore de Rumî. Ne confondons pas la transparence de l’eau avec la couleur du flacon ! On se souviendra aussi d’Héraclite parlant du « feu mêlé d’aromates ». C’est toujours le même feu, qui seul importe !
Philippe Barthelet :
- Qu’est-ce qu’un auteur ? Je songe à ce que disait un de nos amis perdus : un auteur est celui qui fait des volumes. On me passera ce jeu de mots fondé non seulement en raison, mais, j’oserais le dire, en grâce (après tout, ou plutôt avant tout, Dieu Lui-même nous a montré l’exemple de ces calembours qui ne sont en réalité que le déguisement de vérités profondes - que l’on songe au suprême : « Tu es Pierre… »). L’auteur est voué par nature aux trois dimensions créées, et surtout à la plus mystérieuse, telle que saint Paul la spécifie : la profondeur. C’est précisément la profondeur qui distingue le volume du plan. Dans sa Vie de Proudhon, Daniel Halévy rapporte une conversation qu’il avait eue à la fin du XIXe siècle avec un ébéniste du faubourg Saint-Antoine. Il lui demandait pourquoi eux, les ébénistes, étaient anarchistes quand les tailleurs du faubourg Saint-Marcel étaient communistes. L’ébéniste lui a répondu : « À cause du volume ; les tailleurs travaillent dans le plan, qui n’a que deux dimensions, alors que nous autres travaillons dans les trois dimensions, ce qui change tout ». Ce qui change tout, en effet.
On notera en passant que le plan, surface plane, appelle le plan, programme économique ou politique : c’est la même logique géométrique, les planificateurs sont des tailleurs… On retrouve ici « l’exotérisme dominateur » dont vous rappeliez les ravages en tous domaines. Les tailleurs ont pour patron Procuste… L’exotérisme est en définitive une illusion d’optique.
… Et quand on y songe, la « littérature » aussi… Car enfin, une grande œuvre est un accès immédiat à…, je ne sais comment dire, à une certaine dimension originelle qui s’impose comme une évidence (c’est d’ailleurs le seul sens précis de « génie », dont la littérature abuse tant : le génie est le sens de l’origine, l’évidence de son immédiateté : la caractéristique du génie est d’annuler a priori les scoliastes. À quelqu’un qui lui demandait un jour je ne sais quelle annotation qui « renouvellerait » l’œuvre de Simone Weil, Gustave Thibon avait répondu : « Depuis quand faut-il rafraîchir les sources ? »). Donc une grande œuvre (Sophocle, Dante, Shakespeare…) est une porte. On ne voit pas pourquoi il faudrait afficher dessus : « Ceci est une porte »… Comme disait Péguy qui à un examen avait dû expliquer Molière, et qui était resté sec, « c’est l’explication qu’il faudrait expliquer »… La porte, donc : me hante je ne sais pourquoi ce vers de Simone Weil, puisque nous parlions d’elle : « Ouvrez-nous donc la porte et nous verrons les vergers ». Toute grande œuvre est une porte, je ne sais pas, Don Quichotte, Moby Dick, elle nous ouvre les vergers. Arrivent un jour les spécialistes des portes : ils ne s’intéressent pas aux vergers (au début, par politesse ; puis très vite ils mettent en doute leur accessibilité, puis leur existence) ; en revanche ils n’en finissent pas de mesurer les portes sous toutes les coutures, de les comparer entre elles, etc. Ils pensent ou feignent de penser (pensent-ils encore ?) que les portes servent à cela… et ils appellent « littérature » la connaissance précise, documentée, de toutes les portes qu’ils recensent. Vous me pardonnerez cet apologue un peu grossier, mais il n’est tout de même pas très loin de la définition quasi canonique que donne de la littérature l’excellent Marmontel : « la littérature est la connaissance des belles lettres ; (…), lorsque, aidé de ses lumières, (l’homme qui cultive les lettres) a acquis la connaissance des grands modèles en poésie, en éloquence, en histoire, en philosophie morale et politique, soit des siècles passés, soit des temps plus modernes, il est profond littérateur ». Sans doute Marmontel prend-il soin de distinguer le littérateur de l’érudit : « Il ne sait pas ce que les scoliastes ont dit d’Homère, mais il sait ce qu’a dit Homère ». Sur le fond et à plus de deux siècles de distance (cette définition originelle date des Éléments de littérature de 1787, où Marmontel reprend l’essentiel de ses articles pour l’Encyclopédie), sur le fond, disais-je, il n’est pas sûr qu’il y ait aujourd’hui grand-chose à distinguer : il ne s’agit pas de préférer la connaissance des grandes œuvres à celle de leurs scoliastes, il s’agit de constater que l’on ramène tout à la même aune esthétique (dans le meilleur des cas), avec plus ou moins de science. Une grande œuvre est un véhicule, au sens à la fois religieux et… mécanique ; un véhicule est ce qui permet un transport, c’est sa raison d’être ; pour la « littérature », le véhicule est un objet, dont la fonction est simplement d’être là – d’être un objet d’étude… Imaginez une automobile ou un carrosse sans roue, un bateau sans rame et sans voile ou mieux, un oiseau empaillé…
La littérature, j’en reviens à ma première image, ou l’étude des portes qui ne s’ouvrent pas : puisque s’ouvrir est la dernière des choses que l’on demande à une porte, on peut même se suffire de fausses portes, de portes en trompe-l’œil – et l’on pourra même soutenir qu’elles ont plus de qualités – de qualités littéraires – que les portes véritables, qui n’ont d’autre raison d’être que de se faire oublier au bénéfice de ce dont elles gardent l’accès. Le souvenir des vergers – et que les portes ne sont que des portes, que diable ! (si je puis dire…) - et ici, le mot de souvenir redevient le parfait synonyme le réminiscence – le souvenir des vergers, donc, quand il vient poindre et ardre les cœurs vivants, et bien cela donne le meilleur de la « littérature » qui précisément, n’a rien de la littérature au sens marmontélien dégradé : cela donne Rozanov, ses « Feuilles tombées » contre toutes les feuilles mortes « littéraires », ou Dominique de Roux, ou qui vous voulez de lisible qui soit pour son lecteur un accès, un passage – et non une porte close, ou pis, une porte peinte sur un mur. La « littérature » ne mérite une heure de peine – et il en a toujours été ainsi – qu’à cause de ce qu’elle contenait de véridique ; qu’à cause, si vous voulez, de ce « contraire de la littérature » dont elle est l’écorce, ou l’excipient… C’est exactement ce que veut dire Villiers de l’Isle-Adam, quand il s’écrie : « Je me fous de la littérature, je ne crois qu’à la vie éternelle ». Eh bien précisément, la littérature, si elle n’est pas un moyen de vie éternelle - ce qu’elle n’est presque plus depuis qu’elle a pris conscience d’elle-même comme connaissance médiate, sous ce nom dangereux – devient, et je pèse mes mots, un moyen de perdition. Il ne s’agit pas, bien entendu, de recomposer les listes de l’abbé Bethléem le si mal nommé : là encore, contresens évident : ce n’est pas par son contenu que la « littérature » est pernicieuse, mais par cette perspective spirituelle qu’elle nous dérobe ; elle est « intrinsèquement perverse », et dans cet ordre, Chateaubriand est peut-être bien pire que Sade…
C’est quand la littérature retrouve la vie éternelle, ou plutôt le service de la vie éternelle, quand elle n’usurpe plus l’attention, c’est alors qu’elle mérite qu’on s’y attarde. Mais alors les critères qui seront les nôtres ne seront pas forcément ceux que manipulent les spécialistes des portes : c’est au nom de ce « contraire de la littérature » qu’Henry Montaigu soutenait que « Zévaco est plus important que Proust »…
Ce qui brouille évidemment un peu les pistes et les habitudes des auteurs de manuels… À mesure que les choses devenaient plus littéraires, c’est-à-dire plus desséchées, plus extérieures – les klippoth ou écorces mortes de la Kabbale, qui nous étouffent – cette voie du contraire de la littérature s’offrait plus escarpée, plus âpre, plus polémique (au sens littéral de la lutte pour la vie). Et les spécialistes des portes de stigmatiser benoîtement ces affreux « polémistes », qui se disqualifiaient eux-mêmes en haussant le ton : là encore, la définition du genre (où l’on enferme celui qu’on a ainsi défini) permet de ne pas se prononcer sur le fond : démarche éminemment littéraire. Encore un mot, et j’en aurai fini, je suis terrifié par cette inondation de paroles dont je vous prie de m’excuser : un mot de Drieu La Rochelle. Il dit un jour que sa génération était la dernière génération littéraire (et quelle ! songeons à tous les écrivains français nés entre 1885 et le début du siècle, entre Mauriac et Malraux) : « Après nous, il n’y aura plus le choix qu’entre la métaphysique et le bavardage ». Nous y sommes…
Luc-Olivier d’Algange :
- La métaphysique et les jeux de mots sont des instruments de connaissance. Toute métaphysique tient ses pouvoirs et ses vertus éclairantes des mots et des choses qu’elle fait parler. Ce que vous dites de la porte en trompe-l’œil, qui pourrait servir de définition à la littérature bien-pensante, « citoyenne » (plus fallacieuse, sinon plus opaque, que la porte simplement close du « travail du texte », de ce formalisme pur qui fut à la mode vers le milieu du siècle passé) nous donne à comprendre la nature de notre « post-modernité » qui n’est sans doute rien d’autre qu’un peinturlurage du nihilisme. Certains eurent ainsi l’idée de repeindre, en banlieue, les immeubles couleur de sorbet, sans pour autant en rendre l’architecture plus rafraîchissante. Nous sommes au comble de l’opacité lorsque les apparences précisément ne sont plus des apparences, lorsqu’elles ne laissent plus rien apparaître ni transparaître. Sans doute l’ésotérisme n’est-il rien d’autre que la restitution de l’apparence à son essence, à sa liberté d’apparaître, ce mouvement d’apparition (« tout fut jadis apparition d’esprits », dit Novalis), que la véritable théologie honore par l’herméneutique et dont le sens est tout entier dans le mot révélation.
Ce qui me fait penser à cette trouvaille de Marcel Duchamp qui dissimule peut-être une intuition : la porte angulaire qui s’ouvre lorsqu’elle se ferme, et inversement. Cette intuition serait alors alchimique, en référence au traité d’Eyrénée Philalèthe, L’Entrée ouverte au Palais fermé du Roi. Il n’est pas exclu, au demeurant, que Duchamp s’en soit inspiré. Celui qui vise le contraire de la littérature serait ainsi celui qui franchit le pas, mais il peut aussi, et c’est la principale et peut-être la seule vertu de la polémique, claquer la porte derrière lui. Alors, il disparaît. Il me semble que les auteurs que nous aimons écrivent en quelque sorte pour disparaître dans ces paysages qui apparaissent quand ils écrivent, dans ces vergers soleilleux, ou, s’ils inclinent au taoïsme, dans ces « montagnes vides »…
La porte qui ne donne sur rien sinon sur elle-même est à l’image de notre temps de fausses promesses : la liberté, par exemple, n’est plus qu’un argument publicitaire pour la servilité rigoureusement planifiée. Les scoliastes des portes cultivent une ingéniosité frivole à quoi il faut opposer, selon l’étymologie que vous rappelez du mot génie, l’ingénuité profonde des vergers.
L’exotérisme dominateur, le littéralisme morose, au demeurant, ne sont nullement « fanatiques » ou « médiévaux » comme feignent de le croire nos journalistes : ils sont frivoles, principalement occupés de modes vestimentaires, de foulards, et d’activités sexuelles. « Morale de midinette » disait Montherlant, les midinettes réduisant pareillement leurs curiosités. Et le littérateur est au diapason lorsqu’il devient sa propre commère ou celle des autres, non sans prétendre conférer à ses potins narcissiques ou fureteurs une « portée » psychologique ou sociologique. Mais à quoi se réduit cette portée ? À la désillusion érigée en fin mot de tout. La flèche tombe à ses pieds et voici le littérateur de s’enorgueillir de sa perspicacité : tout se peut réduire à une sacro-sainte banalité, le supérieur toujours s’explique par l’inférieur, le hasard et la nécessité régentent nos destinées et la Providence est un leurre. Ce qui manque à ces Messieurs, ce n’est plus la dialectique, c’est l’archée, autrement dit le sens de la profondeur qui naît de la vitesse de la flèche.
Il nous reste à nous désillusionner des spécialistes de la désillusion, à démystifier les démystificateurs qui sont les grands marabouts de notre temps. Que cache leur jubilation dépréciatrice, ce cri de victoire : « Ce n’est que cela ! » Quelle ruse du pouvoir s’exerce dans ce ricanement qui veut être le dernier mot ? Que nous veulent ces ingénieux de la dérision ? D’où procède, et vers quelles fins, cette méthode procustéenne ? Rien ne semble autant réjouir le Moderne que de savoir que nous ne serons bientôt qu’une carcasse vermineuse selon le hasard et la nécessité. Toute générosité est donc bien inutile et vaines la grandeur d’âme, la beauté sise dans l’instant. Le moindre signe de ferveur est considéré par nos « sceptiques » comme un ridicule ou un danger, mais c’est la vie même, pour ces censeurs, qui est ridicule et dangereuse. Si la littérature contraire n’est rien d’autre que le protocole de la désillusion, il revient au contraire de la littérature, qui n’est autre que la littérature hauturière, de retrouver les ingénuités magnifiques de la poésie et de la métaphysique, en précisant que la métaphysique inclut la physique, de même que l’âme inclut le corps. Il nous faudra donc pousser le pessimisme jusqu’au bout, traverser, comme le préconisait Nietzsche, tous les champs du nihilisme pour retrouver ce qui jamais ne cessa d’être là, le Royaume.
Or le Royaume, à la différence de la nation, invention littéraire qui ne concerne que les hommes, s’ouvre sur les volumes de la terre, du ciel, et de Dieu. Ce qui insatisfait dans la nation, qu’il faut pourtant parfois défendre bec et ongles, c’est bien cette absence de volume, cette subjectivité abstraite que l’on nomme « identité » mais où le « culte du nous », de la nation, n’est jamais que la transposition du « culte du moi ». Celui qui appartient au Royaume n’a pas besoin d’identité : il appartient au Royaume, la question ne se pose plus. Et le Royaume lui-même n’a pas besoin d’identité, étant l’empreinte d’un sceau invisible, d’un plus haut Royaume dont l’autorité nous désillusionne du hasard et de la nécessité.
Philippe Barthelet :
- Oui, il faut en finir avec le nationalisme, où s’est fourvoyée la pensée royaliste au XXe siècle. Nous a-t-on assez répété que « nation » voulait dire naissance ! Eh bien précisément ce n’est pas naître qui nous intéresse, mais renaître ; non pas le corps de chair passible et mortel mais le corps glorieux, ne soyons pas si modestes… Que la pensée royaliste s’achève dans la cuisine de M. Renan m’a toujours révulsé… « Qu’est-qu’une nation ? » Je vous répondrai comme aurait peut-être répondu un homme du XIIe siècle : je n’en sais rien – et moi qui suis du XXIe j’ajouterai que je n’en veux plus rien savoir. Bien sûr je n’oublie pas, comme vous le rappelez, que la nation est une réalité première, immédiate qu’il faut parfois défendre bec et ongles, comme il l’a fallu au début du dernier siècle, quand Maurras et quelques autres ont fondé « l’Action française ». Mais au fait s’agit-il tellement de « nation », en l’occurrence ? Un autre supposé « nationaliste » (voire « maurrassien », selon la vulgate médiatique), le général de Gaulle, n’emploie presque jamais ce mot : ce fut une surprise pour quelques politologues qui avaient passé ses discours à la moulinette informatique. Le mot « nation » n’apparaît presque jamais ; de Gaulle parle de « France », naturellement, et de « patrie ». Rappelez-vous l’appel du 18 juin : « Notre patrie est en péril de mort : luttons tous pour la sauver ! » Au lieu que la « nation » est une invention révolutionnaire, la réduction biologique et pour tout dire la perte du Royaume. Allez donc voir dans une vitrine du métropolitain, sur le quai de la station Odéon et à côté du buste de Danton l’un de ses signataires, le décret n° 222 (pourquoi pas 666 ?) en date du 21 septembre 1792, « an quatrième de la liberté » : « La convention nationale décrète à l’unanimité que la royauté est abolie en France ». Le décret a pour en-tête un blason aux trois fleurs de lys entre lesquelles court en capitales le nom du nouveau souverain, « LA NATION FRANçAISE » et en dessous le millésime, « 1789 ». Pierre Boutang, qui a fait de ce nom le titre de son journal, n’a pas dû prendre souvent le métro à Odéon…
Vous me permettrez ici de vous citer en rappelant l’opposition capitale que vous faite (capitale, j’insiste, et s’il y a un jeu de mots, eh bien c’est qu’il a peut-être un sens) entre les deux titulatures à quoi les historiens et les politologues prennent d’ordinaire si peu garde : entre “roi de France” et “roi des Français”. C’est Louis XVI le premier, rappelons-le, qui a accepté de n’être plus que le “roi des Français”, c’est-à-dire le roi de ses contemporains, des hommes actuels vivant au même moment que lui, à l’exclusion des morts et des hommes à naître, à l’exclusion des bêtes, des fées, des anges et des démons, à l’exclusion des arbres, des pierres, des rivières, de la terre et du ciel, en un mot de tout ce qui fait que la France excède infiniment sa réduction nationale… La “nation” est ici la réduction du “royaume” aux deux dimensions du plan… Louis XVI avait parjuré, je sais qu’il n’est pas bien vu de critiquer le roi-martyr, mais enfin, être “roi des Français”, ce n’est pas ce qu’il avait promis à son sacre… Il fallait bien qu’il meure pour expier, rétablir un équilibre mystérieux qu’il avait perturbé – et le vrai roi-martyr est le petit Louis XVII, véritable dernier roi de France, mort Dieu sait quand…La disparition de la royauté en France est le secret de Dieu – et j’entends “disparition” comme mouvement inverse à l’apparition, au sens où l’emploie Novalis.
Après, il y eut les rois restaurés, “de France” (et même “… et de Navarre”) pour rire, car enfin, la royauté ne se restaure pas plus que les têtes ne se recollent (on prétend que les saints de la cathédrale de Reims, décapités par les révolutionnaires et que l’on avait replâtrés en hâte pour le sacre de Charles X, ont reperdu leur tête au moment de la canonnade…) Enfin Louis-Philippe a cru pouvoir assumer la révolution en reprenant la titulature de 1791 : “roi des Français”, où le baiser de La Fayette remplaçait l’onction de Reims. Sans doute son petit-fils, au moment de devenir, à la mort du comte de Chambord, le chef de la maison de France, a-t-il voulu prendre en charge tout l’héritage capétien – c’est pourquoi il a tenu à s’appeler Philippe VII et non Louis-Philippe II. Il n’en reste pas moins que la cause royale a été dévoyée, au XXe siècle, par le nationalisme… C’est si vrai que Maurras a fini par se brouiller avec son prince et lui préférer un quelconque Franco ou Pétain – un régent qui préparerait les voies à la restauration, mais qui les préparerait à n’en plus finir (on réédite Mac-Mahon). La moindre ganache étoilée fait l’affaire mieux qu’un prince : on croit dire “vive le Roi !” quand on a dit “à bas la république !”. Les monarchistes (si peu royalistes, au fond) de 1870 à 1950 auront tout perdu à cause de leur nature profondément timorée – à cause de leur nationalisme. Quand Pierre Boutang (pourtant l’un des plus fols – l’un des moins à l’abri de la sagesse calculatrice de M. Renan qui compte ses hommes, ses rois (“les quarante rois qui ont fait la France” !) ses sous et ses abattis – quand Pierre Boutang, donc, appelle son journal, par quoi il veut refaire l’Action française, la Nation française, il dit tout : il manifeste aussi que tout est dit, que le cycle du nationalisme français (et de la confusion nationalisme-royalisme) se referme. Il a cru que le général de Gaulle serait un Monk possible – encore un, et cette fois-ci le bon ; et puisqu’il y avait un prince, qui s’apprêtait nous disait-on à “remonter à cheval”… On sait comment tout cela a fini, de catastrophe en catastrophe jusqu’à la faillite personnelle… Aujourd’hui, Dieu merci sans doute, la confusion politique n’est plus permise : la cause royale n’a même plus d’apparence…
Je ne veux pas m’acharner contre Maurras, mais enfin est-ce qu’il est absolument nécessaire que les royalistes partagent le goût des nationalistes pour les uniformes ? Ce n’est certes pas Joseph de Maistre qui aurait soutenu Mac-Mahon, ou Boulanger, ou Pétain, lui qui disait que le pire des gouvernements est le gouvernement militaire… Le fond du problème est que ces monarchistes des deux derniers siècles n’étaient que très peu royalistes…Aujourd’hui, le malheur des temps est comme toujours simplificateur : nous ne pouvons plus nous leurrer avec je ne sais quel “pays réel”, qui attendrait que l’on remette en place le trône renversé, une fois liquidé le malentendu de la République. La république n’est pas un malentendu : c’est l’écorce morte de la royauté, la chair méhaignée du Royaume, qui attend la question de Perceval…
Luc-Olivier d’Algange :
- La liberté, mot infiniment galvaudé, ne vaut que lorsqu’elle est, non une abstraction, une généralité, mais un envol qualifié. Sinon elle est ce “partout”, exact équivalent de “nulle part”, autrement dit un “sur-place” désespérant. Il nous faut des libertés qui soient autant de qualités. Or, la seule expérience est un leurre publicitaire. La liberté ne s’expérimente pas en laboratoire, elle se vit, elle s’établit comme on établit une relation. Ainsi on ne tarde pas à s’apercevoir que les expériences de la liberté qu’on nous propose sont autant de chausses-trapes, de faux-semblants qui s’apparentent plus ou moins au tourisme organisé, cette utopie réalisée du moi qui perdure “tel quel” mais ailleurs…
Ce qui importe, c’est de passer de l’autre côté du miroir, avec les gants, comme dans le film de Jean Cocteau, de l’autre côté de cette onde sombre et frémissante… Dans ce franchissement du miroir, je vois la définition même du mot “relation”. La relation haussée au mystère devient translation orphique. Et l’on voit bien, alors, à quel point le monde où nous sommes ne veut rien savoir de la liberté, à aucun prix ! Ce monde modernisé est un monde où chaque individu est l’ennemi personnel de l’homme libre. D’où ce terrifiant grégarisme, cette socialisation extrême (toujours au seuil du lynchage ou de la lapidation) qui est le propre de la démocratie fondamentaliste dont la devise demeure : “Pas de liberté pour les ennemis de la liberté”.
Mais revenons à Cocteau, et à ce que l’on pourrait nommer son hypnosophie et distinguons d’emblée cette hypnosophie, en tant que science orphique, de cette sorte de culte de l’inconscient où se complurent parfois les Surréalistes. J’y reviens précisément en écho à ce que vous disiez de l’Incarnation. Ce qui s’incarne, ce qui prend chair, est semblable à ce sommeil qui nous prend. L’incarnation est un ensommeillement de l’âme, mais il faut distinguer le sommeil léthéen, le sommeil des vagues noires de la surface du sommeil lumineux des tréfonds où retentit la clarté de l’incréé (de l’En-Sof, pour user du langage des kabbalistes). Il y aurait donc deux sommeils, l’un n’étant que la houle ténébreuse de notre état de veille ordinaire, - qui n’est lui-même qu’un état somnambulique ; l’autre étant le sommeil bruissant de clartés, le sommeil d’enfance, le sommeil enchanté qui s’ouvre sur l’éveil véritable, sur ce matin philosophal dont la rosée rafraîchit les mains et les joues. La chair alors n’est plus ce qui sépare de l’âme, mais le sommeil et l’éveil de l’âme. Le somnambule moderne livré à son activisme technomorphe ou lucratif ne peut ni dormir ni s’éveiller, ni s’incarner. Il est cette abstraction, cette virtualité errante, insomniaque et jamais éveillée, cette réalité spectrale manipulée par les logiciels, ce déni absolu de la réalité douce ou tragique, de cette “tache bleue du Pacifique” que vous évoquiez, et qu’il appartient aux hypnosophes, autrement dit aux poètes, de nous restituer.
Toute chose ne cesse de s’endormir et de s’éveiller ; nous avons oublié cette inspiration et cette expiration. On mesure les vertus de l’hypnosophie, dont Nerval et Jünger furent les intercesseurs, dès lors que l’on considère la littérature née de son absence. Nous évoquions, dans une conversation à la fin du précédent millénaire, s’il m’en souvient, cette héraldique du songe à propos de Jünger… Toute œuvre digne de ce nom est un armorial, - dont elle possède aussi les lignes fermes et les couleurs éclatantes et profondes. Toute œuvre est un éloge de la lumière qu’elle capte et qui vient de plus loin qu’elle-même pour aller ailleurs, à travers la prunelle du lecteur.
Les œuvres héraldiques sont les œuvres où l’on se perd, et parfois une seule phrase y suffit, mais l’on s’y perd comme on se perd dans le Grand Ordre, dans une cathédrale, dans une forêt. On s’y perd pour s’y retrouver dans la clairière, comme l’éveil au sommeil succède. Le progressisme, qui favorise la pire régression, n’est autre que la méconnaissance des contrées du sommeil, de cet “au-delà des portes de corne et d’ivoire” qu’évoque Nerval aux premières lignes d’Aurélia (qui est sans doute le texte fondateur de ce que nous nommons ici le “contraire de la littérature”.) Ne jamais se recueillir, ne jamais s’abandonner, être dans le faux-jour perpétuel de la technique, abolir toutes les distances dans une omniprésence somnambulique… - rien d’étonnant alors à ce que les Modernes veuillent éperdument le “changement”, et même la mort : leur monde est invivable. Observons qu’à l’inverse les hommes des sociétés dites traditionnelles craignaient et même détestaient le changement : signe, peut-être, qu’ils se trouvaient dans un monde heureux ?
Nietzsche ne dit rien d’autre dans son chant des Douze Coups de Minuit : “D’un rêve profond je me suis éveillé / Le monde est profond / Et plus profond que ne le pensait le jour / Profonde est sa douleur / La joie plus profonde que l’affliction / La douleur dit: Passe et finit / Mais toute joie veut l’éternité / Veut la profonde éternité.”
Philippe Barthelet :
- Mutantur non in melius, sed in aliud… Sénèque le remarquait déjà à propos ses contemporains, « modernes » avant la lettre, qu’ils voulaient changer non pas en mieux, mais en autre chose… Les modernes sont mal assis, « mal perchés », comme disait Baudelaire de son éditeur, et ce prurit de changement sans fin ni cesse et à tout prix est, en effet, à la fin des fins et même s’il se méconnaît comme tel, une aspiration à la mort… (D’ailleurs il serait facile – et lugubre – d’énumérer tout ce que notre monde a de thanatocratique… L’enfer du décor, pour reprendre une autre de vos expressions qui a la concision – et la complétude – d’une devise héraldique…)
L’héraldique me fait songer à un autre vieux mot, du vocabulaire d’avant le déluge, et qui connaît aujourd’hui une vogue singulière, celui de « médiatisation ». C’est l’office des “médiateurs” : on désigne sous ce nom tous ceux, journalistes, intellectuels, oracles divers, qui parlent ou écrivent dans « les médias » pour nous, c’est-à-dire à la fois pour notre gouverne et à notre place. Le mot est révélateur. On ne pourrait donc avoir accès à la réalité que par la médiation des medias… On parlait autrefois, en droit germanique, des princes « médiatisés » : c’était ceux qui, relevant directement de l’Empereur, voyaient leurs États incorporés dans un autre État vassal. Nous voilà tous, désormais, médiatisés – privés d’une relation directe avec l’empire de nous-mêmes et soumis à la tutelle pédagogique de tous ceux qui pensent et qui parlent pour nous…
« Vous avez mis les peuples au collège », ô Bernanos, qui aviez flairé l’imposture d’instituteur de la démocratie… La pédagogie universelle, panacée à tous les maux de l’homme et de la société, thérapeutique efficace du péché originel… On devrait s’interroger un peu sur le cousinage de « pédagogie » et de « démagogie »… On devrait rappeler aussi, en passant, qui est l’inventeur de l’expression « éducation nationale », cette formule de la démocratie comme pédagogie perpétuelle : le marquis de Sade, dans Français, encore un effort si vous voulez être républicains, un intermède théorique de la Philosophie dans le boudoir… Eh oui, le texte fondateur de la République française est un chef-d’œuvre de la pornographie. On peut d’ailleurs tout reprocher à Sade, sauf de manquer de conséquence ; « l’éducation nationale » est pour lui le combat contre la religion des « imposteurs chrétiens » et la propagation de l’athéisme : « Français, vous frapperez les premiers coups ; votre éducation nationale fera le reste ». Il réclame donc d’enlever au plus tôt les enfants à leurs parents : « N’imaginez pas de faire de bons républicains tant que vous isolerez dans leurs familles les enfants qui ne doivent appartenir qu’à la république ». D’ailleurs, pour lui, la communauté des enfants répond de la communauté des femmes. « L’amour » doit être une passion commune, et c’est faire injure à ses semblables que d’aimer quelqu’un en particulier, puisque c’est leur retirer un objet de jouissance possible… Les enfants naîtront sans père, tous fils de la « patrie » : on reconnaît là la théorie des Lebensborn hitlériens. Hitler, en bon Allemand, a pris au sérieux la « grande Révolution française », dont il avait annoncé dès son arrivée au pouvoir que « la révolution nationale-socialiste » serait l’accomplissement (mais on s’est bien gardé de le répéter, surtout en France…)
Autre point sur lequel le divin marquis est un précurseur du nazisme : l’élimination des « enfants difformes » : il explique que la dépense des hôpitaux, asiles et maisons de charité, « richement dotés pour conserver cette vile écume de la nature humaine (sic) » doit être « réformée par la nation » ; en effet, « tout individu qui naît sans les qualités nécessaires pour devenir un jour utile à la république n’a nul droit à conserver la vie, et ce qu’on peut faire de mieux est de la lui ôter au moment où il la reçoit ». Voilà qui est clair, et surtout qui est logique ; encore une fois, au contraire des « républicains » à qui il s’adresse, Sade à l’éminent mérite de la cohérence. Il ne recule devant aucune conséquence des principes qu’il défend. Son culte de la nature – la « loi de la nature » qui est pour lui la loi suprême n’est rien d’autre que la loi du plus fort, au sens de Hobbes – le pousse à conclure en souhaitant la mort de l’homme : en effet, la nature est sainte, rien n’est crime à ses yeux et la seule fausse note du concert universel est apporté par l’homme et toutes les chimères, « impostures » et « superstitions » qu’il enfante sans cesse. Que si la nature nous enseigne la Raison, elle nous désigne fatalement le seul obstacle au règne incontesté de celle-ci – et cet obstacle, c’est l’homme lui-même. Quand Sade dit que le triomphe de la nature serait la mort de l’homme, il ne fait que pousser le sophisme « humaniste » jusqu’à ses dernières conséquences. Je ne vous cache pas que j’ai pour le marquis de Sade une inavouable tendresse ; et que je donnerais pour son œuvre – y compris tout ce fatras ergastulaire qui est à peine fait pour être lu – tout Voltaire, tout Diderot et même tout Jean-Jacques, sans compter tous les petits maîtres… il n’a manqué à tous ceux-là que de vivre quinze ou vingt ans de plus, pour connaître – et croyez que ça n’aurait pas manqué ! – le sort de ce pauvre Condorcet : celui-là, la conséquence qu’il n’avait pas dans l’esprit, les événements se seront chargés de la lui enseigner… Ce que j’aime par dessus tout chez M. de Sade, c’est ce « plaisir aristocratique de déplaire » qu’il manifeste quasi à son insu. Ce n’est pas un fils de notaire ou de marchand de couteaux, il n’a rien de ce pharisaïsme chafouin, de cette prudence petite bourgeoise des « philosophes » : lui s’expose, « se mouille », joint le geste à la parole et soutient les conséquences de ce qu’il dit, même si ce qu’il dit est délirant – même, ou surtout, peut-être. Pierre Klossowski observait que deux hommes seulement auront compris la Révolution pour ce qu’elle était : une « communauté caïnite », et il les place de part et d’autre de son allégorie, comme deux soutiens héraldiques : le marquis de Sade et le comte de Maistre.
Le soleil de l’après-midi faisait briller les vitrines ; les deux causeurs étaient les derniers convives, et les serveurs échangeaient entre eux des regards appuyés. Ils ouvrirent soudain de grands yeux quand le dernier qui avait parlé, un cigare à la main qu’il humait, les interpella : “Garçon ! la guillotine !”.
L'ouvrage entier, naguère publié par les éditions Arma Artis, est réédité aux éditions de L'Harmattan, dans la collection Théôria.
« Ce qui manque le plus à notre temps, c'est une aristocratie de l'esprit » déclarait le grand Bernanos comme le rappelle Philippe Barthelet au cours de l'un de ces onze entretiens avec Luc-Olivier d'Algange placés sous le signe des Soirées de Saint-Pétersbourg de Joseph de Maistre dont ils reprennent le protocole, ce qui est audacieux, mais non pas présomptueux tant le résultat se révèle édifiant et comble à merveille ce vide désigné par le prophète de La France contre les robots.
Réédition d'un livre publié en 2010, Terre Lucide n'a rien perdu de son urgente actualité puisque les deux écrivains s'y attaquent à l'époque en tant qu'ère métaphysique, autant dire que les années qui passent ne cessent d'en révéler davantage la nature profonde ; une ère qui fait du vivant avec du mort, dont la perspective est mécanique, déliée, absurde, et l'humeur dépressive et grimaçante. Se référant aux grands mystiques, à la théologie médiévale, à Novalis, Hölderlin et Jünger, Maistre ou Bloy, nos contemplatifs armés lui opposent un symbolisme supérieur où la vie, l'art et le surnaturel retrouvent leurs connexions, leurs vibrations et leur puissance. Une cure d'altitude, le temps d'une promenade au bord de la Seine ou de quelques verres devant le Louvre, tandis que tout s'effondre. Salutaire, voire salvifique.
Romaric SANGARS, L'INCORRECT, décembre 2022.
元
Deux hommes en quête de l'âme du monde
Les dialogues de Philippe Barthelet avec Luc-Olivier d'Algange, réunis dans Terre lucide, ne sont pas des colloques d'intellectuels, Ils nous offrent cette chose presque unique aujourd'hui, un art de vivre, et quelques indices et pistes pour retrouver des chemins trop longtemps abandonnés ou simplement oubliés.
Notre époque est assourdissante. La musique du monde et ses rythmes sont recouverts par la mitraille incessante des fausses paroles et des slogans. Les voix essentielles ne trouvent aujourd'hui qu'un très faible écho, brouillé par le bavardage des sectes intellectuelles, les novlangues idéologiques et le vacarme des industries culturelles. Et nous avons parfois le sentiment accablant que tout est tout est vain, que tout est joué, et que c'est à la fin la "panmuflerie sans limites" ( Charles Péguy) qui l'emportera dans le tintamarre et le brouhaha.
C'est dire que j'ai lu avec bonheur et soulagement Terre lucide, une conversation en onze entretiens entre Luc-Olivier d'Algange et Philippe Barthelet que publie aux éditions de L'Harmattan et dans son excellente collection Théôria notre ami Pierre-Marie Sigaud. Je me suis en effet promené dans ce livre comme dans un vaste jardin isolé en bord de mer. Une brise rafraîchissante y souffle, qui nous tient en éveil, et l'on y cueille des fleurs des fruits rares ou trop négligés. D'Algange et Barthelet sont aimables, courtois et érudits, d'une amabilité et d'une courtoisie qui m'ont semblé presque médiévales, et d'une érudition qui vient toujours à point nommé, dont ils n'usent jamais pour flatter ou épater leurs lecteurs. Les deux auteurs de ces denses et libres propos sur la littérature, la politique, la poésie, l'histoire, les rois, les peuples, les dieux, Dieu et le monde, feront fuir les "ennuyés, les grincheux, les puritains, les commères, les censeurs, les faiseurs de système et les accusateurs" et toutes les légions d'assommeurs et d'abrutisseurs. Les autres, en arpentant cette Terre lucide et en écoutant attentivement les deux amis, trouveront de quoi se ragaillardir et se remettre en selle.
Philippe Barthelet et Luc-Olivier d'Algange sont-ils des antimodernes, m'a demandé un amateur de définitions qui a lu le manuel d'Antoine Compagnon. Ils sont assurément les sujets de cette France souterraine dont parle Nicolas Berdiaev dans son autobiographie spirituelle, de ce pays secret qui compte parmi ses paladins Joseph de Maistre, Charles Baudelaire, Barbey d'Aurevilly, Villiers de l'Isle-Adam et Léon Bloy. Et ce n'est pas pour eux une posture littéraire. Barthelet et d'Algange mènent le combat pour ce royaume contre les idoles et les impostures de l'immonde moderne, contre ses cliques, ses nations et ses sociétés anonymes. On trouve dans les pages de ces entretiens sur les météores et les signes des temps des charges et des assauts. Les misères et les ridicules du temps y sont bien nommés, et les agents du néant et du désastres, et les plus tristes et les plus dangereux, y sont justement fustigés. Luc-Olivier d'Algange écrit par exemple ces phrases: " Les hommes de ce temps sont abaissés, humiliés, ratiboisés selon une méthode procustéenne si efficace qu'elle donne à leurs revendications hédonistes, profiteuses ou festives, un ridicule frôlant sans cesse le pathétique. La société est-elle en proie aux individus ? Mais quelle société ? Quels individus ? Je vois, plutôt qu'un éclatement, une concentration de laideur, un monde concentrationnaire, comme une parodie théocratique de laquelle on ne peu s'échapper que par une sorte de ruse animale" Voilà qui touche au coeur, n'est-ce pas ?
Mais les beautés de Terre lucide ne sont pas seulement des beautés d'offensive et de contestation. J'ai dit plus haut qu'on pouvait y cueillir des fruits rares ou trop négligés. Parmi ceux-là, et c'est au fond l'essentiel, la seule chose nécessaire, j'y ai découvert une invitation à renouer avec les oeuvres, les paysages et les Muses. Ces oeuvres, ces paysages et ces Muses sont aujourd'hui aussi bien ensevelis sous des tonnes de béton que sous des montagnes de gloses et de commentaires. Ils attendent leur libération. Il suffirait sans doute que nous nous prêtions à nouveau à leurs jeux et à leurs entretiens.
Olivier François, article paru dans la revue Eléments.
元
Un trop bref texte que j'avais écrit après la lecture de «Terre lucide» de mon ami Luc-Olivier d'Algange, alors que je voyageais dans les montagnes du Caucase en octobre :
Parution d’un livre de dialogue important entre Luc-Olivier d’Algange et Philippe Barthelet. Il est question, dans ce compendium, des météores, ces signes dans le ciel, à quoi s'arrêtent les Pharisiens et Saducéens, qui ne savent pas lire les signes des temps, comme il le leur est reproché dans l’Evangile : - «Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps.» (Mt, XVI, 4). Les deux auteurs de ces entretiens s'attachent à relever ces signes des temps, dont René Guénon a fait le titre d'un livre célèbre, publié en 1945. Et si la vérité débutait après nos dernières illusions ?
Il était, dit-on en Géorgie où je me trouve, un roi qui décida un jour de quitter son palais pour parcourir le monde. Il voulait connaître le secret du bonheur. Il alla de terres en terres, puis de provinces en provinces, mais partout, il retrouvait ce qu’il avait quitté : une nostalgie, une tristesse, un désir inassouvi. Partout, jusqu’au jour où, au plus profond d’une vallée, protégés par une rivière, il découvrit, retirés de tous, des êtres heureux, comme il n’en pouvait plus imaginer. Ils banquetaient, le vin coulait à flot, les discours poétiques s’enchaînaient, et il décida de s’asseoir avec eux pour partager leur bonheur. C’est alors que …
Sur ce point, la suspension s’impose. Cette découverte du roi, c’est celle que Luc-Olivier d’Algange et Philippe Barthelet dans leur ouvrage, «Terre lucide», arrivent à susciter, au gré d’un dialogue passionné, dans l’esprit de leur lecteur. Lire ce livre en Géorgie, alors que les Russes fuyant la conscription sont nombreux à errer dans la capitale et sur les routes du pays, lire ce livre, dis-je, dans de telles conditions et dans un tel endroit, c’est ressentir un double plaisir : échapper à l’histoire en ce qu’elle a de pire, et être à son rendez-vous en ce qu’elle entretient une promesse qui, d’âge en âge, ne cesse de nous tenir debout.
Luc-Olivier d’Algange est un éminent connaisseur des penseurs de la poésie, de Novalis à Jünger, quand Philippe Barthelet est un poète de la connaissance, comme le fut son maître, Gustave Thibon, l’ami de Simone Weil. Tous deux ont en commun dans ce livre de se déposséder de la prétention à avoir raison l’un sur l’autre, ou à prouver que l’un seul aurait raison. Non qu’ils soient d’accord sur tout dans détail, sans être en désaccord sur l’essentiel. À la parole conçue comme un tournoi, ils opposent un dialogue apparenté au chant selon une exigence autrement plus redoutable : où la première voix fait entendre ses harmonies, la seconde reprend et se doit de développer le motif, comme à l’infini. Autant le dire : rien de plus plaisant, car on sent qu’on est soi-même convoqué à chercher la vérité avec les amis, plutôt que d’assister à une joute où chacun est condamné à son quant-à-soi. Vieille tradition, au demeurant, qui remonte aux Entretiens de Goethe avec Eckermann, en passant par le dialogue de Mercier et Camier chez Beckett, ou sur un versant intellectuel, à celui de Pierre Boutang et George Steiner qui avait tant ébloui ceux qui l’avaient vu à la télévision. C’est que ce livre montre ce qu’est un dialogue : non pas un monologue interrompu par une question, mais l’appréhension à deux d’une vérité qui ne s’offre que dans l’échange, selon une loi dégagée voilà des millénaires par les disciples de Socrate et Platon. Mais après tout, n’était-ce pas Nietzsche qui affirmait lui aussi que «la vérité commence à deux» ?
La vérité, certes, mais laquelle ? Celle qui veut qu’on ne se montre digne de sa vocation à être humain que si on cherche «l’âme du monde», qui n’est rien de commun avec une énigme. «L’âme du monde» est au mystère ce que la devinette est à l’énigme : ce qu’on désire chercher sans fin, plutôt qu’une interrogation subtile dont la réponse disqualifierait la profondeur. Pour avancer dans leur quête, Luc-Olivier d’Algange et Philippe Barthelet convoquent le meilleur de la tradition : Joubert, Joseph de Maistre, les Romantiques allemands, des penseurs aussi originaux que René Guénon ou Philippe Muray. Pour autant, ils ne se privent pas de cravacher certaines vaches sacrées. Alors revient, lancinante, la question à l’oracle comme à Delphes : que faire, non pour fabriquer je ne sais quoi, mais pour être ? À l’heure où la science rend les avancées du post-humanisme concrètes, cette question prend toute sa force, qui n’est pas tant passéiste qu’appelée à être prophétique. Qui suis-je dès que je ne souhaite pas me réduire à un numéro de sécurité sociale, à un code-barre, à un agent consommateur et bientôt consommé ? Qui suis-je pour pouvoir rêver, aimer, créer ? Qui suis-je, si le Verbe peut seul me conduire au salut, pour parler comme il le conviendrait ? Luc-Olivier d’Algange et Philippe Barthelet ne manquent de décrire notre époque pour y apporter non seulement une critique, mais les éléments pour résister à cette critique et aller plus avant, emporté par le vent d’un galop, où nos plus lointains ancêtres reconnaîtraient leur frappe. Certes, comment ne pas être saisi ? «Nous nous trouvons comme à ce moment de L'Ile mystérieuse de Jules Verne où le frêle esquif des héros se trouve pris dans une immobilité exquise, encalminée entre deux magnifiques mouvements en sens inverse l'un de l'autre : celui, en bas, des bancs de poissons, et, en haut, des nuées d'oiseaux.»
C’est l’impression du conte géorgien. Le secret du bonheur peut soudain advenir. Mais que dit la fin du conte ? Après avoir bu et mangé avec un ravissement inconnu, et après avoir écouté les discours de celui qui tenait la table, le roi alla voir le chef du village et lui déclara : «j’ai tout quitté pour trouver le bonheur. Et je l’ai enfin trouvé chez vous.» À quoi le chef du village répondit : «Mais que dis-tu ? Nous sommes les êtres les plus malheureux du monde ! C’est pour cette raison que nous faisons la fête et que nous chantons.»
Stéphane Barsacq
Luc-Olivier D'Algange, Philippe Barthelet, Terre lucide, Entretiens sur les météores et les signes des temps, Collection Théôria, L'Harmattan, 30 €