12/04/2024
Gérard de Nerval, lecteur de Joseph de Maistre:

Luc-Olivier d'Algange
Gérard de Nerval, lecteur de Joseph de Maistre
Il existe dans la tradition française un fort courant songeur, surnaturaliste, mystique et prophétique qui, loin de soustraire à notre entendement quelque clarté que ce soit en éprouve les véritables puissances d'embrasement et de transfiguration. Comment ne pas entendre l'œuvre de Racine comme l'épanouissement d'un Songe mélodieux et terrible ? Comment ne pas reconnaître dans les pensées de Pascal la persistante présence des abysses ? S'il est une constante dans la littérature française, elle est bien dans la coïncidence de la métaphysique et de la poésie, dans l'accord de la Doctrine et du Chant et dans l'audace à requérir contre la banalité des apparences le jugement d'une « expérience-limite » où la claire raison, en s'éprouvant à ce qui la fonde et la menace, ouvre à la pensée l'empire des illuminations et des correspondances.
Gérard de Nerval fut, comme Baudelaire et Balzac, un fervent lecteur des Soirées de Saint-Pétersbourg. Il y trouva l'idée, traditionnelle par excellence, d'une antériorité lumineuse et inspiratrice, qui réduit à l'état de vantardise pure la prétention civilisatrice des modernes: « C'est une idée très-frappante, écrit Gérard de Nerval, que celle de Joseph de Maistre qui suppose que les sauvages ne sont nullement des hommes primitifs, mais, au contraire, les derniers représentants d'une civilisation dégradée et abolie ». En amont du temps, en quelques contrées hors d'atteinte mais présentes dans l'âme des poètes, il y eut donc une sapience plus haute. Certes, cette sapience semble éteinte, sa doctrine est généralement oubliée, et toutes les « valeurs » modernes se fondent sur cet oubli, mais elle n'est pas, pour autant, annulée. De tout ce qui fut, il demeure quelque chose. La sagesse s'est éloignée, mais ses traces demeurent en nous, non dans notre entendement diurne mais dans nos rêves, une fois franchies « les portes de cornes et d'ivoire qui nous séparent du monde invisible » - et gardent l'empreinte des Symboles oubliés ou bafoués.
La vie et l'œuvre de Gérard de Nerval consisteront à retrouver, par des voies périlleuses, dans les profondeurs du rêve, l'empreinte du sceau invisible des Symboles. Dans Le carnet de Dolbreuse, Nerval écrit: « Les songes avertissent l'homme parce qu'alors la conscience prend une vision indépendante ». L'œuvre du poète consiste à se rendre attentif à ces avertissements. Ce qui demeure en nous des Symboles d'un Age d'Or oublié nous avertit des désastres et des reconquêtes futures en nous révélant que l'espace-temps qui nous emprisonne n'est qu'une illusion. « Pour en revenir à la nuit et aux songes, écrit Joseph de Maistre, nous voyons que les plus grands génies de l'antiquité, sans distinction, ne doutaient nullement de l'importance des songes, et qu'ils venaient même s'endormir dans les temps pour y recevoir des oracles. Job n'a-t-il pas dit que Dieu se sert des songes pour avertir l'homme ? »
Tel est donc le paradoxe admirable: les songes nous avertissent, ils nous éveillent. La plongée dans le monde invisible éveille les images, et ces images sont vraies. Pour Gérard de Nerval, le rêve éveille à cette vérité que le somnambulisme ordinaire recouvre de ses écorces de cendre. A la veille machinale des travaux utiles et des distractions planifiées, dont le caractère hypnotique n'échappe qu'à ceux qui le subissent, Nerval oppose l'insurrection des songes où vivent les assemblées des déesses et des dieux. Son audace ultime sera de porter la Veille du Songe avertisseur au cœur même de la vie éveillée au risque d'être frappé par foudre d'Apollon. Lorsque le monde ressemble à un faux-sommeil machinal, lorsque la raison partagée ignore la vérité, comment encore oser donner une voix aux augustes et vertigineuses vérités de la Doctrine et du Chant ?
Sans doute l'intelligence moderne n'est-elle si désastreuse que par son impuissance à accorder l'image et la vérité. Pour le moderne, l'imagination est bien « maîtresse de fausseté ». Aux Symboles se sont substituées les fantasmagories. Les songes mentent car ils sont édictés, non par le monde intermédiaire entre le sensible et l'intelligible dont nous parle Henry Corbin, le mundus imaginalis, mais par rumeur confuse des subjectivités agrégées. Cependant le souvenir lancine, et la nostalgie ardente, d'une imagination vraie, telle qu'elle se déploya, par exemple, dans L'Odyssée ou La Divine comédie.
Ce souvenir, qui présume l'antériorité d'une sapience lumineuse, d'une anamnésis possible, rassemble en lui les forces conjointes de l'Intellect et de l'impression. Les signes avertisseurs des rêves et les signes que nous adresse le monde sensible sous les atours du « hasard objectif », ou, pour mieux dire, des « synchronicités », lorsqu'ils opèrent ensemble, peuvent aussi bien éclairer que foudroyer. « Le monde est un ensemble de choses invisibles manifestées visiblement ». Si le songe est bien l'avertissement de l'invisible dans le visible, alors l'oniromancie, saisie par le génie du poète, peut d'avérer être une rigoureuse méthode d'induction. Les Soirées de Saint-Pétersbourg ne disent rien d'autre: « Certains philosophes se sont avisés dans ce siècle de parler de causes. Mais quand voudra-t-on comprendre qu'il ne peut y avoir de causes dans l'ordre matériel et qu'elles doivent toutes être recherchées dans un autre cercle ? Il n'y a que les hommes religieux qui puissent et veulent en sortir; les autres ne croient qu'en la matière et se courroucent même lorsqu'on leur parle d'un autre ordre de chose. »
Or cet « autre cercle », plus vaste que les mondes, est aussi, par la prodigieuse magnanimité de la providence divine, contenue dans nos âmes. Le mystère des hauteurs se tient dans les profondeurs, le point de focalisation extrême détient l'ampleur hors d'atteinte, toute la splendeur du monde est dite dans le iota de la lumière incréée. La sagesse humaine, lorsqu'elle s'affranchit des fausses sciences, nous dit Jacob Böhme, « outrepasse la sagesse des Anges ».
Le péril contre lequel nous mettent en garde Joseph de Maistre et Gérard de Nerval est de confondre cette possibilité magnifique avec le prométhéisme des modernes. Rien ne s'accomplit avec bonheur sans le diapason d'une humilité, que l'on peut dire pythagoricienne ou chrétienne. « La musique creuse le ciel » disait Baudelaire qui savait entendre comme naguère l'on savait prier. L'œuvre de Joseph de Maistre déplait fort aux modernes car elle ne laisse presque aucune carrière à l'outrecuidance. Le moderne veut bien prétendre aux gnoses souveraines, mais il ne veut rien abandonner aux prérogatives de son « moi », il veut bien s'approcher des « ésotérismes », des « réalités cachées », surtout lorsqu'elles sont exotiques, - mais la simple et humble prière lui est étrangère, hostile, incompréhensible. « Si la crainte de mal prier, écrit Joseph de Maistre, peut empêcher de prier, que penser de ceux qui ne savent pas prier, qui se souviennent à peine d'avoir prié et ne croient pas même à l'efficacité de la prière ? »
Qu'est-ce qu'une prière ? Les heures où lentement s'écoulent les entretiens du Comte, du Sénateur et du Chevalier sont des prières de l'intelligence. Si l'âme et le cœur entrent en prière sous l'afflux des sentiments généreux et des pressentiments magnanimes, est-ce à dire que l'intelligence ne saurait prier ? Il existe une prière de l'Intellect, qui est pure théorie, c'est-à-dire contemplation. Mais cette prière, en nos temps de fausses raisons outrecuidantes, est aussi la plus rare et la plus difficile. Une prière de l'Intellect serait ainsi une prière de délivrance. La raison doit s'affranchir des raisons et des déraisons et devenir pure oraison; elle doit se délivrer non seulement de la rationalité linéaire mais de la temporalité même où s'inscrit cette linéarité. Il faut infiniment prier pour cette libre gloire de la pensée.
« L'homme est assujetti au temps et néanmoins, il est, par nature, étranger au temps ». La considération maistrienne ouvre des perspectives infinies. Elle fonde la légitimité du prophétisme, non moins que la pertinence de la négation du hasard. Ainsi, la providence divine, loin d'être une énigme impénétrable, serait inscrite, au titre de sapience originelle, dans la nature même de l'homme, « étranger au temps ».
Cette perspective métaphysique modifie, et rectifie, les notions fondamentales de l'humanisme moderne, si éloigné de l'humanitas des Anciens. Si la nature de l'homme est d'être « étranger au temps », toute explication de l'humain par des théories évolutionnistes est infirmée. La prière de l'Intellect témoigne de la possibilité d'une vision surplombante. « L'esprit prophétique, écrit Joseph de Maistre, est naturel à l'homme et ne cessera de s'agiter dans le monde. L'homme en essayant à toutes les époques et dans tous les lieux de pénétrer dans l'avenir, déclare qu'il n'est pas fait pour le temps, car le temps est quelque chose de forcé qui ne demande qu'à finir... »
« Le temps est quelque chose de forcé ». On peut ajouter qu'il en est de même de l'espace. La juste et humble prière de l'Intellect touche sans efforts aux réalités, si troublantes pour des raisons profanes, que sont la prédiction et l'ubiquité. En témoignent les Prédictions et les Bilocations de Sœur Yvonne-Aimée de Malestroit. L'espace et le temps sont « forcés », ils sont illusoires. En franchir les limites artificieuses, ce n'est point transgresser l'ordre de notre nature mais retrouver par la simple légèreté de la prière un état d'être non forcé, ni soumis. Outrepasser les conditions de l'espace et du temps, ce n'est point conquérir quelque pouvoir d'exception mais répondre à l'attente même de l'univers. « L'univers, écrit Joseph de Maistre, est en attente. Comment mépriserions-nous cette grande persuasion, et de quel droit condamnerions-nous les hommes qui, avertis par des signes divins, se livrent à de saintes recherches ? » La prière répond à l'attente de l'univers, et cette réponse résonne en notre cœur, dont l'humilité essentielle est de se confondre avec le cœur de l'univers.
« Toute la science changera de face; l'Esprit longtemps détrôné et oublié, reprendra sa place. Il sera démontré que les traditions antiques sont toutes vraies, que le paganisme entier n'est qu'un système de vérités corrompues et déplacées. » Déplacées, en l'occurrence, par le temps lui-même, - d'où l'importance d'une clef de voûte, d'un Hors-du-Temps, fine pointe de la spéculation divinatrice. « Tout annonce je ne sais quelle grande unité vers laquelle nous marchons à grand pas ». Mais ces pas n'y conduiront que s'ils sont autant d'étapes d'un déchiffrement des signes et des intersignes.
L'armorial initiatique des Chimères de Gérard de Nerval marque, lui aussi, le pas de la recouvrance du limpide secret des songes et des raisons, du Chant et de la Doctrine. Ces sonnets sont des creusets versicolores où le récit autobiographique s'inscrit. Cette inscription fait office, en même temps, de mystère et de précepte. La nuit reconquise, la nuit aimée, la nuit éperdue tient en elle le principe d'un ordre ensoleillé, d'une souveraine raison d'être.
Il est temps d'en finir avec ce dualisme de pacotille qui ne se lasse point d'opposer une raison diurne à une irrationalité nocturne, un « classicisme » prétendument raisonnable et un « romantisme » qui serait tout embarbouillé d'obscurantisme. La forte prégnance mystique de Racine et des œuvres dites du Grand Siècle tient en son exactitude rhétorique une perspective à perte de vue, de même que le romantisme roman, celui de Novalis, dans ses plus libres effusions, rétablit la légitimité d'une norme métaphysique qui s'avère être, désormais, l'ultime sauvegarde de l'homme différencié. La vertu augurale et inaugurale de l'œuvre de Joseph de Maistre tient à cette double appartenance. Ce que l'on nomme le classicisme s'exaltera dans les Soirées de Saint-Pétersbourg jusqu'à donner à Baudelaire et à Nerval les ressources et les puissances nécessaires à s'affranchir des épigones du classicisme.
Œuvre par excellence frontalière, non seulement par sa chronologie mais par sa vocation (l'appel auquel elle répond non moins que celui qu'elle lance !), l'œuvre de Joseph de Maistre illustre la permanente possibilité de penser hors des entraves édictées. Toute pensée exigeante, pour peu qu'elle envisage de ne point servir les idéologies mais les Idées, doit ainsi faire son deuil des facilités conjointes de l'alternative et du compromis. La divine providence que les Soirées déchiffrent, par le dialogue et non par l'exposé systématique, s'exerce sur nous par la quête où elle nous précipite. Elle avive nos curiosités, nous entraînant à une approche encyclopédique, et peut-être faudra-t-il quelque jour admettre que les points de convergences de l'Encyclopédie de Diderot et de l'Encyclopédie de Novalis sont autant à considérer que leurs divergences, de même que l'allure, voltairienne quelquefois, de Joseph de Maistre devrait peut-être interdire de réduire Voltaire au seul usage qu'en font des « voltairiens » qui ne l'ont guère lu.
La providence, et c'est le propre de sa nature divine, s'inscrit à la fois dans la raison et dans un mystère plus haut que le raison. Rien de tout cela n’est compréhensible sans la notion de hiérarchie. Qu’il y eût un mystère plus haut que la raison, cela, certes, n’ôte rien à la raison ; et que ce mystère fût déchiffrable par la raison, et que cette raison s’éployât en oraison, cela ne diminue en rien la souveraineté du mystère.
La grande détresse des modernes sera d’avoir perdu à la fois la raison et le mystère par l’exacerbation simultanée d’un rationalisme outrecuidant et des superstitions du « démos ». Sans l’appel du mystère, la raison s’effondre. Nous autres modernes vivons dans cette raison ruinée, dans les décombres de cet en-deçà de la raison que hantent les superstitions et les barbaries. Contrairement à ce que feignirent de croire certains intellectuels, la destruction des normes grammaticales et métaphysiques, loin de donner lieu à l’épanouissement de la sirène Diversité fut au contraire extrêmement uniformisatrice. Les gravats sont toujours plus uniformes que les édifices et la confusion, pour séduisante qu’elle apparaisse aux yeux de certains, présage immanquablement la planification. Comme l’écrivait Dominique de Roux, « nous en sommes là ».
Les différenciations individuelles elles-mêmes s’estompent dans la subjectivité de masse : la preuve en est qu’il suffit d’une phrase pour distinguer les uns des autres, pour reconnaître en leur singularité irréductible, les écrivains de belle race et de grande tradition, alors que nos adeptes du subjectivisme se ressemblent tous. Tel est l’apparent paradoxe : la norme grammaticale et métaphysique est l’éminente gardienne de la diversité humaine, alors que la confusion, la subversion, sont les non moins évidentes propagatrices de l’uniformité. La divine providence nous laisse toutes les chances de comprendre ou de ne pas comprendre, et sa mise-en-demeure, loin de nous planifier, nous hausse vers l’extrême singularité. Cette aventure-là, certes, n’est pas du goût de tout le monde car ce elle exige de nous, - outre l’épreuve de la solitude, - s’apparente à quelque dédaigneux dédain pour le « moi », cette idole bourgeoise, laquelle, comme l’automobile, si chère à nos classes moyennes, n’est jamais qu’un objet de série. Le « moi », la subjectivité du moderne, où il se figure être délivré des normes, n’est jamais que le véhicule de sa banalité.
« Tout se tient, tout s’accroche, tout se marie, écrit Joseph de Maistre, lors même que l’ensemble échappe à nos faibles yeux c’est une consolation de savoir que cet ensemble existe et de lui rendre hommage dans l’auguste brouillard où il se cache. »
Que serait une raison qui se refuserait à s’affronter au brouillard, une raison qui se déclarerait au-suffisante, sinon la pire des folies ? A l’inverse, il est des divagations fécondes en hypothèses surgissantes dont le cheminement, pour déroutant qu’il paraisse, réconcilie entre eux, et quand bien leurs auteurs en furent parfois égarés, les pouvoirs de l’Esprit. Etait-elle si irrémédiablement folle, la folie de Nerval, en son siècle bourgeois où se précisaient déjà les méthodiques folies qui allaient conduire aux totalitarismes modernes ? Pour retrouver nos raisons d’être, il fallut qu’un homme doué des grâces du pur idiome du Valois s’aventure en des contrées crépusculaires. Nous lui en sommes infiniment redevables, comme nous le sommes à Joseph de Maistre, d’avoir restauré, pour nous, le « flambeau de l’Analogie ».
L’Analogie et la hiérarchie, celle-là étant le mode opératoire de celle-ci, sont au cœur de la pensée maistrienne, bien proche à cet égard de la métaphysique des gradations du Colloque entre Monos et Una d’Edgar Poe. Cette métaphysique graduée, ou graduelle, au vrai sens initiatique, témoignera des correspondances et de ce monde qu’il faut bien voir comme un « temple de symboles », sous peine ne rien percevoir du grain et de la ductilité du monde sensible.
L’idée à la fois architecturale et musicale d’une Analogie fondatrice, - l’architecture, de par le mouvement de celui qui la découvre, se faisant musique, et la musique reconstruisant dans l’entendement une architecture, - nous sauvera peut-être des déterminismes inférieurs où prétendent nous enfermer ces « rationalistes » dont l’engagement n’a d’autre fin que la destruction pure et simple de la raison. Quiconque croit, par exemple en la légitimité exclusive du « démos » à gouverner toute chose, y compris ce qui échappe, de fait, à ses prérogatives, doit faire son deuil de la raison qui, par nature, est hostile « au sommeil de la brute et à la convulsion du fauve ». A Joseph de Maistre écrivant : « Il n’y a rien de pire que la foule », Gérard de Nerval renchérit : « Fatale époque d’aveuglement, de doutes et de haines mortelles, où la Providence n’intervient plus par les éclairs du génie, mais par les forces déchaînées des éléments et des passions ». Et ceci encore : « C’est un triste appel celui qui se fait, au nombre d’une part, et de l’autre à la force : au courage sans raisonnement, à la foule sans moralité ». Point d’envol qui d’emblée on s’englue dans l’Opinion. Aux esprits ouraniens, en revanche, à ceux qui manifestent leur préférence pour l’esprit de l’air, et contre le démon calibanesque, la chance est offerte de gravir l’échelle du vent, - qui nomme cette hiérarchie que nous évoquions, qui n’a, en soi, rien d’administratif, ni même de militaire.
Que les esprits vétilleux cherchent encore à démêler le tien du mien, à répartir ce qui appartient au christianisme et ce qui appartient au paganisme, il n’importe. Nous savons par l’Aurélia de Gérard de Nerval que les dieux antiques dorment à peine derrière les plus fines apparences du Songe et du Réel, et par Joseph de Maistre, prédécesseur capital de René Guénon, qu’il est une tradition antérieure à tous les dogmes. Une identique menace pèse désormais sur toutes les formes de l’esprit, et cette menace s’accroît de tout ce qu’elle divise en prévision de son règne sans nuance. « La génération présente, écrit Joseph de Maistre, est témoin de l’un des plus grands spectacles qui jamais ait occupé l’œil humain : c’est le combat à outrance du christianisme et du philosophisme. La lice est ouverte, les deux ennemis sont aux prises, et l’univers regarde. » Le « philosophisme », en l’occurrence, c’est l’ « isme » qui ne se soucie plus ni de l’amour ni de la sagesse, - tout entier livré au despotisme de ses bonnes intentions meurtrières.
Gérard de Nerval lui répondra, dans Quintus Aucler, par cette question : « S’il était vrai, selon l’expression d’un philosophe moderne que la religion chrétienne n’eût guère plus d’un siècle à vivre encore, - ne faudrait-il pas s’attacher avec larmes et prières au pieds de ce Christ détaché de l’arbre mystique, à la robe immaculée de cette Vierge mère, expression suprême de l’alliance antique du ciel et de la terre, - dernier baiser de l’esprit divin qui pleure et qui s’envole ? »
Luc-Olivier d'Algange
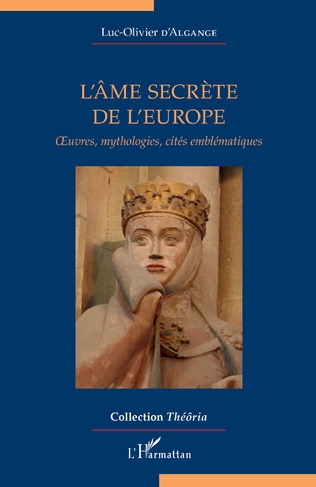
13:13 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
L'Ivresse et les dieux, extrait de "L'Ame secrète de l'Europe", éditions de L'Harmattan

Luc-Olivier d'Algange
L'Ivresse et les dieux
Qu'en est-il des dieux antérieurs ? Peut-on, sans avoir à se dire « païen », recevoir d'eux quelque lumière ? Peut-on s'interroger, par leurs ambassades ouraniennes, maritimes ou forestières sur le monde tel qu'il s'offre à nos sens et à notre intelligence? Pouvons nous les entendre, ces dieux, dans l'acception ancienne du verbe, c'est-à-dire les comprendre, les ressaisir dans la trame de notre entendement où vogue la navette du tisserand, dieu lui-même, comme des réalités allant de soi, mues par elles-mêmes, pourvues de cet impondérable que l'on nomme l'âme ? Les dieux existent: c'est leur faiblesse car ce qui existe peut disparaître; ce qui existe n'est point l'être; et l'être lui-même n'est qu'à l'infinitif (or l'impératif seul est créateur !). Mais ce qui existe vaut tout de même que l'on s'y attarde... L'existence des dieux demeure difficile à situer car elle est ubique: à la fois intérieure et extérieure. Précisons encore. Les dieux sont ce qui se laisse dire comme une réalité qui est à la fois en dedans et au-dehors, subjective non moins qu'objective. Hélios éclaire à la fois la terre et notre intellect. Dionysos fait danser en même temps la terre et nos âmes. Apollon ordonne ensemble le Cosmos et nos pensées. Ces quelques notes, prises sur le vif, il y a déjà longtemps, s'interrogent sur cette « zone frontalière », avec les inconséquences désirables qui sont le propre du promeneur.
Les rivages scintillants: disparition et apparition des dieux
Longtemps, et il n'est pas vraiment certain que l'on se soit dépris de cette habitude, on associa l'intérêt pour le monde antique à un engagement « républicain » dont nos sociétés modernes (où la res publica, hélas, s'est évanouie dans le culte de l'économie) seraient les héritières. Le fidèle aux anciens dieux se retrouvait ainsi fort paradoxalement du côté de la modernité, des « réformes », voire d'une forme de « progressisme » opposée aux « ténèbres » du Moyen-Age et des souverainetés royales Or, on ne saurait imaginer forme de pensée plus étrangère aux Anciens que l'idéologie du Progrès. Toute leur pensée était au contraire orientée par le constat d'une dégradation, d'une déchéance, d'un éloignement graduel de l'Age d'Or. Comment cette pensée « pessimiste » fut à l'origine des créations les plus audacieuses en philosophie, de la plus grande plénitude artistique, c'est là une question décisive à laquelle il nous importe d'autant plus d'apporter une réponse que nous constatons que la croyance inverse, « optimiste », nous fait sombrer dans la veulerie et l'informe. Le Progrès, disait Baudelaire, est la doctrine des paresseux. N'est-ce point se dispenser d'avance de tout effort et briser tout élan créateur que d'assigner au seul écoulement du temps le pouvoir de nous améliorer ou de nous parfaire ? Au contraire, si, comme Hésiode, nous croyons au déclin, à l'assombrissement des âges, ne disposons nous point alors nos intelligences et nos âmes, notre ingéniosité et notre courage à faire contrepoids à ce déclin ?
Pour une intelligence qui s'accorde aux présocratiques, le monde de la symbolique romane demeurera certes infiniment plus proche, plus amical, que la « société du spectacle » du monde des esclaves sans maîtres. Fidèles à la logique du tiers inclus, nous n'entrerons point dans ces polémiques qui font du paganisme une sorte d'anti-christianisme à peine moins sommaire que l'anti-paganisme des premiers chrétiens, tel que le décrivent Celse et l'Empereur Julien. Si le combat du Poète contre le Clerc revêt à nos yeux quelque importance, comment n'engagerions-nous pas la puissante vision poétique et métaphysique de Maître Eckhart et de Jean Tauler contre les modernes cléricatures de la « pensée unique » ? De plus en plus vulgaire, utilitaire, éprise de médiocrité, l'idéologie dominante n'a jamais cessé de détruire la splendeur divine chère aux Archaiothrèskoi, les fidèles aux anciens dieux, alors même qu'elle paraît de temps à autres s'en revendiquer. Mais cet éloignement, n'est qu'un éloignement quantitatif. La qualité de l'être, sa vision, demeure, elle, subtilement présente.
Le monde des dieux anciens n'est pas mort car il n'est jamais né. Que cette pérennité lumineuse soit devenue provisoirement hors d'atteinte pour le plus grand nombre d'entre nous, n'en altère nullement le sens ni la possibilité sans cesse offerte. Pérennes, les forces et les vertus divines s'entrecroisent dans le tissu du monde et nous laissent le choix d'être de simples spectateurs enchaînés dans une représentation schématique du monde ou bien d'entrer dans la présence réelle des êtres et des choses par la reconnaissance de l'Ame du monde. Séparés de tout, enfermés dans une « psyché » qu'il croit être l' « autre » du monde, le Moderne s'asservit à la représentation narcissique qu'il se fait de lui-même.
Pour le Moderne, les dieux, les Idées, les Formes prennent source dans son esprit, mais il ne voit pas assez loin pour comprendre que cet esprit lui-même prend source ailleurs qu'en lui-même. Cette impuissance à imaginer au-delà du cercle étroit de sa propre contingence, n'est-ce point ce que les platoniciens nommaient « être prisonniers des ombres de la Caverne » ? Le Moderne idolâtre sa propre contingence, il en fait la mesure de toute chose, inversant le principe grec qui enseigne que l'homme doit retrouver la mesure de toute chose. Croire que les dieux sont purement « intérieurs », aboutit à une idolâtrie de l'intériorité. Les utopies meurtrières du vingtième siècle, le fanatisme uniformisateur et planificateur des fondamentalismes divers qui se donnèrent cours n'ont-ils pas pour origine ce subjectivisme effréné qui veut faire de l’intériorité de l'homme et de son incommensurable prétention d'être moral, la mesure du monde ? Pour l'homme ancien, les dieux sont en nous car ils miroitent en nous. Notre entendement capte les forces extérieures auxquelles il lui appartiendra, en vertu d'un principe de création poétique, de donner des Formes; et ces Formes, à leur tour, seront hommages aux dieux qu'elles nomment et enclosent pour d'autres temps.
Cette vue du monde est humble et généreuse, attentive et donatrice. Loin de penser l'homme comme l'Autre, ou face à l'Autre, elle reconnaît en soi le Même sous les atours de l'apparition divine. Le dieu est celui qui apparaît. Or l'homme, qui va à la rencontre du monde divin et ne connaît ni naissance, ni mort, apparaît à l'éternité et le dieu qui lui apparaît est selon l'admirable formule d'Angélus Silésius, « un éclair dans un éclair ». C'est dans l'éclat le plus bref et le plus intense que l'éternité nous est donnée. La fulguration d'Apollon demeure à jamais dans l'instant de l'apparition qui nous révèle à nous-mêmes, dans la pure présence de l'être.
Etres de lumière, les dieux; et non point êtres d'ombre, êtres de présence et non point être de représentation. L'apparition est l'acte du saisissement souverain où la vision se délivre de la représentation pour reconquérir la présence. Telle est la promesse, la seule, que nous font les dieux antérieurs. Ils ne nous promettent que d'être présents au monde, car aussitôt sommes-nous présents au monde que nous entendons leurs voix. Etre présent au monde, n'est-ce point déjà, dans une large mesure, être déjà désencombré de soi-même ? N'est-ce point devenir l'infini à soi-même ? Que suis-je qui ne soit à l'image des vastes configurations des forces du monde que nomment les dieux ?
Croire aux dieux, c'est croire que le monde intérieur et le monde extérieur sont un. La force lumineuse apollinienne se manifeste à la fois dans le soleil physique, qui épanouit la nature et le soleil métaphysique, le Logos, qui épanouit l'Intelligence. Le génie de l'ancienne sagesse est d'avoir donné un même nom à ces forces intérieures et extérieures, visibles et invisibles. Comment vaincre l'usure des temps, la transformation progressive de la vie en objet, la réification propre à la société marchande, sans le recours aux exigences et aux beautés plus anciennes? La diversité, la liberté, la complexité des anciennes sagesses, la précellence accordée aux Poètes, Bardes, Chantres ou Aèdes (qui sont les créateurs de la vérité qu'ils énoncent, à la différence du Clerc qui administre une vérité déjà définitivement formulée) nous demeurent une injonction permanente à ne point nous soumettre. Le monde moderne paraît triompher dans ses vastes planifications, mais il est bien connu qu'il existe des triomphes dont on périt.
Le déterminisme dont les Modernes se rengorgent pour affirmer l'irrémédiable de leurs soi-disantes « civilisations » n'est probablement qu'une vue de l'esprit, particulièrement inepte, qu'un peu de pragmatisme suffirait à corriger. Là où le Moderne voit un enchaînement nécessaire, ce qu'il nomme un « progrès » ou une « évolution », un esprit libre ne verra qu'une interprétation à posteriori. La suite d'événements qui conduisent à un désastre ou à une circonstance heureuse, selon l'interprétation qu'on lui donne, n'apparaît précisément comme « une suite » qu'après coup. Cette suite, que la science du dix neuvième siècle nomme déterminisme, apparaît à l'intelligence dégagée et pourvue de quelque imagination, comme un leurre. Dans la vaste polyphonie humaine et divine, les choses eussent pu se passer autrement, et de fait, elles ne cessent de se passer autrement. Les configurations auxquelles elles obéissent engagent non seulement la ligne et le plan, mais aussi les hauteurs et les profondeurs.
2. La terre dansante
Apollon et Dionysos, par exemple, se manifestent par une logique différente de celle de la planification ou de la linéarité. Apollon fulgure des Hauteurs et s'épanouit dans l'ensoleillement intérieur des Formes parvenues à l'équilibre parfait. Dionysos, lui, selon la formule d'Euripide, fait danser la terre. « Quand Dionysos guidera, la terre dansera » chante le chœur des Bacchantes. La formule mérite que l'on s'y recueille. Ce recueillement est recueillement dans la légèreté. La terre dionysiaque n'est plus la terre lourde, immobile, des gens « terre à terre », c'est la terre vibrante, la terre mystérieuse, la terre gagnée par le Symbole aérien de l'excellence: la danse, victoire sur la pesanteur.
Dans le temps et le monde profane, la pesanteur est ce qui nous attache à la terre, nous ferme le royaume du ciel, le séjour des dieux. Dans l'espace et le temps sacré, sous le signe de Dionysos, les forces telluriques elles-mêmes nous délivrent de la pesanteur: la terre danse. Notre danse sur cette terre gagnée par les puissances phoriques du sacré, est la danse de la terre elle-même. L'ivresse nous accorde au monde.
Cet accord, certes, ne préjuge point d'ultérieurs désaccords. L'accord au monde que suscite l'ivresse n'est pas une béatitude définitive, il n'est pas davantage une approbation sans limite. La face sombre du mythe dionysien, comme du mythe orphique, témoigne que l'accord est la conquête d'un dépassement de la condition humaine ordinaire, avec toutes les audaces, les périls, mais aussi les enchantements qu'implique un tel dépassement. La part dangereuse de l'ivresse n'est pas seulement dangereuse pour l'individualisme, elle est aussi dangereuse pour l'ordre social lorsque celui-ci ne parvient pas à lui donner la place qui lui revient.
Le génie grec fut d'avoir donné au mystérieux et inquiétant Dionysos une place centrale dans la mythologie. Alors que les fondamentalismes modernes paraissent être avant tout des expressions humaines de la crainte devant les dionysies de l'âme et du corps, les mythologies anciennes surent réserver au sens de la dépense pure et à l'exubérance festive, la part royale. Dans la mythologie grecque, Dionysos est souvent nommé, à l'égal de Zeus, « le maître des dieux ». C'est que l'infinie prodigalité de l'ivresse est à l'image de l'inépuisable richesse du monde des dieux.
Aux valeurs d'utilité, de thésaurisation, l'ivresse oppose le Don rendu à son ingénuité native. Lorsque Dionysos guide, les identités sont bouleversées. Ce qui, dans la temporalité profane, nous circonscrit dans l'espace-temps dont nous tenons nos identités, est ici remis en jeu sous l'influx des forces du devenir. Dans les époques bourgeoises, les êtres humains qui ne savent conquérir de nouvelles vertus sont de plus en plus attachés à leur identité, mais cet attachement est mortel, car l'identité n'est qu'une écorce morte et seule importe la tradition qui irrigue, traverse et bouleverse les apparences comme une rivière violente. Lors des dionysies, les identités profanes sont mises à mal et une force de renouvellement saisit l'être, le désencombre de ses écorces mortes, l'expose à nouveau aux aventures. Pour les hommes épris de leur statut, pour les hommes imbus de leurs certitudes, les dionysies sont la pire des menaces. En revanche, pour le poète, voire pour l'homme qui désire faire de sa vie un hommage au Beau et Vrai, les dionysies sont une promesse. Les certitudes qu'elles détruisent dans leur emportement, les identités dont elles révèlent le mal fondé ne sont que des leurres qui font obstacle à l'expérience de la vérité de l'être.
Le resplendissement de l'être, dont les dieux sont en ce monde les messagers, ne cesse, dans les conditions profanes de l'existence, d'être voilé, recouvert de scories qui sont autant d'habitudes mentales. C'est en nous délivrant de ces habitudes mentales par l'apport de la vigueur donatrice de l'ivresse que nous recouvrons une vision de la réalité qui n'est plus une vision instrumentale mais ontologique. L'ivresse nous révèle le monde non plus tel que nous l'utilisons ou le planifions, mais tel qu'il est dans l'ouragan de l'être se révélant à lui-même. Quittant les évidences illusoires de l'identité, nous nous retrouvons au centre d'un jeu de forces dansantes qui nous portent témoignage de l'être que nous méconnaissions.
L'ivresse, lorsque Dionysos en personne guide la danse est connaissance. Le monde devant lequel nous passons habituellement, comme devant un spectacle qui ne nous concerne pas, s'impose à nous, retentit en nous, nous exalte et nous effraie tour à tour. L'homme en proie à l'ivresse, ou mieux vaudrait dire, à une ivresse (car il existe autant d'ivresses que de couleurs et même de nuances à l'arc-en-ciel) est enclin à voir dans les choses des Mystères. Les arbres deviennent des arcanes. Les ciels et les mers s'offrent à lui comme de lancinantes interrogations. Les forêts sont bruissantes de présences, et les villes elles-mêmes deviennent des Brocéliande. Mais par dessus tout, les mots acquièrent une puissance et une résonance nouvelles.
Le dithyrambe dionysiaque fête les retrouvailles de l'homme avec les sources de la parole. Car la source de la parole n'est pas dans l'utilisation du réel mais dans sa célébration. Ces mots qui, dans le langage profane sont des écorces mortes, de vaines identités, la puissance dionysiaque va leur rendre la magie invocatoire. Là où le monde est rendu à la présence de l'être, le mot résonne infiniment dans l'âme humaine. Le mot n'est pas étranger à la réalité qu'il nomme, il est le site magique de la rencontre de l'homme et du monde. L'ivresse dionysiaque désempierre la source de la parole. De tout temps, le génie verbal eut partie liée avec l'ivresse. La pauvreté de la parole, la ladrerie de l'expression (que certains critiques modernes vantent sous l'appellation « d'économie des moyens ») qu'est-elle d'autre sinon une crispation sur les évidences, un refus de se laisser gagner par les vastes exactitudes de l'ivresse. Les belles éloquences sont les œuvres du consentement à l'ivresse, de l'accord souverain de l'âme et du corps. La parole, lorsqu'elle se fait rythme et musique et entraîne avec elle la pensée en de nouvelles aventures, naît de l'accord de l'âme et du corps. Lorsque l'âme et le corps sont désaccordés, la parole se fige et s'étiole.
3. Le rire des dieux et la Science de l'Ame
La culture du ressentiment, anti-dionysienne par excellence, répugne à ces preuves magnifiques de la concordance de la hauteur et de la profondeur. La parole, elle la veut « écriture » et « minimaliste », c'est-à-dire aussi peu enivrée que possible, comme si l'ivresse, qui bouleverse les identités, était le Mal par excellence. Les œuvres d'André Suarès, de Saint-John Perse ou de John Cowper Powys sont de magnifiques défis à cette culture du ressentiment dont les seules « valeurs » irréfutables sont la mesquinerie et le calcul. Le « rire des dieux » dont parle Nietzsche est fait précisément pour effaroucher le « bien-pensant », pour montrer le comique foncier des « valeurs », et leur inanité face aux Principes et la puissance dont se compose la polyphonie du monde.
Le Moderne, soumis au principe d'identité, est foncièrement attaché aux « valeurs » alors que l'Archaiothrèskos est fidèle aux Principes qui seront dans la geste éperdue des extases, principes de métamorphoses. Protéenne, l'ivresse invente des formes là où l'identité se contente de reproduire des formes. L'ivresse change, l'ivresse transfigure, là où le principe d'identité profane se limite à la duplication quantitative. L'ivresse crée des qualités. Elle inaugure l'ère, sans cesse reportée mais sans cesse sur le point d'advenir, du qualitatif. Toute perception d'une qualité est prélude d'ivresse. La qualité appartient à l'ordre de l'indiscutable. Celui qui ne la perçoit point ne saurait en parler. Perçue, la qualité suscite une interprétation infinie. L'herméneutique de la qualité est sans limite, alors que la quantité, aussi considérable soit-elle, se définit d'emblée par sa limite. La quantité est limitée, la qualité est infinie. L'ivresse dionysiaque est principe de poésie car elle invite au registre des harmoniques qualitatives du monde. Le souffle s'accorde à l'idée et le poème naît de ce « rien » qui est la chose elle-même rendue à la souveraineté de l'être. Les Mystères orphiques ou dionysiaques n'ont d'autre sens. Le moment du mystère est celui où l'être apparaît sous les atours de la réalité. Mystère car le site d'où se déploie le chant est celui de l'être irréductible dont aucune explication logique, ou grammaticale, ne peut s'emparer. Ce Mystère n'est point le mystère des « arrière-mondes », il ne relève pas davantage de cette sorte d'occultisme qu'affectionnent les Modernes. C'est le Mystère de la chose rendue, enfin, après la traversée odysséenne du Chant, à son propre silence.
Or, nous ne pouvons dire les choses que si nous recevons en nous, comme une promesse, le silence dont elles émanent. Longtemps, les sciences humaines feignirent de croire que les dieux n'étaient que de maladroites explications, dont on pouvait désormais se passer, des phénomènes naturels. Le dieu, en réalité, est ailleurs. Il n'explique pas, il nomme, et il nomme avec une pertinence telle que nous n'avons pas jusqu'à présent trouvé mieux que les noms des dieux, et les récits de leurs aventures, pour décrire les aléas de l'âme et du monde. Dire que la croyance aux dieux est morte avec le christianisme, c'est se faire de cette croyance, et de la croyance en général, une bien pauvre idée. L'exubérance, la prodigalité, l'ivresse ne meurent pas sur un décret, fût-il « théologique ». Leconte de l'Isle, par son goût pour la plénitude prosodique, les espaces grands et profonds, les symboles augustes, retrouve naturellement une part du génie ancien. La fidélité aux dieux antérieurs loin d'être une construction artificielle renoue avec une tradition qui ne fut jamais vraiment interrompue. L'éloignement des sagesses anciennes, leur supposée incompréhensibilité pour nous « Modernes », apparaît de plus en plus comme un vœu pieux que la plupart des œuvres d'art, de littérature ou de poésie modernes démentent avec ardeur.
Les dieux virgiliens frémissent dans la Provence de Giono avec une évidence que la morale chrétienne, pour louable qu'elle soit à certains égards, ne saurait leur ôter. Celui qui veut connaître l'être comme une présence, et non comme un concept, voit paraître les dieux qui nomment et racontent les aspects et les forces du monde réel qui échappent à toute utilisation possible. Nous pouvons ainsi reconnaître la pertinence herméneutique du récit mythique, son aptitude à dire ce qui advient en ce monde dans l'obéissance à des lois que nous ne comprenons pas entièrement. Les dieux décrivent une connaissance et disent en même temps les limites de la connaissance. Les dieux, certes, régissent, mais l'homme consent à la limite de sa science en disant qu'il ne sait pas exactement de quelle façon les dieux régissent. On ne saurait attendre une plus heureuse pondération de la part d'un physicien actuel. Le dieu ne dit pas la cause d'un mécanisme, il nomme le mécanisme et tout ce qui dans son antériorité ou sa postérité ne révèle rien d'évaluable.
Si nous acceptons de reconsidérer cette terminologie divine dans la perspective de nos propres préoccupations herméneutiques, nous allons au-devant d'heureuses surprises. Qui n'a constaté que la faiblesse de maints systèmes d'interprétation tenait d'abord à la scission entre l'intérieur et l'extérieur, l'objet et le sujet ? Dans l'épistémologie moderne, la science du monde intérieur et la science du monde extérieur paraissent séparées par des barrières infranchissables. Or, chacun sait que le monde intérieur conditionne la connaissance du monde extérieur, et inversement. Il n'en demeure pas moins que les sciences de l'Ame et les sciences de la « physis » se développent de façon séparées et marquent l'une à l'égard de l'autre une indifférence immense.
Le génie du paganisme et des récits mythologiques fut de formuler la connaissance du monde dans une terminologie qui concernait simultanément le monde physique et le monde l'Ame. Loin d'être au-delà de la science, cette recherche d'une coïncidence de l'intérieur et de l'extérieur semble désormais au diapason des recherches contemporaines. Pourquoi faudrait-il tenir en des catégories radicalement séparées ce qui ordonne le monde et ce qui ordonne l'esprit ? Cette obstination dualiste n'est-elle pas la cause du désemparement où nous sommes ? Le triomphe de la technique extérieure et l'absence totale de maîtrise de soi, de discipline intérieure, où nous voyons nos contemporains n'est-il point la preuve de l'inefficience de cette pensée dualiste ? Le dieu antique nous parle car il parle d'un site qui ignore la séparation de l'en-dehors et de l'en-dedans.
Dans les mythologies hindoues, grecques, celtiques, les principes intérieurs et les principes extérieurs ne sont pas jugés de nature différente. Ils sont des degrés différents, non des natures différentes. Nous avons traité ailleurs de l'erreur d'interprétation fort commune, qui voit dans l'œuvre de Platon une « séparation radicale » entre l'Idée et le monde sensible, là où Platon parle d'une « gradation infinie ». De même, les dieux ne sont pas radicalement séparés du monde. Ils sont eux-mêmes gradation infinie, messagers, principes de variations infinies, reliés à d'autres principes selon la loi de l'analogie qui gouverne le monde et nous enseigne que, dans la présence de l'être, rien ne se crée et rien n'est perdu. Les dieux témoignent de l'éternité de nos âmes, de nos pensées comme ils témoignent de l'éternité du monde.
4. Une temporalité illuminée
Maître des ivresses, Dionysos nous invite à une expérience du temps dégagé de toute servitude linéaire. L'ivresse dionysiaque est la première, et la plus immédiate, des approches du temps modifié. Par l'ivresse, la temporalité devient chatoyante, complexe, variable selon des données métaphoriques et poétiques dont l'imagination est alors la maîtresse souveraine. L'accélération et l'exacerbation des idées, la fougue des sentiments et de l'imaginaire, les puissances démultiplicatrices de l'ivresse subvertissent l'illusion du temps mécanique et du temps quantifiable. Lorsque Dionysos mène la danse, l'âme bondit de qualités en qualités, d'intensités en intensités, si bien que le temps devient semblable à un espace résonnant d'échos et miroitant d'apparitions, toutes moins prévisibles les unes que les autres. L'univers entier devient alors le théâtre de cette fête dithyrambique. Pleine d'intersignes, de manifestations brusques, d'illuminations, au sens rimbaldien, la temporalité dionysiaque est une temporalité illuminée.
La lumineuse construction apollinienne n'est pas moins dégagée du temps linéaire que la fougue dionysiaque. Dionysos lutte encore avec le temps linéaire comme avec un ennemi, alors qu'Apollon domine toutes les temporalités de son évidence sculpturale. L'erreur d'interprétation la plus commune croit tirer avantage de l'intemporalité des dieux pour conclure à leur inexistence, car, selon l'historiographie profane, seules existent les choses et les créatures soumises au temps. Certes, tout ce qui tombe sous nos yeux semble soumis au temps. N'est-ce point parce que nous sommes soumis au temps que nous croyons voir dans les choses la marque de cette soumission ? N'anticipons-nous point arbitrairement de la nature des dieux par la connaissance de nos propres infirmités ? Nous passons à travers les apparences vers une extinction plus ou moins certaine et nous en concluons à la fugacité de toute chose. N'est-ce point sauter directement de la prémisse à la conclusion et faillir aux exigences élémentaires de l'exactitude philosophique ? L'ivresse, en nous délivrant de nos affaires trop humaines, de nos préoccupations mesquines, et des conditions qui nous enchaînent, nous laisse enfin face au monde réel que nous ne nous croyons plus obligés, alors, d'assujettir aux circonstances qui voient nos limites et nos défaites. Les théurgies anciennes, néoplatoniciennes et orphiques, prescrivaient de sortir de soi-même par l'extase afin d'accéder à la vision. Ce n'est que délivré des conditions de la nature humaine que nous pouvons voir. L'extase visionnaire fut ainsi longtemps considérée comme un instrument de connaissance.
Connaître par l'extase, voir par l'extase, loin de ramener l'homme vers la subjectivité ou l'intériorité, était alors un moyen de voir le monde hors des limites ordinaires de l'entendement humain. La mesure de l'homme ne devient la mesure du monde, du Cosmos, que si nous acceptons de nous abandonner à l'Odyssée de la pensée et de l'Ame. L'exigence épique n'est pas radicalement différente de l'exigence philosophique. Empédocle rejoint Homère dans la célébration de l'areté, cette vertu fondamentale qui dégage l'homme de la soumission banale aux phénomènes. L'éthique héroïque est une éthique du dégagement qui peut aller jusqu'à paraître désinvolture. La vision sera d'autant plus juste, et d'autant plus riche d'enseignements, qu'elle sera plus inhabituelle, mieux dégagée des conditions ordinaires de l'existence. De même, par ses instruments, explorateurs de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, par ses audacieuses hypothèses mathématiques, le chimiste et le physicien usent de méthodes qui invitent le regard à voir la réalité sous un jour radicalement différent de celui auquel elle se propose dans la vie quotidienne. Ce que le physicien nous apprend de la nature du Temps, depuis Newton, contredit l'expérience que nous en faisons dans la succession de nos travaux et de nos jours. Le Théurge des Mystères dionysiens ou orphiques n'agissait pas autrement en faisant de l'expérience visionnaire, qui rompt les logiques de la perception profane, une source de connaissance. Seul le point de vue inhabituel peut nous renseigner sur la nature de l'habituel. La « sur-temporalité » du monde divin qui se révèle dans la vision du Théurge délivre de la prison de la subjectivité, qui ne voit en toute chose que sa propre image insignifiante et périssable.
Dans les civilisations de masse, soumises à la loi du plus grand nombre et au règne de la Quantité, il est de coutume d'expliquer le supérieur par l'inférieur. Ainsi le désintéressement et les comportements humains, qui participent de la vertu donatrice, sont-ils soumis à la suspicion de l'inférieur qui cherchera les motifs intéressés là où s'exerce librement un génie dispendieux. De même, l'inspiration divine, l'extase visionnaire, les hautes opérations de l'entendement auxquelles nous convie la Théurgie orphique seront-elles soumises, par la critique profane, à la « subjectivité » ou justiciables d'une psychologie plus ou moins naturaliste. Dans un ordre plus récent et plus restreint, l'œuvre littéraire et son auteur, lorsqu'ils ne bénéficient point, en espèces sonores et trébuchantes, des fruits de leur labeur sont invariablement taxés de vanité. L'inaptitude du Moderne à voir au-delà du cercle étroit de ses intérêts les plus immédiats lui ôte d'emblée toute compétence à juger de la poésie et de la métaphysique. Il s'agit là moins d’une question de culture que d'orientation intérieure. Le monde auquel l'ivresse porte atteinte laisse place à de plus subtiles constructions où la multiplicité des états de conscience dévoile la multiplicité des états de l'être.
Les cultes grecs tardifs, les philosophies hermétiques, loin d'être seulement les éléments décadents d'une civilisation destinée à laisser place au christianisme, paraissent ainsi à celui qui s'y attache avec une certaine déférence, d'une richesse exceptionnelle. Les Hymnes Orphiques, dont une traduction nouvelle et musicale vient d'être donnée par Jacques Lacarrière, témoignent d'une ferveur ancienne et portent en eux le témoignage des plus lointaines méditations grecques. De même le Discours sur Hélios-Roi de l'Empereur Julien, Les Mystères égyptiens de Jamblique, les fragments pythagoriciens, loin de témoigner d'une corruption des sagesses anciennes en révèlent certains aspects probablement maintenus cachés jusqu'alors, la discipline de l'arcane se levant, par exception, en ces périodes pressenties comme ultimes.
Si ces témoignages ne sont que lubies ou médiocres compilations, alors, en effet, le christianisme le plus exclusif et le plus administratif prouve sa nécessité. En revanche, si les ultimes formes libres du paganisme sont diaprées de sens et de beauté, si nous pouvons entendre et laisser miroiter en nous ce sens et cette beauté, alors, rien n'est joué. La perspective traditionnelle, à laquelle certains des plus éminents auteurs catholiques se sont ralliés, incline à croire que la Sagesse n'est point datable, « qu'elle naît avec les jours » selon la formule de Joseph de Maistre, et que les formes religieuses les plus anciennes sont aussi les plus lumineuses ambassadrices de la lumière d'or des origines. Ces conceptions, ennemies de toute exclusive religieuse, étaient partagées par les fidèles aux dieux antérieurs. Si le centre du temps est l'origine du monde, alors toutes nos formulations sont des points sur la périphérie, horizon d'éternité que rien n'altère, qu'aucune obsolescence ne menace fondamentalement.
5. Les textes sacrés et l'étincelle d'or du secret
Le génie du paganisme tardif fut d'avoir transposé dans l'ordre du secret, en vue d'une transmission de maître à disciple, les vastes certitudes des dieux afin de garantir leur survie en « ces temps de détresse » qu'évoquait Hölderlin. L'orphisme, le pythagorisme, les poétiques dionysiennes, alexandrines, hermétiques, ne sont pas du paganisme « préchrétien », mais du paganisme rendu subtil, en vue d'une traversée historique pleine d'incertitudes. Si les polémiques contre le christianisme, surtout sous la forme vulgaire qu'affectionnent les Modernes, nous semblent vaines (un cloître roman demeurant plus proche, par la forme et le fond, du temple d'Epidaure que de n'importe quelle construction moderne, fût-elle « néo-classique », issue de l'hybris moderniste) nous garderons à cœur, en revanche, de ne rien céder des ferveurs anciennes à l'illusion d'un quelconque « progrès ». Si le génie grec persiste dans l'architecture romane, il persiste aussi ailleurs, avant et après. La similitude entre la fin de l'Empire et l'actuel déclin de l'Occident est trop évidente pour n'être pas de quelque façon fallacieuse.
Certes, l'Occident sombre, et l'arrogance occidentale est mise à mal, mais voici bien longtemps que cet Occident-là, voué au dogme bicéphale de la marchandise, et de la technique n'est plus que la subversion des principes fondateurs des Cités et des Empires dont nos arts et nos philosophies furent les héritiers. Voici bien longtemps que le génie de l'Europe et les destinées historiques de l'Occident ne coïncident plus en aucune façon, et souvent paraissent, aux observateurs les plus avisés, antagonistes. Le génie de l'Europe n'a pas disparu avec le triomphe historique de l'Occident mais il est devenu secret, apanage des individus audacieux qui surent résister à la planification et à l'uniformisation.
Les trois totalitarismes du siècle, totalitarisme nazi, communiste et capitaliste, furent des tentatives partiellement réussies d'arracher définitivement l'homme à son autarcie pour en faire l'objet docile de la technique et de la société de masse, où l'Occident marque précisément son désastreux triomphe. Le vingtième siècle restera dans l'Histoire comme le siècle de la destruction programmée de toutes les cultures traditionnelles. L'Occident fut destructeur de la magnifique culture chevaleresque et visionnaire des Indiens d'Amérique parce qu'il avait déjà renié en lui-même le génie européen. Pourquoi serions-nous solidaires de ce qui nous tue ? Poètes, artistes, ou amoureux des grandes heures, des ivresses dionysiennes et des songes apolliniens, pourquoi notre destin se confondrait-il avec le titanisme d'un pouvoir qui se fonde, selon l'excellente formule de Heidegger, sur « l'oubli de l'être » ? Le génie de l'Europe est fidélité aux dieux, le destin de l'Occident est la soumission aux Titans. Lorsque, selon la formule de Drieu « les Titans à genoux raidissent leur buste », ce ne sont point les dieux qui rêvent leur défaite mais le règne d'une force mécanique, aussi insolite que destructrice et passagère. Certes, des milliers de destinées humaines peuvent encore s'y briser, mais le simple regard d'Athéna qui se pose sur nos tumultes, si nous en prenons conscience, éloigne déjà tout ce dont nous souffrons dans les limbes des erreurs passées. Quoiqu'il advienne, les dieux nous précèdent. Les dieux ne sont pas dans notre passé, c'est nous qui sommes dans le passé des dieux et qui nous efforçons de les rejoindre.
6. La Mémoire et la bienveillance des dieux
A chaque phrase que nous écrivons, et qui arrache à l'abrutissement et au mutisme le sens de la parole, nous reconnaissons que nous vivons dans la bienveillance des dieux. Lorsque les dieux veillent sur nous, notre existence est une ardente veillée. Aux confins du déclin, nous discernons « l'étincelle d'or » rimbaldienne. Les poètes gardent le sens, c'est-à-dire la possibilité infinie de dire le génie d'une tradition, quand bien même cette tradition paraît être provisoirement vaincue ou oubliée: il n'est d'autre combat que de mémoire. Par l'étymologie, et par l'expérience de la pensée, la vérité et la réminiscence ne sont qu'une seule et même chose. Nous méconnaissons le sens profond de la mémoire dès lors que nous ne discernons plus en elle la source de la vérité. Un monde peuplé de dieux n'est pas un monde, plus que d'autres, soumis à l'irrationalité.
Un monde peuplé de dieux innombrables, s'il n'est pas un monde où l'on croit davantage, est parfois un monde où l'on voit mieux, un monde où les hommes sont davantage préoccupés du monde et des forces qui le gouvernent que d'eux-mêmes, un monde où les regards s'attardent plus volontiers sur le ciel, les mers, les forêts. Les dieux viennent là où la déférente attention au monde devient inventive. Les poètes sont les chantres des dieux car ils reçoivent de l'attention qu'ils portent au monde des messages dont témoigneront leurs poèmes. Les Anciens croyaient que le poème est un moyen de connaissance du monde, et pas seulement un moyen de connaissance du poète. Ce que l'on nomme la littérature sacrée n'est rien d'autre qu'une littérature à laquelle on reconnaît le pouvoir d'être un moyen de connaissance du monde, et non pas seulement un « vecteur de savoirs ». Sacrée est toute littérature dont le dessein est de dire le monde et d'unir à ce monde, par le Dire, celui qui l'entend et qui, par son entendement, va revivre l'aventure dite.
Lorsque le texte sacré n'est pas lu avec un regard profane ou profanateur, celui qui déchiffre les phrases en devient l'Auteur. Le principal reproche que l'on peut adresser à certains sectateurs monothéistes, adversaires de l'herméneutique, est d'avoir voulu désacraliser l'ensemble des poésies du monde, depuis l'origine des temps, au profit exclusif de la Bible et du Coran. La critique moderne, formaliste, narratologique ou psychanalytique est l'héritière de cette désacralisation. Pour les poètes cependant, et pour les herméneutiques issues de Homère et de Virgile, cette désacralisation est à peine un vœu pieux! Quiconque lit Novalis, Hölderlin, Mallarmé, Rimbaud ou Saint John Perse voit bien qu'il s'agit d'une littérature qui nous apporte bien davantage qu'un savoir concernant leurs auteurs. Ce qui se trouve remis en jeu dans ces œuvres nous touche précisément car nous avons accès par elles à la Connaissance dont les auteurs et nous-mêmes ne sommes que les miroirs. Toutefois, la littérature sacrée ne demeure sacrée que par l'herméneutique. En l'absence d'une herméneutique, d'un art de l'interprétation, le sacré du texte devient un pur secret, hors d'atteinte.
L'augure dit le sens du vol des oiseaux, il déchiffre ces configurations célestes. En l'absence de l'interprète, certes, les oiseaux ne suspendent point leur vol mais leur vol ne dit plus rien. De même, lorsque les herméneutiques sont étouffées par la pesanteur des Dogmes, des convictions et des mots d'ordre, les textes sacrés ne disent plus rien ou ne disent plus que des banalités répertoriées et admises. Réduire les textes sacrés à l'insignifiance, telle fut, de tous temps, la stratégie des uniformisateurs, soit qu'ils eussent pour dessein d'établir l'exclusive d'un discours symbolique au détriment de tout les autres, soit qu'ils ourdissent le projet de faire disparaître toute forme de sacré, de langage mythique, et d'éteindre le Logos lui-même sous l'accumulation des scories et des insignifiances.
Qu'est-ce qu'un texte sacré ? La science sacrée étant ce qui qualifie la réalité par opposition à la science profane qui quantifie la réalité, on pourrait dire qu'un texte sacré est un écrit qui dispose du pouvoir de faire entrer son lecteur ou son auditeur dans le monde des qualités. Connaître qualitativement le monde, tel est le projet créateur du texte sacré. Cette connaissance qualitative, cette Gnose, diffère de la connaissance quantitative comme le déchiffrement diffère du dénombrement. Le texte sacré déchiffre le réel et offre ce déchiffrement, par le Don poétique, à celui qui sera digne de s'en approprier l'exigence. L'interprète du texte sacré, l'herméneute, prolonge les résonances de la création initiale. Son dessein se confond avec le dessein de l'œuvre. L'herméneutique homérique et virgilienne ne fut point un simple commentaire des œuvres, mais une réponse du déchiffrement entrepris par les œuvres elles-mêmes. L'herméneute ne se situe point à l'extérieur de l'œuvre, dont il dénombrerait les caractéristiques de façon neutre, il reprend l'opération du déchiffrement là où elle fut laissée par l'Auteur, afin de mener l'entendement humain le plus loin possible dans le monde des qualités, autrement dit, le monde sacré.
7. La légère et infinie trame du monde
Dans un monde où règnent les dieux, la primauté de la Qualité sur la Quantité est avérée par les rites qui conditionnent l'ordre de la Cité. Lorsque la Qualité prime la Quantité (de même que le léger domine le lourd) l'existence s'enrichit elle-même de qualités, qui sont vertus et puissances. Contrairement à ce que prétendent certains exégètes hâtifs, le monde du sacré est beaucoup moins finaliste que le monde profane, lequel soumet finalement tout acte et toute chose à une évaluation quantitative, utilitaire et marchande. Si le monde des qualités auquel nous invite l'herméneutique sacrée ignore les finalités générales des logiques linéaires, il nous dispose, en revanche, à comprendre l'interdépendance des qualités, des puissances et des vertus. Les dieux et les hommes entrecroisent leur destin, et de cet entrecroisement naît l'épopée.
Hommes et dieux tissent la trame du monde et leurs hostilités mêmes sont fécondes. Les dieux pas davantage que les hommes n'ont de sens insolite, ils prennent sens par leurs échanges, en des configurations complexes qui témoignent de l'éternité de l'être. Une certaine intelligence philosophique est nécessaire pour comprendre que le non-finalisme des théurgies anciennes coïncide avec une vision de l'éternité et de l'être. L'être et l'éternité ne sont pas des finalités, ils sont les principes du déchiffrement en même temps qu'ils en sont la fin. Pour les contemporains d'Empédocle mais aussi pour ceux de Platon et de Jamblique, il n'y a point évolution de l'intelligence mais reconnaissance du vrai, ce que résume le mot grec Aléthéia, qui signifie à la fois vérité et réminiscence. Cette vision non-évolutive de l'accroissement de la connaissance suppose que la plénitude est toujours une recouvrance.
« Deviens ce que tu es ». La formule delphique résume admirablement cette vue-du-monde qui tient la plénitude de la connaissance de la recouvrance de l'origine. Le devenir est la célébration de l'être et non point, comme on se hasarde parfois à la penser, le refus ou la négation de l'être. Les dithyrambes de Dionysos de Nietzsche saisissent au vif cette vision du tréfonds à partir de la surface, tréfonds et surface ne faisant qu'un dans la vision que gemme l'instant ! Le finalisme de la théologie exotérique dogmatique et l'évolutionnisme sont également étrangers au « deviens ce que tu es » dans la mesure où, pour eux, tout se joue, sinon dans l'achèvement, du moins dans l'étape ultérieure qui marque l'obsolescence de l'étape antérieure. Pour le finaliste et l'évolutionniste, ce que nous sommes dans la présence des choses est dépourvu de sens. La plénitude est hors d'atteinte.
Pour les intuitions les plus anciennes, en revanche, l'éternité est consubstantielle au monde. Chaque instant témoigne d'un faisceau de forces à nul autre semblable. L'unificence de l'Instant est le signe de son éternité. Ce qui est unique, irremplaçable, ne passe jamais. La fidélité aux dieux antérieurs n'est point nostalgie, ni seulement un recours au passé afin de peupler un présent déserté de présences. Cette fidélité est éveil. La foi que nous dispense la magnificence du monde est éveil. Nous nous éveillons à la grandeur sitôt que nous nous oublions quelque peu. Un monde sans dieux est un monde sans grandeur. Voyez la mesquinerie de ces existences réduites à elles-mêmes, vaniteuses, despotiques, sourdes à toutes les sollicitations du monde, à toute musique !
Les dieux nous éveillent à la conscience du monde. En nommant les forces qui nous gouvernent en même temps qu'elles gouvernent le monde, nous tentons d'entrer dans leur connivence. Les rites qui invoquent les dieux tentent l'approche, au sens jüngérien du mystère dont émanent nos heures les plus belles. L'absurde de certaines formes religieuses tardives ou décadentes est de vouloir contraindre l'homme au sacré alors que le sacré est la nature fondamentale du monde perçu qualitativement. Or, on peut contraindre à la Quantité, ce que font la productivité, la religion du rendement et la démocratie; il est impossible de contraindre à la Qualité, la Qualité étant, par définition, ce qui échappe à toute détermination. La Qualité conditionne, elle n'est jamais conditionnée.
8. L'inépuisable « première foi » et l'exactitude herméneutique
Invoquer un dieu, c'est déjà nier le déterminisme. Tant que des dieux, quelles que soient leurs appellations, vivent dans nos mémoires, l'uniformisation n'est que partiellement réalisée et le totalitarisme est un échec. Or, la distance qui sépare certains hommes des grandes théurgies antiques est moins grande qu'il n'y paraît. Cendrars est un Eubage. Ce qui sépare Saint-John Perse des grands Aèdes est certainement beaucoup moins significatif que ce qui sépare le soldat d'aujourd'hui du guerrier de jadis. Les poètes inventent le nouveau car leur parole provient du site de l'éternelle nouveauté. Leur Logos est la source de l'inépuisable « première fois ». Eliade sut montrer magistralement que le rite ne commémore point mais réactualise. Par le rite qui invoque les dieux, nous retrouvons la première fois (où prend source la fidélité première) et la possibilité universelle de toutes les Formes. Ce qui naît de la première fois est sans précédent et rigoureusement imprévisible. La Tradition, dans sa primordialité inépuisable, devrait, à partir de telles prémisses, être quelque peu moins sujette aux mésinterprétations et aux abus. L'acte herméneutique, si proche de l'acte poétique, devrait également retrouver un sens plus précis et autre que celui de la glose, de l'analyse ou de l'exégèse. La fidélité aux sources les plus lointaines de notre culture ne saurait, en aucune façon, sous peine de tomber dans les pires contrefaçons, se dispenser de l'exactitude herméneutique.
Mais qu'est-ce, au juste, que l'exactitude herméneutique ? Ce n'est point à coup sûr, s'embourber dans une terminologie de spécialiste, ni singer la rigueur de la prose juridique. L'exactitude herméneutique réside bien davantage dans le sens de la nuance, une certaine plasticité de l'intelligence qui favorise le sens de la sympathie entre l'œuvre et son interprète. Les Modernes ne connaissent plus d'exactitude que dans le domaine de la Technique. Lorsqu'ils abordent les questions essentielles, ils le font avec une telle négligence que l'on pourrait croire à du pur mépris. Or, rien n'exige plus d'exactitude et de rigueur qu'une approche herméneutique. Les Modernes, persuadés qu'ils sont que tout ce qui ne concerne pas le monde mécanique est purement subjectif, s'autorisent à aborder le monde métaphysique dans la confusion la plus grande, comme s'il était absolument indifférent de dire n'importe quoi sur des questions qui furent, par les réponses qu'on leur donna, à l'origine des styles des différentes civilisations dont nous héritons.
Pour l'herméneute, le style exprime la profondeur du sens, et pour ainsi dire, sa réalité ultime. Dans la perspective d'une herméneutique créatrice, il n'y a rien de plus profond que le style. L'idée générale, l'opinion, la conviction, le savoir, les significations immédiatement repérables, tout ce qui relève du jeu du « pour » et du « contre » n'est que l'apparence, la surface. Le profond est le style, qui manifeste ce qui anime les idées. Par le style, quelles que soient nos argumentations, nos parti-pris (qui peuvent être origine et cause de malentendus) nous témoignons essentiellement de la provenance de nos pensées. Notre style témoigne du site originel de notre pensée. Chaque vrai lecteur sait que la première et la plus profonde sympathie qui se noue entre un auteur et son lecteur est d'ordre musical. Que nous importent les convictions d'un auteur lorsque la « consanguinité des esprits », pour reprendre la formule de Marcel Proust, dispose du privilège d'accorder les intelligences par la sympathie musicale. « Nous nous entendons bien »- l'expression familière dit tout. L'herméneute excelle à trouver le la. Dès lors, son interprétation sera infinie comme l'est, même enclose dans une durée immanente, la variation du musicien. Par la faute de certaines traductions quelque peu moroses et pesantes, mais surtout par manque d'oreille (et l'entendement dans sa plénitude est toujours divinateur !) nous mésestimons la vertu musicale de l'Epopée.
L'Odyssée est non seulement le paradigme de presque tous nos récits d'aventure et de toutes nos audaces herméneutiques, elle est aussi la source de notre grande musique. Variation, musique, interprétation, tels sont les modes opératoires des « odyssées » de notre âme. Dans cette perspective, l'expression « perdre son âme » reprend son sens fatidique. Lorsque nous avons perdu notre âme dans l'oubli, tout en nous et autour de nous devient immobile et schématique. Les puissances lumineuses et bouleversantes des dieux n'irriguent plus les apparences et nous nous étiolons doucement dans des identités d'emprunt. L'âme, si l'on se souvient de l'étymologie, est ce qui anime. A l'interprétation musicale de la variation correspond, dans l'Epopée, l'herméneutique métaphysique de la péripétie. L'Odyssée est elle-même art de l'interprétation. Ulysse est non seulement le héros exemplaire, il est aussi le regard qui découvre et délivre dans les choses elles-mêmes le sens et les qualités qui, autrement, seraient demeurées inaperçues.
9. Le Groenland métaphysique
L'exemplarité du héros se renforce de la primordialité du regard dont l'amplitude conquiert à la fois les hauteurs et les profondeurs. Le regard ample, cela même qu' Ernst Jünger nommera la vision panoramique, telle est la conquête de l'Epopée. En lisant Homère, nous voyons avec d'autres yeux, et comme pour la première fois, un monde riche d'émerveillements et d'effrois, un monde de forces et de présences qui nous entraîne avec lui dans la plus belle et la plus irrécusable métaphore de l'existence humaine: un voyage en mer.
Ceux des écrivains qui firent l'expérience de l'aventure maritime, tel Hermann Melville, se reconnaissent à une vision qui dépasse l'apparence immédiate, une vision symbolique. La vision symbolique du réel ne naît point d'un refus ou d'un éloignement du réel mais de l'expérience de la réalité la plus intense qui soit. Lorsque la réalité est portée à un degré extrême d'incandescence et d'intensité, elle devient Symbole. Celui qui vit dans la banalité et l'ennui du quotidien a fort peu de chances d'atteindre à une vision symbolique du réel. Les navigateurs, les poètes, les hommes qui remettent en jeu leur existence dans l'aventure d'une réalité non soumise à la planification, non réduite à l'innocuité, se haussent souvent à une vision lyrique et symbolique de la réalité. Nul mieux que Hermann Melville ne sait dire l'expérience métaphysique fondamentale: « Nous servons de fourreau à nos âmes. Quand un homme de génie tire du fourreau son âme elle est plus resplendissante que le cimeterre d'Aladin. Hélas ! combien laissent dormir l'acier jusqu'à ce qu'il ait rongé le fourreau lui-même et que l'un et l'autre tombent en poussière de rouille ! Avez-vous jamais vu les morceaux des vieilles ancres espagnoles, les ancres des antiques galions au fond de la baie de Callao ? Le monde est plein d'un bric-à-brac guerrier, d'arsenaux vénitiens en ruines et de vieilles rapières rouillées. Mais le véritable guerrier polit sa bonne lame aux brillants rayons du matin, en ceint ses reins intrépides et guette les taches de rouille comme des ennemies; par maint coup de taille et d'estoc il en maintient l'acier coupant et clair comme les lances de l'aurore boréale à l'assaut du Groenland. »
Toute aventure, lorsqu'elle n'est pas réduite à une pure représentation est toujours une aventure de l'âme. L'audace qui se lance à l'assaut des éléments et des circonstances inhabituelles ou extrêmes, est déchiffrante. Le navigateur doit déchiffrer les signes du ciel et de la mer. La météorologie, si décisive dans toutes les aventures physiques, n'est autre que le langage des hauteurs dont l'herméneute doit s'efforcer de discerner la correspondance dans le langage des profondeurs. L'aventure est déchiffrement et tout déchiffrement est aventureux. Point d'Epopée ni d'herméneutique sans une confrontation directe avec l'Inconnu.
L'Inconnu, nous enseigne l'Odyssée, doit être recherché et affronté héroïquement. Il ne s'agit point pour le héros-herméneute de ramener l'inconnu au connu mais bien au contraire de s'affronter intensément et amoureusement à l'inconnu. Le héros ne réduit point l'inconnu au connu; il hausse le connu jusqu'à la magnificence de l'inconnu. L'herméneute et le héros non seulement ne se contentent point du connu, ils considèrent que ce connu est un leurre misérable, un mensonge. L'attrait de l'inconnu guide également celui qui s'aventure sur les mers que l'interprète qui s'aventure dans les contrées indéchiffrées de l'esprit. L'Odyssée conjugue magistralement ces deux exigences fondamentales de l'être humain. Dans la vision héroïque et herméneutique du monde, l'inconnu n'étant pas réduit au connu, mais au contraire, le connu augmenté d'une plénitude d'inconnu, l'être humain, loin de ramener le monde à lui-même, à son propre usage et à ses instrumentations, s'expose à être métamorphosé par le monde. L'inconnu dans lequel je m'aventure fait de moi un être inconnaissable, et cet inconnaissable est le pouvoir de ma souveraineté.
Dans la part du secret réside ma liberté, ce qui en moi ne saurait être l'objet d'une utilisation ou d'une évaluation quantitative. Affronté à l'inconnu de l'aventure herméneutique, je deviens ce que je conquiers. La lumière herméneutique transfigure ce qu'elle touche et qui elle atteint. L'inconnaissable dont elle me revêt m'illumine jusqu'au fond du cœur.
Luc-Olivier d'Algange
Extrait de L'Ame secrète de l'Europe, Oeuvres, mythologies, cités emblématiques, éditions de L'Harmattan, collection Théôria. 370 pages, 38 euros.

13:00 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
09/04/2024
Luc-Olivier d'Algange, Léon Bloy l'Intempestif, suivi d'une traduction en espagnol:
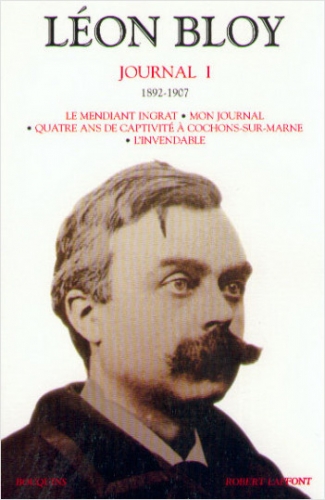
Léon Bloy l'Intempestif
« Il est indispensable que la Vérité soit dans la Gloire. »
Léon Bloy
A mesure que les années passent, avec une feinte ressemblance dans leur cours de plus en plus désastreux depuis la première parution du Journal de Léon Bloy, l'écart n'a cessé de se creuser entre ceux qui entendent cette parole furibonde et ceux qui n'y entendent rien. Certes, on ne saurait s'attendre à ce que les rééditions des œuvres de Léon Bloy fussent accueillies comme des événements ou des révélations par un milieu « culturel » qui ne cesse de donner les preuves de sa soumission à l'Opinion, de son aveuglement et de son mépris pour toute forme de pensée originale. Une sourde hostilité est la règle et je lisais encore des jours-ci un folliculaire récriminant contre « le douloureux labyrinthe narcissique » que serait à ses yeux le Journal de Léon Bloy. Certes, labyrinthiques et préoccupés de l'Auteur, tous les journaux le sont par définition, mais au contraire du fastidieux et potinier Journal de Léautaud, devant lequel maints critiques modernes pratiquèrent une ostensible génuflexion, le Journal de Bloy est d'une vivacité électrique. L'humour ravageur, les flambées de colère, les fulgurantes intuitions mystiques, un style d'une densité et d'une musicalité prodigieuse font de ce Journal un chef d'œuvre de la forme brève, aphoristique ou illuminative. Que lui vaut donc cette disgrâce où nous le voyons ? Sans doute la pensée qui s'y affirme et s'y précise sous la forme d'une critique radicale du monde moderne, dans la lignée de Barbey d'Aurevilly et de Villiers de L'Isle-Adam.
« Tout ce qui est moderne est du démon », écrit Léon Bloy, le 7 Août 1910. C'était, il nous semble, bien avant les guerres mondiales, les bombes atomiques et les catastrophes nucléaires, les camps de concentration, les manipulations génétiques et le totalitarisme cybernétique. En 1910, Léon Bloy pouvait passer pour un extravagant; désormais ses aperçus, comme ceux du génial Villiers de L’Isle-Adam des Contes Cruels, sont d'une pertinence troublante. L'écart se creuse, et il se creuse bien, entre ceux qui somnolent à côté de leur temps et ne comprennent rien à ses épreuves et à ses horreurs, et ceux-là qui, à l'exemple de Léon Bloy vivent au cœur de leur temps si exactement qu'ils touchent ce point de non-retour où le temps est compris, jugé et dépassé. Léon Bloy écrit dans l'attente de l'Apocalypse. Tous ces événements, singuliers ou caractéristiques qui adviennent dans une temporalité en apparence profane, Léon Bloy les analyse dans une perspective sacrée. L'histoire visible, que Léon Bloy est loin de méconnaître, n'est pour lui que l'écho d'une histoire invisible. « Tout n'est qu'apparence, tout n'est que symbole, écrit Léon Bloy. Nous sommes des dormants qui crient dans leur sommeil. Nous ne pouvons jamais savoir si telle chose qui nous afflige n'est pas le principe de notre joie ultérieure. »
Cette perspective symbolique est la plus étrangère qui soit à la mentalité moderne. Pour le Moderne, le temps et l'histoire se réduisent à ce qu'ils paraissent être. Pour Bloy, le temps n'est, comme pour Platon et la Théologie médiévale, que « l'image mobile de l'éternité » et l'histoire délivre un message qu'il appartient à l'écrivain-prophète de déchiffrer et de divulguer à ses semblables. Pour Léon Bloy, le Journal, loin de se borner à la description psychologique de son auteur a pour dessein de consigner les « signes » et les « intersignes » de l'histoire visible et invisible afin de favoriser le retour du temps dans la structure souveraine de l'éternité.
Pour Léon Bloy, qui se définit lui-même comme « un esprit intuitif et d'aperception lointaine, par conséquent toujours aspiré en deçà ou au-delà du temps », la fonction de l'auteur écrivant son journal n'est pas de se soumettre à l'aléa de la temporalité, du passager ou du fugitif, mais tout au contraire « d'envelopper d'un regard unique la multitude infinie des gestes concomitants de la Providence ». Le Journal, - tout en marquant le pas, en laissant retentir en soi, et dans l'âme du lecteur ami, la souffrance ou la joie, plus rare, de chaque jour, les « nouveautés » menues ou grandioses du monde, ne s'inscrit pas moins dans une rébellion contre le fragmentaire, le relatif ou l'éphémère. Ce Journal, et c'est en quoi il décontenance un lecteur moderne, n'a d'autre dessein que de déchiffrer la grammaire de Dieu.
Là où le Moderne ne distingue que des vocables sans suite, de purs signes arbitraires, Léon Bloy devine une cohérence éblouissante, et, par certains égards, vertigineuse et terrifiante. Léon Bloy n'est pas de ces dévots qui trouvent dans la foi et dans l'Eglise de quoi se rassurer. Ces dévots modernes, bourgeois au sens flaubertien, Léon Bloy les fustige ainsi que la « société sans grandeur ni force » dont ils sont les défenseurs. Il est fort improbable, quoiqu'en disent les journaleux peu informés qui voient en Bloy un « intégriste », que l'auteur du Désespéré et de La Femme Pauvre se fût retrouvé du côté de nos actuels, trop actuels « défenseurs des valeurs », moralisateurs sans envergure ni générosité,- et par voie de conséquence, sans le moindre sens de la rébellion. Or s'il est un mot qui qualifie avec précision la tournure d'esprit de cet homme de Tradition, c'est rebelle !
Pour Léon Bloy, quel que soit par moment son harassement, le combat n'est pas fini, il y retourne, chaque jour est le moment décisif d'une guerre sainte. Léon Bloy est un moine-soldat qui va son chemin d'écrivain, non sans donner ici et là quelques coups de massue, pour reprendre la formule évolienne. Ainsi le sport, objet, depuis peu, d'un nouveau culte national est-il, pour Léon Bloy « le moyen le plus sûr de produire une génération d'infirmes et de crétins malfaisants ». Quant à la Démocratie, bien vantée, elle lui suggère cette réflexion : « Un des inconvénients les moins observés du suffrage universel, c'est de contraindre des citoyens en putréfaction à sortir de leurs sépulcres pour élire ou pour être élus. » Cette outrance verbale dissimule souvent une intuition. Tout, dans ce monde planifié, ne conjure-t-il pas à faire de nous une race de morts-vivants, réduits à la survie, dans une radicale dépossession spirituelle. Que sont les Modernes devant leurs écrans ? Quel songe de mort les hante ? Les rêveries du Moderne ne sont-elles pas avant tout macabres ? Non, la religion de Léon Bloy n'est pas faite pour les « tièdes ». C'est une religion pour ceux qui ressentent les grandes froidures et qui attendent l'embrasement des âmes et des esprits. Le modèle littéraire de Léon Bloy ce sont les langues de feu de la Pentecôte.
Léon Bloy s'est nommé lui-même « Le Pèlerin de l'Absolu ». Chaque jour qui advient, et que l'auteur traverse comme une nouvelle épreuve où se forge son courage et son style, le rapproche du moment crucial où apparaîtront dans une lumière parfaite la concordance de l'histoire visible et de l'histoire invisible. Cette quête que Léon Bloy partage avec Joseph de Maistre et Balzac le conduit à une vision du monde littéralement liturgique. L'histoire de l'univers, comme celle de l'auteur esseulé dans son malheur et dans son combat, est « un immense Texte liturgique. » Les Symboles, ces « hiéroglyphes divins », corroborent la réalité où ils s'inscrivent, de même que les actes humains sont « la syntaxe infinie d'un livre insoupçonné et plein de mystères. »
Cette vision symbolique et théologique du monde en tant que Mystère limpide, c'est à dire offert à l'illumination (« l'illumination, lieu d'embarquement de tout enseignement théologique et mystique ») est à la fois la cause majeure de l'éloignement de l'œuvre de Léon Bloy et le principe de sa proximité extrême. Pour le moderne, la « folie » de Léon Bloy n'est pas dans sa véhémence, ni dans son lyrisme polémique, mais bien dans cette vision métaphysique et surnaturelle des destinées humaines et universelles. Pour Léon Bloy, qui n'est point hégélien, et qui va jusqu'à taquiner Villiers pour son hégélianisme « magique », les contraires s'embrassent et s'étreignent avec fougue. La nature porte la marque de la Surnature, mais par un vide qui serait l'empreinte du Sceau. De même, l'extrême pauvreté engendre le style le plus fastueux. C'est précisément car l'écrivain est pauvre que son style doit témoigner de la plus exubérante richesse. La pauvreté matérielle est ce vide qui laisse sa place à la dispendieuse nature poétique. Car la pauvreté, pour Bloy, n'est pas le fait du hasard, elle est la preuve d'une élection, elle est le signe visible d'un privilège invisible qu'il appartient à l'Auteur de célébrer somptueusement. La richesse verbale de Léon Bloy est toute entière un hommage à la pauvreté, à sa profondeur lumineuse, à la grâce qu'elle fait à la générosité de se manifester. Celui qui donne se sauve. Le mendiant peut donc, à bon droit être « ingrat ». Son ingratitude rédime celui qui pourrait s'en offenser. Mais qu'est-ce qu'un pauvre, dans la perspective métaphysique ? C'est avant tout celui qui récuse par avance toute vénalité. Or qu'est-ce que le monde moderne si ce n'est un monde qui fait de la vénalité même un principe moral, une cause efficiente du Bien et « des biens » ? Pour le Moderne, celui qui parvient à se vendre prouve son utilité dans la société et donc sa valeur morale. Celui qui ne parvient pas, ou, pire, qui ne veut pas se vendre est immoral.
Contre ce sinistre état de fait, qui pervertit l'esprit humain, l'œuvre de Léon Bloy dresse un grandiose et intarissable réquisitoire. Or, c'est bien ce réquisitoire que les Modernes ne veulent pas entendre et qu'ils cherchent à minimiser en le réduisant à la « singularité » de l'auteur. Certes Léon Bloy est singulier, mais c'est d'abord parce qu'il se veut religieusement « un Unique pour un Unique ». La situation dans laquelle il se trouve enchaîné n'en est pas moins réelle et la description qu'il en donne particulièrement pertinente en ces temps où face à la marchandise mondiale le Pauvre est devenu encore beaucoup plus radicalement pauvre qu'il ne l'était au dix-neuvième siècle. La morale désormais se confond avec le Marché, et l'on pourrait presque dire que, pour le Moderne libéral, la notion d'immoralité et celle de non-rentabilité ne font plus qu'une. Refuser ce règne de l'économie, c'est à coup sûr être ou devenir pauvre et accueillir en soi les gloires du Saint-Esprit, dont la nature dispensatrice, effusive et lumineuse ne connaît point de limite.
Contre le monde moderne, Léon Bloy ne convoque point des utopies sociales, ni même un retour au « religieux » ou à quelque manifestation « révolutionnaire » ou « contre-révolutionnaire » de la puissance temporelle. Contre ce monde, « qui est du démon », Léon Bloy évoque le Saint-Esprit, au point que certains critiques ont cru voir en lui un de ces mystiques du « troisième Règne », qui prophétisent après le règne du Père, et le règne du Fils, la venue d'un règne du Saint-Esprit coïncidant avec un retour de l'Age d'Or. Lorsqu'un véritable écrivain s'empare d'une vision dont la justesse foudroie, peu importent les terminologies. Sa vision le précède, elle n'en précède que mieux les interprétations historiographiques. « Aussi longtemps que le Surnaturel n'apparaîtra pas manifestement, incontestablement, délicieusement, il n'y aura rien de fait. "
°
Léon Bloy, el Extemporáneo
“Es indispensable que la Verdad esté en la Gloria.” Léon Bloy.
“Todo lo moderno pertenece al demonio”, escribe Léon Bloy el 7 de agosto de 1910. Fue, según nos parece, mucho antes de las guerras mundiales, las bombas atómicas y las catástrofes nucleares, los campos de concentración, las manipulaciones genéticas y el totalitarismo cibernético. En 1910, a Léon Bloy se lo podía tomar por un extravagante; hoy en día sus vislumbres, como los del genial Villiers de L’Isle-Adam de los Cuentos crueles, son de una pertinencia turbadora. Aumenta, y cada vez más, la distancia entre los que dormitan al margen de su época y no comprenden nada de las pruebas y los horrores a los que nos somete, y los que, a ejemplo de Léon Bloy, viven tan precisamente en el centro mismo de su época que alcanzan ese punto de no retorno en el que se la comprende, se la juzga y se la supera. Léon Bloy escribe a la espera del Apocalipsis. Todos esos acontecimientos, singulares o característicos, que se producen en una temporalidad aparentemente profana, Léon Bloy los analiza en una perspectiva sagrada. La historia visible, que Léon Bloy está lejos de desconocer, sólo es para él el eco de una historia invisible.
“Todo es pura apariencia, todo es puro símbolo”, escribe Léon Bloy. “Somos durmientes que gritan durante el sueño. Nunca podemos sabes si algo que nos aflige no es el principio de nuestra dicha ulterior.”
Esta perspectiva simbólica es la más ajena posible a la mentalidad moderna. Para el Moderno, el tiempo y la historia se reducen a lo que parecen ser. Para Bloy, el tiempo sólo es, como para Platón y la teología medieval, “la imagen móvil de la eternidad”, y la historia comunica un mensaje que al escritor-profeta le toca descifrar y divulgar entre sus semejantes. Para Léon Bloy, el Diario, lejos de limitarse a la descripción psicológica de su autor, tiene por objetivo el de dejar registrados los “signos” y los “intersignos” de la historia visible e invisible, a fin de favorecer el retorno del tiempo en la estructura soberana de la eternidad.
Para Léon Bloy, que se define a sí mismo como “un espíritu intuitivo y de apercepción lejana, y, por consiguiente, siempre arrastrado más acá o más allá del tiempo”, la función del autor al escribir su diario no es la de someterse a la temporalidad fugitiva sino, muy por el contrario, la de “abarcar con una mirada única la multitud infinita de los gestos concomitantes de la Providencia”. El Diario —al mismo tiempo que marca el paso, dejando resonar en sí mismo, y en el alma del lector amigo, el sufrimiento o la dicha, menos frecuente, de cada día, las “novedades” modestas o grandiosas del mundo— no deja de inscribirse en una rebelión contra lo fragmentario, lo relativo o lo efímero. Este Diario, que en esto desconcierta a un lector moderno, no tiene otra finalidad que la de descifrar la gramática de Dios.
Allí donde el Moderno sólo distingue vocablos inconexos, puros signos arbitrarios, Léon Bloy intuye una coherencia deslumbrante y, en ciertos aspectos, vertiginosa y aterradora. Léon Bloy no es uno de esos devotos que encuentran en la fe y en la iglesia con qué tranquilizarse. A esos devotos modernos, burgueses en el sentido de Flaubert, Léon Bloy los fustiga al igual que a la “sociedad sin grandeza ni fuerza” que defienden. Es altamente improbable, digan lo que digan los periodistuchos poco informados que ven en Bloy a un “integrista”, que el autor de El desesperado y de La mujer pobre hubiese estado en el mismo campo de nuestros actuales, demasiado actuales “defensores de los valores”, moralizadores sin envergadura ni generosidad —y, por consiguiente, sin el menor sentido de la rebelión. Ahora bien, si hay una palabra que define con precisión la mentalidad de este hombre de Tradición, esta palabra es “rebelde”.
Para Léon Bloy, por más extenuado que esté por momentos, el combate no ha terminado, vuelve a él, cada día es el momento decisivo de una guerra santa. Léon Bloy es un monje soldado que sigue su camino de escritor, no sin dar acá y allá algunos mazazos, para emplear la expresión de Julius Evola. Así es como el deporte, objeto, desde hace poco, de un nuevo culto nacional, es para Léon Bloy “el medio más seguro de producir una generación de inválidos y de cretinos dañinos”. En cuanto a la Democracia, tan ensalzada, le sugiere esta reflexión: “Uno de los inconvenientes menos observados del sufragio universal es el hecho de obligar a ciudadanos en estado de putrefacción a salir de su sepulcros para elegir o ser elegidos”. Esta desmesura verbal a menudo disimula una intuición. ¿Acaso no conspira todo, en este mundo planificado, para hacer de nosotros una raza de muertos vivos, reducidos a sobrevivir en una radical desposesión espiritual? ¿Qué son los Modernos delante de sus pantallas? ¿Qué sueño de muerte los posee? ¿Las Ensoñaciones del Moderno no son, ante todo, macabras? No, la religión de Léon Bloy no está hecha para los “tibios”. Es una religión para quienes sienten los grandes fríos y esperan el incendio de las almas y los espíritus. El modelo literario de Léon Bloy son las lenguas de fuego de Pentecostés.
Léon Bloy se llamó a sí mismo “El Peregrino del Absoluto”. Cada día que llega, y que el autor atraviesa como una nueva prueba en que se templan su coraje y su estilo, lo acerca al momento crucial en que aparecerán con perfecta claridad la concordancia entre la historia visible y la historia invisible. Esta búsqueda, que Léon Bloy comparte con Joseph de Maistre y Balzac, lo conduce a una visión del mundo literalmente litúrgica. La historia del universo, tanto como la del autor aislado en su desdicha y en su combate, es “un inmenso Texto litúrgico”. Los Símbolos, esos “jeroglíficos divinos”, corroboran la realidad en que se inscriben, así como los actos humanos son “la sintaxis infinita de un libro insospechado y lleno de misterios”.
Esta visión simbólica y teológica del mundo como Misterio límpido, es decir, alcanzable por la iluminación (“la iluminación, punto de embarque de toda enseñanza teológica y mística”), es, al mismo tiempo, la causa principal de lo alejado de la obra de Léon Bloy y el principio de su cercanía extrema. Para el moderno, la “locura” de Léon Bloy no reside en su vehemencia ni en su lirismo polémico, sino precisamente en esta visión metafísica y sobrenatural de los destinos humanos y universales. Para Léon Bloy, que no es en absoluto hegeliano, y que hasta llega a burlarse de Villiers de l’Isle-Adam por su hegelianismo “mágico”, los contrarios se abrazan y se estrechan con ardor. La naturaleza tiene la impronta de la Sobrenaturaleza, pero por medio de un vacío que fuese la marca del Sello. De igual modo, la extrema pobreza engendra el estilo más fastuoso. Es precisamente porque el escritor es pobre por lo que su estilo debe dar testimonio de la riqueza más exuberante. La pobreza material es el vacío que le cede el lugar a la dispendiosa naturaleza poética. Ya que la pobreza, para Bloy, no es el resultado del azar: es la prueba de una elección, es el signo visible de un privilegio invisible que le incumbe al Autor celebrar suntuosamente.
La riqueza verbal de Léon Bloy es toda ella un homenaje a la pobreza, a su profundidad luminosa, al favor que le hace a la generosidad permitiéndole manifestarse. El que da, se salva. El mendigo puede entonces, con toda razón, ser “ingrato”. Su ingratitud redime al que podría tomarla como una ofensa. Pero ¿qué es un pobre, en la perspectiva metafísica? Es, ante todo, aquél que rechaza de antemano toda venalidad. Ahora bien, ¿qué es el mundo moderno sino un mundo que hace de la venalidad misma un principio moral, una causa eficiente del Bien y de “los bienes”? Para el Moderno, el que logra venderse prueba su utilidad en la sociedad y, por lo tanto, su valor moral. El que no logra o, peor aún, no quiere venderse, es inmoral.
Contra esta siniestra situación de hecho, que pervierte el espíritu humano, la obra de Léon Bloy lanza una grandiosa e inagotable acusación. Ahora bien, es precisamente esta acusación lo que los Modernos no quieren oír y tratan de minimizar, reduciéndola a la “singularidad” del autor. Por cierto, Léon Bloy es singular, pero esto es, en primer término, porque elige ser, religiosamente, “un Único para un Único”. La situación en que se encuentra encadenado no es por esto menos real, y la descripción que da de ella es particularmente pertinente en estos tiempos en que, ante la mercancía mundial, el Pobre se ha vuelto aún mucho más radicalmente pobre de lo que lo era en el siglo XIX. La moral, ahora, se confunde con el Mercado, y casi podríamos decir que, para el Moderno liberal, la noción de inmoralidad y la de no rentabilidad no son más que una y la misma. Rechazar este reino de la economía es, con toda seguridad, ser o volverse pobre, y acoger en uno mismo las glorias del Espíritu Santo, cuya naturaleza dispensadora, efusiva y luminosa no conoce límite alguno.
Contra el mundo moderno, Léon Bloy no llama a ninguna utopía social, ni siquiera a un regreso a lo “religioso” o a alguna manifestación “revolucionaria” o “contrarrevolucionaria” del poder temporal. Contra este mundo, “que pertenece al demonio”, Léon Bloy invoca al Espíritu Santo, hasta el punto de que algunos críticos han creído ver en él a uno de esos místicos del “Tercer Reino” que profetizan, para después del Reino del Padre y del Reino del Hijo, el advenimiento de un reino del Espíritu Santo que coincidirá con un retorno a la Edad de Oro. Cuando un auténtico escritor se apodera de una visión de exactitud fulminante, poco importan las terminologías. Su visión le precede y, por lo mismo, mejor aún precede a las interpretaciones historiográficas. “Mientras lo Sobrenatural no se muestre de modo manifiesto, indiscutible, delicioso, nada estará hecho.”
Traducción de Carlos Cámara y Miguel Ángel Frontán.
23:34 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
06/04/2024
Luc-Olivier d'Algange, La morale du Prince de Ligne:
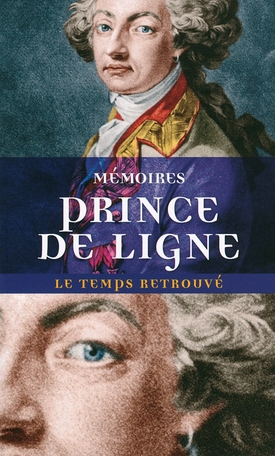
La Morale du Prince de Ligne
La fin du siècle dernier pouvait, aux regards distraits, laisser croire que le temps de la morale sévère était révolu et que, par un assentiment général, on allait pencher vers une sorte d'hédonisme démocratique et universel, ainsi que le laissaient à entendre les théoriciens de la « fin de l'Histoire » et les mœurs les plus ostentatoirement affichées. Force est de constater qu'il n'en fut rien; nous voici en des temps où la morale la plus âpre, la plus « indignée », souvent persécutrice, s'exerce sur tous les fronts.
Rien ne vaut, pour prendre la mesure du présent que de prendre conseil d'un Maître plus ancien, et, peut-être, de tenter de voir par ses yeux ce que nous sommes devenus. A cet exercice de dioptrique morale, nul ne nous invite mieux que le Prince de Ligne.
Un esprit hâtif, jugeant ses œuvres d'après ses titres et l'homme par la réputation que lui firent ses contemporains, serait enclin à le classer, comme on classe un dossier, pour s'en défaire comme d'un legs obsolète, parmi les libertins du XVIIIe siècle, auquel, certes, il appartient mais dont il se dégage par sa désinvolture même. Nul ne fut moins idéologue que le Prince de Ligne; ses voltes ne sont pas des révoltes: elles surgissent de son propre mouvement, lequel est guidé par le goût, cette notion française par excellence.
Il faut lire l'auteur des Contes immoraux et de Mes Ecarts, pour comprendre que la morale demeure son grand souci, que ses goûts ne cessent d'alerter son intelligence et que celle-ci, si libre qu'elle soit dans ses exercices, demeure ancrée dans une idée du beau indissociable du bien; idée d'autant plus exigeante qu'elle ne s'abandonne jamais à la confusion ou à l'outrance. Une certaine longanimité est nécessaire afin que l'expression de ce que l'on croit être le bien ne soit pas une grimace. La formule bien connue du Prince de Ligne: « Etre heureux et rendre heureux » nous semblerait une morale minimale, sinon minimaliste, si l'on ne s'avisait aussitôt qu'elle est, à tout le moins, plus difficile à exercer que son contraire, « être malheureux et rendre les autres malheureux », - ce qui pourrait être la devise des moralisateurs puritains.
Réduire la morale, pour le Prince de Ligne, ce ne sera pas lui accorder un statut inférieur, mais la réduire, presque au sens d'une « réduction phénoménologique », la décanter, en révéler l'essence, lui ôter ses écorces mortes, la délivrer de ses idolâtries forcenées, afin qu'elle nous revienne, calme, et source des heures heureuses.
Une morale décantée est une morale concrète, une morale du cas particulier qui ne se laisse pas fasciner par l'abstraction, par ces généralisations abusives, et fausses, qui seront, ultérieurement, au principe des contraintes les moins légitimes: « J'ai souvent vu ces Messieurs, qui travaillent pour le bien des hommes en général, ne pas assister un homme en particulier. Ils me rappellent cet Anglais qui, après avoir passé la nuit à travailler contre la traite des nègres et leur esclavage, tirait tous les jours les oreilles au sien, parce qu'il se levait un peu trop tard. »
La morale décantée par le bonheur, celle, enfin, qui sait qu'elle retrouve sa raison d'être en se délivrant du ressentiment, est d'abord délicatesse, - cette subtile science de ne point offenser: « Je trouve horrible à un homme d'esprit d'attraper un sot. Qu'il attrape un autre homme d'esprit, s'il le peut. Celui des deux qui sera l'attrapé est à coup sûr le plus présomptueux des deux ». Mes Ecarts, ou ma tête en liberté propose une morale, non point générale et déclarative, non point présomptueuse ou fière mais humble à sa façon, parfois pyrrhonienne, pratiquant la « suspension de jugement », mais seulement jusqu'au point où ne défaille l'impératif premier de « rendre heureux ».
Notre temps est aux justiciers, c'est dire à l'outrecuidance fondée sur la méconnaissance de la nature humaine. Punir est la grande affaire de ces esprits à la fois naïfs et retors, - naïfs car ils s'imaginent accroître l'empire du Bien, alors qu'ils ne font que leur propre bien, au détriment d'autrui, et retors car l'usage excessif de la mauvaise foi, qui est le filigrane de leurs arguties, en fait des sophistes controuvés et perpétuellement menaçants. A l'inverse, le style du Prince de Ligne témoigne du juste, qui est plus profond que la Justice, de même que la civilité est plus profonde que la civilisation. La juste formulation est pour lui, comme elle le fut pour Confucius, la garante de l'harmonie entre les hommes. Au juste, en tant qu'épithète plutôt qu'à la Justice, en tant qu'hypostase, va la préférence du Prince de Ligne: « Il est souvent de la justice de ne pas faire justice ».
Le Prince de Ligne, réputé homme d'esprit, et que ses mauvais disciples imitent en rivalisant d'arrogance, nous semble d'abord un homme de cœur, ayant la vigueur de l'homme de cœur, c'est dire le courage de celui ne s'en conte pas. La certitude, la remontrance, le grief ne sont pas fort: « Malheur aux gens qui n'ont jamais tort, ils n'ont jamais raison ». Sa leçon est de ne point faire leçon. Il s'adresse au lecteur avec amitié et ne porte pas plus loin ses maximes, dans l'idée qu'il s'en fait, que des propos de table. Ce convive, qui n'est pas de pierre, ne veut pas imposer sa loi mais se rendre aimable, simplement, et sans ambages: « Une seule chose peut nous ennoblir, c'est élévation de l'âme. Mais mon Dieu ! Que cela devient rare ! On en avait plus quand on avait pas tant d'esprit ».
Encore que le ton donné à ses propos, à ses contes, soit porté par un résolu carpe diem, que sa sagesse soit enclose dans la célébration du moment présent et que ses regards soient orientés en avant, vers le bonheur attendu, vers l'un de ces « commencements amoureux » qu'il préfère à toutes les vanités mondaines, voire aux gloires de l'héroïsme, parfois lui pointe une nostalgie pour des temps plus nobles et d'une plus haute vigueur, mais cette nostalgie même lui est un encouragement à vivre pour en délivrer les sources empierrées.
S'il y eut jadis cette vigueur, eh bien, qu'elle soit ! Le Prince de Ligne, telle est son intelligence appliquée aux situations, n'avait nul besoin de connaître quelque philosophie existentialiste pour comprendre qu'il faut tout jeter dans le feu de l'acte d'être, dans « l'être-là », et avec ces quelques brins de folie qui font, selon la formule d'Héraclite, « le feu mêlé d'aromates ». L'ataraxie ne lui vaut guère. Plus danseur que stylite, et danseur dionysien, qui fait « danser la terre », selon la formule antique, d'une danse où l'on s'oublie pour faire corps avec quelque mouvement plus grand que nous, le Prince de Ligne préfèrera la danse des Cosaques ou « des jeunes femmes grecques et des beautés de Géorgie et de Circassie » à « la grâce stupide et importante d'un menuet, accompagné d'un sourire en donnant la main, avec un sot balancé ».
Plus on le fréquente et mieux l'on comprend que le Prince de Ligne, tout immoraliste qu'il se donne, célèbre les vertus, au sens étymologique, non la vertu des ligues et des censeurs, des jaloux et des aigris, mais les vertus immémoriales, de bonne venue, qui font les gens de bonne compagnie, les vertus qui sont générosité et vigueur: « Je ne vois plus d'envie de s'amuser: tous les esprits sont lents; plusieurs sont pesants; on croit aux impossibilités. On se laisse aller à une vie uniforme, à une monotonie insupportable; on n'a plus qu'une sourde ambition. »
La force qui ne se représente pas, la force sans la prétention au bon droit, est pour le Prince de Ligne la preuve, et la condition, de la bonté heureuse, faite pour le bonheur, et pour en donner, sans pour autant déroger à ces goûts dont on hérite et dont on inventera le jour qui vient; il nous offre ainsi de ces phrases souveraines, que l'on voudrait pouvoir faire siennes: « On n'a que des bonheurs d'enfant. Je ne connais pas de carrière plus heureuse que la mienne. Le remord, l'ambition, la jalousie n'en ont jamais troublé le cours ».
L'exemple de sagesse vaut mieux que la leçon de sagesse. L'intuition du Prince de Ligne précède la grande pensée morale de Nietzsche: le ressentiment est l'écueil affreux; sans la jalousie, il y aurait du paradis sur terre. Or, pour le Prince de Ligne, héritier des Moralistes du XVIIe siècle, que Nietzsche affectionnait particulièrement, cette jalousie tient à la boursouflure, à l'importance que l'on se donne et que l'on se joue: « C'est l'importance que je reproche le plus à tout le monde. Les dévots, par exemple, s'imaginent que Dieu même doit leur savoir gré de leurs soins. »
S'il est une mauvaise dévotion et de sinistres dévots, - et celle-ci ne dira la grandeur de Dieu que pour affirmer ce que ceux-là pensent être la leur, et leur droit à méconnaître la simple dignité des êtres et des choses, - il est cependant, pour le Prince de Ligne, une bonne dévotion, qu'il prend la peine de définir, « la dévotion de bonne foi d'une âme tendre et un peu exaltée, d'un cœur juste et pur ». Ce qu'il nous en dit, de la façon exquise qui lui est propre, vaut singulièrement pour notre temps: « Ce dévot, tel que je l'entends, avec toutes les aimables vertus de la société, ne dira, ni ne fera, ni ne désirera le mal. Il ne scandalisera pas, il ne condamnera personne et tirera d'affaire une jolie femme que les lois de bien des pays condamnent à la mort pour le plus joli petit péché du monde ».
Mesurons, en passant, l'effroyable régression de la morale depuis l'heureux Prince de Ligne. Prenons à cœur de recevoir ce qu'il nous donne sans prétendre à nous édifier, sans nous livrer à ces rituels spectaculaires où la défense du « Bien » devient une forme d'hystérie; et songeons enfin, avec une « bienveillance » enfin non galvaudée, mais résolue à les défendre, à ces « plus jolis petits péchés du monde » qui désormais, ne seront, parfois, que de laisser ses cheveux au vent et ses regards aux couleurs de la vie.
Cet homme particulièrement actif, qui fut guerrier, cosmopolite à sa façon, galant, connaisseur des hommes et des femmes pour en avoir fréquenté diverses sortes en divers lieux plus qu'à son tour, fut aussi, on le sait moins, un contemplatif et un rêveur, pour lequel l'imagination était, non pas « la folle du logis », mais l'une des facultés reines de l'esprit humain. Entre ses excursions d'homme pressé par le sentiment de la brièveté de la vie, entre ses voyages et ses conquêtes, le temps des heures creuses n'est nullement, pour le Prince de Ligne, du temps perdu ou gâché, mais un temps qui s'approfondit, un temps en conque marine où se rassemblent des rumeurs de réminiscence et de songe. Sa façon d'écrire, tout en musiques sous-jacentes, et de voir, tout en couleurs et nuances, tient à ce temps-là, qui n'est plus le temps de l'usure et de la mort.
Le Prince de Ligne, dont l'imagination n'est pas moins visuelle que musicale, nous entraîne en des tableaux vivants, comme le savent les véritables amateurs qui, plutôt que de gloser sur l'histoire de l'art, aiment à se promener dans les arrière-plans des peintures illustres et, dédaignant le motif principal, le sujet historique ou religieux représenté, préfèrent s'imaginer, promenant ou divagant, sous le soleil peint là-bas comme sous un vrai soleil, au milieu des cyprès, ou dans sa nuit, sous d'indiscernables feuillages, comme dans une nuit véritable. Au repos, un repos gagné par la vigueur dépensée, livré à sa songerie, le Prince de Ligne ne dédaigne pas, en homme de son temps, à imaginer quelque cité idéale, qui serait, non l'accomplissement d'une idéologie, toute idéologie étant la préméditation d'un massacre, mais un reflet de son âme, qui est une âme chromatique: « Je voudrais qu'on s'attachât plus aux couleurs qu'on ne le fait ». Dans cette cité, advenue, non par la vengeance des envieux mais par un rêve venu de loin, peut-être de quelque conque marine atlantidéenne, il y aurait, précise le Prince de Ligne un beau climat « Astrakan, par exemple, ou Poltava, quelque part où l'été ne fût pas trop chaud, avec très-peu d'un hiver assez léger ». On y verrait des « brunes vêtues de bleu » et des « blondes, de rose cendré ». « La mort viendrait, je crois, plus tard qu'ailleurs descendre sur cette jolie ville ».
Luc-Olivier d'Algange
L'Ame secrète de l'Europe, oeuvres, mythologies, cités emblématiques, L'Harmattan, 2020.
Terre Lucide entretiens sur les météores, avec Philippe Barthelet, L'Harmattan 2022.
Propos réfractaires, L'Harmattan 2023.
22:01 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
Luc-Olivier d'Algange, Nicolas Gomez Davila ou les droits de l'âme:
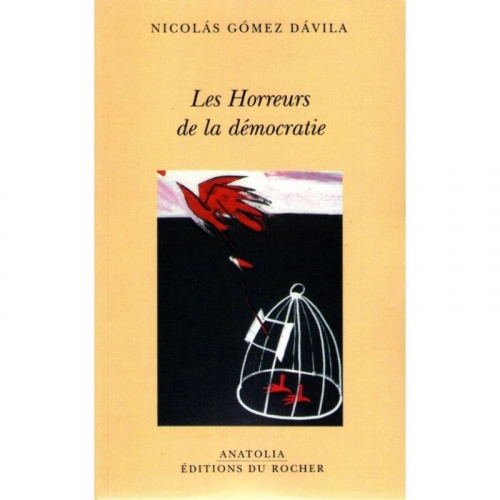
Nicolas Gomez Davila ou les droits de l'âme
« Les deux ailes de l’intelligence sont l’érudition et l’amour »
Nicolas Gomez Davila.
Nicolas Gomez Davila est de ces rares auteurs qui tiennent leur lecteur en assez haute estime pour ne lui offrir que le meilleur d’eux-mêmes. Le véritable titre de ces formes brèves, qui ne sont ni des aphorismes, ni des sentences, rassemblées sous le titre Les Horreurs de la Démocratie (choix d’éditeur non dépourvu de roborative provocation) est « Escolios a un texto implicito », Scolies pour un texte implicite. Ces « scolies » ont pour règle de ne laisser apercevoir de la pensée que la fine pointe et pour vertu, la générosité de supposer au lecteur l’intelligence et l’art de déployer, à partir de ces fines pointes, un texte qui est à la fois absent et présent, implicite, c’est à dire donné, sans être pour autant révélé.
Toute œuvre digne que l’on s’y attarde ressemble à la part émergée de l’Iceberg : ce qu’elle dit n’est que le signe de ce qu’elle ne dit point. L’implicite est, plus généralement, le propre de la haute littérature ; ce qui la distingue de l’information, des sciences humaines et du bavardage où ce qui n’est pas dit vaut encore moins que ce qui est dit. Lorsque l’écrit s’élève au rang de parole, lorsque les pages sont comme la réverbération du Logos-Roi, le moindre scintillement témoigne du gouffre lumineux du Ciel. Ce qui est dit est comme soulevé par la puissance de ce qui n’est pas dit, comme le roulement de la vague accordée au magnétisme des marées. Or, cette puissance-là, l’éminente générosité de Nicolas Gomez Davila est de l’accorder d’emblée à son lecteur, sans se soucier d’aucune autre qualification extérieure. Ce réputé « anti-démocrate » pose en a priori théorique à son œuvre, à sa « méthode » (au sens où Valéry parle de la « méthode » de Léonard de Vinci) la possibilité pour tout homme soucieux d’une vie intérieure de le comprendre. « Les hommes sont moins égaux qu’ils ne le disent mais plus qu’ils ne le croient ». La logique est ici exactement inverse à celle du « démocrate » fondamentaliste qui affirme théoriquement l’égalité de tous non sans s’accorder le magistère de la définition de l’égalité et, par voie de conséquence, une supériorité absolue qui ne saurait se traduire, en Politique, que par la généralisation des méthodes policières. « L’Etat moderne réalisera son essence lorsque la police comme Dieu, sera témoin de tous les actes de l’homme ».
Les Scolies de Gomez Davila sont une œuvre de combat. Ce qui est en jeu n’est rien moins que la dignité et la liberté humaines, mais à la différence de tant d’autres qui mâchonnent les mots de « dignité » et de « liberté », Gomez Davila ne pactise point avec les forces qui les galvaudent et les ruinent. Ne nous attardons pas sur les roquets-folliculaires qui furent lancés aux basques de ce livre magnifique : ils n’existent que pour en illustrer la pertinence : « Le démocrate ne considère pas que les gens qui le critiquent se trompent, mais qu’ils blasphèment ». Cette figure du Moderne, que Gomez Davila nomme le « démocrate » (non, précise-t-il en tant que partisan d’un système politique mais comme défenseur d’une « perversion métaphysique ») peut, en effet, être définie ici comme fondamentaliste dans la mesure où elle ne louange le « débat », la « discussion », le « polémos » que sous l’impérative condition que ceux avec qui il est permis de débattre, discuter et polémiquer fussent déjà, de longtemps et notoirement, du même avis qu’elle ; et qu’ils le soient, par surcroît, avec le même vocabulaire, les mêmes rhétoriques, et si possible, avec les mêmes intonations, le même style ou, plus probablement, la même absence de style. Le démocrate fondamentaliste ne « raisonne » ainsi que dans les limites de sa folie procustéenne ; son amour de l’humanité « en général » ne s’accomplit qu’au mépris du particulier ; la liberté d’expression ne lui vaut que strictement réservée à ceux qui n’ont rien à dire ; la « dignité » humaine ne mérite à ses yeux d’être défendue qu’en faveur de ceux qui s’en moquent et s’avilissent à plaisir.
« Aux yeux d’un démocrate, qui ne s’avilit pas est suspect. » Il n’est point d’écrivain un peu libre qui ne fasse chaque jour l’expérience de cette suspicion. Quand bien même se tiendrait-il à l’écart des idées qui fâchent, une simple tournure, un mot pris dans une acception un peu ancienne, une vague nostalgie, ou le refus de considérer le monde contemporain comme le parangon de toutes les vertus et la source de tous les bienfaits suffisent à le désigner comme suspect. La critique littéraire qui devrait se situer entre la métaphysique et l’hédonisme, entre la sagesse et le plaisir, le vrai et le beau, se réduit tristement à des rodomontades moralisatrices ou de fastidieuses rhétoriques de procureur ou d’avocat, comme si l’on ne pouvait plus lire un roman ou un essai sans en instruire le procès, comme si tout sentiment de gratitude s’était évanoui des cœurs humains pour ne plus laisser place qu’à des maniaqueries de Fouquier-Tinville sans envergure ni courage. « Les individus, dans la société moderne, sont chaque jour plus semblables les uns aux autres et chaque jour plus étrangers les uns aux autres. Des monades identiques qui s’affrontent dans un individualisme féroce. »
Le critique moderne est un homme qui, pour exercer son office, ne doit connaître ni remord, ni merci, mais s’enticher éperdument de la scie procédurière à quoi se réduit désormais toute forme d’Eris. Transposée dans la mesquinerie, l’agressivité moderne prend le visage patelin de la bien-pensance, c’est-à-dire de la « pensance » collective, grégaire, aussi revêche, obtuse et obscurantiste dans le « village planétaire » qu’elle le fut dans les « villages » imaginés par des bourgeois libéraux, peuplés, comme de bien entendu, d’une paysannerie torve et cruelle et d’affreux chouans ennemis de la liberté. Le Moderne lorsqu’il décrie son ennemi se décrit lui-même. Cet « archaïque », ce « superstitieux », cet « adversaire de la raison », c’est lui-même. Plus il se nomme « démocrate », et plus il méprise ce « peuple » auquel il n’accorde d’autre pouvoir que celui de l’état de fait, qu’il nomme « volonté générale », par pure tartufferie. « La volonté générale, c’est la fiction qui permet au démocrate de prétendre que pour s’incliner devant une majorité, il y a d’autres raisons que la pure et simple couardise. »
La composition pointilliste des Scolies, qui mêlent les aperçus éthiques, esthétiques et politiques, interdit que l’on traitât de chaque domaine comme d’une région séparée. Le bien, le beau et le vrai sont indissociables. L’esthète est toujours moraliste et politique. « Le monde moderne est un soulèvement contre Platon ». Il appartient donc au « réactionnaire » tel que le définit Gomez Davila (dont la vocation est d’être « l’asile de toutes les idées frappées d’ostracisme par l’ignominie moderne ») d’œuvrer à la recouvrance du platonisme, non en tant que système philosophique ( à supposer qu’il existât un « système » platonicien hors des aides-mémoires de quelques pédagogues trop pressés d’enseigner ce qu’ils ne savent pas pour lire des Dialogues) mais en tant qu’expérience métaphysique fondamentale de la lecture (lecture du monde non moins que lecture des livres). « Derrière chaque vocable se lève le même vocable avec une majuscule : derrière l’amour, l’Amour, derrière la rencontre la Rencontre. L’univers s’évade de sa prison lorsque dans l’instance individuelle, nous percevons l’essence. »
Le Politique, pour Gomez Davila, n’est pas la fin de la pensée, ni même son commencement. Elle se tient dans une zone médiane, plus où moins fréquentable selon les époques, entre le métaphysique et le perceptible, entre la théorie et le goût. « Tout est banal si l’homme n’est pas engagé dans une aventure métaphysique. » Cette banalité toutefois n’est point banale, au sens où elle serait négligeable : elle est horrible. Elle nous livre à la servitude et à la laideur, pire à une servitude et une laideur toujours identiques à elles-mêmes, comme dans une catastrophe ou un cauchemar, sous couvert de « changement » et de « nouveauté ». « Le monde moderne est arrivé à institutionnaliser avec une telle astuce le changement, la révolution, l’anticonformisme que toute entreprise de libération est une routine inscrite dans le règlement de la prison. ». Ce « changement », c’est-à-dire cette haine de la Tradition, qui est le propre du Moderne, ce culte de l’amnésie, cet oubli de l’oubli est tel qu’il en oublie sa propre identité avec lui-même. L’oubli de l’oubli est ce pur néant immobile qui se rêve comme un changement perpétuel, autrement dit comme un présent sans présence. Ainsi, « les démocrates décrivent un passé qui n’a jamais existé et prédisent un avenir qui ne se réalise jamais. »
La politique se détruisant elle-même dans la lâcheté, le Logos se profanant en propagande et publicité, l’alchimie à rebours transformant l’or du pur amour en plomb de « convivialité » obligatoire, nous tombons sous le joug de cette caste qui prétend n’en point être une et dont l’amour de l’humanité en général est le prétexte pour n’avoir personne à aimer en particulier, dont la « tolérance » abstraite est la ruse pour n’avoir jamais à pardonner une offense, et « l’ouverture aux autres » la condition première à se dispenser de toute magnanimité. L’idéologie « citoyenne » fait office d’indulgences, sans que les pauvres n’en profitent le moins du monde.
Si pour Gomez Davila la politique est impossible, c’est une raison supplémentaire pour s’y intéresser, mais seul. « La lutte contre le monde moderne doit être conduite dans la solitude. Lorsqu’on est deux, il y a déjà trahison ». On songe ici à la phrase de Montherlant : « Dès que les hommes se rassemblent, ils travaillent pour quelque erreur. » Il n’en demeure pas moins qu’il y eut des temps où l’ordre politique semblait destiné à nous éviter le pire, autant que possible. Le pire, c’est à-dire, le nihilisme, le totalitarisme, la terreur. « La démocratie a la terreur pour moyen et le totalitarisme pour fin ». Toutefois, le « totalitarisme » et la « terreur » ne disent point l’entièreté du pire. Le démocrate ne cesse d’en parler, de s’en prétendre le rempart lorsqu’il s’en trouve être la condition, la prémisse. Le pire est ce que l’homme devient, ce que tous les hommes deviennent, lorsque la contemplation disparaît du monde, lorsque le commerce entre les hommes ne s’ordonne plus qu’à l’économie.
« L’absence de vie contemplative fait de la vie active d’une société un grouillement de rats pestilentiels ». Ce par quoi le langage témoigne de la contemplation, et de cette joie profonde, ambrée et lumineuse du Logos-Roi, c’est peu dire que le Moderne ne veut plus en entendre parler. Son monde, il le veut sans faille, compact et massif, c’est-à-dire réduit à lui-même, à sa pure immanence, autrement dit à l’opinion que les plus sots et les plus irréfléchis se font de lui. « Le moderne se refuse à entendre le réactionnaire, non que ses objections lui paraissent irrecevables, mais parce qu’elles ne lui sont pas intelligibles ».
A mesure que s’étend cet espace de l’inintelligible, s’étend le malheur. La sagesse et la joie, la ferveur et la subtilité, les nuances et les gradations, reléguées aux marges de plus en plus lointaines, ou dans un secret de plus en plus profond, ne font plus signe qu’aux rares heureux dévoués à une règle d’art ou de religion. « Celui qui se respecte ne peut vivre aujourd’hui que dans les interstices de la société ». Mieux qu’une pensée « réactionnaire » au sens restreint du terme ( dont on doit cependant oser, de temps à autre, se faire un étendard, mais le bon), les Scolies de Gomez Davila rétablissent les droits immémoriaux d’une grande pensée libertaire et aristocratique, alliant, dans l’exigence de son style « la dureté de la pierre et le frémissement de la feuille ». Que dit cette dureté, qui n’est point dureté du cœur ? Elle nous dit que pour être, il nous faut résister à l’informe, aimer l’éclat, la justesse lapidaire, et peut-être encore la pierre qui triomphe de ce Goliath qu’est le monde moderne.
Gomez Davila, cependant, n’envisage point une victoire temporelle. « Le réactionnaire n’argumente pas contre le monde moderne dans l’espoir de le vaincre, mais pour que les droits de l’âme ne se prescrivent jamais. ». Comme le texte, la victoire est implicite, secrète. Car si les droits de l’âme demeurent imprescriptibles, le Moderne est bel et bien vaincu et ses triomphes ne sont que nuées. A l’imprescriptibilité des droits de l’âme, le Moderne voulut opposer les « droits de l’homme », autre marché de dupe, car le droit de quelque chose de général et d’abstrait fait piètre figure face à la force, - ce que savait déjà Démosthène. Or, le droit de l’âme est, en chaque instant, ce qui s’éprouve. A commencer dans le ressouvenir plus vaste que nous-mêmes : « L’âme cultivée, c’est celle où le vacarme des vivants n’étouffe pas la musique des morts. ». Au contraire des « droits de l’homme », les droits de l’âme, de cette âme qui emporte et allège, n’apportent aucune solution. « Les problèmes métaphysiques ne tourmentent pas l’homme afin qu’il les résolve, mais qu’il les vive. »
Sans doute y a t-il dans cette manie moderne à vouloir trouver des « solutions », à laisser les « problèmes » derrière soi, dans des époques révolues, à se croire plus avisé de ne s’intéresser à rien, une immense lassitude à vivre. Ce Moderne qui ne cesse de louanger la « vie » et le « corps » les réduit à bien peu de chose. Que lui est-elle cette « vie » s’il ne la voit comme le miroitement d’une gradation vers l’éternité, qu’est-ce que ce « corps » dont il a une si forte conscience, sinon un corps malade, et malade d’avoir oublié que ce n’est point l’âme qui est dans le corps mais bien le corps qui est dans l’âme ? Sous prétexte que certains crurent médiocrement en Dieu, nommant « Dieu » leur propre médiocrité, le Moderne ne veut plus croire qu’en « l’homme », mais « si le seul but de l’homme est l’homme, de ce principe dérive une vaine réciprocité, comme le double reflètement de deux miroirs vides ». C’est bien en vain que les Modernes et les anti-modernes, cherchent en amont, dans l’histoire de la philosophie, de dignes précurseurs au monde moderne. Laissons Spinoza, Hegel, et même Voltaire où ils sont. Le véritable précurseur du monde moderne est, bien sûr, Monsieur de La Palice. Le Moderne n’est point panthéiste, dialecticien ou ironiste, il est « lapaliciste ». Sa philosophie est des plus claires : l’homme n’est que l’homme, la vie n’est que la vie, le corps n’est que le corps. Voilà bien cette pensée moderne dans toute sa splendeur qui exige de nous que nous brûlions, comme obsolètes et néfastes, toutes les philosophies, toutes les religions, tous les arts qui durant quelques millénaires, de par le monde, firent à l’humanité l’affront abominable de lui enseigner la complexité, les nuances, les relations, les rapports et les proportions, toutes choses vaines, en effet, pour qui ne veut que détruire.
Ces « Scolies à un texte implicite » se donnent à lire ainsi, non seulement comme une suite d’aperçus lucides en forme d’exercices de désabusement, dans la lignée des meilleurs d’entre nos Moralistes, tels que Vauvenargues ou Rivarol, mais aussi, comme un Art de la guerre, un traité de combat contre les « lapalicistes ». « Est démocrate, celui qui attend du monde extérieur la définition de ses objectifs ». Contre la passivité des tautologies et contre le règne de la quantité qu’elle instaure, c’est à la seule vie intérieure, à la seule âme imprescriptible du lecteur qu’il appartient, dans cette solitude essentielle qui est la véritable communion, de nuancer d’un imprévisible ensoleillement, autrement dit, d’une espérance implicite mais prête à bondir dans le monde, ces scolies qu’un inattentif regard ordonnerait au seul pessimisme. D’autant plus inquiétantes, roboratives et salubres, ces scolies, que ce qu’elles ne disent pas chemine en nous à l’insu des censeurs. « Seuls conspirent efficacement contre le monde actuel ceux qui propagent en secret l’admiration de la beauté. »
Ce qu’il en sera de cette beauté et de cette admiration, nous le savons déjà. « Il n’est jamais trop tard pour rien de vraiment important. » Gomez Davila opère ainsi à une sorte de renversement du pessimisme, celui-ci n’étant plus seulement la fine pointe de la lucidité, mais celle d’une audace reconquise sur le ressassement sans fin de la vanité de toute chose. Certes, nous sommes bien tard dans la nuit du monde, dans la trappe moderne ( « tombés dans l’histoire moderne comme dans une trappe »), mais s’il n’est jamais trop tard pour rien de vraiment important, n’est-ce point à dire que toute l’espérance du monde peut se concentrer en un point ? « Un geste, un seul geste suffit parfois à justifier l’existence du monde ». Cette pensée guerroyante et savante, polémique et érudite, est avant tout une pensée amoureuse. Le combat contre l’uniformité, l’étude savante qui distingue et honore la diversité prodigieuse sont autant de sauvegardes de l’amour. « L’amour est l’organe avec lequel nous percevons l’irremplaçable individualité des êtres ». Or cette « irremplaçable individualité » n’est autre que la beauté. « La beauté de l’objet est sa véritable substance ». Celle-ci n’appartient pas à la durée, de même que la tradition n’appartient pas à la perpétuité, mais à l’instant. « L’éternité de la vérité, comme l’éternité de l’œuvre d’art sont toutes deux filles de l’instant ». L’instant ne s’offre qu’à celui qui le saisit au vol, chasseur subtil, qui discerne dans le monde des rumeurs qui se font musique, en-deçà ou par-delà le vacarme obligatoire (le monde moderne étant bruyant comme le sont les prisons). « Les choses ne sont pas muettes, seulement elles sélectionnent leurs auditeurs. » L’utopie du « tout pour tous » renversée en réalité du « rien pour personne » en vient alors à médire des choses elles-mêmes, muettes ou parlantes. La véritable bonté n’est jamais générale de même que « Dieu n’est pas le monde comme un rocher dans un paysage tangible mais comme la nostalgie dans le paysage d’un tableau. ». La véritable bonté advient dans l’imprévisible : « Pour éveiller un sourire sur un visage douloureux, je me sens capable de toutes les bassesses ».
De même que les scolies sont les cimes du discours, leur « par-delà » salvateur, la véritable magnanimité est l’au-delà de la morale générale, le surgissement de la connaissance de l’Un dans l’instant lui-même, la fulgurance pure où la liberté absolue rejoint la soumission au Règne de Dieu. « Celui qui parle des régions extrêmes de l’âme doit vite avoir recours à un vocabulaire théologique ». Théologique, la pensée de Gomez Davila n’en garde pas moins ses distances avec ce que Gustave Thibon nommait le « narcissisme religieux », cette inclination fatale à voir l’Eglise d’abord comme une communauté humaine, avec ses administrations, sa sociologie, et son opportunisme. « L’obéissance du catholique s’est muée en une docilité infinie à tous les vents du monde ». Peu importe au demeurant : « Un seul concile n’est rien de plus qu’une seule voix dans le véritable concile oecuménique de l’Eglise, lequel est son histoire totale ». Or, pour Gomez Davila cette histoire totale inclut les dieux antérieurs. L’Iliade et Pythagore lui sont plus proches que cette Eglise « qui serre dans ses bras la démocratie non parce qu’elle lui pardonne mais pour que la démocratie lui pardonne ».
Le sacré doit « jaillir comme une source dans la forêt et non pas comme une fontaine publique sur une place ». Face au monde moderne « cette effrayante accoutumance au mal et à laideur », le discord entre paganisme et christianisme apparaît secondaire et artificieux. « Le christianisme est une insolence que nous ne devons pas déguiser en amabilité ». Cette insolence, il ne sera pas interdit de la retourner contre les « représentants » du christianisme lui-même : « N’ayant pas obtenu que les hommes pratiquent ce qu’elle enseigne, l’Eglise actuelle a décidé d’enseigner ce qu’ils pratiquent. » Le monde grec apparaît alors comme « l’autre ancien Testament » auquel il n’est pas malvenu de recourir car « entre le monde divin et le monde profane, il y a le monde sacré ». Tout, alors, est bien une question de timbre et d’intonation. La justesse du scintillement d’écume est dans le mouvement antérieur de la vague. « La culture de l’écrivain ne doit pas se répandre dans sa prose mais ennoblir le timbre de sa phrase ». Ainsi faut-il également entendre le monde, comme l’œuvre d’un écrivain « qui nous invite à comprendre son langage, et non à le traduire dans le langage de nos équivalences ». Cette leçon d’humilité et d’orgueil, humilité face au monde et orgueil apparent face à l’arrogance moderne, nous invite à la seule aventure essentielle qui est d’être au monde, comme l’écriture même du monde, nous mêmes scolies du texte implicite du monde qu’il nous appartient de déchiffrer.
Le monde, disent les Théologiens médiévaux, est « la grammaire de Dieu ». C’est ainsi que nous perdons ou gagnons en même temps Dieu et le monde, de même que nous perdons en même temps (ou gagnons) la compréhension d’Homère et des Evangiles. « Lorsque le bon goût et l’intelligence vont de pair, la prose ne semble pas écrite par l’auteur, mais par elle-même. » Que nous dit le texte implicite sinon notre propre secret qui est le secret du monde ? Tout se joue alors dans la voix, la voix unique, irremplaçable, celle de l’amour divin ( « Nous ne sommes irremplaçables que pour Dieu ») ; la plus irrécusable preuve de l’Un étant que toute chose, tant que demeurent les droits imprescriptibles de l’âme, est unique. Point de feuille dont les nervures fussent exactement semblables à sa voisine. Le grand mythe moderne, au sens de mensonge, tient dans cette lâcheté, cette paresse face à l’interprétation qui sans fin hiérarchise les êtres et les choses du plus épais jusqu’au plus subtil. Le Moderne veut croire à tout prix que le monde est inintelligible pour pouvoir le saccager à sa guise. Le bonheur et le malheur est qu’il en est rien. Tout est écrit, et nous ne faisons qu’ajouter la ponctuation. « Mes phrases concises sont les touches d’une composition pointilliste ». L’implicite ne serait alors que le non-encore ponctué. « Si l’univers est d’une lecture malaisée, ce n’est pas qu’il soit un texte hermétique, mais parce que c’est un texte sans ponctuation. Sans l’intonation adéquate, montante ou descendante, sa syntaxe ontologique est inintelligible. »
Il n’est point de question de sens qui ne soit une question de style, d’intonation. Or, les questions de sens sont sans solution, alors que les questions de style se prouvent à chaque instant. « Cohérence et évidence s’excluent ». Toute justesse ne saurait apparaître que sous les atours du paradoxe ou du scandale. Lorsque la pensée est justement ponctuée, elle heurte de front cette inclination unanimiste du démocrate pour qui seuls l’informe et l’indistinct sont aimables. « Maint philosophe croit penser parce qu’il ne sait pas écrire ». La quête de la juste ponctuation, de l’intonation adéquate dépasse non seulement l’opinion commune, et même l’opinion minoritaire, elle dépasse du même élan les idées, les théories, les systèmes. « Le malheur de celui qui n’est pas intelligent, c’est qu’il n’y a pas d’idées intelligentes. Des idées qu’il suffirait d’adopter pour se mettre à la hauteur de l’homme intelligent ».Le dessein de Gomez Davila n’est pas de faire partager ses idées, de les mettre en circulation, comme une monnaie frappée à son effigie, mais de rendre possible une méditation sur la « cohérence » qui échappe à l’évidence, sur « l’implicite » que ses scolies désignent et dissimulent. « Si l’on veut que l’idée la plus subtile devienne stupide, il n’est pas nécessaire qu’un imbécile l’expose, il suffit qu’il l’écoute. » Le silence autour du livre de Gomez Davila serait donc d’excellent aloi s’il ne préjugeait toutefois à l’excès de l’écoute des imbéciles et de la surdité des intelligents.
« Je ne suis pas un intellectuel moderne contestataire mais un paysan médiéval indigné ». Si le mot rebelle voulait encore dire quelque chose, l’exégète des scolies pourrait en faire usage ; tel n’est pas le cas. Demeure à travers ce qui est dit la possibilité offerte de n’être pas soumis au temps, d’imaginer ou de se souvenir d’une cohérence du monde, mystérieuse et sensible à « l’intonation montante ou descendante ». L’implicite des scolies est une mise-en-demeure à la recouvrance de l’histoire sacrée, c’est-à-dire d’une histoire qui ne se réduit pas à « l’incertitude de l’anecdote » ni à la « futilité des chiffres ». En ce sens, « les ennemis du mythe ne sont pas les amis de la réalité mais de la banalité », le mythe n’étant pas alors le mensonge, mais bien la réverbération du vrai, la beauté suspendue entre l’immanence ingénue de notre race et la transcendance universelle. Tout écrivain digne de ce nom récite une mythologie d’autant plus réelle, au sens platonicien, c’est-à-dire d’autant plus vraie, qu’elle lui est plus personnelle, se proposant à lui presque par inadvertance, comme une fatalité heureuse. « Les penseurs contemporains sont aussi différents les uns des autres que les hôtels internationaux dont la structure uniforme se pare superficiellement de motifs indigènes. Alors qu’en vérité seul est intéressant le particularisme qui s’exprime dans un langage cosmopolite. »
La meilleure façon de favoriser la haine fanatique des hommes entre eux est de favoriser leur ressemblance, de les confronter en autrui à l’image détestée d’eux-mêmes. L’universalisme, ce péché qui, selon le mot de Gustave Thibon, consiste « à vouloir faire l’Un trop vite » devient alors, faute d’adversaire loyal, le principe d’une catastrophe immense, de même que « la libération totale est le processus qui construit la prison parfaite ». Entre le principe universel du christianisme et l’héritage culturel, où bruissent encore les feuillages orphiques, les armes de l’Iliade et les écumes de l’Odyssée, les pensives sagesses pythagoriciennes ou la souveraineté intérieure de Marc-Aurèle, la liberté de Gomez Davila sera de ne pas choisir. « La structure des relations entre christianisme et culture doit être paradoxale. Tension dynamique des contraires. Non pas fusion où ils se dissolvent mutuellement ni capitulation d’aucun des deux. » On aura compris que ce « réactionnaire », dont les « saints patrons » sont Montaigne et Burckhardt, cet adversaire déclaré de la démocratie, en tant que « perversion métaphysique » est, par cela même, le contraire d’un fanatique. « Ne flattent le Peuple que ceux qui mijotent de lui vendre ou de lui voler quelque chose. » Face à la démagogie (« Démagogie est le mot qu’emploie les démocrates quand la démocratie leur fait peur »), il n’y a guère que l’aristocratie, celle-ci toutefois, étant définie, non en termes sociologiques, mais rigoureusement métaphysiques comme une possibilité universelle : « Le véritable aristocrate est celui qui a une vie intérieure. Quels que soient son origine, son rang ou sa fortune. L’aristocrate par excellence n’est pas le seigneur féodal dans son château, c’est le moine contemplatif dans se cellule. » Et ceci encore : « Au milieu de l’oppressante et ténébreuse bâtisse du monde, le cloître est le seul espace ouvert à l’air et au soleil ». Ces scolies apparaîtrons ainsi, à qui voudra bien en répondre, comme les signes de la présence de ces cloîtres détruits, de ces temples saccagés, mais dont les cryptes demeurent, textes implicites, de nos vie intérieures imprescriptibles.
Luc-Olivier d’Algange
Nicolas Gomez Davila, Les Horreurs de la démocratie, éditions du Rocher.
21:36 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
31/03/2024
Luc-Olivier d'Algange, la conversation d'André Suarès:

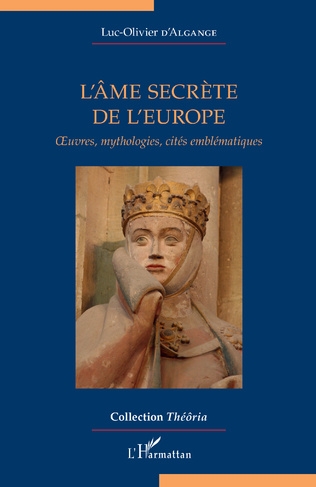
14:45 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
18/02/2024
Luc-Olivier d'Algange, le "Nocturne" de Gabriele D'Annunzio, version française suivie de la version italienne
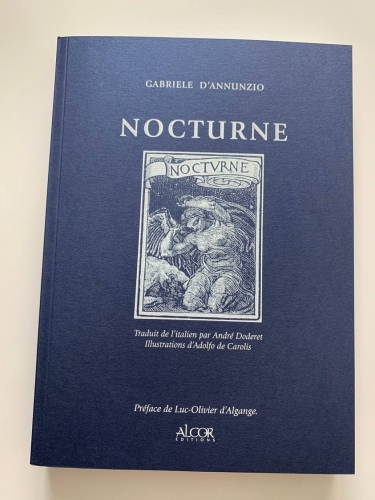
Luc-Olivier d'Algange
D'Annunzio entre les contrées de l'Aigle et le territoire du Serpent
Il était inévitable que le poète qui tant laissa transparaître dans ses œuvres la vision d'un paradis terrestre, - l'absolu non dans l'indéfini, mais dans une finitude resplendissante, incarnée, dans une âme qui fait frémir le corps et porte l'esprit à l'aventure et à la gloire, - sortît enfin du purgatoire où des esprits mesquins prétendirent l'enfermer à jamais.
D'Annunzio fut magnifiquement tout ce que notre temps nous prescrit de n'être plus. Il n'est pas une de ses vertus, ou de ses vices, qui ne fussent mises au ban, - et surtout ses vertus, qu'il faut prendre ici au sens originel, comme on parlait jadis de la virtu du condottière. Sa gloire en son temps fut immense, mais peu lui demeurèrent fidèles, excepté Montherlant, et cet autre condottière, auteur du plus beau voyage en Italie qui soit, André Suarès qui, mieux que quiconque, pouvait le comprendre, jusque dans son équipée de Fiume. On a beaucoup glosé sur le “Comandante” et le “Comediante”, sur ses audaces et sur ses éclats, sur son italianité qui ne l'éloigne pas tant de notre francité, telle qu'elle fut incarnée par Cyrano de Bergerac, qui fut non seulement le personnage coruscant de la pièce d'Edmond Rostand, mais aussi, on l'oublie parfois, l'auteur génial du Voyage aux pays de la Lune et du Soleil, qui hausse la prose française à l'un de ses plus ardents zéniths.
Sous ces belles augures, - où figurent aussi, d'entre les contemporaines, la magistrale biographie de Mauricio Serra et la fidélité active, au coeur du Vittoriale degli Italiani, l'ultime demeure de d'Annunzio, de Giordano Bruno Guerri, auteur de plusieurs livres consacrés au Vate - D'Annunzio revient et le moment est venu de se souvenir du poète qu'il fut avant tout. Les rabat-joie, les Lugubres et les puritains ont ricanés, amers, mais leur nature est de ne rien comprendre à rien, et de se tenir, bien serrés, sur la ligne défensive de leur médiocrité ; les idéologues nous ont mis en garde contre l'esprit libre, mais c'est leur fonction que de trier administrativement les bons et les mauvais sujets. Ces dénigrements cependant suintent l'envie, qui est de tous les péchés le plus stupide car aucune joie, même fugace ou coupable, ne l'accompagne. Les gloires, le luxe, avec cependant les soucis de l'endetté perpétuel, mais dans la désinvolture et le panache, la plus grande gloire littéraire de son temps, un foisonnement de présences féminines, tout cela jeté dans la balance du risque et de l'audace, - D'Annunzio reprenant à son compte la fameuse phrase Pompée citée par Plutarque, Naviguer est nécessaire mais il n'est pas nécessaire de vivre, - il y avait là sans doute de quoi tordre les entrailles de ceux qui ont, avant l'heure, étranglés leurs songes !
Qu'une telle vie eût été possible, et aimée, devrait cependant nous donner à nous interroger sur les pouvoirs de la poésie même, - pouvoirs magiques qui remontent haut dans le temps, jusqu'aux Mystères de Delphes et d'Epidaure, jusqu'à Empédocle et jusqu'aux premiers songes orphiques, et plus haut encore, dans la communion immémoriale des hommes avec la terre des Abruzze, avec le ciel, avec la mer.
Pour D'Annunzio, la poésie n'est pas une représentation mais une présence réelle, qui prolonge la nature et le monde, qui en émane et témoigne de son secret, de ce feu central de l’être, lequel, sans l'intercession du poète, demeurerait méconnu, - “un pays sans légendes condamné à mourir de froid " selon les mots de Patrice de la Tour du Pin. Il a été beaucoup reproché à D'Annunzio de n'avoir été que le poète des sensations, et, de préférence, des sensations fortes, mais c'est méconnaître que la sensation, lorsqu'un poème s'en saisit et la chante n'est pas seulement la sensation, de même que la vie n'est pas seulement la vie, mais un signe, une annonciation, - celle de son propre nom : " la vie était belle par ce que je vivais et parce qu'elle m'avait créé semblable à l'image voilée de l'Ange de mon nom". Pour D'Annunzio, la vie est signe et intersigne, analogie créatrice ; la rumeur qu'elle laisse en nous est semblable à celle dont elle naquit, ses objets les plus précis, les plus familiers viennent de la nuit des temps, telle la cigale talismanique aimée des Félibres, qui, à tant d'égards, furent proches de D'Annunzio, la cigale "noire mais couverte d'un duvet cendré qui luisait comme un vêtement de soie".
Le refus de l'existence plate, soumise, utilitaire n'est pas seulement pour D'Annunzio une pose, ni même une éthique, - ce qui serait déjà honorable, mais, plus profondément, une métaphysique expérimentale. Celui qui envisage de sacrifier sa vie dans un combat juge une idée plus haute que la vie, non comme une abstraction, mais comme sa fine pointe. Pour D'Annunzio, la vie n'est pas seulement la vie, la raison n'est pas seulement la raison, la patrie n'est pas seulement la patrie mais ils sont les empreintes d'une vérité plus haute, - divine, - qu'il appartient au poète d'éprouver et de louer. Cet idéalisme n'a rien d'anémique ou de falot, il est puissance en acte, non dépourvu de ce pragmatisme supérieur qui caractérise le héros homérique, - et puis, toute vie n'est-elle pas un sacrifice, ce "feu mêlé d'aromates" dont parlait Héraclite ? Mieux valent les flammes hautes, crépitantes de parfums que le feu crapoteux et puant de la sécurité et du confort. Le don reçu à la naissance est immense, indiciblement immense. Le dessein de D'Annunzio fut, durant toute sa vie fervente et inquiète, de n'en pas démériter.
L'équipée de Fiume qui succéda au Nocturne n'est pas sans faire songer au voyage des Argonautes. Avant cette aventure, qui évoque la conquête de la Toison d'Or, le Nocturne, dans son paradoxe temporel, est préfiguration. Pour reconquérir, et hausser la beauté conquise par-delà la beauté perdue, il faut avoir été laissé, abandonné sur des rivages de nuit ; il faut avoir été presque vaincu, trahi ; il faut qu'une légitimité ait été bafouée et niée. Dans certaines circonstances, qui appartiennent alors au Mythe, le destin individuel rejoint le destin collectif. Le ressouvenir devient alors pressentiment. L'honneur rendu aux héros passés dans le Nocturne annonce, par "l'Ange du nom" ceux qui se dresseront contre la "victoire mutilée".
Toute vie pleinement vécue est mythologique. Pour D'Annunzio, les mythes ne sont pas les témoins d'une civilisation antique disparue mais les clefs de déchiffrement de son propre destin, exactement comme ils le furent pour un Grec contemporain d'Homère ou d'Empédocle. Loin, très loin, de n'être que les ornements métaphoriques d'un homme de Lettres, ils sont la substance vive de ses actes et de ses pensées. Il est une façon mythologique de voir le monde, de s'y inscrire et une façon ratiocinant, bourgeoise, au sens flaubertien de "celui qui pense bas". D'Annunzio qui est à la fois paysan des Abruzze et esthète à la manière d'un Des Esseintes, ne laissera pas la pensée calculante et planifiante ordonner sa vie ; il rejoindra les dieux, leurs légendes et leurs mystères. On pourrait y voir simplement le panache d'un artifice majeur, d'un défi à l'époque, si par exemple l'œuvre de Jung ne nous avait appris que les mythes sont notre trame secrète, le filigrane de la plage blanche sur laquelle nous écrivons nos jours et nos nuits, les racines de notre conscience que les abstractions du monde moderne voudraient trancher.
Tout ce qu'il y eut d'aventureux dans l'existence de D'Annunzio apparaît ainsi comme une suite d'actes rituels destinés à délivrer la part mythologique, orphique, et à lui donner ce resplendissement, cette vérité dont la beauté miroite, comme au matin, le soleil sur la surface des eaux. Le grand péril n'est pas celui que l'on croit, mais, comme disait Ernst Jünger celui de "laisser la vie nous devenir quotidienne", - non que les choses les plus simples ne suffisent à notre joie, mais précisément parce que dans l'abstraction moderne, elles risquent de devenir hors d'atteinte. C'est ainsi que D'Annunzio ne se lassera pas de chanter les feuillages, la pluie, les animaux, les saveurs, les saisons, les labeurs et les combats de ses semblables, " le miel que la bouche arrache à la cire tenace", la diversité heureuse des apparences, et bien sûr, les femmes étreintes ou seulement désirées. Son inquiétude naît d'un constat auquel il ne se résignera jamais : les hommes, et surtout ceux de son temps, passent à côté de la vie magnifique. Tout est offert et rien n'est pris. Par quelque noir ensorcellement, - qui pose à la rationalité, - le don magnifique du dieu est sans cesse refusé dans les circonstances les plus infimes comme les plus grandioses.
Son immense poème Laus Vitae, - d'une hauteur, d'une vigueur et d'une inspiration comparables, aux XXème siècle, aux Cinq grandes odes de Claudel ou aux Amers de Saint-John Perse,- est ce contre-sort, cette opération théurgique dont la vocation est, par l'éloge, de délivrer la vie de la triste incarcération où elle se trouve, de la hausser à la hauteur idéale du chant et de faire ainsi de son lecteur le contemporain de Virgile, De Dante et du "plus grand avenir", celui "des aurores védiques" selon la citation que Nietzsche porta en exergue à son Gai Savoir. Ce contre-sort n'est pas sans évoquer le “contre-monde” de Stephan George qui, au demeurant, traduisit D’Annunzio et le publia dans son anthologie des poètes emblématiques de son temps. Ce contre-sort et ce contre-monde par ces temps d'uniformisation globale sont plus nécessaires encore qu'ils ne le furent aux temps de Stefan George et de D'Annunzio. Ce que ces poètes altiers craignirent nous advient avec une force d'arasement sans pareille. D'où l'importance de prendre leur conseil et de passer outre aux jugements partiaux de ceux qui les jugent obsolètes ou dangereux. Dangereux, certes, ils le sont, mais pour les garde-chiourmes, les hommes sans visages, les Lugubres. Dangereux, certes, pour les discours qui nous enjoignent à la servitude volontaire, pour l'humanité satisfaite d'être QRcodée ou réduite au rôle de rats de laboratoire, avec pour toute ambition, dans un labyrinthe absurde, de trouver la manette qui active la distribution de nourriture, le fameux “pouvoir d'achat”.
Dans la nuit, D'Annunzio se souvient de l'axe, de l'arcane de tous les soleils. Cette nuit n'est pas une pure et simple absence de lumière. Elle est peuplée de phosphènes, de réminiscences et d'annonciations. Cette plongée dans le globe oculaire, dans un réseau des nerfs, dans un cerveau, un corps, est d'une précision extraordinaire : elle réalise exactement ce que toute écrivain devrait faire : écrire à partir de l'être-là physique et métaphysique. Ce fut la règle d'or des plus grands, Proust, Faulkner, Conrad, Artaud, Jünger, et bien sûr, en amont, Nietzsche que D'Annunzio considéra à juste titre non comme un guide (“ Il me répugne de suivre autant que de guider” est-il dit dans le Zarathoustra) mais comme un frère blessé. On peut considérer, après tant d'études savantes qui, depuis, furent consacrée au Solitaire d'Engadine que D'Annunzio fut un nietzschéen approximatif ; il n'en demeure pas moins que sa vie fut sans doute de celles que Nietzsche eût aimées, méditerranéenne, solaire, guerrière, mue par une volonté de puissance qu'il ne confondit jamais avec les atermoiements et les servitudes du pouvoir.
Lorsqu'il fut le maître de Fiume, ce fut en Vate bien plus qu'en dictateur, sinon pour relever, chez chacun l'exercice de la liberté. La Constitution de Fiume, au demeurant, rédigée par Alceste de Ambris fut proche de l'idéal libertaire, et, en Europe, à l'avant-garde de toutes les libertés conquises sur le puritanisme et l'esprit bourgeois. Dans la vie, et la vie politique en particulier, il faut choisir ce que l'on sert, l'individualisme absolu étant un leurre, ou du moins un horizon hors d'atteinte, sinon dans une œuvre de jeunesse de Julius Evola. Les plus grandes querelles idéologiques se jouent autour de la notion d'individu, les uns tenant pour un individualisme abstrait, interchangeable, et les autres pour diverses formes de collectivisme. Or le génie de D'Annunzio échappe d'emblée à cette alternative qui ressemble fort à un traquenard. Fiume fut, mais dans la logique de l'œuvre tout entière, - une tentative de desserrer la tenaille, d'ouvrir à une possibilité d'être qui ne soit pas exclusivement soumise à l'intérêt des notables ou d'un Etat hypertrophié sous le seul règne de l'Economie et de la technique. Cette possibilité d'être définit une notion de l'individu étrangère au règne de la quantité qui nous soumet à la statistique. L'individu pour D'Annunzio est incarné ; il est, dans un esprit, une âme et un corps, une chose irremplaçable, indivise, forgée ou sculptée par ces influences que sont sa langue, son paysage de prédilection, ses amours, son imagination en mouvement, sa fidélité aux heures profondes et heureuses, son oraison la plus secrète. Chaque individu diffère de l'autre précisément par l'organisation variable de ses influences, par lesquelles cependant il est relié aux autres, relié mais non agrégé.
Le génie de D'Annunzio fut ainsi d'inventer un élan commun à partir du refus du grégarisme. Les grandes libertés que la Constitution de Fiume accorde aux individus sont destinées non à un hédonisme de masse mais à libérer des puissances, - celles -là même qui gisent, en ressouvenirs, en pressentiments, en mythologies vivantes aux tréfonds du Nocturne. Fiume, certes, fut écrasée par la force mécanique des gens “sérieux”, mais son exemplarité demeure. Les hommes ont d'autres destins possibles que d'être des insectes, des rouages d'une mécanique sociale. Tout ce qui vibre et chante, la singularité irréductible de chacun où s'accorde la multiplicité de ses influences, demeure face à nous-même et face au néant, à la fois tragique et joyeuse. Tragique précisément car irremplaçable et joyeuse car sa flamme irremplaçable éclaire nos dissemblables et nos amis, et notre ferveur commune. Contre la société anonyme, D'Annunzio nous donne celle du “nom qui annonce” ? Contre la pensée calculante, celle du Don, - “J'ai ce que j'ai donné”. Contre la servitude volontaire, un horizon homérique et virgilien : la poésie première servie.
On se souvient de la bibliographie de Cocteau qui répartissait des œuvres en poésie de roman, poésie de théâtre, poésie d'essais etc… La méthode eût été tout aussi pertinente pour D'Annunzio, sinon qu'il eût été nécessaire d'y ajouter la poésie de l'action. Nocturne est une méditation sur l'action, fondée, certes sur le ressouvenir mais aussi, nous l'avons vu, sur la préfiguration, l'annonce. “La poésie ne rythmera plus l'action, elle sera en avant” écrivait Rimbaud. Le poème précède l'action, celle-ci n'est plus ce qui est chanté après, mais le chant dont l'action sera la fine pointe, - et cette action elle-même ne vaudra que par l'intensité de la poésie qu'elle éveille, à jamais, comme une flamme que rien, pas même la défaite historique, ne pourra éteindre.
Sur le papier où D'Annunzio écrivait ses éloges, ses joies, ses mélancolies, son courage, figurait ce filigrane : “Per non dormire”, pour ne pas dormir, même et surtout dans la nuit phosphorescente, même et surtout au coeur du Songe. Comment expliquer que celui qui passait pour un poète décadent, un Des Esseintes pris de vertige par les synesthésies, sut avec un tel bonheur conquérir le coeur des Arditi, - qui n'étaient pas particulièrement de délicats érudits en chambres ou en salons ? C'est qu'il apportait la preuve, (selon la formule de Cocteau “ la preuve par neuf des neufs Muses”), que la poésie, comme le savait Hamann est bien la langue originelle de l'humanité. De ce rappel, en dépit de l'échec apparent de Fiume, demeure la réjuvénation de l'âme, sa possibilité inaltérée. Ce grain, couleur de cinabre qui, au contact du plomb, transmute, par un effet d'ensoleillement intérieur, la matière opaque. Le secret du soleil est dans la nuit, et le secret de la nuit dans le soleil noir alchimique. Nulle mieux que l'œuvre de D'Annunzio ne montre que le recours au passé, à la plus lointaine mémoire, est au principe de l'élan, de la force qui va, de la conquête. La nostalgie est chose mal comprise. On la croit une déperdition de la puissance, elle en est la ressource, le viatique. On présume que le nostalgique s'abandonne à des images révolues, alors qu'il les invente. Tel ces philosophes, peintres et sculpteurs de la Renaissance qui se tournent vers le monde antique pour mieux fonder leur pensée et leur art et leur donner des audaces impressenties, D'Annunzio œuvre avec ce double regard, cette virtuosité de Janus.
Pour faire de son langage la proue du vaisseau qui avance dans le futur, D'Annunzio sait qu'il faut revenir à la vérité du Logos, sa vérité héliaque, impériale, virgilienne, - celle dont il nous dira qu'elle vole, qu'elle dépasse le Grand Cap, “au-delà de toute misère, au-delà de cette vie, au-delà de nous nous-mêmes”. Et remotissima prope. Par le Logos, les choses les plus lointaines nous deviendront au plus proche. Dans le soleil noir du Nocturne D'Annunzio retrouve, nous dit-il, la sapience de l'Indien, du l'Egyptien, du Chaldéen, du Perse, de l'Etrusque, du Grec, et l'œil de Moïse lui-même qui croyait lire dans les signes de l'univers l'origine du monde,- mais tout cela dans un corps, tout cela dans son œil aveuglé, dans le fleuve noir de sa souffrance physique, avant qu'elle ne s'ouvre sur son au-delà: la vision des Alpes transfigurées, une nuit d'astre mort venue du fond de la mémoire millénaire, nous dira-t-il, d'on ne sait quel dieu extatique.
Le passé est bien cette présence que viendront couronner les faveurs du poème qui ressuscite ce qu'il nomme : “ L'odeur des livres, écrit D'Annunzio, était peu à peu vaincue par l'odeur des fleurs (…) écrit D'Annunzio dans Le Triomphe de la mort. “Les choses suggéraient au survivant une foule de souvenirs. De ces choses montait le chœur léger et murmurant qui l'enveloppait. De toutes part s'élevait les émanations du passé. On aurait dit que les choses émettaient des effluves d'une substance spirituelle qui les eût imprégnées (…) Est-ce que je m'exalte se demanda-t-il à l'aspect des images qui se succédaient en lui avec une rapidité prodigieuse, claires comme des visions, non pas obscurcies par une ombre funèbre, mais vivants d'une vie supérieure”.
Rien ne passe, tout revient. Chaque heure, là où elle se trouve est intacte, pure de son propre feu, dans une dimension révolue, mais toujours présente, de même que le sillon d'un disque, même lorsque l'aiguille de saphir y est passée, demeure avec sa musique gravée; de même la révolte annonciatrice de D'Annunzio nous fait signe, comme toute la beauté qui, dans son cours vif, est passé dans notre vie, comme tous les paysages qui nous accueillirent, cités emblématiques, pierres qui gardent la mémoire des pluies et des soleils, refuge de feuillages, jardins de la mer. Ce qui nous en sépare est un leurre, une sinistre fiction inventée par des esprits moroses qui se sont emparés du réel pour en faire une “réalité” profanée, réduite à l'abstraction et à la statistique, - autrement dit, à la restriction. A cette “science de la pénurie”, D'Annunzio, comme Jüger opposera la “science de l'abondance”, l'immmoriale sapience, la théodicée.
Lorsque tout conjure à nous contraindre à une vie inférieure, hypnotique, devant des écrans, où l'on ne sait plus guère si la distraction est travail où le travail parfaite distraction de l'essentiel, de la vraie vie sensible et intelligible, le songe d'Annunzien de la “vie supérieure”, qui fait échos à la “vie magnifique” qu'évoquait Ernst Jünger, redevient d'une lancinante actualité. Elle est exactement ce qui nous est ôté, mais dans ce manque, du coeur même de cet exil, brille, - comme l'iota de la lumière incréée au fonds de la pupille, l'appel du monde qui a été, arbitrairement, abstraitement, despotiquement, éloigné de nous, mais que la poésie, l'usage magique du Logos rapproche infiniment : “ sous le ciel prié avec une foi sauvage, sur la terre labourée avec une patience séculaire”. Faire chanter la vie, la faire vibrer, frémir, bourdonner comme les abeilles d'Aristée, la jeter toute entière dans la flamme qu'elle suscite, dans le volcan empédocléen ou sur la plage de Fiume, sous les tirs de ceux dont l'honneur eût été de n'être pas des ennemis; être nietzschéen, mais avec le bon conseil de L'Arétin et de Catulle, et la sagesse natale, et la fidélité aux morts avec lesquels toute âme généreuse poursuit la conversation par-delà l'apparaître et le disparaître, - telle fut la vocation, l'appel de celui que vous allez lire et relire, sa raison d'être à laquelle nous nous rendrons, sans rendre les armes, pour un “paradis à l'ombre des épées”, pour la grande paix du coeur retrouvée des hommes qui agissent et qui rêvent, sachant la fugacité de tout et qui n'obéissent qu'à la seule devise: “Penser comme si nous étions éternels et vivre comme à notre dernier jour”.
L'éternité pour D'Annunzio, comme pour Nietzsche, n'est pas ailleurs que dans l'instant, et la pensée est la juste pesée de cet instant qui oscille doucement, amoureusement, entre le passé et l'avenir. Toute vie est toujours au bord de l'abîme. De le méconnaître ne nous empêche guère d'y tomber mais ternit, avilit les heures infiniment précieuses qui nous en séparent.
D'Annunzio nous parle en ami, et dans la gloire, l'enthousiasme, comme dans l'épreuve et le désarroi, ses phrases résistent à ces forces qui voudraient nous déposséder, et mieux encore, elles sont contre-attaques afin de reprendre l'estuaire d'où reviendront à nous “notre bien et notre beau”, si loin qu'ils paraissent être, en quelque lointaine Atlantide où ils semblent d'être perdus, scintillantes îles englouties et ressurgies à la faveur des mots qui les évoquent, là où nous sommes, dans les ténèbres de la nuit extrême ou dans les blondeurs du soleil du matin, hommes de désir, fragiles et fervents, entre les contrées de l'Aigle et le territoire du Serpent.
Luc-Olivier d'Algange

D'Annunzio, tra le terre dell'Aquila e il territorio del Serpente
Era inevitabile che il poeta che tanto lasciava trasparire nelle sue opere la visione di un paradiso terrestre - l'assoluto non nell'indefinito, ma in una splendente finitudine, incarnata, in un'anima che fa fremere il corpo e innalza lo spirito all'avventura e alla gloria - uscisse finalmente dal purgatorio in cui menti
meschine cercavano di imprigionarlo per sempre.
D'Annunzio è stato magnificamente tutto ciò che il nostro tempo ci prescrive di non essere più. Non c'è una sola delle sue virtù, o dei suoi vizi, che non sia bandita, e soprattutto le sue virtù, che devono essere prese qui nel senso originario, come una volta si parlava della virtù del condottiero.
La sua fama ai suoi tempi era immensa, ma pochi gli rimasero fedeli, tranne Montherlant e quell'altro condottiero, autore del più bel viaggio in Italia, André Suarès, che meglio di chiunque altro riuscì a capirlo, anche nella sua tenuta fiumana.
Del "Comandante" e del "Comediante" si è detto molto, della sua audacia e della sua genialità, della sua italianità, che non è poi così lontana dalla nostra francesità, incarnata da Cyrano de Bergerac, che non fu solo il corrusco personaggio del dramma di Edmond Rostand, ma anche, come talvolta si dimentica, il geniale autore del Voyage aux pays de la Lune et du Soleil, che eleva la prosa francese a uno dei suoi zenit più ardenti.
Sotto questi buoni auspici - che comprendono anche, tra i contemporanei, la magistrale biografia di Maurizio Serra e l'attiva fedeltà, nel cuore del Vittoriale degli Italiani, ultima dimora di d'Annunzio, di Giordano Bruno Guerri, autore di diversi libri dedicati al Vate - d'Annunzio ritorna ed è giunto il momento di ricordare il poeta che soprattutto è stato. I guastafeste, i Lugubri e i puritani hanno sogghignato amaramente, ma è nella loro natura non capire nulla di nulla e tenersi stretti alla linea difensiva della loro mediocrità; gli ideologi ci hanno messo in guardia contro lo spirito libero, ma è loro compito selezionare amministrativamente i buoni dai cattivi soggetti. Queste denigrazioni, tuttavia, trasudano invidia, che è il più stupido dei peccati, perché non c'è gioia in esso, per quanto fugace o colpevole.
Gloria e lusso, con le preoccupazioni però di un uomo perennemente indebitato, ma con un senso di disinvoltura e di brio, la più grande gloria letteraria del suo tempo, una ricchezza di presenze femminili, il tutto gettato nella bilancia del rischio e dell'audacia, - D'Annunzio riprende la famosa frase di Pompeo, citata da Plutarco: "Navigare è necessario, ma non è necessario vivere"- c'era senza dubbio qualcosa in essa che torceva le viscere di coloro che hanno strangolato i loro sogni prima del tempo!
Che una vita del genere sia stata possibile, e amata, dovrebbe tuttavia farci riflettere sui poteri della poesia stessa, poteri magici che vanno molto indietro nel tempo, ai Misteri di Delfi e di Epidauro, a Empedocle e ai primi sogni orfici, e ancora più indietro, alla comunione immemorabile dell'uomo con la terra d'Abruzzo, con il cielo, con il mare. Per D'Annunzio la poesia non è una rappresentazione ma una presenza reale, un'estensione della natura e del mondo, che emana da esso e ne testimonia il segreto, quel fuoco centrale dell'essere che, senza l'intercessione del poeta, rimarrebbe misconosciuto - "una terra senza leggende condannata a morire di freddo", per dirla con Patrice de la Tour du Pin.
D'Annunzio è stato spesso criticato per essere un poeta di sole sensazioni, e preferibilmente di sensazioni forti, ma questo non tiene conto del fatto che la sensazione, quando una poesia se ne impadronisce e la canta, non è solo sensazione, così come la vita non è solo vita, ma un segno, un annuncio: quello del proprio nome: "La vita era bella per quello che vivevo e perché mi aveva creato come l'immagine velata dell'Angelo del mio nome".
Per D'Annunzio la vita è un segno e un intersegno, un'analogia creativa; la voce che lascia in noi è simile a quella da cui è nata, i suoi oggetti più precisi, più familiari, vengono dalla notte dei tempi, come la cicala talismanica amata dai Félibres¹, che per tanti versi erano vicini a D'Annunzio, la cicala "nera ma coperta di una peluria cinerea che brillava come una veste di seta".
Per D'Annunzio, il rifiuto di un'esistenza piatta, sottomessa e utilitaristica non è solo una posa, o addirittura un'etica - che sarebbe già onorevole - ma, più profondamente, una metafisica sperimentale. Chiunque pensi di sacrificare la propria vita in battaglia giudica un'idea superiore alla vita, non come un'astrazione, ma come la sua avanguardia.
Per D'Annunzio la vita non è solo vita, la ragione non è solo ragione, la patria non è solo patria, ma sono tutte impronte di una verità superiore, divina, che è compito del poeta sperimentare e lodare. Non c'è nulla di anemico o di vacillante in questo idealismo, è potenza in azione, non priva di quel superiore pragmatismo che caratterizza l'eroe omerico, - e poi, non è forse tutta la vita un sacrificio, quel "fuoco misto ad aromi” di cui parlava Eraclito? Meglio le fiamme alte e crepitanti di profumi che il fuoco fetido e puzzolente della sicurezza e della comodità. Il dono ricevuto alla nascita è immenso, indicibilmente immenso.
L'intento di D'Annunzio fu, durante tutta la sua vita fervida ed inquieta, di non esserne indegno. La spedizione fiumana succeduta al Notturno ricorda il viaggio degli Argonauti. Prima di questa avventura, che evoca la conquista del Vello d'Oro, il Notturno, nel suo paradosso temporale, è una prefigurazione. Per riconquistare ed elevare la bellezza conquistata al di là della bellezza perduta, bisogna essere stati lasciati, abbandonati sulle rive della notte; bisogna essere stati quasi sconfitti, traditi; la propria legittimità deve essere stata calpestata e negata.
In alcune circostanze, che poi appartengono al Mito, il destino individuale si unisce a quello collettivo. Il ricordo diventa allora presagio. L'onore reso agli eroi del passato nel Notturno preannuncia, attraverso l' "Angelo del nome", coloro che si solleveranno contro la "vittoria mutilata".
Ogni vita pienamente vissuta è mitologica. Per D'Annunzio, i miti non sono i testimoni di un'antica civiltà scomparsa, ma le chiavi per decifrare il proprio destino, proprio come lo erano per un greco contemporaneo di Omero o Empedocle. Lungi, molto lungi dall'essere semplici ornamenti metaforici di un letterato, sono la sostanza viva delle sue azioni e dei suoi pensieri.
È un modo mitologico di vedere il mondo, di farne parte, e un modo raziocinante, borghese, nel senso flaubertiano di "uno che pensa basso". D'Annunzio, che era allo stesso tempo un contadino abruzzese e un esteta alla maniera di Des Esseintes, non avrebbe lasciato che il pensiero calcolatore e pianificatore ordinasse la sua vita; si sarebbe unito agli dei, alle loro leggende e ai loro misteri.
Potremmo vedere questo semplicemente come il fascino di un grande spettacolo, una sfida ai tempi, se l'opera di Jung, per esempio, non ci avesse insegnato che i miti sono la nostra trama segreta, la filigrana della spiaggia bianca su cui scriviamo i nostri giorni e le nostre notti, le radici della nostra coscienza che le astrazioni del mondo moderno vorrebbero recidere.
Tutto ciò che è avventuroso nella vita di D'Annunzio appare quindi come una serie di atti rituali volti a liberare la parte mitologica, orfica, e a dargli quella luminosità, quella verità la cui bellezza brilla, come il sole del mattino sulla superficie dell'acqua.
Il grande pericolo non è quello che pensiamo noi, ma, come diceva Ernst Jünger, quello di "lasciare che la vita ci diventi quotidiana" - non perché le cose più semplici non bastino alla nostra gioia, ma proprio perché nell'astrazione moderna rischiano di diventare irraggiungibili. E così D'Annunzio non si stancava di cantare il fogliame, la pioggia, gli animali, i sapori, le stagioni, le fatiche e le lotte dei suoi simili, "il miele che la bocca strappa alla cera ostinata", la felice diversità delle apparenze e, naturalmente, le donne che abbracciava o solo desiderava.
La sua preoccupazione nasce da una constatazione alla quale non si rassegnerà mai: la gente, soprattutto quella del suo tempo, si sta perdendo una vita magnifica. Tutto viene offerto e nulla viene preso. Per qualche oscuro incantesimo - che pone una sfida alla razionalità - il magnifico dono di Dio viene costantemente rifiutato nelle circostanze più minute e in quelle più grandiose.
Il suo immenso poema Laus Vitae - di un'altezza, di un vigore e di un'ispirazione paragonabili alle Cinq grandes odes di Claudel o agli Amers di Saint-John Perse - è questo controincantesimo, questa operazione teurgica la cui vocazione è, attraverso la lode, liberare la vita dalla sua triste prigionia, innalzarla all'altezza ideale del canto, e rendere così il suo lettore contemporaneo di Virgilio, di Dante e del più grande futuro, quello delle "albe vediche", secondo la citazione che Nietzsche scrisse in esergo alla sua Gaia Scienza.
Questo contro-incantesimo ricorda il “contro-mondo” di Stephan George che, peraltro, tradusse D'Annunzio e lo pubblicò nella sua antologia dei poeti emblematici del suo tempo. Questo contro-incantesimo e questo contro-mondo in questi tempi di standardizzazione globale sono ancora più necessari di quanto lo fossero ai tempi di Stefan George e D'Annunzio. Ciò che temevano questi poeti altezzosi sta accadendo a noi con una forza livellatrice senza precedenti. Da qui l’importanza di seguire i loro consigli e di ignorare i giudizi parziali di chi li considera obsoleti o pericolosi.
Pericolosi, certo, ma per i guardiani, gli uomini senza volto, i Lugubri. Pericolosi, certo, per i discorsi che ci ingiungono la servitù volontaria, per l'umanità che si accontenta di essere "QR coded" o ridotta al ruolo di topi da laboratorio, la cui unica ambizione, in un labirinto assurdo, è trovare la leva che attiva la distribuzione del cibo, il famoso "potere d'acquisto".
Nella notte, D'Annunzio ricorda l'asse, l'arcano di tutti i soli. Questa notte non è una pura e semplice assenza di luce. È popolata da fosfeni, reminiscenze e prefigurazioni. Questo tuffo nel bulbo oculare, in una rete di nervi, in un cervello, in un corpo, è straordinariamente preciso: fa esattamente ciò che ogni scrittore dovrebbe fare: scrivere a partire dall'essere fisico e metafisico.
Questa era la regola d'oro dei più grandi scrittori, Proust, Faulkner, Conrad, Artaud, Jünger e, naturalmente, Nietzsche, che D'Annunzio considerava giustamente non come una guida ("Sono restio a seguire quanto a guidare", dice in Zarathustra) ma come un fratello ferito. Dopo tutti gli studi che da allora sono stati dedicati al Solitario d'Engadina, potremmo considerare D'Annunzio un nietzschiano approssimativo, ma resta il fatto che la sua vita fu senza dubbio quella che Nietzsche avrebbe amato: mediterranea, solare, bellicosa, guidata da una volontà di potenza che non confuse mai con le procrastinazioni e le servitù del potere.
Quando divenne signore di Fiume, lo fece come Vate piuttosto che come dittatore, se non altro per promuovere l'esercizio della libertà da parte di tutti. La Costituzione di Fiume, redatta da Alceste de Ambris, era vicina all'ideale libertario e, in Europa, all'avanguardia di tutte le libertà conquistate sul puritanesimo e sullo spirito borghese.
Nella vita, e in politica in particolare, bisogna scegliere ciò che serviamo, essendo l'individualismo assoluto un'illusione, o almeno un orizzonte irraggiungibile, tranne che in un'opera giovanile di Julius Evola. Le più grandi dispute ideologiche si giocano intorno alla nozione di individuo, con alcuni che sostengono un individualismo astratto e intercambiabile e altri che sostengono varie forme di collettivismo. Ma il genio di D'Annunzio sfugge subito a questa alternativa che somiglia moltissimo ad una trappola.
Fiume è stato, ma nella logica dell'intera opera, - un tentativo di allentare la presa, di aprire una possibilità di essere che non sia esclusivamente soggetta agli interessi dei notabili o di uno Stato ipertrofizzato sotto il solo regno dell'economia e della tecnica. Questa possibilità di essere definisce una nozione di individuo estranea al regno della quantità che ci assoggetta alle statistiche.
Per D'Annunzio, l'individuo è incarnato; è, nello spirito, nell'anima e nel corpo, una cosa insostituibile, indivisa, forgiata o scolpita da quelle influenze che sono la sua lingua, il suo paesaggio preferito, i suoi amori, la sua immaginazione in movimento, la sua fedeltà alle ore più profonde e felici, la sua preghiera più segreta. Ogni individuo si differenzia dall'altro proprio per l'organizzazione variabile delle sue influenze, attraverso le quali è comunque legato agli altri, legato ma non aggregato.
Il genio di D'Annunzio fu dunque quello di inventare un impulso comune fondato sul rifiuto del gregarismo. Le grandi libertà che la Costituzione di Fiume concede ai singoli sono destinate non a un edonismo di massa, ma alla liberazione dei poteri, quelli stessi che giacciono, nei ricordi, nei presentimenti, nelle mitologie vive nelle profondità del Notturno.
Fiume, certo, è stata schiacciata dalla forza meccanica delle persone serie, ma la sua esemplarità resta. Gli uomini hanno altri destini possibili oltre a essere insetti, ingranaggi di un meccanismo sociale. Tutto ciò che vibra e canta, l'irriducibile singolarità di ogni persona dove concordano la molteplicità delle sue influenze, resta di fronte a noi stessi e di fronte al nulla, tragico e gioioso insieme. Tragico proprio perché insostituibile, e gioioso perché la sua fiamma insostituibile illumina le nostre diversità, i nostri amici e il nostro comune fervore. Contro la società anonima, D'Annunzio ci dà quella del "nome che annuncia" Contro il pensiero calcolatore, quello del Dono, - "Io ho quel che ho donato". Contro la servitù volontaria, un orizzonte omerico e virgiliano: la poesia prima di tutto.
Ricordiamo la bibliografia di Cocteau, che divideva le sue opere in poesia romanzesca, poesia teatrale, poesia saggistica, ecc. Il metodo sarebbe stato altrettanto pertinente per D'Annunzio, se non fosse che sarebbe stato necessario aggiungere la poesia d'azione. Il Notturno è una meditazione sull'azione, basata certo sul ricordo ma anche, come abbiamo visto, sulla prefigurazione, sull'annuncio. "La poesia non darà più il ritmo all'azione, ma le starà davanti", scriveva Rimbaud. La poesia precede l'azione, l'azione non è più ciò che si canta dopo, ma il canto di cui l'azione sarà la punta di diamante, - e questa stessa azione varrà solo per l'intensità della poesia che risveglia, per sempre, come una fiamma che nulla, nemmeno la sconfitta storica, potrà spegnere.
Sulla carta su cui D'Annunzio scrisse le sue lodi, le sue gioie, la sua malinconia, il suo coraggio, appariva questa filigrana: "Per non dormire", non dormire, anche e soprattutto nella notte fosforescente, anche e soprattutto nel cuore del Sogno. Come spiegare che colui che passava per un poeta decadente, un Des Esseintes preso dalla vertigine delle sinestesie, sapesse conquistare con tanta felicità il cuore degli Arditi - che non erano particolarmente delicati studiosi di camere da letto o di salotti? Questo perché ha fornito la prova (secondo la formula di Cocteau “la prova del nove delle nove Muse”) che la poesia, come Hamann sapeva, è effettivamente il linguaggio originario dell'umanità.
Di questo richiamo, nonostante l'apparente fallimento di Fiume, resta il ringiovanimento dell'anima, la sua inalterata possibilità. Questa grana, del colore del cinabro che, a contatto con il piombo, trasmuta, attraverso un effetto della luce solare interna, la materia opaca. Il segreto del sole è nella notte, e il segreto della notte è nel sole nero alchemico.
Nessuno meglio dell'opera di D'Annunzio mostra che il ricorso al passato, alla memoria più lontana, è al principio dello slancio, della forza di andare, di conquistare. La nostalgia è una cosa poco compresa. Si crede sia una perdita di potere, è la sua risorsa, il suo viatico. Si presume che il nostalgico si abbandoni a immagini del passato, mentre in realtà le sta inventando. Come quei filosofi, pittori e scultori del Rinascimento che si rivolsero al mondo antico per fondare meglio il loro pensiero e la loro arte e dar loro audacia inaspettata, D'Annunzio lavora con questo doppio sguardo, questo virtuosismo bifronte.
Per fare della sua lingua la prua della nave che si muove verso il futuro, D'Annunzio sa che deve tornare alla verità del Logos, alla sua verità eliaca, imperiale, virgiliana - la verità che ci dirà che vola, che va oltre il Grande Capo, "oltre ogni miseria, oltre questa vita, oltre noi stessi".
Et remotissima prope. Attraverso il Logos, le cose più lontane diventeranno le più vicine a noi. Nel sole nero del Notturno, D'Annunzio riscopre, ci racconta, la saggezza degli indiani, degli egizi, dei caldei, dei persiani, degli etruschi, dei greci, e l'occhio stesso di Mosè, che credeva di leggere l'origine del mondo nei segni dell'universo - ma tutto questo in un corpo, tutto questo nel suo occhio cieco, nel fiume nero della sua sofferenza fisica, prima che si si aprisse sulla sua vita ultraterrena: la visione delle Alpi trasfigurate, una notte d’una stella morta che viene dal profondo della memoria millenaria", ci dirà, "da chissà quale dio estatico".
Il passato è infatti questa presenza che sarà coronata dai favori della poesia che risveglia ciò che chiama: "L'odore dei libri fu a poco a poco sopraffatto dall'odore dei fiori" scrive D'Annunzio ne Il trionfo della morte: "Le cose suggerivano al sopravvissuto una schiera di ricordi. Da queste cose si levava il coro leggero e mormorante che lo avvolgeva. Le emanazioni del passato salivano da ogni parte. Era come se le cose emettessero gli effluvi di una sostanza spirituale che le aveva impregnate (...) Mi sto esaltando?" si chiedeva alla vista delle immagini che si susseguivano nella sua mente con prodigiosa rapidità, chiare come visioni, non offuscate da un'ombra funerea, ma vive di una vita superiore.
Niente passa, tutto ritorna. Ogni ora, ovunque sia, è intatta, pura del proprio fuoco, in una dimensione passata, ma sempre presente, così come il solco di un disco, anche quando l’ago di zaffiro lo ha attraversato, rimane con la sua musica incisa; allo stesso modo ci interpella la rivolta annunciatrice di D'Annunzio, come tutta la bellezza che, nel suo vivace corso, è passata nella nostra vita, come tutti i paesaggi che ci hanno accolto, città emblematiche, pietre che custodiscono la memoria delle piogge e dei soli, rifugi di foglie, giardini dal mare. Ciò che ci separa da loro è un'illusione, una finzione sinistra inventata da menti cupe che si sono impadronite della realtà per farne una realtà dissacrata, ridotta ad astrazione e statistica, - in altre parole, alla restrizione. A questa "scienza della scarsità", D'Annunzio, come Jünger, opporrà la "scienza dell'abbondanza", la sapienza immemorabile, la teodicea.
Quando tutto cospira per costringerci a una vita inferiore, ipnotica, davanti agli schermi, dove non sappiamo quasi più se la distrazione è lavoro o se il lavoro è una perfetta distrazione dall'essenziale, dalla vera vita sensibile e intelligibile, il sogno dannunziano della vita superiore, che riecheggia la vita magnifica evocata da Ernst Jünger, torna ad essere di struggente attualità. È proprio ciò che ci viene tolto, ma in questa mancanza, nel cuore stesso di questo esilio, risplende - come un briciolo di luce increata in fondo alla pupilla - l'appello del mondo che è stato arbitrariamente, astrattamente, dispoticamente allontanato da noi, ma che la poesia, l'uso magico del Logos, avvicina infinitamente: "sotto il cielo pregato con fede selvaggia, sulla terra arata con pazienza secolare".
Far cantare la vita, farla vibrare, fremere, ronzare come le api di Aristeo, gettarla tutta nella fiamma che suscita, nel vulcano empedocleo o sulla spiaggia di Fiume, sotto il fuoco di coloro il cui onore sarebbe stato quello di non essere nemici; essere nicciano, ma con i buoni consigli dell'Aretino e di Catullo, e la saggezza innata, e la fedeltà ai morti con cui ogni anima generosa persegue il dialogo oltre l'apparire e lo scomparire, - tale era la vocazione, il richiamo di colui che noi leggeremo e rileggeremo, la sua ragione d'essere alla quale ci arrenderemo, senza rinunciare alle armi, per un “paradiso all'ombra delle spade”, per la grande pace del cuore ritrovata dagli uomini che agiscono e sognano, conoscendo la caducità di ogni cosa e che obbediscono soltanto al motto: “Pensa come se fossimo eterni e vivi come nel nostro ultimo giorno”.
Per D'Annunzio, come per Nietzsche, l'eternità si trova solo nell'attimo, e il pensiero è la giusta pesatura di questo attimo che oscilla dolcemente, amorevolmente, tra il passato e il futuro. Tutta la vita è sempre sull'orlo dell'abisso. Ignorarlo difficilmente ci impedisce di caderci dentro, ma offusca e degrada le ore infinitamente preziose che ci separano da esso.
D'Annunzio ci parla da amico, e nella gloria e nell'entusiasmo, come nella prova e nello sgomento, le sue frasi resistono a quelle forze che vorrebbero spodestarci, e meglio ancora, sono contrattacchi per reclamare l'estuario da cui torneremo a noi stessi, per dirla con Rimbaud, "il nostro bene e il nostro bello", per quanto lontane appaiano, in qualche remota Atlantide dove sembrano perdute, scintillanti isole sommerse e restituite sopra l’orizzonte grazie alle parole che le evocano, dove noi siamo, nel buio della notte estrema o nel biondo del sole mattutino, uomini del desiderio, fragili e ferventi, tra le terre dell'Aquila e il territorio del Serpente.
Luc-Olivier d'Algange
(traduction d'Aldo Righetti )
18:11 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
07/01/2024
Un texte de Stéphane Barsacq sur les "Propos réfractaires" de Luc-Olivier d'Algange:

Saint-Augustin raconte ses erreurs, Rousseau justifie les siennes, Stendhal a les impudences des masques, Gide est plus près du modèle que du tableau et de la pose que de la grâce. La sincérité de Luc-Olivier d'Algange est d'une exactitude nonchalante. L'observation n'y est pas au piquet ni figée et morte comme le glacier d'Amiel; ici l'oiseau rend des libertés avec son arbre. Il se retranche mais il tranche. Il a des fenêtres qui donnent sur la guerre, sur la sottise, sur l'Europe. Prudent, il ne bégaye pas; avisé, il n'est pas irrésolu. Il est assez original pour citer souvent parce que l'esprit naît dans une société d'esprits. S'il nous parle de lui, c'est qu'il nous connaît. On ne le range pas parmi les philosophes parce qu'il refuse leurs cages, leur jargon, leur pédanterie, leurs querelles de fantômes. Aussi quelle succulence de langage ! J'aime Luc-Olivier d'Algange comme il aime Paul Valéry. "Les fous nous rendent fous, les sages nous rendent sage sans le vouloir".
Stéphane Barsacq
Luc-Olivier d'Algange, Propos réfractaires, éditions de L'Harmattan.
19:52 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
Un article de Maximilien Friche paru dans "Zone critique":
Dans Propos réfractaires, Luc-Olivier d’Algange s’attaque au Moderne qui est contre tout ce que nous aimons. L’auteur nous propose tout simplement de partir au combat pour l’Âme du monde, mais avec un zeste de désinvolture et dans la joie de contempler les éternités chatoyantes.
 s
s
« Être réfractaire, ce n’est pas être révolté avec le pathos moderne, c’est rompre là, avec calme et le plus simplement du monde afin de demeurer fidèle à l’essentiel. » A la lecture du dernier essai de Luc-Olivier d’Algange, ne vous attendez pas à un énième pamphlet réac. Ce n’est pas du tout le genre de notre dandy métaphysique. Ce qui est en jeu dans Propos réfractaires relève de la raison d’être. Et nous entrons dans ce livre comme nous entrons en conversation avec un ami qui va à la rencontre de la pensée en cherchant ses mots. Quelques références sont parsemées comme des balises : Bloy, Blanchot, Guénon, Dominique de Roux, Nietzsche, Daumal, Dante. Pas de dialectique ici, on ne peut utiliser l’outil de celui que l’on veut combattre sans le rejoindre dans l’arène et devenir son simple reflet. Luc-Olivier d’Algange ne cherche pas à convaincre car il ne cherche pas à tromper. Comme Sainte Bernadette, il ressent juste le devoir de nous le dire. Qu’il est doux de fréquenter celui qui parle avec autorité… celui-là distribue les aphorismes comme on ouvre les fenêtres d’un monde sentant le renfermé. Ses phrases se changent presque en dictons mâtinés de sagesse orientaliste. Ce qu’il nous livre ressemble parfois à la morale d’une fable et cette fable, nous la connaissons bien, c’est la farce de notre monde. Dans cette farce, Luc-Olivier d’Algange a identifié le protagoniste, c’est le Moderne. Ce Moderne, comme l’Homo Festivus de Muray, devient le masque archétypal figé d’un théâtre antique pour nos jours. Ce qui fige ce masque dans une grimace, est tout ce qui l’empêche d’être : le monde du travail, l’ère de la technologie, la société du contrôle, le dogme de l’utilité, le culte de la quantité… « L’arme du barbare moderne étant la haute technologie. » Mais cela ne s’arrête pas là car d’Algange a bien identifié que cette modernité était aussi un virus de la pensée ou plus exactement un refus de penser qui ordonne jusqu’aux décisions politiques. « Les modernes ont cette passion, nier l’évidence. »
Un plaidoyer pour l’incarnation et la vie intérieure
Pour notre auteur, face aux attaques que subit l’être, l’enjeu est de demeurer humain dans un monde qui veut nous faire trans-humains dans un confort post-humain. Voilà, « Les modernes fabriquent du chaos… ». Lui se fait plutôt le chantre de la tradition en action : « Je n’aime pas le passé ; j’aime ce qui est présent du passé. » La subtilité est de taille pour échapper au conservatisme et au moralisme et mieux combattre toutes ses formes insidieuses du totalitarisme moderne. Via l’érotisme des phrases, des saisons, l’invitation à convertir notre regard aux épiphanies, aux éternités chatoyantes, à reconnaître les symboles, à entrer en contact avec l’âme du monde, Luc-Olivier d’Algange nous offre un plaidoyer pour l’incarnation et la vie intérieure. « Symboliser est un acte amoureux. Noces du visible et de l’invisible. » Tout est pourtant mis en place pour brouiller ces épiphanies. Il faut dire que « L’immense gratuité de la création inquiète et scandalise les calculateurs, les impies. » Le Moderne ayant la pensée courte se contente de croire en l’homme et finit par être contre tout ce que nous aimons. Notre auteur dandy se veut chevalier. « Le combat pour l’Âme du monde oppose un sacrifice à un gâchis. Le moderne, ne voulant rien sacrifier, gâche tout. » En refermant ces Propos réfractaires, nous avons bien envie d’épouser cette chevalerie spirituelle proposée pour échapper au monde policier, de l’épouser avec cette pointe de désinvolture nécessaire à la lettre et l’esprit. « Être réfractaire, ce serait alors se souvenir que nous avons reçu. »
-
Propos réfractaires, essai de Luc-Olivier d’Algange, L’Harmattan, 2023
18:50 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
16/12/2023
Luc-Olivier d'Algange, les inédits de Gustave Thibon:
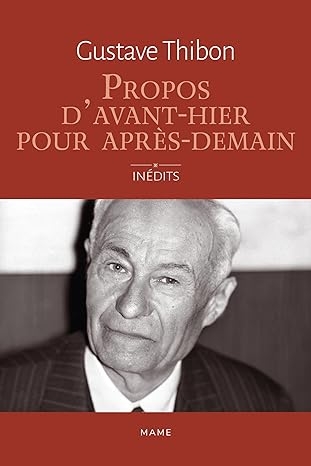
Propos d'avant-hier pour après-demain,
les inédits de Gustave Thibon
Le livre d'inédits de Gustave Thibon, qui vient de paraître aux éditions Mame, est un événement. L'ouvrage rassemble des notes, des conférences, « feuilles volantes et pages hors champs », lesquelles, pour les lecteurs non encore familiers constitueront une introduction du meilleur aloi, et pour les autres, une vision panoramique des plus instructives. Presque tous les thèmes connus de l'oeuvre sont abordés, et d'autres encore, où l'on découvre un philosophe dont la vertu première est l'attention. Il y est question de la France, des « liens libérateurs », formule qui n'est paradoxale qu'en apparence, des « corps intermédiaires », de Nietzsche et de Simone Weil, du mystère du vin, de l'âme du Midi, du Portugal, de la vie et de la mort. Ces « pensées pour soi-même », nous donnent la chance de remonter vers l'amont, vers la source d'une pensée qui ne se contente pas d'être édifiante et sauvegarde l'inquiétude, ce corollaire de la Foi, qui est au principe de toute aventure intellectuelle digne d'être vécue.
Encore qu'il eût, depuis plus d'un demi-siècle, des lecteurs fidèles, et, mieux encore, de ceux qui surent entrer en conversation avec lui et prolonger sa pensée et son œuvre, - tel Philippe Barthelet auteur d'un livre d'entretiens avec Gustave Thibon, et d'un magistral Dossier H consacré à l'auteur de L’Ignorance étoilée, aux éditions de L'Age d'Homme - il est à craindre que Gustave Thibon ne soit pas encore reconnu à sa juste valeur, et surtout, à sa juste audace. Une image s'interpose : celle du « philosophe-paysan » qui se contenterait de dispenser une sagesse traditionnelle appuyée sur le catholicisme et l'amour de la terre.
Forts de cette vision réductrice, sinon fausse, on se dispense de le lire, de confronter son œuvre à celles des philosophes, plus universitaires, de son temps, et l'on méconnaît ce qu'il y a de singulièrement affûté, et sans concession d'aucune sorte, dans sa pensée érudite, mais de ligne claire et précise, sans jargon. Gustave Thibon, dans ces pages « hors champs », adresse au lecteur, une mise-en-demeure radicale, non certes au sens actuel de radicalisme, mais, à l'inverse, par un recours aux profondeurs du temps, aux palimpsestes de la pensée, à cette archéologie, voire à cette géologie de l'âme, à cette géographie sacrée, celle de la France, qui est, par nature, la diversité même, qui se décline de la Bretagne à l'Occitanie, et n'en nécessite point d'autre, abstraite, importée ou forcée.
Certes, la terre est présente, et Gustave Thibon rejoint Simone Weil dans ses réflexions sur l'enracinement ; certes, il est catholique, sans avoir à passer son temps à le proclamer, - mais ces deux évidences sont, avant tout, l'expérience d'une transcendance véritable, qui ne cède jamais à la facilité revendicatrice, à ces représentations secondes qui nous poussent, sur une pente fatale parfois, à parler « en tant que ». Gardons-nous, dit Gustave Thibon, de nous reposer dans l'image que nous nous faisons de nous-mêmes ou dans le sentiment, d'être, par nos opinions et nos convictions, une incarnation du « Bien ».
Il existe bien un narcissisme religieux, une satisfaction indue, une façon de s'y croire, au lieu de croire vraiment, une pseudo-morale de dévots, une « charité profanée » (selon l'expression de Jean Borella) que Gustave Thibon, dans ces inédits, n'épargne pas de ses flèches. On se souviendra, en ces temps hâtifs et planificateurs que nous vivons, de sa formule qui ne cesse de gagner en pertinence : « Il ne faut pas faire l'Un trop vite ». Contre la fiction d'un universalisme abstrait, Gustave Thibon propose un retour au réel , celui du monde, avec ses limites et ses frontières heureuses ; celui de l'homme qui défaille et parfois se dépasse. Il suivra Nietzsche, pas à pas, dans son « humain, trop humain », dénonçant les leurres, la morale comme masque du ressentiment et de la faiblesse, non pour « déconstruire », et se livrer au désastre dans « un vacarme silencieux comme la mort » ainsi que l'écrivait Nietzsche, - noble naufragé qui en fit la tragique expérience, - mais pour comprendre que le vide qui se dissimule derrière nos vanités est appel à une plénitude infiniment proche et lointaine.
La faiblesse exagère tout. Son mode est l'outrance. Elle conspue, elle maudit, elle excommunie avec la rage de ceux dont la Foi est incertaine. Ces Propos d'avant-hier pour après-demain, le sont aussi pour notre pauvre aujourd'hui. Nous avons nos Robespierre, nos Précieuses ridicules, nos propagandistes du chaos, sous l'habit policé des technocrates, perfusés d'argent public, et tous ont pour dessein de faire table rase de notre héritage pour y établir leurs fatras, leurs encombrements de laideurs, de fictions lamentables, autant d'écrans entre nous et le monde ; écrans entre nous et un « au-delà de nous-mêmes », vaste mais autrefois familier, comme le furent les Rameaux, Pâques, Noël. - ces temporalités qualifiées où les hommes se retrouvaient entre eux et en eux-mêmes à la recherche de « la juste balance de l'âme » : « Existence simultané des incompatibles, balance qui penche des deux côtés à la fois : c'est la sainteté » écrivait Simone Weil, citée, dans ces pages, par Gustave Thibon.
Philosophe-paysan, Gustave Thibon le serait alors au sens où il nous intime de nous désembourgeoiser, de cesser, par exemple, de considérer l'argent comme le socle des valeurs et de retrouver le « dépôt à transmettre » : le fief, la terre, la religion. « Le socle dévore la statue (…), avarice bourgeoise, aucune magnificence, pas de générosité ; abaissement des valeurs : pour le marchand tout se chiffre – et mépris des valeurs artistiques ; mentalité étriquée (…) ; règne du Quantitatif. Les « gros » ont replacé les « grands ».
Où demeurer alors ? Gustave Thibon nous le dit, en forme de devise héraldique : « Contre l'espoir dans l'espoir ».
Luc-Olivier d'Algange
22:33 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
03/12/2023
Un article d'Eric Naulleau sur les "Propos réfractaires" de Luc-Olivier d'Algange:

Un article d'Eric NAULLEAU sur les Propos réfractaires de Luc-Olivier d'Algange, Le journal du dimanche, 5 novembre 2023.
Pour une vie poétique
Révélation. Cioran et Philippe Muray ont un fils, commet l'appellent-ils ? Luc-Olivier d'Algange ! Ses Propos réfractaires plongent leurs racines plus profondément encore dans la tradition des moralistes du dix-septième siècle, que l'auteur prend soin de distinguer des moralisateurs : « Le moralisateur ne peut penser qu'en accord préalable avec son groupe : il ne pense pas ce qu'il pense, il pense ce qu'il faut penser, en obéissant à l'argument d'autorité des spécialistes. »
Dissipons d'emblée un possible malentendu, nous n'avons pas ici affaire à quelque scrogneugneu du « c'était mieux avant ». Sculptés dans une langue dépouillée jusqu'à l'essentiel, ces fragments désignent tous la même issue hors d'une existence ravagée par le matérialisme en roue libre et « l'individualisme de masse » - il s'agit de rétablir l'homme dans toutes ses souverainetés perdues, de choisir « la passation du feu » contre « le parti des éteignoirs ». Soit renouer les liens entre visible et invisible, entre tradition et modernité, réveiller par l'écriture et par la lecture le souvenir des textes fondateurs et des matins du monde : « Un Grand Large scintille du fond de nos mémoires, l'âme odysséenne nous revient dans cette épiphanie d'eau et de lumière qu'avive le cours de nos phrases françaises. »
Luc-Olivier d'Algange descend volontiers du ciel des illuminations pour revenir sur terre afin de distribuer les aphorismes comme autant de bourre-pifs à l'époque : « Les modernes ont cette passion, nier l'évidence », « Nous ne reprochons pas à la vulgarité d'être vulgaire, mais d'être totalitaire » ou « il faut plus de force pour résister à la meute que pour en manger les restes : le politiquement correct s'explique ainsi. »
Nuire à la bêtise, après Nietzsche, tel est le programme, ou plutôt, nuire à l'assotement, son synonymes jeté au rebut par l'Académie française et ainsi remis à l'honneur : « Se laisser assoter n'est rien d'autre que se laisser vaincre. On nous assote par la veulerie et la frayeur, la distraction et le travail, par l'ignorance et par le bourrage de l'information, par les généralités idéologiques et par les potins, par la musique d'ambiance et par le vacarme des rues, par la désolation des centres commerciaux et par le puanteur de l'air, et même par les bons sentiments. »
Sortie par le très haut, par la transcendance entendue dans son sens le plus large, par cette voie étroite frayée entre fanatisme et nihilisme. Nul n'est à l'abri de la révélation, quand un poème fait soudain tourner sur ses gonds une porte dérobée et suscite une présence accrue au monde l'espace d'un instant ou tout au long d'un passage sur terre.
Dès lors que celui-ci se trouve garanti par l'or littéraire, comme la monnaie d'autrefois par l'or tout court, dès lors que l'ici-bas et l'au-delà deviennent l'endroit et la doublure d'une même étoffe, « dès lors que nous comprenons que toute grande politique s'ordonne et s'est toujours ordonnée à la poésie, dès lors que notre stratégie se fonde sur Homère, la Bhagavad-Gîta ou la Geste arthurienne plutôt que sur un stage "force de vente". »
Lus d'une traite ou à raison d'un fragment chaque matin au réveil, peu importe la posologie, ces Propos réfractaires fortifient la santé de l'esprit.
Eric NAULEAU
Propos réfractaires, LUC-OLIVIER D'ALGANGE, L'Harmattan, 192 pages, 21 euros
15:51 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
01/12/2023
Olivier François. D'où parle luc-Olivier d'Algange ?
Olivier François
Eléments N° 205, décembre 2023
D'où parle Luc-Olivier d'Algange ?
Certaines révoltes contre le monde moderne, certaines charges contre le désordre établi viennent parfois moins d'une aspiration au vrai, au beau et au juste que d'un ressentiment ou du désir de s'anéantir dans la défense d'une bonne cause. Il ne s'y entend pas un chant profond, mais des grincements de dents, la clameur des slogans scandés par les militants ou les trémolos de tribuns qui cherchent à rallier la foule des humiliés. Cela est sinistre et vindicatif. Cela est gros déjà de futurs conformismes, de servitudes inédites, de nouvelles formes d'abaissement et de dégradation. Il n'y a rien à espérer de ces révoltes d'esclaves qui se rêvent tyrans. Je suis assuré que Luc-Olivier d'Algange n'a jamais été un esclave et qu'il ne se rêve pas tyran. Il suffit s'ouvrir son dernier livre pour s'en convaincre. Propos réfractaires, recueil de discours et d'aphorismes que viennent de publier les éditions de l'Harmattan, signale encore une fois que cet écrivain a su se préserver des atteintes de l'époque et incarner une dissidence qui ne cède jamais à cet esprit de lourdeur qu'évoque Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathoustra. C'est hélas aujourd'hui une chose bien rare quand se multiplient les espèces les plus invasives de culs-de-plomb et d'imbéciles plombés.
Les réfractions d'un réfractaire
On en voit désormais qui agitent des drapeaux, qui revendiquent et qui protestent, comme dit la chanson, et qui se font une estrade de la poutre qu'ils ont trouvée dans l'oeil de leurs adversaires. Agités par les passions les plus tristes, ils arborent des faces vengeresses et se saoulent de rages impuissantes. Et ils nomment cela "lutter pour un monde plus juste et plus humain" . Luc-Olivier d'Algange, lui, n'est pas un entrepreneur en bonheur public et en simplification sociale. Il émane de ses livres un air d'altitude . On ne s'y sent jamais confiné. Pour ma part, en lisant d'Algange, il me semble toujours être un peu en promenade, en promenade quelque part en montagne, loin, très-loin des zones soumises au règne de la quantité où s'entassent les ruines, « ruines des choses, ruines des dogmes, ruines des institutions ». je chemine, je m'arrête un instant pour contempler le paysage ou pour méditer sur les joies et les mystères que nous offre l'univers. Je respire.
« D'où parle Luc-Olivier d'Algange ? » me demande un ami qui aime à employer ironiquement le vocabulaire des anciens gauchistes. C'est là une excellente question, cher camarade ! A rebours de beaucoup de nos contemporains, disons que l'auteur de Propos réfractaires sait cultiver ces anciennes vertus que sont la piété et la ferveur. Il ne pratique pas cette mélancolie morbide et cette nostalgie incapacitante qui précède souvent les redditions. Il n'a pas renié les dieux. « Contre le pouvoir qui nous avilit, que nous le subissions ou que nous l'exercions, les deux occurrences étant parfaitement interchangeables, des alliés nous sont donnés, qu'il faut apprendre à discerner dans la confusion des apparences. Ces alliés infimes ou immenses, dans l'extrême proximité ou le plus grand lointain, les hommes, jadis, les nommaient les dieux. » écrit-il. Et, plus loin loin, ces phrases qui peuvent servir de viatique : « Tant que, dans l'aventure, les dieux et les déesses veillent, rien n'est dit. Les circonstances les plus hostiles ou les plus favorables peuvent tourner et se retourner. Ce toujours possible est la puissance même, celle qui nous porte à échapper au monde des planificateurs et des statisticiens ».
Nos temps sont hostiles à toutes les formes de méditation, et le silence est violé ou calomnié . Le découragement nous guette et nous colle à l'âme comme une mauvaise graisse. Nous sommes encombrés par des êtres aussi que par des choses surnuméraires. Et nous évoluons dans un grand fatras d'événements qui se succèdent pour nous désorienter, nous désorbiter, nous énerver c'est-à-dire nous priver de ces nerfs qui nous permettraient de nos ressaisir. Le livre de Luc-Olivier d'Algange vient justement à point. Il faut en savourer toutes les pages. Peut-être aurez-vous soudain l'envie, en achevant la lecture, d'emprunter certains chemins peu défrichés, de quitter la zone ou d'aller au large.
Olivier François
Luc-Olivier d'Algange, Propos réfractaires, éditions de L'Harmattan, collection Théôria. 178 pages. 21 euros.
22:18 | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
26/07/2023
"La métaphysique enchantée", un article de Rémi Soulié sur le dernier livre de Luc-Olivier d'Algange
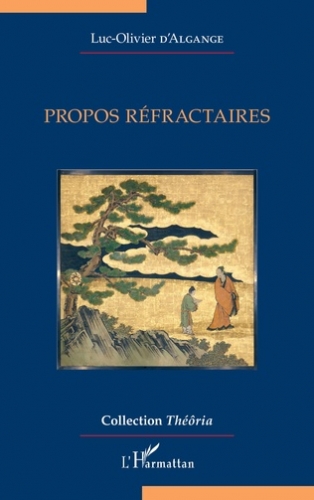
La Métaphysique enchantée
Il ne faut pas se méprendre sur le titre du dernier livre de l’admirable Luc-Olivier d’Algange, Propos réfractaires, en y entendant un écho, fût-il lointain, d’un ressentiment et d’une vengeance, ou en y soupçonnant un positionnement malencontreux qui le placerait sous la dépendance de ce qu’il observe de très loin mais, surtout, de très haut, soit, dirait Guénon, « la fin d’un monde », ou l’anéantissement d’une civilisation.
Si L.-O. d’Algange était un guerrier, je dirais qu’il a le calme des vieilles troupes ; comme c’est un brahmane ou, si l’on préfère, un métaphysicien-poète, je dirais plutôt qu’il a la sérénité du sage. Nul énervement, chez lui (dans tous les sens du mot), mais la paix de celui qui a séjourné au Centre (la « paix du Christ », dira-t-on préférentiellement sous nos latitudes) ou qui, sait-on jamais, a aussi la vertu platonicienne de force pour y demeurer.
L’ « Égout central », comme dirait Renaud Camus, est pourtant torrentiel – cette excellente formule désigne l’une des parodies modernes du Centre et l’une des inversions caractéristiques du Kali-Yuga, terme sanskrit que l’Évangile traduit par « abomination de la désolation » (βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως) et Heidegger par « détresse » (die Not) : destruction de la langue, envahissement de la laideur, démonie de l’économie (Julius Evola), propagandes publicitaires et idéologiques, mélange des castes (René Guénon) puis indistinction, uniformisation, planifications, etc.
Au chaos titanique, L.-O. d’Algange oppose non la rage – ce qui reviendrait à se placer sur le cercle infernal (Tartare) des Titans – mais « le sourire de la pensée la plus profonde » (ainsi Montherlant désignait-il le sourire du Bouddha) et, au vacarme caverneux qui, hélas non sans succès, essaie de recouvrir le son de la vibration initiale (AUM ou Fiat lux), l’écoute ou la contemplation attentive et précaire (priante, donc) du Logos resplendissant, le silence d’où surgit la parole, la vox cordis. Cela suppose donc de comprendre le temps tel qu’il est, en le relativisant (ce qui exclut toute religion de l’histoire) et de percevoir en lui, selon la formule platonicienne, l’image mobile de l’éternité immobile. Qui parvient, ainsi, à se centrer, devient littéralement hors d’atteinte – ce que nous sommes depuis toujours mais que nous avons le plus grand mal à réaliser tant nous sommes attachés à l’illusion phénoménale, laquelle a un versant obscur et lumineux, un ubac et un adret (l’essentiel étant de gravir la montagne, évidemment, sans perdre de vue le sommet).
Avec raison, L.-O. d’Algange insiste sur le second, ce qui est également ma pente, si j’ose dire, d’autant plus que dans l’Âge sombre, la splendeur phénoménale, naturellement, s’obscurcit et que les ténèbres paraissent tout recouvrir, interdisant (et, à travers ses agents, pénalisant) toute recouvrance. La métaphysique consiste à fermer les yeux pour voir, certes (la preuve par ces hauts métaphysiciens que furent Homère ou Tirésias), ou à les ouvrir jusqu’à l’éblouissement, ce qui revient au même (je songe au soleil platonicien). Quoi qu’il en soit, voir, c’est toujours savoir. La question se pose alors de savoir qui voit quoi.
Le poète, bien entendu, est le voyant (ou le clairvoyant) par excellence. Pour lui, dit Goethe, le bleu du ciel est la théorie (θεωρία), la contemplation même – ce pourquoi la couverture de la collection Théôria (dirigée par le non moins admirable Pierre-Marie Sigaud), dans laquelle le livre de L.-O. d’Algange est publié, est aussi bleue que le manteau de la Vierge. Il faut être aussi obtus qu’un Chinois de Königsberg pour ne pas voir que le phénomène est le noumène et qu’il n'y a même que lui qui soit (le Noûs, le νοῦς). Comment voulez-vous voir les formes si vous ne voyez pas les dieux ? Le sortilège est devenu si puissant que nos contemporains ne voient même plus l’envers de la Sainte Face, qui s’affiche pourtant sur tous les écrans et dont le nom est Légion. Ce livre est un pharmakon, mais au sens exclusif de l’antipoison. Autant dire qu’il est un enchantement et qu’il relève donc du réalisme le plus profond.
Un bref Propos, moins métaphysique en apparence, qui convaincra les plus politiques d’entre nous : « La Monarchie était sensiblement mieux une république que ne le sont nos démocraties. Plus nos démocraties liquident l’héritage royal et plus elles s’éloignent de la res publica : on s’afflige d’avoir à énoncer, contre l’opinion générale, de pareilles évidences ».
Propos réfractaires ? Certes, mais surtout, Propos réfracteurs de lumière.
Rémi Soulié
Luc-Olivier d’Algange, Propos réfractaires, L’Harmattan.
21:29 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
18/07/2023
Le "Nocturne" de D'Annunzio, pour la première fois en ce siècle, dans son texte intégral avec les gravures d'origine:
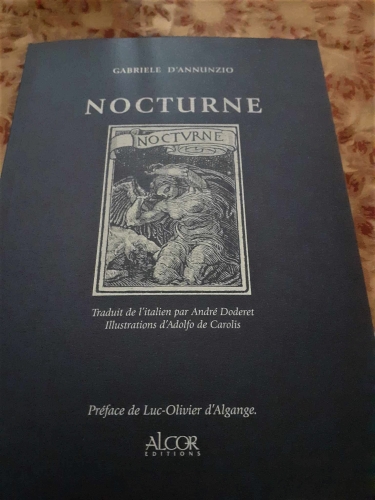
266 pages, 25 euros, aux éditions Alcor.
16:21 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
28/06/2023
Vient de paraître:
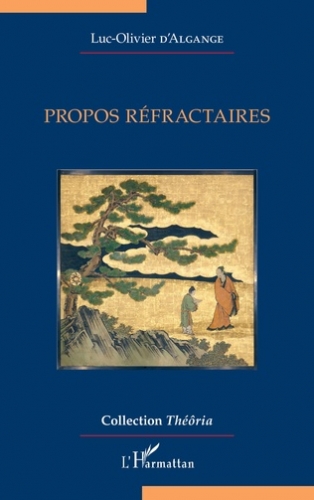
180 pages, 21euros
14:39 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
27/05/2023
Luc-Olivier d'Algange, Prologue aux "Propos réfractaires", nouvelle édition augmentée, à paraître en Juin, aux éditions de L'Harmattan:

Luc-Olivier d'Algange
Prologue aux Propos réfractaires
Le titre de cet ouvrage est venu de lui-même, et presque malgré nous. Quelques mots ne seront pas inutiles pour en dissiper le malentendu possible. Etre réfractaire n'est pas un projet, ni une vocation, et, à Dieu ne plaise, une pose. Le monde est assez achalandé de subversifs subventionnés, de marchands de libertés par procuration, de fortes gueules approximatives, de râleurs et de rabat-joie pour, au moins, hésiter de faire chœur avec eux.
Le monde moderne, certes, est sinistre, et sans en disconvenir, il convient de ne point trop mélancoliser et de tenir la bride courte aux nostalgies. Réfractaires, nous eussions préféré ne l'être pas, et recevoir le monde qui nous entoure, mais désormais nous enserre avec une idiosyncrasie carcérale , avec moins de réticences ; la ferveur et la piété sont plus aimables.
Une civilisation et une civilité s'effacent. Dans leur relativisme général, les intellectuels bien-pensant s'en indiffèrent. Mais la conséquence est là : voici le temps des calculateurs, des moroses, des jaloux, des agités et des dépités, qui ne savent ce qu'est servir plus grand que soi, ou plus vaste, - encalminés dans leurs subjectivités ulcérées, fermés à toute contemplation : rats traqués se dévorant entre eux dans les remugles du ressentiment, tandis que les barbares prennent la place.
Pour atteindre à une affirmation souveraine, si lointaine de nos conditions, de nos fragilités, de nos incertitudes réelles, sans doute faut-il passer par la « négation de la négation » et ne pas méconnaître, car elle agit sur nous, cette grande machine de guerre planificatrice, en mouvement contre tout ce que nous aimons, ici et ailleurs, dans la diaprure des êtres et des choses, dans leurs singularités vivantes, dans le ressac du passé qu'elles nous portent, tels des embruns de pointe océanique. N'opposons pas un système à un autre, qui en serait l'envers ou la grimace. Nous sommes fugaces, comme une allumette brûlée au cœur de la nuit, mais d'un unique éclat. Que peut nous chaloir d'être agrégé à d'autres dont on supposerait qu'ils partagent nos révoltes et nos malheurs ? Le collectivisme comme l'individualisme de masse participent l'un et l'autre de notre expropriation, du refus de qui nous est propre : tradition, flamme presque indiscernable, qui passe, de mains en mains. L'amitié est notre seule cause commune.
Les idéologues, ces dévergondés de l'abstraction, sont flatteurs et vivent aux dépens de ceux qu'ils prétendent défendre, ou, pire encore, « représenter », en les réduisant à leurs plus petits dénominateurs communs. Cette morne ruse n'est courue que par la presque infinie complaisance des hommes de notre temps à se faire plaindre et à vouloir « exister » non par leurs propres vertus, ou vices, dont ils héritent ou qu'ils inventent, mais par un statut de victime qui leur serait accordé d'office et sur lequel ils pourraient se reposer, - sans voir que ceux qui les encouragent à ce triste rôle se servent d'eux, et les avilissent. Le beau fromage de la reconnaissance sociale tombe ainsi du bec aux dents, et leur ultime bien, qui était leur irréductible singularité, leur est ôté dans une statistique.
Il sera donc question, dans ces digressions et ces formes brèves, de ce qui, dans la nature humaine, résiste à ce qui voudrait nous uniformiser et nous avilir. L'ambition, somme toute est modeste, mais parfois modestie est gageure : demeurer humain dans un monde qui ne songe qu'à nous appareiller pour nous faire « trans-humain » ou nous installer, devant nos écrans, dans la servitude volontaire d'un confort « post-humain ». La voie qui rechigne à de si vantées perspectives, est parfois capricieuse et risquée, mais souvent bienheureuse en ce qu'elle nous relie à des beautés oubliées. D'où vient notre pensée ? Elle vient d'autres pensées et du monde. De la séquence de Sainte-Eulalie; de la romance arthurienne; de nos promenades en forêt ou au bord de la mer ; des nuits traversées au long cours jusqu'au petit matin froid et rose; d'Héraclite d'Ephèse et de son feu mêlé d'aromates dans l'Obscur; de la délicatesse violente de Valéry Larbaud; des romans d'aventure qui disent la vraie vie; des orages dont parle Henry Bosco; du Sacre de la cathédrale de Reims; de l'Éclair dans l'éclair d'Angélus Silésius; de l'ermitage aux buissons blanc; du gaélique et de la kabbale des arbres; de l'épaule de cette jeune femme où j'ai posé mes lèvres; de la lumière qui est l'ombre de Dieu.
Etre réfractaire, ce serait alors se souvenir que nous avons reçu bien plus que nous ne pourrions jamais donner. Rompre là, pour mieux honorer, s'éloigner de ceux qui déprécient, qui se vengent, pour mieux s'approcher de l'éloge ingénu. Si l'on considère à quel point les moralisateurs, de nos jours, enlaidissent le monde par leurs griefs, leurs jalousies, leurs morosités, leurs hystéries, leurs récriminations, leurs censures, leurs menaces et leurs jugements, à quel point ils jettent, venimeuses vermines, une systématique suspicion empoisonnée sur toute forme de beauté et de grandeur, à quel point ils sont aveugles à la vérité et au réel en leurs nuances, leurs gradations et leurs variations, nous devons reconnaître que l'alliance immémoriale entre le vrai, le beau et le bien a, hélas, été rompue, collectivement et délibérément, et que seules les âmes légères, baroques, désinvoltes, rares heureux, fils de Roi, pourront en retrouver le goût, la saveur, qui est sapience.
La reconnaissance est la clef et sa mission, que résume propos du grand Latin, « naviguer est nécessaire mais il n'est pas nécessaire de vivre » offre aux réfractaires cet horizon d'enfance qui détient un secret de poésie : combattre l'indéfini, la confusion, l'indistinction avec les armes de l'infini et reconquérir enfin nos paysages et l'armorial des songes dans les étymologies de notre langue natale.
L-O.d'A.
Bibliographie
-
Manifeste baroque, Toulouse, Cééditions, 1981
-
Orphiques, éditions Style, 1988
-
Le Secret d'or, éditions des Nouvelles Littératures Européennes, 1989
-
La Victoire de Castalie, Aguessac, Editions Clapàs, 2000
-
Traité de l'ardente proximité, Aguessac, Éditions Clapàs, 2005
-
L'Étincelle d'or : notes sur la science d'Hermès, Paris, Les Deux Océans, 2006
-
L'Ombre de Venise, essai, Billère, Alexipharmaque, 2006
-
Le Songe de Pallas , suivi de De la souveraineté et de Digression néoplatonicienne, essai, Billère, Alexipharmaque, 2007
-
Fin mars. Les hirondelles, éditions Arma Artis, 2009
-
Terre lucide. Entretiens sur les météores (avec Philippe Barthelet), La Bégude de Mazenc, Éditions Arma Artis, 2010 ; rééd. revue et corrigé Editions L'Harmattan, coll. Théôria, 302 p., 2022
-
Le Chant de l'Ame du monde, poèmes, éditions Arma Artis, 2010
-
Lectures pour Frédéric II, Alexipharmaque, 2011
-
Lux Umbra Dei, éditions Arma Artis, 2012
-
Propos réfractaires, éditions Arma Artis, 2013
-
Au seul d'une déesse phénicienne, éditions Alexipharmaque, 2014
-
Apocalypse de la beauté, éditions Arma Artis, 2014
-
Métaphysique du dandysme, éditions Arma Artis, 2015
-
Intempestiva Sapientia, suivi de L'Ange-Paon, éditions Arma Artis, 2016
-
Notes sur L'éclaircie de l'être, éditions Arma Artis, 2016
-
Le Déchiffrement du monde : la gnose poétique d'Ernst Jünger, Paris, L'Harmattan, coll. Théôria, 2017 )
-
Sous la dir. de Pierre-Yves Rougeyron, Pourquoi combattre ?, Éditions Perspectives Libres, Paris, Janvier 2019, .
-
L'Âme secrète de L'Europe : Œuvres, mythologies, cités emblématiques, Paris, L'Harmattan, coll. Théôria, 2022.
-
Terre Lucide entretiens sur les météores et les signes des temps (avec Philippe Barthelet) Paris, L'Harmattan, coll.Théôria, 2023.
Propos réfractaires, édition revue et augmentée, Paris, L'Harmattan ( à paraître)
19:37 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
08/04/2023
Luc-Olivier d'Algange, Mythe et Logos:

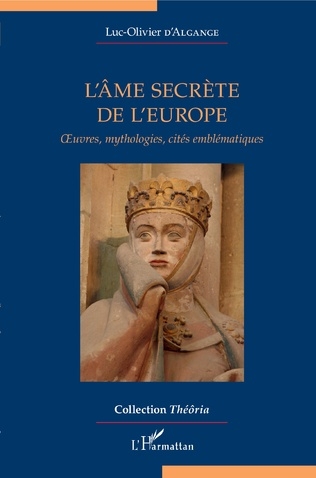
19:12 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
05/04/2023
Luc-Olivier d'Algange, Hommage à Roger Nimier:

Luc-Olivier d’Algange
Hommage à Roger Nimier
Roger Nimier fut sans doute le dernier des écrivains, et des honnêtes gens, à être d'une civilisation sans être encore le parfait paria de la société; mais devinant cette fin, qui n'est pas une finalité mais une terminaison.
Après les futilités, les pomposités, les crises anaphylactiques collectives, les idéologies, viendraient les temps de la disparition pure et simple, et en même temps, des individus et des personnes. L'aisance, la désinvolture de Roger Nimier furent la marque d'un désabusement qui n'ôtait rien encore à l'enchantement des apparences. Celles-ci scintillent un peu partout dans ses livres, en sentiments exigeants, en admirations, en aperçus distants, en curiosités inattendues.
Ses livres, certes, nous désabusent, ou nous déniaisent, comme de jolies personnes, du Progrès, des grandes abstractions, des généralités épaisses, mais ce n'est point par une sorte de vocation éducative mais pour mieux attirer notre attention sur les détails exquis de la vie qui persiste, ingénue, en dépit de nos incuries. Roger Nimier en trouvera la trace aussi bien chez Madame de Récamier que chez Malraux. Le spectre de ses affections est large. Il peut, et avec de profondes raisons, trouver son bien, son beau et son vrai, aussi bien chez Paul Morand que chez Bernanos. Léautaud ne lui interdit pas d'aimer Péguy. C'est assez dire que l'esprit de système est sans prise sur lui, et que son âme est vaste.
On pourrait en hasarder une explication psychologique, ou morale. De cette œuvre brève, au galop, le ressentiment qui tant gouverne les intellectuels modernes est étrangement absent. Nimier n'a pas le temps de s'attarder dans les relents. Il va à sa guise, voici la sagesse qu'il nous laisse. Ses quelques mots pointus, que l'on répète à l'envie, et que ses fastidieux épigones s'efforcent de reproduire, sont d'un piquant plus affectueux que détestateur. Pour être méchant, il faut être bien assis quelque part, avec sa garde rapprochée. Or le goût de Roger Nimier est à la promenade, à l'incertitude, à l'attention. Fût-ce par les méthodes de l'ironie, il ne donne pas la leçon, mais invite à parcourir, à se souvenir, à songer, - exercices dont on oublie souvent qu'ils exigent une intelligence toujours en éveil. Son goût n'est pas une sévérité vétilleuse dissimulée sous des opinions moralisatrices, mais une liberté exercée, une souveraineté naturelle. Il ne tient pas davantage à penser comme les autres qu'il ne veut que les autres pensent comme lui, puisque, romancier, il sait déjà que les autres sont déjà un peu en lui et lui dans les autres. Les monologues intérieurs larbaudiens du Hussard bleu en témoignent. Nimier se défie des représentations et de l'extériorité. Sa distance est une forme d'intimité, au rebours des familiarités oppressantes.
L'amour exige de ces distances, qui ne sont pas seulement de la pudeur ou de la politesse mais correspondent à une vérité plus profonde et plus simple: il faut aux sentiments de l'espace et du temps. Peut-être écrivons nous, tous, tant bien que mal, car nous trouvons que ce monde profané manque d'espace et de temps, et qu'il faut trouver quelque ruse de Sioux pour en rejoindre, ici et là, les ressources profondes: le récit nous autorise de ses amitiés. Nul mieux que Roger Nimier ne sut que l'amitié est un art, et qu'il faut du vocabulaire pour donner aux qualités des êtres une juste et magnanime préférence sur leurs défauts. Ceux que nous admirons deviendront admirables et la vie ressemblera, aux romans que nous écrivons, et nos gestes, aux pensées dites « en avant ». Le généreux ne jalouse pas.
Il n'est rien de plus triste, de plus ennuyeux, de plus mesquin que le « monde culturel », avec sa moraline, son art moderne, ses sciences humaines et ses spectacles. Si Nimier nous parle de Madame Récamier, au moment où l'on disputait de Mao ou de Freud, n'est-ce pas pour nous indiquer qu'il est possible de prendre la tangente et d'éviter de s'embourber dans ces littératures de compensation au pouvoir absent, fantasmagories de puissance, où des clercs étriqués jouent à dominer les peuples et les consciences ? Le sérieux est la pire façon d'être superficiel; la meilleure étant d'être profond, à fleur de peau, - « peau d'âme ». Parmi toutes les mauvaises raisons que l'on nous invente de supporter le commerce des fâcheux, il n'en est pas une qui tienne devant l'évidence tragique du temps détruit. La tristesse est un péché.
Les épigones de Nimier garderont donc le désabusement et s'efforceront de faire figure, pâle et spectrale figure, dans une société qui n'existe plus que pour faire disparaître la civilisation. La civilisation, elle, est une eau fraîche merveilleuse tout au fond d'un puits; ou comme des souvenirs de dieux dans des cités ruinées. L'allure dégagée de Roger Nimier est plus qu'une « esthétique », une question de vie ou de mort: vite ne pas se laisser reprendre par les faux-semblants, garder aux oreilles le bruit de l'air, être la flèche du mot juste, qui vole longtemps, sinon toujours, avant son but.
Les ruines, par bonheur, n'empêchent pas les herbes folles. Ce sont elles qui nous protègent. Dans son portrait de Paul Morand qui vaut bien un traité « existentialiste » comme il s'en écrivait à son époque (la nôtre s'étant rendue incapable même de ces efforts édifiants), Roger Nimier, après avoir écarté la mythologie malveillante de Paul Morand « en arriviste », souligne: « Paul Morand aura été mieux que cela: protégé. Et conduit tout droit vers les grands titres de la vie, Surintendant des bords de mer, Confident des jeunes femmes de ce monde, Porteur d'espadrilles, Compagnons des vraies libérations que sont Marcel Proust et Ch. Lafite. »
Etre protégé, chacun le voudrait, mais encore faut-il bien choisir ses Protecteurs. Autrefois, les tribus chamaniques se plaçaient sous la protection des faunes et des flores resplendissantes et énigmatiques. Elles avaient le bonheur insigne d'être protégées par l'esprit des Ours, des Lions, des Loups ou des Oiseaux. Pures merveilles mais devant lesquelles ne cèdent pas les protections des Saints ou des Héros. Nos temps moins spacieux nous interdisent à prétendre si haut. Humblement nous devons nous tourner vers nos semblables, ou vers la nature, ce qui n'est point si mal lorsque notre guide, Roger Nimier, nous rapproche soudain de Maurice Scève dont les poèmes sont les blasons de la langue française: « Où prendre Scève, en quel ciel il se loge ? Le Microcosme le place en compagnie de Théétète, démontant les ressorts de l'univers, faisant visiter les merveilles de la nature (...). Les Blasons le montrent couché sur le corps féminin, dont il recueille la larme, le soupir et l'haleine. La Saulsaye nous entraîne au creux de la création dans ces paradis secrets qui sont tombés, comme miettes, du Jardin royal dont Adam fut chassé. »
Hussard, certes, si l'on veut, - mais pour quelles défenses, quelles attaques ? La littérature « engagée » de son temps, à laquelle Nimier résista, nous pouvons la comprendre, à présent, pour ce qu'elle est: un désengagement de l'essentiel pour le subalterne, un triste "politique d'abord" (de Maurras à Sartre) qui abandonne ce qui jadis nous engageait (et de façon engageante) aux vertus mystérieuses et généreuses qui sont d'abord celles des poètes, encore nombreux du temps de Maurice Scève: « Ils étaient pourtant innombrables, l'amitié unissait leurs cœurs, ils inspiraient les fêtes et décrivaient les guerres, ils faisaient régner la bonté sur la terre. » De même que les Bardes et les Brahmanes étaient, en des temps moins chafouins, tenus pour supérieurs, en leur puissance protectrice, aux législateurs et aux marchands, tenons à leur exemple, et avec Roger Nimier, Scève au plus haut, parmi les siens.
Roger Nimier n'étant pas « sérieux », la mémoire profonde lui revient, et il peut être d'une tradition sans avoir à le clamer, ou en faire la réclame, et il peut y recevoir, comme des amis perdus de vue mais nullement oubliés, ces auteurs lointains que l'éloignement irise d'une brume légère et dont la présence se trouve être moins despotique, contemporains diffus dont les amabilités intellectuelles nous environnent.
Qu'en est-il de ce qui s'enfuit et de ce qui demeure ? Chaque page de Roger Nimier semble en « répons » à cette question qui, on peut le craindre, ne sera jamais bien posée par l'âge mûr, par la moyenne, - dans laquelle les hommes entrent de plus en plus vite et sortent de plus en plus tard, - mais par la juvénilité platonicienne qui emprunta pendant quelques années la forme du jeune homme éternel que fut et demeure Roger Nimier, aimé des dieux, animé de cette jeunesse « sans enfance antérieure et sans vieillesse possible » qu'évoquait André Fraigneau à propos de l'Empereur Julien.
Qu'en est-il de l'humanité lorsque ces fous qui ont tout perdu sauf la raison régentent le monde ? Qu'en est-il des civilités exquises, et dont le ressouvenir lorsqu’elles ont disparu est exquis, précisément comme une douleur ? Qu'en est-il des hommes et des femmes, parqués en des camps rivaux, sans pardon ? Sous quelle protection inventerons-nous le « nouveau corps amoureux » dont parlait Rimbaud ? Nimier écrit vite, pose toutes les questions en même temps, coupe court aux démonstrations, car il sait que tout se tient. Nous perdons ou nous gagnons tout. Nous jouons notre peau et notre âme en même temps. Ce que les Grecs nommaient l'humanitas, et dont Roger Nimier se souvient en parlant de l'élève d'Aristote ou de Plutarque, est, par nature, une chose tant livrée à l'incertitude qu'elle peut tout aussi bien disparaître: « Et si l'on en finissait avec l'humanité ? Et si les os détruits, l'âme envolée, il ne restait que des mots ? Nous aurions le joli recueil de Chamfort, élégante nécropole où des amours de porphyre s'attristent de cette universelle négligence: la mort ».
Par les mots, vestiges ultimes ou premières promesses, Roger Nimier est requis tout aussi bien par les descriptifs que par les voyants, même si « les descriptifs se recrutent généralement chez les aveugles ». Les descriptifs laisseront des nécropoles, les voyants inventeront, comme l'écrivait Rimbaud « dans une âme et un corps ». Cocteau lui apparaît comme un intercesseur entre les talents du descriptif et des dons du voyant, dont il salue le génie: «Il ne fait aucun usage inconsidéré du cœur et pourtant ses vers ont un caractère assez particulier: ils semblent s'adresser à des humains. Ils ne font pas appel à des passions épaisses, qui s'essoufflent vite, mais aux patientes raisons subtiles. Le battement du sang, et c'est déjà la mort, une guerre, et c'est la terre qui mange ses habitants ».Loin de nous seriner avec le style, qui, s'il ne va pas de soi, n'est plus qu'un morose « travail du texte », Roger Nimier va vers l'expérience, ou, mieux encore, vers l'intime, le secret des êtres et des choses: « Jean Cocteau est entré dans un jardin. Il y a trouvé des symboles. Il les a apprivoisé. »
Loin du cynisme vulgaire, du ricanement, du nihilisme orné de certains de ses épigones qui donnent en exemple leur vide, qui ne sera jamais celui des montagnes de Wu Wei, Roger Nimier se soucie de la vérité et du cœur, et de ne pas passer à côté de ce qui importe. Quel alexipharmaque à notre temps puritain, machine à détruire les nuances et qui ne connaît que des passions courtes ! Nimier ne passe pas à côté de Joseph Joubert et sait reconnaître en Stephen Hecquet l'humanité essentielle (« quel maître et quel esclave luttant pour la même cause: échapper au néant et courir vers le soleil ») d'un homme qui a « Caton pour Maître et Pétrone pour ami. » Sa nostalgie n'est pas amère; elle se laisse réciter, lorsqu'il parle de Versailles, en vers de La Fontaine: « Jasmin dont un air doux s'exhale/ Fleurs que les vents n'ont su ternir/ Aminte en blancheur vous égale/ Et vous m'en faites souvenir ».
On oublie parfois que Roger Nimier est sensible à la sagesse que la vie et les œuvres dispensent « comme un peu d'eau pris à la source ». La quête d'une sagesse discrète, immanente à celui qui la dit, sera son génie tutélaire, son daemon, gardien des subtiles raisons par l'intercession de Scève: « En attendant qu'à dormir me convie/ Le son de l'eau murmurant comme pluie ».
Luc-Olivier d'Algange
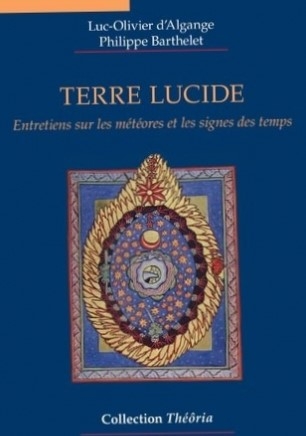
19:11 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
03/04/2023
Luc-Olivier d'Algange, notes sur Fernando Pessoa:

Luc-Olivier d’Algange
Hétéronymes et « états multiples de l’être »
Notes sur l’œuvre de Fernando Pessoa
Le dessein initiatique de Fernando Pessoa est de donner accès à ce paysage qui, bien qu'il soit à jamais, à l'exemple du poète, « tel qu'en lui-même l'éternité le change », offre des visages multiples. De même que change l'apparence de la mer et des feuillages selon la position du soleil, de même, dans l'œuvre de Fernando Pessoa, change, par l'usage des hétéronymes et en vertu des états multiples de l'être, le sens et l'orientation du poème.
Tout va se jouer dans cette autre conception de l'être et du temps dont la perspective non-utilitaire suffit déjà à nous délivrer des identités fixées par des déterminismes étrangers à la poésie et à la métaphysique. Il suffit que le désir de transmettre un message spirituel prime sur l'utilité de la « communication » pour que nous entrions dans cet espace limpide et incandescent où les « valeurs » du monde moderne ne sont plus que d'imperceptibles écorces de cendre. Le sens d'un poème, alors, s'avère identique, par essence, au sens d'une cathédrale, d'un cairn, d'une rune gravée sur la pierre qui contient l’audace de transcender le temps, la volonté d'abattre Kronos du trait de cette lance de feu que l'on nomme l'Instant. A cette exigence correspondent également une éthique et une esthétique.
L'initiation n'est pas une formalité. Elle n'est pas le résultat invariable de quelques lectures ou rituels choisis, mais avant tout, pour reprendre le mot de Malraux, le destin d'un « anti-destin », une rébellion, éternisée par l'Instant, contre les déterminismes et les normes profanes qui nous condamnent habituellement à la médiocrité, à la banalité hargneuse ou satisfaite, morne ou fanfaronne. Le monde moderne étant, par définition, un monde subverti (et particulièrement dans ses mœurs les plus bourgeoises), il ne saurait être question d'y prôner ces valeurs d'obéissance, de fidélité, d'enracinement, ou de civisme, qui seraient légitimes dans un ordre traditionnel. L'homme de la Tradition ne saurait obéir au chaos, être fidèle à l'ignorance, s'enraciner dans la parodie ni certes exercer les vertus civiques à l'endroit d'une société qui, à chaque instant, bafoue le Vrai, le Beau et le Bien.
Disciple sur une terre traditionnelle, l'homme de la Tradition se voudra, ainsi que l’écrit Fernando Pessoa, « indisciplineur » dans le monde moderne et bourgeois: « Le Portugal a besoin d'un indisciplineur... Travaillons au moins, nous les jeunes, à perturber les âmes, à désorienter les esprits... » Que ceci nous aide à dissiper une fois pour toute l'équivoque issue de l'usage ésotérique ou initiatique du mot Tradition. L'homme de la Tradition sera toujours, à l'égard des morales bourgeoises, travaillistes ou grégaires infiniment plus « libertaire » que ceux-là mêmes qui se revendiquent comme tels. L'initiation commence par une révolte contre l'identité profane, c'est-à-dire, comme l'indique le sens même du mot révolte, par un retour sur soi. L'aventure débute ainsi: il faut rompre les amarres, être fidèle, non aux convenances, mais à l'appel du Grand Large que décrit admirablement l'hétéronyme Alvaro de Campos, dans son Ode maritime:
« Mais mon âme est avec ce que je vois le moins
Avec le paquebot qui entre
Parce qu'il est avec la Distance, avec le Matin
Avec la signification maritime de cette Heure... »
Pessoa évoque ainsi, dans une splendide inspiration néoplatonicienne:
« Le Grand Quai Antérieur, éternel et divin,-
De quel port? En quelles eaux? Et pourquoi ainsi ai-je rêvé
Grand Quai, comme les autres quai, mais l'Unique
Plein comme eux de silences bruissant dès l'aurore... »
L’Idée est très-exactement une chose vue, ainsi que nous l'enseignent Jamblique, Proclus ou Porphyre. Le matin profond de la vision commence le temps sacré, le Grand Départ vers les jardins de la mer, et le vent est soudain annonciateur de la présence invisible, mais indubitable, de l'Ile Verte, refuge des dieux et des héros, qui n'est autre que le Soi:
« Plus je sentirai, plus je sentirai en personnes diverses,
Plus j'aurai de personnalités
Plus je les aurai avec intensité, avec stridence
Plus je sentirai simultanément avec elles toutes
Plus divers dans l'unité, attentif dans la dispersion
Je sentirai, je vivrai, je serai dans l'Instant et dans mon essence,
Plus je possèderai l'existence totale de l'univers
Plus je serai complet dans l'espace entier
Plus je serai analogue à Dieu, quel qu'il soit
Parce que, quel qu'Il soit, Lui à coup sûr, est Tout
Et hors de Lui il n'est que Lui, et tout pour Lui n'est guère.
Chaque âme est une échelle qui mène à Dieu
Chaque âme est un corridor-univers qui débouche sur Dieu... »
Nul mieux qu'Alvaro de Campos, dans son Ode Maritime, n'éclaire le sens même du dessein « hétéronymique » de Fernando Pessoa, qui, en aucune façon ne saurait se réduire à quelque jeu littéraire (du genre oulipiste) issu de quelque scepticisme philosophique, de même que l'on ne saurait réduire l'ésotérisme à un vague syncrétisme de croyances religieuses. « La religion, écrit René Guénon, considère l'être uniquement dans l'état individuel humain et ne vise aucunement à l'en faire sortir mais au contraire à lui assurer les conditions les plus favorables à cet état même, tandis que l'initiation a essentiellement pour but de dépasser les possibilités de cet état et de rendre effectivement possible le passage aux états supérieurs, et même, finalement, de conduire l'être au-delà de tout état conditionné quel qu'il soit. » La fonction de l'acteur, du personnage et du masque s'en trouvent singulièrement éclairée. « L'acteur, écrit encore René Guénon, est un symbole du Soi ou de la personnalité se manifestant par une série indéfinie d'états et de rôles différents, et il faut noter l'importance qu'avait l'usage du masque pour la parfaite exactitude de ce symbolisme. » Le propre de l'œuvre de Fernando Pessoa étant justement de se manifester « par une multiplicité de noms représentant autant de modalités de l'être », le théâtre spirituel dissimule et divulgue à la fois l'unité du dessein et du message.
Indissolublement liés, l'œuvre et la destinée de Fernando Pessoa semblent ainsi illustrer cet autre propos de René Guénon concernant les noms profanes et les noms initiatiques: « La désignation par un nom profane, même si elle est exacte matériellement, sera toujours entachée de fausseté, à peu près comme le serait la confusion entre un acteur et un personnage dont il joue le rôle et dont on s'obstinerait à lui appliquer le nom dans toutes les circonstances de son existence... On peut aller plus loin: à tous degrés d'initiation effective correspond encore une autre modalité de l'être; celui-ci devra donc recevoir un nom pour chacun de ces degrés. »
Un nombre considérable d'études se contentent de constater des similitudes symbologiques ou thématiques entre certains textes littéraires et le corpus des écrits dits « ésotériques » sans toutefois s'attacher à préciser la nature de la ressemblance, laquelle peut être d'ordre purement formel, et donc, sans aucune conséquence autre qu'ornementale, ou, au contraire, témoigner d'une expérience de la pensée qui réactualise véritablement l'esprit des Mystères. Il se peut aussi qu'un dessein ou un processus initiatique soient présents en des œuvres qui, par ailleurs, ne portent aucune référence explicite à la Tradition. On pourrait dire que, par définition même, les formes et les références sont toujours d’importance secondaire. Ainsi que l'écrit Joao Gaspar Simoes (in Vida e obra de Fernando Pessoa, qui publié en 1949, fut le premier livre consacré à Pessoa): « La grandeur de sa poésie ne réside pas tant dans ses extrêmes beautés de forme ou dans ses prodigieuses richesses de contenus, ou dans la complexité de l'âme même du poète qui l'a produite que dans le fait qu'elle se trouve toute entière réellement structurée sur une pensée métaphysique, métaphysique magique, métaphysique occultiste, si l'on veut mais non moins révélatrice, pour autant, d'une conscience qui vécut en communion avec l'insondable mystère. »
De même que la rigueur, qui tranche de façon systématique et puritaine, s'oppose à l'exactitude, qui discerne et respecte les nuances, de même les convenances, les conformismes et les fondamentalismes sont les ennemis de la Tradition. L'uniformité est la parodie et l'ennemie de l'unité. La théorie du corps des couleurs d'Oswald (que cite à juste escient l'auteur anonyme des Méditations sur les 22 arcanes majeurs du Tarot) éclaire cette idée. Ce corps de couleur est constitué de deux cônes et donc de deux pôles et d'un équateur. Le pôle « nord » est le pôle blanc, synthèse de toutes les couleurs. La lumière blanche se différencie de plus en plus à mesure qu'elle descend vers l'équateur. Les mêmes couleurs, en continuant leur descente de l'équateur vers le pôle sud perdent progressivement leurs distinctions, s'obscurcissent et deviennent toutes également noires. Le pôle blanc est la synthèse, le pôle noir la confusion de toutes les couleurs. Or, ce point lumineux de synthèse transcendante (qui correspond à l'En-Sof de l'Arbre séphirotique) se retrouve dans tous les ordres de la pensée et du monde. Il est, en quelque sorte, la clef de voûte de toute herméneutique du Livre et du monde. Ainsi, l'idée de Tradition primordiale correspond de toute évidence au pôle blanc alors que l'universalisme moderne, qui réduit tous les hommes au plus petit dénominateur commun, correspond au pôle noir. En tout ce qui concerne l'initiation et les sciences traditionnelles, voire les questions métapolitiques, il importe de garder présente à l'esprit cette distinction, sous peine de lâcher la proie pour l'ombre et se laisser abuser par des contrefaçons, les totalitarismes uniformisateurs s'opposant ici à l'unificence impériale. Aussi bien ne s'étonnera-t-on pas de trouver l'idée d'Empire au cœur même de la pensée de Fernando Pessoa dont l'œuvre, il faut le redire, ne vise point à charmer les loisirs mais se propose comme un instrument de transmutation de l'entendement.
« Tout Empire, écrit Fernando Pessoa, qui n'est pas fondé, sur un impérialisme spirituel est un cadavre régnant, une Mort sur un trône. Seule une petite nation peut véritablement réaliser un Empire Spirituel car en elle la croissance d'un idéal national ne saurait susciter nulle tentative d'annexion territoriale qui finirait par adultérer son impérialisme psychique initial et le détourner de son destin spirituel. » L'idée d'Empire pose ainsi la question de l'au-delà et de l'en-deçà de l'individualisme. « L'individu, c'est la masse » écrivait Ernst Jünger, s'en prenant à cet individualisme bourgeois où chaque individu se trouve uniformisé par un même idéal de réussite sociale et de confort matériel. Ce pourquoi, les prétendues élites du monde moderne, technocratiques ou financières, pas davantage que les masses ne sauraient prétendre à donner une orientation à nos destinées. Or, tel est le magnanime pressentiment de Fernando Pessoa: de la destruction nuptiale des identités naîtront de nouveaux règnes.
Au pôle transcendantal de l'unique souveraineté de l'Esprit s'oppose donc la sinistre parodie des « identités » soumises à un « ordre moral » que les classes dominantes, aussi bien que les subalternes, s'accorderaient à faire régner au détriment des poètes, des esthètes, des mystiques et des hommes de connaissance. On devine ainsi de quelles nostalgies et de quels pressentiments s'éclaire le dessein initiatique de Fernando Pessoa, ce dessein qui débute avant la page écrite et s'achève après elle en des oeuvres vives, ardentes, que l'on peut dire philosophales. En refusant, par le jeu des hétéronymes, le romantisme inférieur de l'individualisme psychologique, l'œuvre polyphonique de Pessoa entre d'emblée dans cette « impersonnalité active » condition impérieuse de l’expérimentation des états multiples de l'être. Comparable à l'Arbre séphirotique de la Kabbale, l'arbre généalogique des hétéronymes de Fernando Pessoa, avec ses colonnes de Clémence et de Rigueur, et ses stations opératoires que surplombe l’En-Sof (l'infini souverain d'où procèdent toutes les couleurs et toutes les valeurs sensibles ou intellectuelles), nous laisse entrevoir une anthropologie radicalement différente de celle de l'humanisme moderne. Encore faut-il, pour ne pas rester dans le vague, se familiariser quelque peu avec la pensée par analogie dont on peut dire qu'elle œuvre sur les qualités alors que la pensée par déduction travaille sur les quantités. « De même, écrit Fernando Pessoa, que l'intelligence dialectique, que l'on nomme raison, régente et ordonne tous les éléments de la connaissance scientifique, de même l'intelligence analogique, qui n'a aucun nom particulier, régente et ordonne tous les éléments de la connaissance occulte. La perfection de l'œuvre matérielle est un tout parfaitement constitué dans lequel chaque partie a sa place et concourt selon son mode et son grade à la formation de ce tout; la perfection de l'œuvre spirituelle est l'exacte correspondance entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'âme et le corps, de telle sorte que la connaissance de l'un englobe la connaissance de l'autre. Dans le Grand Oeuvre, le métal préparé selon la raison pour devenir l'or, perfection de la matière, doit, dans le même acte, être préparé selon l'Analogie pour devenir l'Or Spirituel symbolisé. Dans ces quelques mots réside ce qui fait l'intime distinction entre la production artificielle de l'or par l'alchimie et cette même production par la science. Dans les deux cas l'or matériel sera identique en tant que matière, mais l'or produit par la science ne sera rien de plus que de l'or, puisque dans la fabrication de celui-ci elle ne visait qu'à produire de l'or, tandis que l'Or produit par l'alchimie sera beaucoup plus que de l'or, puisque dans la fabrication de celui-ci elle cherchait non seulement à produire de l'or mais aussi le secret de l'or. »
Ce secret d'Or est le dessein de l'œuvre, sa vie intime, ardente, inextinguible. Le refus de l'ésotérisme n'est souvent que la haine du secret. Cette haine, comme le soulignait René Guénon dans ses Aperçus sur l'Initiation est un trait caractéristique de l'homme moderne. A cette haine du secret s'ajoute la haine de l'élite, présumée défendre jalousement ces secrets. La vérité est tout autre. Le secret initiatique n'est pas un secret bancaire. Secret par nature et non par convention, il relève du secret de l'Art, voire du secret de la jouissance du l'Art. A l'homme dépourvu de toute sensibilité musicale, l'Art de la fugue de Bach demeurera secrète; l'accès de cette beauté lui sera à jamais défendue, non par une volonté délibérée mais par la nature même de l'œuvre. Sans doute la haine du secret n'est-elle rien d'autre que la haine du Sens et du Sacré. Le Sens s'oppose à l'insignifiance comme l'ordre s'oppose au chaos. Séparé de l'insignifiance, pourvu de limites précises et claires, le Sens est retranché, secret. Il ne s'en révèle pas moins à notre conscience par un geste où la divulgation extérieure se confond à la réminiscence intérieure. La naissance du Sens est dévoilement, anamnèse. Elle nous donne accès à la « conscience de la conscience », où le Soleil du soleil s'exhausse des ténèbres antérieures, conscience aurorale et aurifère.
Ainsi, à la haine du secret Pessoa oppose un amour du secret qui serait d'abord un amour de la nuance, de la variation, de la transition infime, presque imperceptible, subtile. L'attente contemplative, l'ardente veillée précède les Retrouvailles du visible et de l'Invisible. « L'acte même de la foi, écrit Frithjof Schuon, est le souvenir de Dieu. Or se souvenir en latin est recordare, c'est-à-dire re-cordare, ce qui évoque un retour au cœur, cor. L'acte d'oraison, en tant qu'acte de foi actualise en effet la certitude immanente et quasi-paraclétique; le cœur est la foi immanente et incréée, il coïncide avec cette grâce naturellement surnaturelle qu'est l'Intellection. Le mystère de la certitude, c'est notre consubstantialité avec tout le connaissable, avec tout ce qui est. » Art hiératique, fidèle au dessein initiatique, la poésie, à la fois royale et sacerdotale, dépassera ainsi les dualités connues. L'archaïsme ingénu d'Alberto Caiero et le futurisme savant d'Alvaro de Campos, témoignent que, pour Pessoa, l'antérieur est la fleur ultime de l'ultérieur. « Inventons, écrivait Pessoa, un Impérialisme androgyne réunissant qualités masculines et féminines; un impérialisme nourri de toutes les subtilités féminines et de toutes les forces de structuration masculines. » Soit un Empire à l'image exacte du rebis alchimique, irisé d'une fulgurance apollinienne.
Le grand songe du Cinquième Empire fut, pour Fernando Pessoa, à n'en pas douter, la seule vision possible de l'avenir: « L'avenir du Portugal que je n'imagine pas mais que je sais est déjà écrit, pour qui sait lire, dans les strophes de Bandara et dans les quatrains de Nostradamus. Cet avenir c'est d'être tout. Qui donc, s'il est portugais, peut vivre dans l'étroitesse d'une seule personnalité, d'une seule nation, d'une seule foi ? » Qu'advienne enfin cet impérialisme des poètes ! « Absorbons tous les dieux, nous avons déjà conquis la Mer, il ne reste qu'à conquérir le Ciel, en laissant aux autres, la terre. »
Luc-Olivier d'Algange
Extrait de L'Ame secrète de L'Europe, éditions de L'Harmattan, collection Théôria.
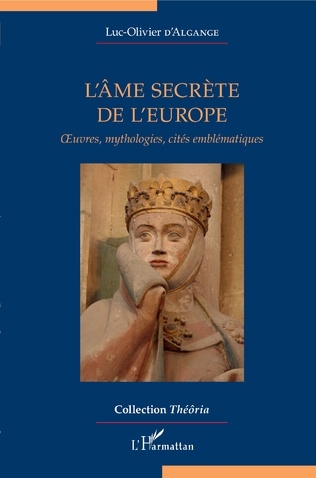
19:06 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
26/03/2023
Luc-Olivier d'Algange, Léon Bloy l'Intempestif, suivi d'une traduction en espagnol:

Luc-Olivier d’Algange
Léon Bloy l'Intempestif
« Il est indispensable que la Vérité soit dans la Gloire. »
Léon Bloy
A mesure que les années passent, avec une feinte ressemblance dans leur cours de plus en plus désastreux depuis la première parution du Journal de Léon Bloy, l'écart n'a cessé de se creuser entre ceux qui entendent cette parole furibonde et ceux qui n'y entendent rien. Certes, on ne saurait s'attendre à ce que les rééditions des œuvres de Léon Bloy fussent accueillies comme des événements ou des révélations par un milieu « culturel » qui ne cesse de donner les preuves de sa soumission à l'Opinion, de son aveuglement et de son mépris pour toute forme de pensée originale. Une sourde hostilité est la règle et je lisais encore des jours-ci un folliculaire récriminant contre « le douloureux labyrinthe narcissique » que serait à ses yeux le Journal de Léon Bloy. Certes, labyrinthiques et préoccupés de l'Auteur, tous les journaux le sont par définition, mais au contraire du fastidieux et potinier Journal de Léautaud, devant lequel maints critiques modernes pratiquèrent une ostensible génuflexion, le Journal de Bloy est d'une vivacité électrique. L'humour ravageur, les flambées de colère, les fulgurantes intuitions mystiques, un style d'une densité et d'une musicalité prodigieuse font de ce Journal un chef d'œuvre de la forme brève, aphoristique ou illuminative. Que lui vaut donc cette disgrâce où nous le voyons ? Sans doute la pensée qui s'y affirme et s'y précise sous la forme d'une critique radicale du monde moderne, dans la lignée de Barbey d'Aurevilly et de Villiers de L'Isle-Adam.
« Tout ce qui est moderne est du démon », écrit Léon Bloy, le 7 Août 1910. C'était, il nous semble, bien avant les guerres mondiales, les bombes atomiques et les catastrophes nucléaires, les camps de concentration, les manipulations génétiques et le totalitarisme cybernétique. En 1910, Léon Bloy pouvait passer pour un extravagant; désormais ses aperçus, comme ceux du génial Villiers de L’Isle-Adam des Contes Cruels, sont d'une pertinence troublante. L'écart se creuse, et il se creuse bien, entre ceux qui somnolent à côté de leur temps et ne comprennent rien à ses épreuves et à ses horreurs, et ceux-là qui, à l'exemple de Léon Bloy vivent au cœur de leur temps si exactement qu'ils touchent ce point de non-retour où le temps est compris, jugé et dépassé. Léon Bloy écrit dans l'attente de l'Apocalypse. Tous ces événements, singuliers ou caractéristiques qui adviennent dans une temporalité en apparence profane, Léon Bloy les analyse dans une perspective sacrée. L'histoire visible, que Léon Bloy est loin de méconnaître, n'est pour lui que l'écho d'une histoire invisible. « Tout n'est qu'apparence, tout n'est que symbole, écrit Léon Bloy. Nous sommes des dormants qui crient dans leur sommeil. Nous ne pouvons jamais savoir si telle chose qui nous afflige n'est pas le principe de notre joie ultérieure. »
Cette perspective symbolique est la plus étrangère qui soit à la mentalité moderne. Pour le Moderne, le temps et l'histoire se réduisent à ce qu'ils paraissent être. Pour Bloy, le temps n'est, comme pour Platon et la Théologie médiévale, que « l'image mobile de l'éternité » et l'histoire délivre un message qu'il appartient à l'écrivain-prophète de déchiffrer et de divulguer à ses semblables. Pour Léon Bloy, le Journal, loin de se borner à la description psychologique de son auteur a pour dessein de consigner les « signes » et les « intersignes » de l'histoire visible et invisible afin de favoriser le retour du temps dans la structure souveraine de l'éternité.
Pour Léon Bloy, qui se définit lui-même comme « un esprit intuitif et d'aperception lointaine, par conséquent toujours aspiré en deçà ou au-delà du temps », la fonction de l'auteur écrivant son journal n'est pas de se soumettre à l'aléa de la temporalité, du passager ou du fugitif, mais tout au contraire « d'envelopper d'un regard unique la multitude infinie des gestes concomitants de la Providence ». Le Journal, - tout en marquant le pas, en laissant retentir en soi, et dans l'âme du lecteur ami, la souffrance ou la joie, plus rare, de chaque jour, les « nouveautés » menues ou grandioses du monde, ne s'inscrit pas moins dans une rébellion contre le fragmentaire, le relatif ou l'éphémère. Ce Journal, et c'est en quoi il décontenance un lecteur moderne, n'a d'autre dessein que de déchiffrer la grammaire de Dieu.
Là où le Moderne ne distingue que des vocables sans suite, de purs signes arbitraires, Léon Bloy devine une cohérence éblouissante, et, par certains égards, vertigineuse et terrifiante. Léon Bloy n'est pas de ces dévots qui trouvent dans la foi et dans l'Eglise de quoi se rassurer. Ces dévots modernes, bourgeois au sens flaubertien, Léon Bloy les fustige ainsi que la « société sans grandeur ni force » dont ils sont les défenseurs. Il est fort improbable, quoiqu'en disent les journaleux peu informés qui voient en Bloy un « intégriste », que l'auteur du Désespéré et de La Femme Pauvre se fût retrouvé du côté de nos actuels, trop actuels « défenseurs des valeurs », moralisateurs sans envergure ni générosité,- et par voie de conséquence, sans le moindre sens de la rébellion. Or s'il est un mot qui qualifie avec précision la tournure d'esprit de cet homme de Tradition, c'est rebelle !
Pour Léon Bloy, quel que soit par moment son harassement, le combat n'est pas fini, il y retourne, chaque jour est le moment décisif d'une guerre sainte. Léon Bloy est un moine-soldat qui va son chemin d'écrivain, non sans donner ici et là quelques coups de massue, pour reprendre la formule évolienne. Ainsi le sport, objet, depuis peu, d'un nouveau culte national est-il, pour Léon Bloy « le moyen le plus sûr de produire une génération d'infirmes et de crétins malfaisants ». Quant à la Démocratie, bien vantée, elle lui suggère cette réflexion : « Un des inconvénients les moins observés du suffrage universel, c'est de contraindre des citoyens en putréfaction à sortir de leurs sépulcres pour élire ou pour être élus. » Cette outrance verbale dissimule souvent une intuition. Tout, dans ce monde planifié, ne conjure-t-il pas à faire de nous une race de morts-vivants, réduits à la survie, dans une radicale dépossession spirituelle. Que sont les Modernes devant leurs écrans ? Quel songe de mort les hante ? Les rêveries du Moderne ne sont-elles pas avant tout macabres ? Non, la religion de Léon Bloy n'est pas faite pour les « tièdes ». C'est une religion pour ceux qui ressentent les grandes froidures et qui attendent l'embrasement des âmes et des esprits. Le modèle littéraire de Léon Bloy ce sont les langues de feu de la Pentecôte.
Léon Bloy s'est nommé lui-même « Le Pèlerin de l'Absolu ». Chaque jour qui advient, et que l'auteur traverse comme une nouvelle épreuve où se forge son courage et son style, le rapproche du moment crucial où apparaîtront dans une lumière parfaite la concordance de l'histoire visible et de l'histoire invisible. Cette quête que Léon Bloy partage avec Joseph de Maistre et Balzac le conduit à une vision du monde littéralement liturgique. L'histoire de l'univers, comme celle de l'auteur esseulé dans son malheur et dans son combat, est « un immense Texte liturgique. » Les Symboles, ces « hiéroglyphes divins », corroborent la réalité où ils s'inscrivent, de même que les actes humains sont « la syntaxe infinie d'un livre insoupçonné et plein de mystères. »
Cette vision symbolique et théologique du monde en tant que Mystère limpide, c'est à dire offert à l'illumination (« l'illumination, lieu d'embarquement de tout enseignement théologique et mystique ») est à la fois la cause majeure de l'éloignement de l'œuvre de Léon Bloy et le principe de sa proximité extrême. Pour le moderne, la « folie » de Léon Bloy n'est pas dans sa véhémence, ni dans son lyrisme polémique, mais bien dans cette vision métaphysique et surnaturelle des destinées humaines et universelles. Pour Léon Bloy, qui n'est point hégélien, et qui va jusqu'à taquiner Villiers pour son hégélianisme « magique », les contraires s'embrassent et s'étreignent avec fougue. La nature porte la marque de la Surnature, mais par un vide qui serait l'empreinte du Sceau. De même, l'extrême pauvreté engendre le style le plus fastueux. C'est précisément car l'écrivain est pauvre que son style doit témoigner de la plus exubérante richesse. La pauvreté matérielle est ce vide qui laisse sa place à la dispendieuse nature poétique. Car la pauvreté, pour Bloy, n'est pas le fait du hasard, elle est la preuve d'une élection, elle est le signe visible d'un privilège invisible qu'il appartient à l'Auteur de célébrer somptueusement. La richesse verbale de Léon Bloy est toute entière un hommage à la pauvreté, à sa profondeur lumineuse, à la grâce qu'elle fait à la générosité de se manifester. Celui qui donne se sauve. Le mendiant peut donc, à bon droit être « ingrat ». Son ingratitude rédime celui qui pourrait s'en offenser. Mais qu'est-ce qu'un pauvre, dans la perspective métaphysique ? C'est avant tout celui qui récuse par avance toute vénalité. Or qu'est-ce que le monde moderne si ce n'est un monde qui fait de la vénalité même un principe moral, une cause efficiente du Bien et « des biens » ? Pour le Moderne, celui qui parvient à se vendre prouve son utilité dans la société et donc sa valeur morale. Celui qui ne parvient pas, ou, pire, qui ne veut pas se vendre est immoral.
Contre ce sinistre état de fait, qui pervertit l'esprit humain, l'œuvre de Léon Bloy dresse un grandiose et intarissable réquisitoire. Or, c'est bien ce réquisitoire que les Modernes ne veulent pas entendre et qu'ils cherchent à minimiser en le réduisant à la « singularité » de l'auteur. Certes Léon Bloy est singulier, mais c'est d'abord parce qu'il se veut religieusement « un Unique pour un Unique ». La situation dans laquelle il se trouve enchaîné n'en est pas moins réelle et la description qu'il en donne particulièrement pertinente en ces temps où face à la marchandise mondiale le Pauvre est devenu encore beaucoup plus radicalement pauvre qu'il ne l'était au dix-neuvième siècle. La morale désormais se confond avec le Marché, et l'on pourrait presque dire que, pour le Moderne libéral, la notion d'immoralité et celle de non-rentabilité ne font plus qu'une. Refuser ce règne de l'économie, c'est à coup sûr être ou devenir pauvre et accueillir en soi les gloires du Saint-Esprit, dont la nature dispensatrice, effusive et lumineuse ne connaît point de limite.
Contre le monde moderne, Léon Bloy ne convoque point des utopies sociales, ni même un retour au « religieux » ou à quelque manifestation « révolutionnaire » ou « contre-révolutionnaire » de la puissance temporelle. Contre ce monde, « qui est du démon », Léon Bloy évoque le Saint-Esprit, au point que certains critiques ont cru voir en lui un de ces mystiques du « troisième Règne », qui prophétisent après le règne du Père, et le règne du Fils, la venue d'un règne du Saint-Esprit coïncidant avec un retour de l'Age d'Or. Lorsqu'un véritable écrivain s'empare d'une vision dont la justesse foudroie, peu importent les terminologies. Sa vision le précède, elle n'en précède que mieux les interprétations historiographiques. « Aussi longtemps que le Surnaturel n'apparaîtra pas manifestement, incontestablement, délicieusement, il n'y aura rien de fait. »
Léon Bloy, el Extemporáneo
“Es indispensable que la Verdad esté en la Gloria.” Léon Bloy.
“Todo lo moderno pertenece al demonio”, escribe Léon Bloy el 7 de agosto de 1910. Fue, según nos parece, mucho antes de las guerras mundiales, las bombas atómicas y las catástrofes nucleares, los campos de concentración, las manipulaciones genéticas y el totalitarismo cibernético. En 1910, a Léon Bloy se lo podía tomar por un extravagante; hoy en día sus vislumbres, como los del genial Villiers de L’Isle-Adam de los Cuentos crueles, son de una pertinencia turbadora. Aumenta, y cada vez más, la distancia entre los que dormitan al margen de su época y no comprenden nada de las pruebas y los horrores a los que nos somete, y los que, a ejemplo de Léon Bloy, viven tan precisamente en el centro mismo de su época que alcanzan ese punto de no retorno en el que se la comprende, se la juzga y se la supera. Léon Bloy escribe a la espera del Apocalipsis. Todos esos acontecimientos, singulares o característicos, que se producen en una temporalidad aparentemente profana, Léon Bloy los analiza en una perspectiva sagrada. La historia visible, que Léon Bloy está lejos de desconocer, sólo es para él el eco de una historia invisible.
“Todo es pura apariencia, todo es puro símbolo”, escribe Léon Bloy. “Somos durmientes que gritan durante el sueño. Nunca podemos sabes si algo que nos aflige no es el principio de nuestra dicha ulterior.”
Esta perspectiva simbólica es la más ajena posible a la mentalidad moderna. Para el Moderno, el tiempo y la historia se reducen a lo que parecen ser. Para Bloy, el tiempo sólo es, como para Platón y la teología medieval, “la imagen móvil de la eternidad”, y la historia comunica un mensaje que al escritor-profeta le toca descifrar y divulgar entre sus semejantes. Para Léon Bloy, el Diario, lejos de limitarse a la descripción psicológica de su autor, tiene por objetivo el de dejar registrados los “signos” y los “intersignos” de la historia visible e invisible, a fin de favorecer el retorno del tiempo en la estructura soberana de la eternidad.
Para Léon Bloy, que se define a sí mismo como “un espíritu intuitivo y de apercepción lejana, y, por consiguiente, siempre arrastrado más acá o más allá del tiempo”, la función del autor al escribir su diario no es la de someterse a la temporalidad fugitiva sino, muy por el contrario, la de “abarcar con una mirada única la multitud infinita de los gestos concomitantes de la Providencia”. El Diario —al mismo tiempo que marca el paso, dejando resonar en sí mismo, y en el alma del lector amigo, el sufrimiento o la dicha, menos frecuente, de cada día, las “novedades” modestas o grandiosas del mundo— no deja de inscribirse en una rebelión contra lo fragmentario, lo relativo o lo efímero. Este Diario, que en esto desconcierta a un lector moderno, no tiene otra finalidad que la de descifrar la gramática de Dios.
Allí donde el Moderno sólo distingue vocablos inconexos, puros signos arbitrarios, Léon Bloy intuye una coherencia deslumbrante y, en ciertos aspectos, vertiginosa y aterradora. Léon Bloy no es uno de esos devotos que encuentran en la fe y en la iglesia con qué tranquilizarse. A esos devotos modernos, burgueses en el sentido de Flaubert, Léon Bloy los fustiga al igual que a la “sociedad sin grandeza ni fuerza” que defienden. Es altamente improbable, digan lo que digan los periodistuchos poco informados que ven en Bloy a un “integrista”, que el autor de El desesperado y de La mujer pobre hubiese estado en el mismo campo de nuestros actuales, demasiado actuales “defensores de los valores”, moralizadores sin envergadura ni generosidad —y, por consiguiente, sin el menor sentido de la rebelión. Ahora bien, si hay una palabra que define con precisión la mentalidad de este hombre de Tradición, esta palabra es “rebelde”.
Para Léon Bloy, por más extenuado que esté por momentos, el combate no ha terminado, vuelve a él, cada día es el momento decisivo de una guerra santa. Léon Bloy es un monje soldado que sigue su camino de escritor, no sin dar acá y allá algunos mazazos, para emplear la expresión de Julius Evola. Así es como el deporte, objeto, desde hace poco, de un nuevo culto nacional, es para Léon Bloy “el medio más seguro de producir una generación de inválidos y de cretinos dañinos”. En cuanto a la Democracia, tan ensalzada, le sugiere esta reflexión: “Uno de los inconvenientes menos observados del sufragio universal es el hecho de obligar a ciudadanos en estado de putrefacción a salir de su sepulcros para elegir o ser elegidos”. Esta desmesura verbal a menudo disimula una intuición. ¿Acaso no conspira todo, en este mundo planificado, para hacer de nosotros una raza de muertos vivos, reducidos a sobrevivir en una radical desposesión espiritual? ¿Qué son los Modernos delante de sus pantallas? ¿Qué sueño de muerte los posee? ¿Las Ensoñaciones del Moderno no son, ante todo, macabras? No, la religión de Léon Bloy no está hecha para los “tibios”. Es una religión para quienes sienten los grandes fríos y esperan el incendio de las almas y los espíritus. El modelo literario de Léon Bloy son las lenguas de fuego de Pentecostés.
Léon Bloy se llamó a sí mismo “El Peregrino del Absoluto”. Cada día que llega, y que el autor atraviesa como una nueva prueba en que se templan su coraje y su estilo, lo acerca al momento crucial en que aparecerán con perfecta claridad la concordancia entre la historia visible y la historia invisible. Esta búsqueda, que Léon Bloy comparte con Joseph de Maistre y Balzac, lo conduce a una visión del mundo literalmente litúrgica. La historia del universo, tanto como la del autor aislado en su desdicha y en su combate, es “un inmenso Texto litúrgico”. Los Símbolos, esos “jeroglíficos divinos”, corroboran la realidad en que se inscriben, así como los actos humanos son “la sintaxis infinita de un libro insospechado y lleno de misterios”.
Esta visión simbólica y teológica del mundo como Misterio límpido, es decir, alcanzable por la iluminación (“la iluminación, punto de embarque de toda enseñanza teológica y mística”), es, al mismo tiempo, la causa principal de lo alejado de la obra de Léon Bloy y el principio de su cercanía extrema. Para el moderno, la “locura” de Léon Bloy no reside en su vehemencia ni en su lirismo polémico, sino precisamente en esta visión metafísica y sobrenatural de los destinos humanos y universales. Para Léon Bloy, que no es en absoluto hegeliano, y que hasta llega a burlarse de Villiers de l’Isle-Adam por su hegelianismo “mágico”, los contrarios se abrazan y se estrechan con ardor. La naturaleza tiene la impronta de la Sobrenaturaleza, pero por medio de un vacío que fuese la marca del Sello. De igual modo, la extrema pobreza engendra el estilo más fastuoso. Es precisamente porque el escritor es pobre por lo que su estilo debe dar testimonio de la riqueza más exuberante. La pobreza material es el vacío que le cede el lugar a la dispendiosa naturaleza poética. Ya que la pobreza, para Bloy, no es el resultado del azar: es la prueba de una elección, es el signo visible de un privilegio invisible que le incumbe al Autor celebrar suntuosamente.
La riqueza verbal de Léon Bloy es toda ella un homenaje a la pobreza, a su profundidad luminosa, al favor que le hace a la generosidad permitiéndole manifestarse. El que da, se salva. El mendigo puede entonces, con toda razón, ser “ingrato”. Su ingratitud redime al que podría tomarla como una ofensa. Pero ¿qué es un pobre, en la perspectiva metafísica? Es, ante todo, aquél que rechaza de antemano toda venalidad. Ahora bien, ¿qué es el mundo moderno sino un mundo que hace de la venalidad misma un principio moral, una causa eficiente del Bien y de “los bienes”? Para el Moderno, el que logra venderse prueba su utilidad en la sociedad y, por lo tanto, su valor moral. El que no logra o, peor aún, no quiere venderse, es inmoral.
Contra esta siniestra situación de hecho, que pervierte el espíritu humano, la obra de Léon Bloy lanza una grandiosa e inagotable acusación. Ahora bien, es precisamente esta acusación lo que los Modernos no quieren oír y tratan de minimizar, reduciéndola a la “singularidad” del autor. Por cierto, Léon Bloy es singular, pero esto es, en primer término, porque elige ser, religiosamente, “un Único para un Único”. La situación en que se encuentra encadenado no es por esto menos real, y la descripción que da de ella es particularmente pertinente en estos tiempos en que, ante la mercancía mundial, el Pobre se ha vuelto aún mucho más radicalmente pobre de lo que lo era en el siglo XIX. La moral, ahora, se confunde con el Mercado, y casi podríamos decir que, para el Moderno liberal, la noción de inmoralidad y la de no rentabilidad no son más que una y la misma. Rechazar este reino de la economía es, con toda seguridad, ser o volverse pobre, y acoger en uno mismo las glorias del Espíritu Santo, cuya naturaleza dispensadora, efusiva y luminosa no conoce límite alguno.
Contra el mundo moderno, Léon Bloy no llama a ninguna utopía social, ni siquiera a un regreso a lo “religioso” o a alguna manifestación “revolucionaria” o “contrarrevolucionaria” del poder temporal. Contra este mundo, “que pertenece al demonio”, Léon Bloy invoca al Espíritu Santo, hasta el punto de que algunos críticos han creído ver en él a uno de esos místicos del “Tercer Reino” que profetizan, para después del Reino del Padre y del Reino del Hijo, el advenimiento de un reino del Espíritu Santo que coincidirá con un retorno a la Edad de Oro. Cuando un auténtico escritor se apodera de una visión de exactitud fulminante, poco importan las terminologías. Su visión le precede y, por lo mismo, mejor aún precede a las interpretaciones historiográficas. “Mientras lo Sobrenatural no se muestre de modo manifiesto, indiscutible, delicioso, nada estará hecho.”
Traducción de Carlos Cámara y Miguel Ángel Frontán.
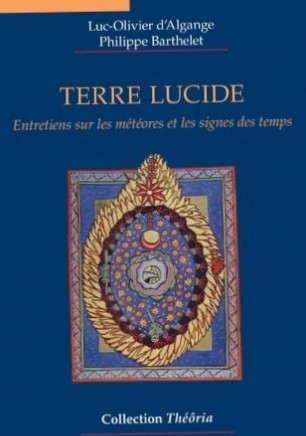
19:49 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
19/03/2023
Luc-Olivier d'Algange, Maurice Magre, fidèle de Mélusine:

Luc-Olivier d'Algange
Maurice Magre, fidèle de Mélusine
« Je percevais dans l’air des forces en suspens »
Maurice MAGRE
De Maurice Magre, on serait tenté de dire, les oxymores seuls pouvant définir les êtres entiers, qu’il fut un hédoniste spiritualiste (ou un spiritualiste hédoniste), espèce qui fut moins rare jadis que naguère et qui devient, par les temps qui courent, rarissime. De nos jours, les spiritualistes sont, en général, d’austères pions et les hédonistes, des gorilles. Il demeure cependant dans nos civilisations, et ailleurs, de merveilleux dispositifs, tels que la philosophie plotinienne ou le premier Romantisme allemand, celui de Schlegel ou de Novalis, conjuguant le frémissement sensible et l’ardeur de la connaissance, le bouleversement à fleur de peau et l’audace à franchir « les portes de corne et d’ivoire qui nous séparent du monde invisible » (Nerval)
Avant de désirer la vie éternelle, à laquelle Maurice Magre croyait en toute liberté, c’est-à-dire en dehors de tous les dogmes, encore faut-il, selon la formule de Pindare, traduite par Valéry, « épuiser le champ du possible ». Cette vie si passagère, si troublée, si incertaine que nous traversons est un appel à la plénitude, une convocation, ainsi que l’écrivait Montaigne, à « jouir loyalement de son être ». Or, nos temps sont à la restriction ; ils ne supportent plus ces alliances subtiles, ces noces philosophales entre le souffre et le mercure, la volupté et la sagesse, entre ce qui flambe dans les hauteurs et disparaît et ce qui roule et se divise dans le miroitement de l’immanence.
Le puritanisme s’est substitué aux ascèses et la pornographie aux jeux de l’Eros : triomphe de la marchandise sur la gratuité heureuse qui n’est autre que la part divine dans un monde humain, trop humain. Maurice Magre célèbre ainsi d’un même mouvement l’ascèse et le plaisir, la quête d’une transcendance, d’un Idéal, et le consentement à la beauté féminine, la recherche de la grandeur et l’amour des humbles. Son sens du grand art, subtil et savant, ne lui interdit pas de faire sienne la juste revendication des pauvres. Ses premières œuvres, comme la Prière au Soleil appartiennent à la tradition du socialisme français, d’inspiration libertaire, unanimiste et païenne :
« Un esprit Fraternel frémissait dans chaque herbe ;
Les Vieux arbres avaient des voix d’êtres aimés ;
Et nous sentions le soir assis parmi les gerbes
La poussière des morts mêlée au sol sacré. »
Proche, à cet égard, de Péguy, Maurice Magre sut dire, au-delà de l’éminente dignité des pauvre, « l’éminente pauvreté des dignes », dont il fut l’un des premiers : « J’ai voulu écrire la chanson des hommes d’aujourd’hui, de ceux que font souffrir l’affaissement des énergies, la pauvreté du cœur, toutes les misères morales et matérielles. » Loin de l’orienter vers un rigorisme aux inclinations totalitaires, cette révolte anti-bourgeoise le conduisit jusqu’aux frontières mêmes de l’invisible, qui n’est point l’abstraction, mais la puissance d’une âme libre, l’au-delà de l’orée qui enchante toutes les apparences du monde :
« Le monde est un secret que soudain je comprends :
Notre corps est léger et notre esprit fidèle »
Ce prosateur qui connaît l’art des longues périodes et de la « rhétorique profonde » fut particulièrement sensible à l’éclat de la soudaineté, qu’elle soit dans l’emportement de la compassion, dans la conversion ou la rencontre des regards. Les « choses vues » lui sont des Symboles, les Cités qu’il habite ou parcourt lui deviennent peu à peu emblématiques, tels le Londres de Thomas de Quincey, dont il partagea le goût de l’Opium, ou l’Ispahan des poètes persans dont les « jardins d’émeraude », suspendus entre le sensible et l’intelligible, sont familiers à ses voyages intérieurs. Ses spéculations et ses rêveries se lovent également dans les lieux de gloire ou de misère. Ses amantes sont haussées au rang de déesses ; ses rares amis lui apparaissent comme des héros ou des saints. De ses ennemis, il ne garde que le souvenir de l’inaccomplissement. Maurice Magre est de ces auteurs sur lesquels la médiocrité n’a aucune prise, quand bien même il s’en accuse, et par cela même. Loin de se croire parfait, ce qui est précisément le propre de la médiocrité forte de son nombre, Maurice Magre mesure, avec autant de précision que possible, l’écart entre son vœu et sa réalisation ; et cet écart n’est autre que l’espace même de son œuvre. Ses regrets ne sont pas moralisateurs : ils sont le secret de la musique des mots, non point contrition mais persistance amoureuse, consentement au « beau secret ».
Ses Confessions sur les femmes, l’amour, l’opium, l’idéal, disent cette soudaineté du secret, cette pointe exquise où le plaisir et la sapience se ressemblent, cette légèreté du corps (car, pour Maurice Magre, c’est bien le corps qui est dans l’âme et non l’âme qui est dans le corps), cette fidélité de l’esprit à l’émotion de ses premières épreuves et de ses premiers émerveillements. Rien ne lui est plus étranger que le reniement ou cette versatilité du consommateur, qui se croit libre pour brûler le lendemain ce que la veille il adora. Ses Confessions s’achèvent sur des « Remerciements à la destinée », d’une hauteur goethéenne, et qui ne sont point sans évoquer, aussi, l’émouvant « Bonsoir aux choses d’ici-bas » qui furent les derniers mots de Valery Larbaud : « Je remercie la loi qui préside à la destinée. Elle a placé mon enfance dans une maison de banlieue toulousaine, dans un jardin où il y avait un pin, un buis et une île de noisetiers… »
Par le don de la gratitude, devenu si rare, toute beauté devient frissonnante. Ni l’habileté technique « qui se manifeste par la glorification du laid », ni les cités industrielles « qui remplacent les antiques cités de pierre qui abritaient jadis des bonheurs paisibles et lents, où les hommes avaient la possibilité de pratiquer la rêverie et l’étude » ne donnent, ou plutôt, ne restituent, à la beauté du monde ce que nous lui devons. Le monde moderne apparaît à Maurice Magre comme « ces pyramides dressées par les esprits du mal ». Or, rien ne nous interdit, sinon quelque mauvais sort jeté à grands renforts de puissance et d’argent, de saisir la seconde heureuse, de retrouver le resplendissement de ce qui est :
« Un frisson de beauté circule une seconde.
Je sens qu’un beau secret dans l’atmosphère passe.
Un bal mystérieux s’éveille dans les choses. »
L’œuvre de Maurice Magre se propose ainsi comme un viatique contre la tristesse et le nihilisme qui nous privent à la fois de la vérité sensible et de la beauté intelligible. Cet hérésiarque de belle envergure, qui trouve son bien chez les gnostiques albigeois, non moins que dans le néoplatonisme des ultimes résistances païennes (qui lui inspira l’admirable roman intitulé Priscilla d’Alexandrie) n’a d’autre ambition que de nous nous enseigner une liberté dont l’apogée serait la fidélité même. Fidélité aux premières rencontres, aux premiers amours, aux premières lectures et aux premières ivresses ; fidélité aux moments d’intensité et de grâce. Priscilla d’Alexandrie, publiée en 1925, qui se situe dans l’Egypte tourmentée entre le christianisme et la paganisme, du quatrième siècle, nous invite, et c’est un genre d’invitation qui ne se refuse pas, à fréquenter les philosophes d’Alexandrie, tel Olympios, ermite néoplatonicien, ou Aurélius qui accomplira un pèlerinage « à l’ombre de l’arbre bodhi ». Priscilla qui sera la réincarnation d’Hypathie, après avoir participé à sa lapidation, médite, en compagnie de ses amis philosophes sur l’accord possible entre la volupté et la sagesse, entre l’assentiment au monde sensible et l’aspiration au monde invisible. Le sceau et l’empreinte, ce qui symbolise et ce qui est symbolisé ne sont-ils pas une seule et même réalité ? « Toute la nature avec ses soleils et ses nuits douces ne serait alors qu’un vaste piège pour empêcher l’homme, par le réseau des désirs, de parvenir à la plus haute spiritualité. Ce n’est pas possible. Il doit y avoir une conciliation entre la splendeur de la matière et le règne de l’esprit. Il doit existe une sagesse qui aime, une vérité qui a du sang ».
On songe à cet autre livre, de Mario Meunier, qui fut un éminent traducteur de Platon et de Sophocle, Pour s’asseoir au Foyer de la Maison des Dieux : « Etre volupteux : c’est entendre en son sang bouillonner tous les vins ; c’est aimer le besoin de multiplier ses amours, ses sympathies et ses admirations ; c’est participer à l’infini de l’Etre, collaborer à son éternité et aimer la vie jusqu’au désir de souffrir pour mieux vivre, et de mourir pour changer et revivre. » Pas davantage que le sensible ne s’oppose à l’intelligible, le multiple ne s’oppose à l’Un, ni le provincial à l’universel : « Ne te scandalise donc pas de la multiplicité des dieux. Si les morcellements de la divinité ne nous apprennent rien sur la vérité de son être insondable, ils affirment néanmoins, en tous temps et partout, sa souveraine présence (…) Une des plus nobles activités de l’esprit est de surprendre, en chacun des dieux des nations, la parcelle d’infini qu’il contient. En cette interminable théorie de déités, ma pensée reconnaît et adore les rayons divers d’un soleil identique. »
Libertaire, par goût de la légèreté, hostile aux pomposités et au puritanisme bourgeois, dont il se moque sans amertume mais avec une sereine ironie, Maurice Magre demeure avant tout fidèle à l’esprit des lieux. L’esprit des lieux, comme toutes les choses difficiles à définir et qui échappent aux ensembles abstraits (dont certains voudraient nous voir dépendre exclusivement) exerce sur nous une influence profonde. Simone Weil évoquait la persistance d’une science romane, d’une gnose occitanienne, Raymond Abellio, Joë Bousquet vinrent à la rencontre du reste du monde à partir de Toulouse, cette Thulée cathare. Il en fut de même pour Maurice Magre. Ne méprisons point le sens de l’universel, mais sachons qu’il n’est jamais que la fine pointe d’une réalité provinciale, d’un cheminement à partir d’un lieu, d’une méditation sur une configuration historique et sensible, d’une tradition dont on ne saurait s’exclure à moins de saccager en nous le Logos lui-même.
Nous existons à parti d’un lieu, et qu’importent nos pérégrinations ou nos errances, une fidélité demeure inscrite dans notre langage même, dans le ressouvenir de nos rencontres, dans la lumière. L’esprit des lieux est un composé de culture et de nature ; le cosmos et l’histoire y ourdissent ces admirables conjurations où nous trouvons nos raisons d’être. L’auteur du Sang de Toulouse et du Trésor de Albigeois donne le sens de son cheminement par l’incipit, cher au cœur des toulousains évoquant le second âge d’or de la cité palladienne : « Par les quatre merveilles de Toulouse, par la beauté de ses clochers et la jeunesse de ses jardins ; par Clémence Isaure, la virginale et la protectrice, par Pierre Goudoulin aux beaux chants, par l’hôtel d’Assezat aux belles sculptures… ».
Ainsi débute la quête du Graal pyrénéen, par cette voix qui s’adresse une nuit de septembre à son héros Michel de Bramevaque : « Lève-toi ! Marche dans le pays toulousain, Retrouve le Graal qui est caché et les hommes seront sauvés ! » La quête du héros sera de retrouver les descendants des quatre chevaliers « portant sous leur manteau l’héritage de Joseph d’Arimathie, l’émeraude en forme de lys ». Ne divulguons pas davantage de ce roman, sinon qu’il y figure une « Nuit des loups » qui est l’un des hauts moments de la littérature fantastique. Evoquons encore, parmi les innombrables romans de Maurice Magre, Jean de Fodoas, qui fut réédité sous le titre La Rose et l’Epée où, ainsi que l’écrit Robert Aribaut, dans son ouvrage sur Maurice Magre, « la fleur royale n’est plus offerte au héros par quatre cavaliers noirs mais par Inès de Saldanna, sœur du vice-roi de Goa ! ». C’est bien la profonde méditation sur le « sang de Toulouse », qui circule d’un mouvement invisible dans l’architecture de la Cité ; c’est bien l’accord du promeneur avec les rues de sa ville, où les temps se superposent et transparaissent les uns dans les autres, qui donne sa vertu poétique à sa conquête du monde, à son amour baudelairien des cartes et des estampes, à sa nature prodigue et accueillante aux merveilles de l’étrange et du lointain.
Dans cette œuvre immense, d’une imagination vive, colorée et voyageuse, où l’art d’écrire n’est ni trop ostensible ni trop caché, où la beauté consent à se manifester, mais comme sous une injonction supérieure dont l’auteur ne serait que l’intercesseur, les romans d’aventures, tels Les Aventuriers de l’Amérique du Sud ou Les Frères de l’or vierge, les récits de voyage aux Indes, alternent avec les romans poétiques ou initiatiques tels Mélusine, où, sous l’égide des Lusignan, et de la reine Chypre, qui hantent aussi un célèbre poème de Gérard de Nerval, Maurice Magre annonce, en le précédant de quelques années, l’Arcane 17 d’André Breton : « Avec quel incommensurable amour étaient attentifs les êtres vivants de la terre et de l’air. Il flottait une pureté que je n’avais jamais ressentie. Elle était dans le dessin des nervures des feuilles, la cristallisation des gouttes de rosée, la fluidité de l’air pénétré par la prescience du soleil levant… ». C’est vers cette « fille de l’air et des songe » que va l’ultime passion de Maurice Magre. « Mélusine, notera Michel Carrouges, est en relation intime avec les forces de la nature et par conséquent avec l’inconscient ; mais elle a des ailes et par là elle est aussi en communication avec les mondes supérieurs, ceux d’où elle s’envole selon la légende ». Symbole de ce spiritualisme hédoniste, que nous évoquions plus haut, de ce supra-sensible concret qui appartient au monde imaginal, la Mélusine de Maurice Magre est la divulgatrice de l’enchantement des apparences, l’amie de ces « créatures messagères » que sont les grillons et les rossignols, elle qui fait de notre âme, non plus cet espace insolite, restreint, carcéral mais une nuit de Pentecôte peuplée de lucioles, de signes d’or, messagers d’une «connaissance cosmologique », à l’instar de ces « paroles profondes » qui étendent le royaume du secret et transfigurent le monde. A l’orée de sa mort, dans ses derniers écrits, Maurice Magre ne demandera plus au monde que d’être lui-même, mais en beauté : « Des milliers de petites gouttes de rosée, invisibles jusqu’alors, devenaient brillantes, s’allumaient comme les lampes d’une féerie minuscule, mais répandue à l’infini. Sortant du bain mystérieux de la nuit, le jardin émergeait, rajeuni et purifié. La lumière cependant continuait à naître d’elle-même. »
21:52 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook



