26/09/2024
Luc-Olivier d'Algange, A propos de "Dominique suivi de Epectases de Sollers" de Stéphane Barsacq, Editions Le Clos Jouve, 2024

Ce livre, composé de feuilles d'un journal, de lettres, d'aperçus, de brefs récits, d'entretiens et de pensées, échappe avec bonheur aux devoirs parfois forcés des genres littéraires, pour donner, par éclats, ce dont nous nous souviendrons avec gratitude. Nous y sommes invités, non comme des thésards, mais comme des amis, à fréquenter Dominique Rolin et Philippe Sollers, qui, pour le moins, ne sont pas des gens ennuyeux. Entre Dominique Rolin, trop peu connue sans doute, mais si vive et illustre dans la mémoire de ses lecteurs, et Philippe Sollers, très connu, mais sans doute méconnu et souvent mal compris, les affinités apparaissent comme autant de preuves. Cocteau parlait de la « preuve par neuf des neuf Muses ». A chacune revient une forme d'amour, distincte de la suivante.
A nos temps autistiques et abstraits, Stéphane Barsacq oppose le génie de la rencontre. Dominique Rolin d'emblée nous advient, aérienne, ailée, attentive, heureuse : « Je chante en moi-même et c'est le bonheur », et ceci « Il faut écrire tous les jours . On a tous un noyau d'horreur dont il faut se défaire ». « Le bonheur, écrit Stéphane Barsacq, fut l'héroïsme de sa vie ». Cocteau encore à propos de son livre Les Marais : « Ce livre est une grande merveille, une joie profonde. Car les racines qu'il enfonce dans la nuit du corps humain, la nuit du sommeil et toutes les nuits inconnues, n'empêchent pas l'intelligence parfaite d'éclater dans le moindre mécanisme de sa fleur. » Toute une civilisation nous revient ainsi dans son enfance « retrouvée à volonté » selon le mot de Baudelaire, avec ses vivants et ceux dont on se souvient, souvent plus grands vivants que les vivants-morts qui nous gouvernent. Une civilisation non d'un bloc, mais en essaims, une « guerre du goût », - en faveur des abeilles d'Aristée.
Sans doute est-ce lorsque nous la voyons en danger, ou sur le point de disparaître, que la civilisation, la nôtre, nous apparaît dans sa nudité glorieuse, anadyomène, comme surgie des flots à ses premières heures, et désirable. Stéphane Barsacq laisse tomber les écorces mortes, les stratégies, les opportunismes subalternes, pour ne garder de Philippe Sollers que l'effort vers Mozart, les Illuminations rimbaldiennes, la conversion du regard dans et par la poésie : « Ce qui m'importe ? Le rythme la vibration, la vérité dans la beauté. » Nul n'en pouvait mieux dire que l'auteur de Mystica, de Météores et de Solstices, - qui vont, par grands chemins, vers la musique et vers Dieu.
S'il cite à Dominique Rolin, lors d'une de leurs rencontres, la phrase de Heidegger « Le poète ne vient pas du passé, mais de l'avenir », il nous donne à comprendre que le tradere est chose vive. Ecrire, alors, c'est demeurer fidèle à des dieux ou des Muses oubliés qui attendent dans l'étymologie, le blason secret, ensommeillé, nocturne, des mots eux-mêmes. Lorsque « cela chante en nous », le temps entre en réverbération, et le mirage, sur la route asphaltée de l'été torride, ou dans le désert, devient une préfiguration de ce qui nous devance ou nous attend. Stéphane Barsacq, s'adressant à Dominique Rolin : « Vous même, Dominique, toute votre vie, cette vie que nous avez mise dans vos livres, elle va revenir, et, avec elle, votre jeunesse. Chaque année supplémentaire aura été vécue, en fait, comme une année de jeunesse à venir. »
Ecrire, déjà, encore, à jamais, ce sera toujours subvertir le temps, n'être ni régressif, ni progressif, mais digressif, - trouver la transversale ou temps, ou sa ronde, la danse, sans laquelle, savait Nietzsche, les philosophes ne sont que de fastidieux balourds. La question que ne cesse de poser Dominique Rolin « Etes-vous heureux » trouve sa réponse claire chaque fois que, par héroïsme ou désinvolture, nous avons vaincu l'esprit de pesanteur, le ressentiment, les théologies parodiques, les idéologies grégaires et vindicatives, pour être, avec Angélus Silésius « Un éclair dans l'Eclair », avec Rimbaud, « la mer allée avec le soleil », - faisant corps, dans notre profonde nuit, avec la soudaine épiphanie.
Qu'est-ce qu'écrire ? A cette question, à laquelle, par exemple, les œuvres de Maurice Blanchot tentent de répondre par la solitude radicale, Stéphane Barscq ajoute une autre question : que sont les écrivains ? Quels soient leurs masques, leurs jeux, voire la représentation publicitaire que, parfois, ils se donnent d'eux-mêmes, sans doute sont-ils moins dissimulés que quiconque, puisque tout s'est déjà donné dans le phrasé, dans la grammaire et la mélodie des mots écrits que ne recouvrent plus les mensonges de circonstance du « langage du corps » si trompeur, ni les apprêts de la voix.
Demeurent, cependant, d'une rencontre, les propos sur le vif, que Stéphane Barsacq ne laisse pas échapper. « Il y a, lui disait Dominique Rolin, tant de jours en une minute ». Dire cela, le noter, sera un acte d'être. Nous ne connaissons pas nos semblables par leurs plus évidentes particularités, celles que tout le monde remarque, ni par leurs généralités, où s'avachit la pensée des « sociologues », mais par leurs intuitions, leur métaphysique expérimentale, qui ne relève plus de la psychologie, mais d'une connaissance, en soi de la « montagne vide » des taoïstes.
Que recevons-nous ? Que donnons-nous ? « L’art du roman, disait Dominique Rolin, est l'art de l'entre-deux. » Parfaite définition, si l'on voit qu'il est entre la nuit et le jour, entre la bouche qui dit et l'oreille qui entend, ni ici, ni là, toujours ailleurs, - pas n'importe où, mais juste là, entre la chose dite, ou vue, et celle entendue ou imaginée. Ce n'est pas le nulle part, mais bien l'exactitude même, une science exacte au possible, un exercice de fine pointe.
Ainsi nous comprenons, touches par touches, sur les noires et les blanches, le dessein de ce livre, de cette fugue, et celui de ceux qu'il nous invite amicalement à connaître, autrement dit « le lieu et la formule ». Dominique Rolin, « sculpte avec le vent », elle est d'une lignée de femmes, Christine de Pisan, Madame du Deffand, Anna de Noailles, entre autres, lesquelles, écrit Stéphane Barsacq, « font mieux que de se mettre à nu comme les nymphes de Diane qu'on voit fleurir, d'ailleurs à raison pour soutenir le combat contre l'obscurantisme. Mieux ? Elles mettent à nu le monde ».
Luc-Olivier d'Algange
21:23 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
24/09/2024
Luc-Olivier d'Algange, entretien avec Marc Alpozzo:

Parmi les quelques noms de grands écrivains de notre époque, de Moralistes pour notre temps, qui n’occupent pas tout l’espace médiatique mais qui écrivent dans le silence de la littérature, pour les générations futures, pour les temps prochains (qui se moqueront allègrement des temps présents), je citerai bien volontiers Luc-Olivier d’Algange, qui écrit dans la grande tradition des Moralistes du dix-septième siècle, et construit patiemment, depuis 1981, une œuvre poétique et philosophique de tout premier plan. Aphorismes, formes courtes, ces textes qui forment à eux seuls une petite sagesse pour notre temps, nous donneront certainement la force d’affronter la confusion et l’indistinction qui sont les nouvelles valeurs d’une époque en détresse. Cet entretien est paru dans le n°44 de Livr'arbitres. Le voici désormais en accès libre dans l'Ouvroir.
Marc Alpozzo :
Votre recueil Propos réfractaires (L’Harmattan, 2023, coll. Théôria) est un ensemble d’aphorismes pas seulement réfractaires par goût, mais intempestifs par nature, insolents pour cette époque vulgaire et imbécile, agitée, tourmentée, redoutable et indécrottable dans ses idées fixes. Qu’est-ce qu’être réfractaire au vingt-et-unième siècle ?
Luc-Olivier d’Algange : Il me semble, oui, que l'on peut être réfractaire sans rage ni dédain, par des préférences, des goûts et des dégoûts qui nous viennent de loin, qui témoignent d'une disposition intime, d'un faisceau d'influences auxquelles nous avons consenti, d'un certain rapport avec les êtres et les choses, d'où les nuances ne pas exclues, d'une inclination vers la contemplation, et plus profondément d'une gratitude à l'égard de ce qui nous fut légué. Nous avons reçu bien plus que nous ne pourrions jamais donner : certains semblent oublier, ou refuser, cette évidence... Être réfractaire, ce serait alors, le plus simplement du monde, refuser le saccage, la table rase, le ressentiment morbide qui semblent être les maîtres de notre temps. Ces paysages, dont on voudrait nous exproprier, en les enlaidissant, ces œuvres, qui nous parlent depuis l'enfance, et que l'on conspue, nous y demeurons, avec piété, et presque malgré nous. Nous sommes pris en tenaille entre deux fondamentalismes qui ne s'opposent qu'en apparence, l'un, que l'on croit « archaïque » et l'autre délibérément moderne, mais l'un et l'autre s'évertuent également à ravager notre héritage français et européen. Être réfractaire, ce serait donc y demeurer présent, se souvenir, être mieux homme de réminiscence que de planification, récuser en pensée et en acte, ce monde « managérial », utilitariste, par l'usage d'une liberté conquise, l'exercice des amitiés vivantes, des admirations ingénues, par le recours, enfin, à ces « ermitages aux buissons blancs », qu'évoquait Ernst Jünger. Chercher et trouver « le lieu et la formule » où ce que nous aimons persiste et verdoie. Aller à sa guise. Disperser, tels des grains de pollen, des noms, des idées, des formes génésiques, sans lesquelles le monde serait plus triste et plus lourd. Lancer des passerelles vers d'autres temps qui exigent, pour se faire entendre, une vivante intercession. Se souvenir que les grandes œuvres demeurent « en réserve » selon la formule de Heidegger, sous un sol gelé, et attendre, selon le mot Nietzsche « le vent du dégel ».
M. A. : Vous parlez avec beaucoup d’intelligence des moralistes. Peut-on dire que vous en êtes un, modestement, mais sûrement, au milieu de la pacotille des moralisateurs de notre époque ? Quelle différence faites-vous entre les deux ?
L.-O. d’A. : Quiconque se refuse à être moralisateur, se retrouve d'emblée du côté des Moralistes. Le moralisateur est, par origine et destination, un censeur. Nos actuel wokistes, ces héritiers hystériques du Juge Pinard, s'adonnent à ce narcissisme pathétique qui consiste à se voir en défenseurs de la vertu et du « Bien ». Les Moralistes déjouent les prétentions de cette sorte et en révèlent les vanités. Les Moralistes sont l'antidote des moralisateurs. Les belles œuvres, celles qui nous parlent amicalement, celles qui nous regardent, ne sont jamais édifiantes et moralisatrices, elles ne cherchent point à nous enrôler. Elles ne nous font point la leçon. Nietzsche encore, ce disciple par excellence de nos Moralistes : « Il me répugne de suivre autant que de guider ». Que nous reste-t-l alors, hors de la sociologie, des drames domestiques, des griefs, de la psychologie plaintive, – toutes ces ficelles de la « moraline » contemporaine ? Eh bien tout le reste : l'impondérable, les variations de la conscience et de l'être, l'Eros et le Logos frémissant d'accords, les mots eux-mêmes, laissés en liberté, comme des scintillements épiphaniques de la lumière sur l'eau.
M. A. : Vous avez choisi d’écrire et de ne pas agir. Vous êtes à votre manière « retiré du monde » mais non pas « hors du monde » ce qui vous permet d’écrire contre les idéologues et les « dévergondés de l’abstraction », le mot est de vous, mais aussi contre les moulins à vent de la bien-pensance et de la société de la production. Vous écrivez, vous procrastinez, vous êtes antimoderne par conviction, est-ce ce pour vous à la fois l’aristocratie de l‘intelligence face à tant de bêtise, et la réponse que vous pouvez donner à l’effondrement de notre civilisation, qui se déroule sous nos yeux impuissants ?
L.-O. d’A. : J'avoue que la frontière me semble incertaine entre écrire et agir. Les hommes politiques, que l'on répute « homme d'action », que font-ils sinon de parler, mais sur un invariable filigrane de banalité, – leur pouvoir désormais confisqué par des instances financières ou technologiques ? Le retour au réel, aux évidences du réel, exige la sauvegarde de notre langue, de ses usages immémoriaux, de la possibilité de dire ce qu'il en est du monde, sans quoi toute action se voue à accroître la confusion. Certes, notre marge de manœuvre est des plus étroites. Nous sommes relégués, parias, clandestins, et tout ce que l'on voudra. Mais qui saurait donner l'assurance absolue que ce qui semble être un « hors du monde » n'est pas véritablement le cœur du monde ? L'acharnement avec lequel les censeurs exercent leur triste fonction montre assez qu'ils discernent un danger ; leurs incessants appels à la délation ne témoignent pas seulement de leur bassesse mais d'une crainte de voir ressurgir des libertés perdues... Qu'ont-ils à nous proposer sinon leurs rancœurs chafouines ? La force d'inertie, – celle de la majorité de nos contemporains qui ne se soucient guère de ces débats médiatiques, – est aussi de notre côté. Contre ceux qui veulent nous faire passer, nous demeurons. Tout est là : notre ciel et notre terre, et nos irréfragables fidélités. À échanger avec les uns et les autres, au hasard des promenades, des terrasses, des marchés, il n'y a guère que les « intellectuels » (par antiphrase), qui soient en désaccord profond avec nous. Nous ne sommes point si seuls à suivre un cours qui vient de loin, à nous reposer au bord de notre Lignon, à entretenir une libre conversation avec les êtres et les choses. Voyez le ridicule de nos adversaires, avec leurs écritures inclusives, leurs théories du « genre ». Rien de tout cela ne peut tenir. Ces précieuses ridicules mâtinées de « gardes rouges » sont vouées à l'oubli. Le propre de tous les totalitarismes est de périr dans leur triomphe. Il reste, bien sûr, que ces temps sont d'une sévère aridité, et que nous sommes provisoirement condamnés à vivre en de sinistres dissonances. Que nous reviennent les Muses ! Accordons-nous avec ce qui est plus vaste que nous !
M. A. : Selon vous, quels sont les grands dangers de notre époque ? Vous écrivez pour vous dépendre du nihilisme. Est-ce la dernière expression d’une désinvolture nécessaire et dont le but est lointain, afin de survivre dans un monde qui effectivement ne croit plus en rien ? Je veux dire, par-là, relire les moralistes et les grands textes, comme une sorte d’antimoderne en liberté, et qui ne se préoccupe pas de l’état du monde sinon pour en faire une œuvre d’art, est-ce désormais la seule réponse à donner à la fragmentation et la désagrégation du monde moderne ?
L.-O. d’A. : « Il y a beaucoup d'action dans l'homme de rêve et beaucoup de rêve dans l'homme d'action », je cite Drieu La Rochelle de mémoire. Lire et relire, et songer grandement par l'intercession des œuvres, c'est reprendre contact avec ce qui nous fonde. L'Europe économique, ce pouvoir usurpateur, est la négation de l'Europe culturelle, laquelle, contre les sinistres, les Lugubres et les rabat-joie, nous enseigna une certaine forme de désinvolture. Du Prince de Ligne à Paul Morand, une humeur se perpétue qui n'est point ennemie de la profondeur. Voici Nimier, Valery Larbaud, Cendrars... Voici, encore la coruscante Mittel-Europa, avec Witkacy dans sa révolte dans le « nivellisme », avec Döblin dans l'humour ravageur de son « Voyage babylonien », et tant d'autres... Witkacy le dit avant nous : le principal danger est le « nivellisme », l'uniformisation, l'éclairage scialytique, le contrôle de tout par tous, l'asservissement à la tristesse. La société, qui est un nihilisme en action, est devenue une machine de guerre contre la civilisation. Cependant une catena aurea, une chaîne d'or, court, nervure solaire, depuis Pythagore, Plotin, Jamblique jusqu'à Rimbaud, Shelley, Stefan George. Contre le clerc moderne, ce traître, nous nous souviendrons de l'Aède antique, de la salutation angélique que Béatrice adresse à Dante sur un pont florentin, et de D'annunzio : « Memento Audere Semper ».
M. A. : Vous avez de très belles pages sur l’Âme. C’est assez désuet de croire en l’âme aujourd’hui. Les modernes croient en la conscience et dans le néant. Les penseurs et les littérateurs à la mode croient dans la mort de l’homme, alors que vous semblez édifier l’existence de l’âme et l’unité du sens. Pouvez-vous nous décrire cette âme, sans laquelle le monde ne serait pas ?
L.-O. d’A. : Sans âme, nous serions morts, – ou nous le seront, machines perpétuelles, étayées de technologies, selon la morose utopie « transhumaniste ». Dans la mythologie cinématographique, les zombies sont venus à la rescousse des vampires, ce sont les créatures sans âme. L'âme est tout bonnement ce qui anime, notre mouvement, notre inquiétude, notre espérance. Ce n'est que de façon toute récente, par des sophistiques « matérialistes » que l'on en est venu à nier l'existence de l'âme, laquelle, naguère et jadis, était une évidence au suprême. La définir de façon scolastique serait peut-être fastidieux et un peu vain. L'âme ne se prouve pas, ni ne se décrit, et comme s'en souvenait aussi Huguenin, ce n'est pas l'âme qui est dans le corps, mais le corps qui est dans l'âme, environné d'âme... Chacun sait d'intuition, ce qu'est une chose sans âme, sans vibrato, une chose inerte. Ce sont les matières plastiques, les architectures de masse et tout ce qui n'est que purement quantifiable. Sans âme, les banques, sans âme, l'Administration. Relisons Gogol et Kafka. Le seul combat qui vaille est le combat pour notre âme. Les Anciens la figuraient l'Âme du monde sur le bouclier d'Achille ou de Vulcain. Un monde sans âme est un monde mort avant d'être mort : ce monde voulu par les nihilistes, non plus les nihilistes hirsutes à l'ancienne, ces contempteurs de « valeurs » bourgeoises déjà déconfites, mais les nihilistes policés, notables, « voulus modernes », adversaires de toute souveraineté individuelle ou collective, de toute aventure intérieure, les nihilistes du « c'est notre projet » clamé d'une voix de fausset, mais infiniment plus redoutables et déplaisants, mais passagers. Une sapience a été perdue, mais dans la nuit, dans son voilement, elle fait signe vers son retour, et voile, et vogue vers nous, nef odysséenne.
19:55 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
22/09/2024
Luc-Olivier d'Algange, De la souveraineté:

Luc-Olivier d'Algange
De la souveraineté
Les idéologues férus de « sciences humaines » cèdent parfois à d'excessives simplifications. De longtemps on vit ainsi s'opposer, en guerres plus ou moins argumentées, les partisans de l'individu et ceux du collectif, quand bien même les premiers finissaient, en troupeaux, dans un « individualisme de masse », particulièrement collectivisé, et que les seconds créaient des sociétés de l'anonymat où les hommes n'étaient pas moins esseulés et surveillés, - les uns et les autres passant à côté, ou plus exactement au-dessous, de la notion de souveraineté qui eût peut-être réconcilié, les meilleurs d'entre eux, par le haut.
En politique la souveraineté est aisée à définir: elle est de la nation en ses frontières propres ; en l'occurrence, pour nous, la nation française. La souveraineté politique vient, comme la France, de « haut et de loin », comme en témoigne d'édit royal établissant que « la terre de France affranchit celui qui la touche ».
La corrélation entre la liberté concrète des individus et du peuple auquel ils appartiennent, - la « franchise » et la nation unies par la souveraineté, - cette corrélation devient plus évidente à mesure qu’elle tend à disparaître, avec la France elle-même, tant dans son rapport avec sa culture, son tradere, ses mœurs, que dans son rapport avec le monde, de plus en plus soumis à des puissances étrangères, qui n'ont rien d'amical.
La globalisation uniformisatrice comme la subdivision en « identités » plaintives et vindicatives sont, l'une et l'autre, étrangères à la souveraineté. Les hommes de notre temps, semble-t-il, ne comprennent guère que leurs souverainetés particulières dépendent, plus qu'ils n'y songent, de la souveraineté de la nation à laquelle ils appartiennent. De leur si chère « individualité » que restera-t-il une fois qu'auront été dissipées ou abolies toutes les influences qui la forment, la langue, avec sa profondeur étymologique, la métaphysique de sa grammaire, les symboles, la relation immémoriale des hommes avec les paysages, les œuvres et les styles architecturaux, le « chœur des vivants et des morts » qu’évoquait Charles Péguy ?
Nul n'est souverain sur rien ou à partir de rien, et nul n'est libre que des lois qu'il se donne, des limites qui le définissent et en font, précisément, une personne et non cette simple unité interchangeable, telle que ce temps fiduciaire et technique le voudrait. De même qu'en sera-t-il des « identités », dès lors qu'aucune clef de voûte ne protège plus l'espace commun de l'effondrement, sinon quelque triste folklore d'usage touristique, ou pire encore, sous le signe du « multiculturalisme », la guerre civile, ostensible ou larvée, où ce sont encore les plus uniformisateurs et les plus fondamentalistes qui menacent le triompher, par le chantage moral ou la terreur ?
Ce qui rend au Moderne la notion de souveraineté si difficile à comprendre, c'est qu'il ne distingue plus la puissance du pouvoir, et que, ne les distinguant plus, il ne sait plus les unir à juste escient. Moins nous saurons honorer la puissance sise au cœur de la souveraineté et plus nous serons soumis au pouvoir, et plus encore la société deviendra l'ennemie de la civilisation, et plus encore les héritiers de la civilisation seront étrangers à leur propre pays défiguré, presque des parias. Or, ce monde qui disparaît avec eux disparaît pour tous, et ce qui disparaît, ce ne sont pas seulement des coutumes et des appartenances, mais des possibilités de l'entendement humain, un art de vivre, une sapience, un espace intérieur, un délié, une désinvolture et un bonheur sensible et intelligible, dont témoignent exactement les œuvres françaises.
Par quoi, si cette civilisation, avec ses limites et ses frontières, nous est ôtée, avec la nostalgie même de la souveraineté, sera-t-elle remplacée ? Nous ne le savons que trop: la monocorde monomanie de la pensée puritaine et calculante, celle qui fait table rase, afin de soumettre sans limites, - pensée non de la gratitude et de la mesure mais de la vengeance et de la démesure. Il suffit hélas de se connecter à quelque média que ce soit pour la voir au travail. Ses champions sont les comédiens de l'outrance, indignés de service, réclamant de nouvelles interdictions à mesure qu'ils abandonnent toute contrainte sur eux-mêmes.
La souveraineté est chose conquise par les prédécesseurs et donnée aux successeurs qui la perpétueront par gratitude, ou l'abandonneront au profit des plus illégitimes. Naguère encore, quoique voilée, plus ou moins indistincte, rendue fragile, blessée par deux conflits mondiaux, nous recevions la souveraineté française en partage. Ce donné, qui ne nous était ni étranger ni hostile, suscitait la gratitude, - ce plus beau d'entre tous les sentiments à envahir le cœur humain.
Toute souveraineté se fonde sur une Geste héroïque. Là où il n'y avait que chaos et servitude, elle instaure une mesure et une civilité. L'élan de remercier venait alors toute naturellement aux hommes. Les jardins et les cités, les heures dévouées à la nature apaisée et rendue féconde par l’ingéniosité humaine, tout cela nous était donné. La souveraineté était le nom de notre liberté, et il n'est rien de plus fragile qu'une liberté. C'est ainsi que le plus dangereux adversaire de notre liberté est notre ingratitude. Dans sa faille se précipitent les ennemis. Si l'on considère la plupart des idéologies modernes, qui toutes visent à un utilitarisme et un collectivisme inhumain, et si l'analyse de René Guénon les définissant comme une soumission au Règne de la Quantité demeure pertinente, une autre caractéristique leur semble commune: le refus du donné. Ce refus se tient au cœur de la soumission moderne. Qu'il y eut des peuples, des traditions, des fidélités, des hommes et des femmes, l'idéologue moderne s'en offusque. Pour le monde publicitaire, technocratique et ploutocratique, le principal inconvénient du donné, ce pourquoi il faut de déprécier, le haïr et si possible l'abolir, c'est qu'il ne s'achète pas. Cette faille, ce manque, cette frustration, ce mauvais romantisme qui consiste à toujours vouloir être autre ou ailleurs que nous ne sommes, sont, pour le vendeur, une nécessité vitale. La souveraine gratitude est son ennemie, elle qui déploie l'heure heureuse, la royale plénitude de l'être détachée des rets de l'insatisfaction, de la consommation et de la servitude.
On sous-estime généralement à quel point la réalité politique et la réalité intime se confondent. La souveraineté perdue et retrouvée est tout autant extérieure qu'intérieure. L'une est la cause de l'autre. Perdue, nous sommes livrés au temps de l'usure, à la division et à d'ineptes querelles. Un « chacun pour soi » éloigne à perte de vue l'horizon de beauté et de vérité qui nous unissait, et chacun, comme le Monsieur Hyde du récit de Stevenson, se trouve changé en sa propre figure monstrueuse. La bonhomie est changée en hargne, la confiance en ressentiment jusqu'à ce que les facultés mêmes de l'entendement soient atteintes, comme en témoigne le délitement profond de la grammaire et de la logique, et plus profondément encore, cette profondeur en soi qui laisse chanter et retentir la dignité des êtres et des choses.
Les hommes de la souveraineté perdue ou refusée désormais divaguent dans le malheur du temps auquel ils ajoutent par leur morosité et leurs griefs. A la légende des rois et des saints, au récit national, au culte des grands hommes, tels qu'ils figurent encore sur les frontons, que plus personne ne regarde, se sont substitué les narrations, à focalisations diverses, du malheur, de la honte et de la défaite. Le malheur sans fin se raconte en rond, et tourne comme l'âne attaché à son piquet, jusqu'à s'étrangler.
La souveraineté retrouvée n'en demeure pas moins, au cœur de quelques-uns, une espérance, et des précieux enseignements que nous recevions de notre enfance, par l’intercession de notre religion, demeure celui-ci : « Ne jamais pécher contre l'Espérance ». Nous ne sommes pas reliés à notre pays par quelque identité administrative mais par notre enfance et nos amours, et plus encore, par nos rimes et nos raisons. De la force qu’ils nous confèrent, tel « l'invincible été » qui persiste au cœur de l'hiver dont parlait Albert Camus, nous reconquerrons les droits de l'âme et la souveraineté de l'Esprit, là où, pour la première fois ils se manifestèrent pour nous, en France, par précellence, avec une solennité légère.
La plus grande ennemie de la souveraineté ou d'un homme, dont nous venons de voir qu’elles sont en relation intime, n'est pas le désordre, qui est toujours un ordre en devenir, mais l'ordre abstrait, l'ordre des « Robots » que, nous disait Bernanos, la mission providentielle de la France était de contrer. La souveraineté donne le la d'un ordre harmonique, hiérarchique, certes, mais aussi « ondoyant et divers », - vivant, comme peut l'être ce qui a une âme, c'est-à-dire une puissance supérieure aux pouvoirs, qui calculent, gèrent et planifient.
Si peu abstraite, c'est dans les circonstances les plus familières de l'existence que la présence ou l'absence de la souveraineté se manifestent, dans un espace et un temps concret, et par un homme, non pas universellement abstrait, ou réduit à une « identité », elle-même abstraite, telle que ce monde publicitaire n'en cesse d'inventer, mais incarné. Etre incarné signifie que nous ne parlons pas de nulle part, et cette chair et ce corps, - auxquels certes on ne saurait nous réduire, mais qui sont, le temps d'ici-bas qui nous est imparti, notre seul moyen de perception -, n'existent que parce qu'ils sont en relation avec ce paysage où nous sommes, et les saisons, et la lumière qui les révèle et les voile tour à tour, dans une évidence et un mystère qui échappent à toute statistique, souverains. L'enracinement, à cet égard, est le fait humain le plus universel et le plus singulier, et suppose une disposition intérieure, qui est de l'ordre de la poésie. « Habiter en poète » disait Hölderlin. Il n'est point d'autres façon; et ceux qui sont conduits à s'y refuser, et peu importe leurs origines, vivront dans la caverne dont parlait Platon, dont Philippe Barthelet, remarquait dans ses Tulipes d'Orage, qu'elle s'est démultipliée, et délocalisée, et se nomme désormais « Cyber-café », - lequel est désormais partout, chaque tête penchée, pour n’être plus là, que ce soit en ville ou à la campagne, sur son écran portable, en toute circonstance, comme en prévision d’une décapitation.
Où et quand sommes nous ? La précipitation dans le négoce, dans le monde et la morale virtuelle, parfaitement adaptée à l'homo economicus, nous le font oublier. L'enracinement n'est pas l'art de faire les hommes et les femmes semblables à des « souches », comme on l'en accuse parfois, mais l'art de se situer dans l'espace et le temps, dans un hic et nunc qui n'est pas interchangeable, et qu'une souveraineté surplombe et sauvegarde.
« Ici » et « maintenant » ne se perdent pas, alors, dans un temps aussitôt détruit que perçu ou dans un espace indifférencié, purement quantitatif, tel que le veulent les urbanistes de la « globalité », mais, très-exactement, des résonances ou des consonances: correspondances, au sens baudelairien. De longtemps, - depuis les Temples de Delphes et d'Epidaure jusqu'aux plus humbles chapelles romanes, l'art humain fut de consacrer l'espace en une architecture accordée aux lois de la musique afin que les hommes, s’en approchant, soient conduits au beau mystère de la profondeur du temps et à l'accord de leurs pensées avec les symboles qui les ordonnent, parfois à leur insu.
Ces bienfaits ont été arrachés aux Modernes, ou, plus exactement, ils s'en sont, par outrecuidance, par démesure, eux-mêmes privé. Les voici, il suffit de se rendre dans la périphérie de n'importe quelle ville française hélas, pour voir que toutes leurs constructions allient la laideur et la désorientation, livrées aux périls d'un insolite, d'une arythmie qui creuseront dans l'âme un néant tyrannique. Une horrible préférence s'en suivra pour ce qui n'est pas au détriment de ce qui est, et contre laquelle il sera bien difficile de lutter, tant qu'en nous-même une sûre souveraineté ne sera pas restaurée. Tant de choses furent désapprises, qu'il nous faut humblement réapprendre: l'attention à l'esprit des lieux, les « jours filés de soie » qu'évoquait Jean de la Fontaine ; le « pur idiome du Valois » dans lequel songeait Gérard de Nerval ; le « tous pour un » des Mousquetaires, Place Royale ; les scintillement de la rivière, ce Lignon de la langue française, qui traverse l’Astrée, et féconde les paysages; les couleurs diverses de la terre de France, ses peupliers d'argents ; l'allant heureux par-delà les déconvenues.
Cependant, la souveraineté n'est pas une forme passée, mais une forme formatrice, - un principe qui ne se réduit pas aux apparences qu'elle revêtit ou aux formes dans lesquelles elle se manifesta. La souveraineté perdue, qui brille par son absence, est déjà la souveraineté retrouvée.
Luc-Olivier d'Algange
16:54 | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
19/09/2024
Luc-Olivier d'Algange, à propos d'Ernst Jünger, entretien avec Laurent Gayard:

Luc-Olivier d'Algange
Entretien avec Laurent Gayard
Ernst Jünger est né le 29 Mars 1895 à Heidelberg et mort le 17 Février 1998 à Riedlingen. Son œuvre s'étend sur un siècle et pourtant on semble, en France du moins, s'acharner à réduire ce contemporain capital à Orages d'aciers et à ses écrits guerriers...
Luc-Olivier d'Algange: Rares sont les lecteurs dont l'attention s'ouvre à l'envergure d'une telle œuvre, qui est, pour l'essentiel une œuvre du poète, de moraliste, et de métaphysicien, méditant sur les aspects et la nature du temps, les symboles, les mythes et les dieux, les rêves et les ivresses, les gradations entre le sensible et l'intelligible. La guerre fut imposée à Ernst Jünger par l'Histoire; elle fut sa première épreuve, sa première expérience; l'étymologie le dit exactement, expérience, ex-perii, traversée d'un danger. Or, ce que cette traversée enseigne, sa résonance, ce qu'elle change en soi est tout aussi important que l'expérience elle-même décrite dans sa durée et sa réalité dans Orages d'acier ou La guerre comme expérience intérieure. Qu'en est-il de l'autre rive, de cette évidence magnifique d'avoir survécu à l'épreuve ? Quel regard portons-nous sur le monde ? A quelles nouvelles méditations accédons-nous ? A quelle éthique, décantée de toute facilité moralisatrice ? Quels seront, dans la belle éclaircie, le calme retrouvé, les objets dignes de notre attention ? Ernst Jünger répond à ces questions par des œuvres, souvent allusives et fragmentaires, parfois visionnaires, et semblables à ces voyages dans le monde imaginal que l'on retrouve aussi bien chez les mystiques persans, dont nous entretient Henry Corbin, que chez les Romantiques allemands. Seuls, disait Nietzsche, importent « les livres qui d'emblée ne veulent pas être des livres », qui ne sont pas composés à cet escient subalterne, mais naissent d'une nécessité plus profonde,- celle (dans Graffitis, Frontalières, ou Les Ciseaux, titres à cet égard significatifs) de l'aperçu impromptu qui est le matin de la pensée, ou celle de la vision, parfois presque hallucinée, dans Héliopolis, qui en est, peut-être, le magnifique et chatoyant crépuscule. Les livres d'Ernst Jünger sauvegardent ainsi la part du feu. Point de thèse ni d'antithèses clairement définies, point de plan, qui laisserait l'ouvrage aux rigueurs de l'ennui, mais d'incessantes ramifications et réminiscences, des arborescences d'images et d'idées, - Jünger se souvenant que l'Idée est aussi, par étymologie, la chose vue. Point de théories, l'étymologie encore nous le confirme, qui ne soient aussi des contemplations.
Il n'existe, au fonds, que deux races d'homme, les Rabat-joie et les Enchanteurs. Les uns jalousent et se plaignent, haïssent la musique, et les cheveux au vent, la désinvolture et la beauté, ce sont les puritains, de sortes diverses, qui nous prennent en otage, et même en tenaille; les autres, les Enchanteurs, à l'exemple du Mage Schwarzenberg de Visite à Godenholm, - et de Jünger lui-même, - persistent dans la fidélité aux plus anciennes sapiences. De grandes épreuves tôt survenues prédisposent à échapper, certes, au rôle sinistre du Rabat-joie, - ce comédien idéologue, fanatique, plaintif et vengeur, ce moralisateur compulsif qui travaille sans relâche à restreindre le champ de l'aventure humaine. Qu'ils soient barbares exotiques ou globalisés bien de chez nous, adeptes de la société de contrôle, les Rabat-joie haïssent les cœurs aventureux... Pour lire une œuvre, comme l'écrivait Ezra Pound, il faut partager au moins une part des expériences dont elle témoigne. Ce dont parle l'œuvre d'Ernst Jünger, ce grand tradere européen qui nous vient, en ressac, jusqu'en nos songes, depuis Hésiode et la Bible, son commerce avec les Milles et une nuits et avec Léon Bloy, mais aussi avec Rivarol et les Moralistes français, n'intéressent plus guère, - ou, ne péchons pas contre l'espérance, pas encore... L'œuvre d'Ernst Jünger, comme Heidegger le disait de celle d'Hölderlin, - et comme nous pouvons désormais le dire de presque toutes les œuvres de notre civilisation abîmée, - demeure « en réserve ». Mais qu'est-ce que la poésie, sinon une attente ardente ? La « vie magnifique », selon la belle formule d'Ernst Jünger, n'est pas une chose hors d'atteinte; la beauté ne s'est pas absentée du monde, elle est présente, de toute sa présence émouvante et puissante, seulement voilée de laideur, telle une Aphrodite couverte, provisoirement, de hardes ignobles.
Du Travailleur, en 1932 aux Falaises de marbre, et 1939, on voit Jünger passer d'un vitalisme teinté de nationalisme et d'une célébration de la technique à une critique onirique de la modernité à l'œuvre dans le totalitarisme et la guerre. Après la guerre, ce sera le Traité du rebelle (1951) puis Eumeswil (1977) qui feront progressivement émerger la figure anarchisante et aristocratique de l'Anarque. Jünger n'est pas toujours facile à suivre...
Luc-Olivier d'Algange: Ernst Jünger semble obéir à cette injonction nietzschéenne qui veut traverser, telle une œuvre-au-noir, tout le champ du nihilisme moderne afin de le laisser « derrière soi, en dessous de soi, surmonté ». Le nationaliste Ernst Jünger cesse d'être nationaliste avec la venue au pouvoir des nationaux-socialistes, au point que le mot « allemand » disparaît de ses œuvres. En certaines circonstances, certains mots ne peuvent plus être partagés. Face à l'Allemagne tonitruante et publiciste demeure cependant une Allemagne secrète, pour reprendre la formule de Stefan George, à laquelle Jünger demeurera fidèle. Le Wanderer, le Chevalier de Dürer, et même les personnages enivrés et divagants d'Eichendorff ou de Hoffmann, jusqu'aux attentions extrêmes qu'exigent les Holzwege, les chemins qui ne mènent nulle part, qu'évoquait Heidegger, sont autant de préfigurations, typiquement allemandes, du refus de la pensée utilitaire et planificatrice et de la société de contrôle Point n'est nécessaire pour Jünger, de parler « en tant qu'Allemand ». La tradition coule de source, sans redondance. Au demeurant, parler « en tant que », c'est déjà, comme le savait Guy Debord, s'éloigner dans une représentation, au détriment de la présence réelle, et lâcher la proie pour l'ombre, être semblable aux « hallucinés de l'arrière-monde »,- la formule de Nietzsche n'étant pas, soit dit en passant, sans évoquer les prisonniers de la Caverne du mythe platonicien... Sortir de la caverne platonicienne, pour Jünger, ce sera sortir de la société qui est devenue, non seulement l'écorce morte, mais, et nous le voyons aujourd'hui mieux que jamais, l'ennemie de la civilisation. Tel sera le dessein du Rebelle, puis de l'Anarque: échapper au contrôle et se délivrer en soi-même de tout ce qui porte encore le joug.
Le Rebelle justement... Dans le Traité du Rebelle, Jünger écrit qu'il « est mis par la loi de sa nature en rapport avec la liberté, relation qui l'entraine dans le temps à une révolte contre l'automatisme et à un refus d'en admettre la conséquence éthique, le fatalisme ». Comment la figure de l'Anarque s'oppose-t-elle à ce qu'Ortega y Gasset nommait « l'individu de masse » ?
Luc-Olivier d'Algange: L'individualisme de masse est le pire collectivisme, destiné à absorber tous les autres collectivismes, d'où la naïveté qui consiste à opposer le collectivisme à l'individualisme, - naïveté de sociologues, sans grande perspective historique pourrait-on dire. Roger Nimier s'en moquait déjà. La pratique de l'Histoire et de la littérature ne sont pas sans déniaiser. Dans l'individualisme de masse, qui perfectionne à cet égard les totalitarismes collectivistes, les individus sont « du pareil au même », selon la formule de Renaud Camus, interchangeables, rouages ou agents, tous également irresponsables, c'est dire sans répons ni correspondance, ni entre eux, ni avec le monde... Esclaves sans maîtres se surveillant les uns les autres dans une sorte de mutualité de la servitude. Par-delà l’alternative de l’individu et du collectif, Jünger distingue « das Einzelne », le singulier caractérisé, « l’homme différencié » dirait Julius Evola, de l'individu interchangeable, en ce que ce « singulier » n'est pas insolite, mais relié à un faisceau d'influences, différent pour chacun, où entrent en jeu sa langue natale, son pays, son époque, ses prédécesseurs, ses songes et ses rencontres - son existence révélant ainsi, comme l'athanor de l'alchimiste, une expérience unique, située et non-reproductible. L'Anarque, nous dit Jünger, est à l'anarchiste ce que le Roi est au monarchiste: non plus une déclaration d'intention, un projet, un vœu, une abstraction universaliste mais un exercice pratique qui va de nuances et nuances.
Dans votre ouvrage, Ernst Jünger ou le Déchiffrement du monde vous écrivez que « la gnose poétique de Jünger est avant tout une philocalie ». Pouvez-vous éclairer sur ce point nos lecteurs ?
Luc-Olivier d'Algange: Si la vérité est dans l'attention et dans la nuance, et si le beau est, comme le dit Platon, « la splendeur du vrai », vouloir les connaître, c'est-à-dire naître et renaître en eux, est bien une philocalie, un amour de la beauté. La beauté, qui exige, pour nous advenir, cette « gnose », cette voie de connaissance, n'est pas seulement une forme, susceptible d'être livrée à quelque muséologie. La beauté est révélatrice; elle est au sens étymologique, une apocalypse. Telle l'Icône, en sa « perspective inversée », dont nous parle le Père Florensky, elle nous regarde autant que nous la regardons, abolissant le hiatus entre le contemplateur et la chose contemplée. La gnose poétique (qui précisément n'est pas un gnosticisme dualiste) est ce chemin vers l'intérieur où l'extérieur nous revient. Nous sommes ici-bas, nous dit Jünger, si nous savons regarder, à bord d'un « vaisseau cosmique ». Dans Héliopolis comme dans Visite à Godenholm, Ernst Jünger nous fait assister à la levée de ces grandes images suprasensibles, intemporelles, ces immensités prodigieuses dont l'infime et le presque indiscernable détiennent le secret.
L'Anarque est aussi celui qui refuse de collaborer à l'enlaidissement du monde. Il n'y résiste pas seulement, il contre-attaque. Le contraire de la consommation, cette ultime raison d'être de l'individu massifié, existe, c'est la création. Chaque instant de beauté créé ou sauvé, l'est à jamais. Une transmutation du temps s'opère alors. L'instant redevient ce qu'il est, stat, ce qui se tient, - Thulé immobile dans le tumulte des flots. Une grande sérénité, une sérénité ardente nous vient de cette certitude. Ce fut aussi l'intuition de Nietzsche dans sa vision de l'éternel retour, en sa réalité physique. Ce qui fut demeure dans sa propre dimension spatio-temporelle. Une morale en découle: ne pas gâcher ce qui en soi, ou dans monde, est une possibilité de susciter ou d’aimer la beauté.
Dans Eumeswil, Jünger écrit, pour expliquer la différence entre le Rebelle et l'Anarque que « la distinction réside en ce que le Rebelle a été banni de la société tandis que l'Anarque a banni la société de lui-même. » Au lieu de ce que l'on pourrait à tort croire comme un appel à fuir le monde, le « recours aux forêts » est-il donc une volonté de replanter en soi-même les germes d'une spiritualité salvatrice, comme un antidote au nihilisme ?
Luc-Olivier d'Algange: « Bannir la société de soi-même », ce n'est pas s'exclure, se marginaliser, mais aller vers la civilisation, ou mieux encore, le cœur, l'essence de la civilisation, l’amicale civilité, l'esprit dont ses œuvres naquirent, le feu sous les écorces de cendre. Cet exercice est celui de l'honnête homme. Le grand refus se traduit non par des poses spectaculaires, des outrances, - ces grimaces propres aux « rebellocrates » dont parlait Philippe Muray, - mais par de nouvelles prévenances et délicatesses, une politesse réinventée à l'égard des êtres et des choses, une certaine discrétion de bon aloi. Jünger est aux antipodes de ces intellectuels qui prennent langue sur tout, s'indignent à foison et s'exhibent sur les lieux des conflits médiatisés, pour en recevoir un lustre d'actualité et quelque facile notoriété. Préférant méditer sur les dieux et les titans, les irisations de l’aile de la libellule, la part d'intemporel sise dans les choses fugitives et légères ; préférant la lecture d'Hérodote, de Tacite ou de Thucydide à celle du journal du matin, Ernst Jünger ne prend jamais son lecteur en otage, ni pour un imbécile ; il ne lui assène point ses convictions, ses affres, sa sentimentalité; il ne dit que ce dont il juge qu'un compagnon de route, honnête homme, pourrait faire son bien: l'aperçu, l'approche, qui augmentent l'intensité et la beauté de la vie, - s’ordonnant ainsi, sans jamais être doctrinaire, à la Théologie, qu'il nomme « la science de l'abondance ».
Le nihilisme moderne, au contraire, est technique de la pénurie; il faut que chacun s'y sente assez pauvre pour s'asservir et joindre l'utile au désagréable. La science de l'abondance, elle, débute par l'attention à ce qui est, par la gratitude. Nous sommes sur la terre qui fleurit et sous le ciel qui change. Il nous appartient d’honorer cette bonne fortune, qui tant ne dure.
En donnant dans toute son œuvre un déchiffrement du monde qui s'oppose au règne de la quantité, Jünger peut-il être considéré comme le théoricien ou l'esthète d'un véritable anarchisme spirituel ?
Luc-Olivier d'Algange: Oui, si l'on considère qu'un anarchisme spirituel a pour dessein de raviver les principes par-delà leurs parodies et leurs faux-semblants et de retrouver, par-delà les représentations abstraites ou administratives, au vif du temps, le secret de l'Archè, là où il se trouve : dans le nuage, la vague et la flamme, - auxquels notre pensée et notre vie devraient s’accorder plus souvent .
Ernst Jünger s'est converti au catholicisme à la fin de sa vie. Quel rapport entretenait-il avec cette religion ?
Luc-Olivier d'Algange: Selon leurs propres préférences les exégètes accordent plus ou moins d'importance à cette conversion. Les uns la jugent de circonstance ou de convenance, les autres y voient le point d'orgue de l'œuvre et son sens ultime. Il est peut-être outrecuidant, ou absurdement prosélyte, d'en vouloir dire, à ce propos, plus que Jünger lui-même. Il n'en demeure pas moins que ce beau mouvement, venu de loin, et qui fut aussi celui de plusieurs Romantiques allemands, vers, justement, une spiritualité romane, laisse entrevoir sa vérité dans la « Marina » qu'évoque Ernst Jünger dans Les Falaises de Marbre, cette contrée de vignes et de livres, avec son « Ermitage aux buissons blancs », où nous pouvons, par ces temps désastreux, en songe nous recueillir.
圓
Luc-Olivier d'Algange, Le Déchiffrement du monde, la gnose poétique d'Ernst Jünger, éditions de L'Harmattan, collection Théôria.
22:26 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
11/09/2024
Luc-Olivier d'Algange, le Chant de la voile latine, poème:

Luc-Olivier d’Algange
Le Chant de la voile latine
L'automne flambe, sa légende douce nous éblouit.
De quel songe ce silence d'être?
Nous sommes dans l'attente comme sur une mer. Nos compagnons
nomment ces lueurs, ces désastres avec la patience des tragiques.
L'aube
se devine dans notre sillage rapide... La gloire s'embrase dans la défaite !
Rien n'est dit. La mémoire est plus grande. Ce destin futur est vertigineux
et cependant nous gagne la paix de l'âme. Tout s'apaise dans cette flambée d'automne,
dans ces arcanes où s'indiquent une omniscience, un oubli identiques.
Toute chose s'accroît dans notre sérénité comme s'inclinent les feuilles sur des fleuves orientaux,
comme les Mystères d'Eleusis fondent à la dernière ardeur
cette mélancolie de l'âme qui se renie et trouve sur l'envers de la feuille
la lueur de l'Orient et la forme précise de l'être !
Rien n'importe que cette puissance qui chante l'être à sa naissance !
Rien n'importe que ces traits de bonheur et d'ivresse… L'air frissonne
de ces étoiles et rochers muets. Les lointains scintillent.
La nuit redit
avec le murmure de l'eau la douce flambée de l'automne et l'exemption.
Ce qui nous sauve nous porte au-delà (et l'heure ancienne brille sur la courbe
de l'aile du souvenir de l'hirondelle que l'automne engloutit mais garde
dans la mémoire, flambe et bruit dans sa mémoire, comme un âtre d'éternité.)
J'en témoigne: ce furent des jours de beauté.
La gratitude me domine. C'est à peine si elle me laisse dire le combat
dont resplendissent les arts, les épreuves que la terre oppose aux esprits de l'air.
La strophe parfaite me domine. Des Anges se nomment
dans les feuillages de mes mots. Les étymologies bruissent comme d'inviolables forêts.
Ce monde est grand. Ce monde est la rhétorique de Dieu.
Dans le mot qui achève une pensée, c'est tout l'azur attique
qui se verse dans mon âme en récompense ! Je souris à l'immense frondaison.
Je devine ce qui revient, ce qui chante sous le joug de l'immanence,
ce qui me délivre dans une douceur lointaine !
Je devine ce qui s'écrit avec reconnaissance. Un dialogue s'ébauche.
Les Anges et les dieux répondent.
Le répons flambe jusqu'au royaume des cieux !
L'automne flambe dans les feuilles, s'adonne aux teintes de feu, à l'infaillible
et vermeille teinte de la puissance que l'ombre d'un Aède conjugue
d'enseignements sacrés, de forces généreuses, héroïques, lorsque le monde défaille
et qu'il nous faut retrouver par un pacte fraternel ce ciel, cette mer et ces dieux,
enfin accordés à notre gratitude,
à notre reconnaissance qui presse sur nos lèvres l'aurore !
Que nous importe que règnent alentour un vacarme d'insignifiance.
Notre silence rayonne, il annonce, c'est à lui que l'offrande revient.
Le silence est au cœur de l'automne comme une flamme, le silence
fonde l'éminente confession des flammes où s'éveille l'étendue, les trônes
de blancheur d'un Temps que l'âme reconnaît.
Honneur à cette reconnaissance !
Car l'aurore est un fruit que le silence de l'attente mûrit pour nos lèvres.
Sa saveur flambe en nous, science auguste, vérité bruissante. Elle tient
sa sagesse de l'or oriental qu'un fleuve élève entre la lumière et la nuit.
La pierre supporte le poids le plus léger. Son âme est crucifiée sous la pluie.
Elle chante l'horizon de ses branches de cendre.
La pierre est une aérienne rosée.
Toi seule, avec l'innocence des sources qui labourent la nuit
reviendras comme l'ordre le plus vaste dans l'âme de la pierre.
Toi seule, d'aurore en aurore portant le secret fleuri de la pierre
tourneras dans le jour comme l'horizon. Nous sommes dans la mémoire
et le ciel sur nous pèse comme un rêve... La pierre ne s'offense point
de la légèreté infinie de l'air, ni des mille édifices immenses
qui, du haut de la profondeur des cieux, accablent nos cœurs. La pierre
nous laisse à nos méditations, nos tragédies; nos ombres sur la neige
la dissimulent.
Telle fut aussi notre nuit, notre œuvre de feu. Les forces
De l'Idée conquièrent des empires, et notre bonheur taciturne demeure
à cette ressemblance. Nous qui sommes légers
supportons le poids le plus lourd, nous qui sommes libres sommes
blessés par le joug le plus dur. Légère est la nostalgie inépuisable.
Léger est le doute lorsqu'il se dépossède de son ombre. Légères
ces journées hautes et bleues que la forme de la coupe nomme
dans l'illusion des heures, des prières: miroir de nature. Légère
est cette parole saisie sur les lèvres par le silence plus grand, son effleurement...
La pierre supporte le poids le plus léger, non par contraste mais par essence,
alors que le ciel si haut nous courbe vers la terre avec le temps. Nos
lampes s'allument dans l'encolure du Soleil. Paisible est le moment.
Il brûle une ode perpétuelle où apparaît l'immense. Et l'immobilité
nous donne à croire et à songer que cette ample ordonnance,
qui nous environne, est peut-être une pierre transparente ! Qui sait ?
Se peut-il que nos batailles soient immobiles et toutes tracées les voies
de nos aventures ?
Et nos sillages sur les mers seraient telles les volutes de l'agathe
prises dans cette éternité qui supporte le poids le plus léger ?
Etranges rivages de la pensée !
Dans quel métal attentif le tonnerre est-il emprisonné ?
Au cœur de quelle perle infaillible nos voix énoncent-elles une vérité ?
Tout concorde à cette limite... Nos philosophies polissent les roches.
Nos entendements sont les âges légers où se reposent les courants profonds.
Rien n'égale cette vie ruineuse, ce chœur infini, ce passage de la terre.
La pierre supporte le poids le plus léger et nous attendons l'assentiment divin.
Que soit aussi légère notre gratitude. L'amphithéâtre rougeoyant de l'automne
Sera l'âtre de la pierre mélodieuse.
Plus lointaine que nos regards, notre vision !
Du cœur du monde tout se déploie, nos pensées ardent à la pointe angélique:
ce foyer du monde est sans pourquoi, notre science prime le soleil
qui tourne dans nos pensées comme des jours périlleux. Quels autres mondes
seront dits dont je ne sais rien ? Qui revient dans cette inquiétude du matin
avec cet aujourd'hui en miroir de nous-mêmes dont nous aurons tout oublié ?
Fraîcheur sur notre front est notre légère gratitude ! Le jour est enclos
dans cette pierre. Son signe de feu est crucifié sur le ciel. L'éther flambe
dans sa rosée tel un hommage silencieux de la grandeur. J'en témoigne.
Dans la beauté, dans la résonance d'aurore en aurore de cette flambée douce
à s'évanouir dans les bras de la puissance du monde comme une suprême
volonté d'harmonie ! Ces temples, ces cathédrales, ces palais, ces jardins
devancent l'orgueil humain d'une gratitude légère... La vision est plus lointaine.
Les regards s'attardent sur la pierre, s'abandonnent aux feuillages, aux nervures
si vertes sur la feuille déjà rougissante, mais la vision est au-delà.
Ce que je vois précède et laisse à mon regard les fastes du chemin parcouru.
Son sillage est le monde. Ce monde que mes regards édifient dans la limpidité
de ce jour d'automne est un sillage qui bouge, scintille et retombe
dans l'éloignement de l'invisible vaisseau de ma vision.
Légère sur le front, en vérité, car toute vérité est réminiscence !
Ai-je aimé ce mouvement, cette matière ! Ces souffles qui peuplent mon sang
d'une force nouvelle ! Ai-je bien dit la merveille des mers, des pâturages
et l'apparition diurne de la voile des astres, des volontés surhumaines ?
Je n'aime que les passions qui resplendissent, les sérénités violentes, les ferveurs
sèches et claires ! Ai-je nommé la ductilité, l'embrun, le sel, et l'or du fruit
qui s'épanouit sur la langue ? Ai-je dit l'hédonisme et la tempête ? Tout
cela n'est rien sans l'être immobile, sans l'éclat vertical du Principe foudroyant.
La nécessité et le hasard, pauvres mensonges de l'inscience… Ai-je dit
ce qui emporte pour ne point aimer ce qui demeure ? Quelle vanité ce serait !
Ce jour d'automne est un promontoire. Les jours anciens protègent
leurs régions d'équinoxe, les ciels s'approfondissent et se transfigurent
de grondements et d'éclairs, les accalmies elles-mêmes sont frissonnantes !
Comment l'âme ne s'allégerait-elle pas ! Ce qui ondoie me révèle
la mathématique des voiles: mes regards. Ai-je nommé ce qui précise
pour bêtement haïr ce qui vague ? La voile est latine et le chant
pythagoricien à la plus haute seconde du tumulte.
Sa pointe est le cœur de l'Ode qui tournoie.
Illicites nos phrases dans l'impétuosité !
Que nous haïssent les adeptes du rabougrissement !
La grandeur est notre amie, jusque dans l'infime nervure !
L'arc-en-ciel qu'emprisonne la goutte de rosée suffit à notre ciel
comme un pont entre les mondes ! La nature et la Surnature
ruissellent l'une dans l'autre ... Illicites nos visions ! Elles devancent
le cours d'un fleuve invisible qui recueille dans sa mémoire (car il n'est rien
de moins oublieux qu'un fleuve) l'image exacte de tous les feuillages
Qui se penchèrent ! Illicites nos joies et nos songes ! Accordés aux saisons divines.
Nous puisons le sens de l'obéissance aux profondeurs et aux hauteurs.
Qu'elles sourdent, les profondeurs ! Et les Hauteurs, qu'elles brillent
d'un Septentrion rayonnant de structures ! J'accompagne le sens
de cette sagesse furibonde avec la rapidité
des hirondelles
qui tranchent l'espace en gemmes prophétiques !
Quel dieu nomme cette justice ?
Quel dieu se nomme à travers cette disposition exacte ?
Quel dieu, en nous, se résout comme une ultime démonstration ?
La tempête s'ordonne à la mathématique d'un songe sans rivage !
Nous parviendrons à l'infini, non comme au sentiment de ce qui nous outrepasse
mais par l'exactitude mathématique d'un entendement tourné vers le Haut !
Qu'elles brillent, hautes dans les nues superposées, qu'elles chantent
jusqu'à l'inaudible accomplissement de l'art ! Elles témoigneront du Profond
comme d'un triomphe en nous de l'inlassable. Ces roches furent nos autels
et nos paupières fermées l'ampleur du crépuscule de l'aurore ! Tout se tient
dans une louange secrète ! Ce monde je le déploie dans mon refus
comme un silence grandissant, ce monde, je le hausse dans la gloire
de mon refus avec la persistance d'un repentir sans objet.
Ces prairies en fleurs
dans le soir qui tombe, qu'elles soient en-deçà ou au-delà de mes paupières,
je les aime. D'un égal amour du voyage et de l'immobilité, d'un égal
amour de la hauteur et de la profondeur, je consacre cette seconde où
je ferme les yeux pour attendre le monde.
Extrait de Le Chant de l'Ame du monde, éditions Arma Artis.
16:40 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
Luc-Olivier d'Algange, Le Voyage intérieur:

Luc-Olivier d'Algange
Notes sur le Voyage intérieur
« L’esprit, nous dit Nûruddîn Abdurrahmân Isfarâyinî, a deux faces, l’une tournée vers l’incréé, l’autre vers le créé. ».
Avant même d’atteindre à la perspective métaphysique dont elle procède, avant même que nous en comprenions le sens profond, gnostique, cette phrase s’adresse déjà à notre entendement, à notre raison. Sans même comprendre la sainteté de l’Esprit, et ses œuvres lumineuses et providentielles, hors même de toute théologie et de toute gnose, l’esprit humain reconnaît en effet, pour peu qu’il s’attarde en lui-même, cette double nature, ce double visage, cette figure de Janus tournée en même temps vers l’advenu et le non-advenu, le possible et le réel, ce que nous pressentons, devinons et imaginons et ce qui s’offre à nous dans l’infinie diversité du monde créé.
Aussi éloignés croyons-nous être de toute métaphysique, aussi attachés au monde sensible que nous nous voulions, nous n’échappons pas à l’exercice quotidien de cette « double nature » de l’Esprit. Chacune de nos actions est précédée de son projet, de même que chaque rêve et chaque désir naissent d’une observation du monde qui nous entoure. Le temps, qui, en un voyage impondérable, nous précipite vers l’incréé et laisse le créé devant nous, non point aboli mais hors d’atteinte, définit à lui seul ce double visage de notre esprit. Aussi attachés soyons-nous au monde qui nous entoure, si réglées que soient nos existences et quel que soit notre consentement à la servitude du temps planifié, nous voyageons dans le temps, et le moindre éclair de lucidité nous révèle la fragilité de notre embarcation, l’incertitude de notre traversée.
Entre ce qui n’est plus et ce qui n’est pas encore, la seule réalité est l’Esprit. Il est cet au-delà du temps, cette crête, qui nous laisse voir à la fois les houles parcourues et les houles pressenties. Toute existence est vagabondage ou pérégrination. Et toute pérégrination est déchiffrement. Dans l’histoire de la philosophie occidentale, l’herméneutique homérique, qui nous entraîne aux métaphores maritimes, précède l’herméneutique biblique. Presque entièrement détruite dans l’incendie de la bibliothèque d’Alexandrie, il ne nous reste de l’herméneutique homérique, que des titres et des fragments (tel cet Antre des Nymphes de Porphyre qui suggère une lecture de l’Odyssée comme traversée du mundus imaginalis) et nous portons encore le deuil de cette destruction. Ce qui subsiste, toutefois, nous laisse entrevoir, sinon comprendre, que le périple d’Ulysse, ce voyage dont l’horizon est le Retour, se laisse lire comme une métaphore de l’art herméneutique. Déchiffrer un texte, c’est-à-dire consentir à la transparence de son chiffre, de son secret, ce n’est point lui ajouter mais révéler sa jeunesse éclatante, venir à lui, dans un commentaire qui s’efface, semblable, pour reprendre le mot de Maurice Blanchot, à « de la neige tombant sur la neige » et se confondant avec elle, ou encore au scintillement de l’écume retombant dans le bleu profond de la mer dont elle provient. « Le sens de cette rejuvénation, écrit Henry Corbin est non pas de tourner le dos à l’origine mais de nous ramener à l’origine, à l’apokatastasis, à la réinstauration de toute chose en leur fraîcheur, en leur beauté originelle. »
La lettre, le phénomène, sont ainsi « sauvés » de l’insignifiance par l’interprétation qui est tout autre chose qu’une explication. Notre cheminement à partir des textes sacrés (et les œuvres des poètes en font partie) ne nous éloigne de la lettre que pour la garder, pour veiller sur elle, pour en rétablir le rayonnement et la souveraineté. L’opposition entre le « littéralisme » et l’herméneutique ne serait ainsi qu’une illusion. Loin de trahir la lettre, l’herméneutique la rétablit dans sa légitimité : littéralement, elle la sauve de la futilité d’une explication figée ou réductrice, telle que la défendent, de façon souvent vindicative, les fondamentalistes.
Les herméneutes qui, tel Ulysse, s’éloignent pour revenir, les « déchiffreurs » pour qui l’Origine est le Retour, seraient ainsi les véritables fidèles de la lettre, mais d’une lettre non plus administrée ou instrumentalisée à des fins trop humaines mais d’une lettre restituée à l’Esprit, d’une lettre véritablement sacrée, non-humaine, et, par cela même, fondatrice de l’humanitas ; d’une lettre délivrée, dénouée, éclose et légère, d’une lettre qui serait une « invitation au voyage », sauvée de la morale subalterne et des illusions de l’identité et rendue, saine et sauve, à l’Autorité qui lui revient et qui est inconnaissable. « Plus nous progressons, écrit Henry Corbin, plus nous nous rapprochons de ce dont nous étions partis. Je crois que la meilleure comparaison que nous puissions proposer c’est ce qu’en musique on a appelé le miracle de l’octave. A partir du sens fondamental, quel que soit le sens dans lequel nous progressions, c’est toujours vers ce même son fondamental, à l’octave, que nous progressons. »
Le voyage herméneutique nous conduit, par étapes successives mais sur une même octave, de l’apparence à l’apparaître, de l’illusion des ombres mouvantes sur les murs de la caverne à la lumière et à la présence réelle. Les étapes sont autant d’épreuves ou d’énigmes dont il importe de déchiffrer le sens, autrement dit l’orientation. Entre l’infini du ciel et celui de la mer, la couleur de la mer se livre à l’herméneutique de la couleur du ciel, la réfléchissant mais en accentuant ses nuances et sa profondeur : le gris léger du ciel, le gris de cendre, par exemple, se fait gris de plomb à la surface des eaux, de même que la mer violette, « lie de vin », annonce l’orage avant qu’il n’apparaisse dans le ciel.
Cette vertu anticipatrice, sinon prophétique, de l’herméneutique, certes, ne révèle que ce qui existe déjà, mais dans l’indiscernable. L’herméneutique serait ainsi ce qu’est la splendeur à la lumière luminante ; mais la surface réfléchie est elle-même profonde, d’où les dangers du voyage, d’où l’importance de l’orientation. De même que le sens d’un mot tient à la fois de la lumière immédiate de l’intelligence qui le frappe et de sa profondeur étymologique, de son palimpseste généalogique, de même l’herméneute qui s’aventure de mots en mots doit se tenir entre l’archéon et l’eschaton, entre le créé et l’incréé, comme le navigateur crucifié entre le ciel et la terre, entre ce côté-ci de l’horizon, et cet autre, qui toujours s’éloigne et le requiert.
Toute traversée comme le suggère Virginia Wolf est « traversée des apparences » » : l’apparaître sans cesse traverse l’apparu, qui est une nouvelle énigme. Que la traversée soit périlleuse, nul n’en doute, mais elle est aussi mystérieusement protégée. Il n’est rien de moins naturel à l’être humain en tant qu’animal social (cellule du « gros animal » dont parlent Platon et Simone Weil) que de s’arracher à la « pensée calculante », qui n’est autre que la transposition rationnelle de l’instinct, pour oser l’aventure de la « pensée méditante ». Le « gros animal » veille à ce que l’humanitas ne soit pas tentée par son propre dépassement. L’individualisme de masse, ce grégarisme des sociétés modernes, définit notre destinée comme exclusivement soumises à une collectivité, quand bien même celle-ci ne serait constituée que d’égoïsmes interchangeables. La solitude est crainte. Qu’il navigue, ou médite, voyageur de l’extériorité ou de l’intériorité, aventurier ou stylite, ou encore adepte face à l’athanor dont les couleurs, en octave, s’ordonnent à ses propres paysages intérieurs, le voyageur est seul, mais d’une solitude nomade immensément peuplée de toutes les rencontres possibles.
De même que l’herméneute quitte le sens littéral pour retrouver l’orient de la lettre, le voyageur quitte l’esseulement grégaire pour s’offrir à la solitude hospitalière ; son adieu contient, en son orient, en son « sens secret », un signe de bienvenue. Le voyage intérieur est si peu dissociable du voyage extérieur qu’il se trouve bien rare que l’un ne fût pas la condition de l’autre. La chevalerie soufie, andalouse ou persane, celle des Fidèles d’Amour, occitanienne ou provençale, les Romantiques allemands, puis Gérard de Nerval, se laissent définir par un ethos voyageur que révèle, chez eux, la précellence de l’orientation intérieure sur les contextes religieux, historiques ou culturels dont il importe de ne pas méconnaître l’importance mais qui ne sont que des écrins. Qu’ils fussent Juifs, Chrétiens ou Musulmans, d’Orient ou d’Occident, fidèles aux dieux antérieurs, zoroastriens ou soucieux, comme les ismaéliens duodécimains et septimaniens, d’une recouvrance, d’une « rejuvénation » du monde par « l’étincelle d’or de la lumière nature », les Nobles voyageurs trouvent sur leur chemin des intersignes et des Symboles qui ne doivent plus rien au déterminisme historique ni au jeu des influences.
La parenté des récits visionnaires de Nerval avec ceux de Rûzbehân de Shîraz témoigne de l’existence entre le sensible et l’intelligible, du « supra-sensible concret » que l’on ne saurait confondre avec la subjectivité ou une quelconque fantaisie individuelle ou collective. Les paysages du monde imaginal, les événements qui y surviennent, les rencontres qui s’y opèrent n’appartiennent pas davantage que la mer et le ciel, à un monde « culturel » dont on pourrait définir les aires d’influence ou expliquer les figures en tant qu’épiphénomènes d’une psychologie individuelle ou collective. L’Archange empourpré dont une aile est blanche et l’autre noire, - cette « intelligence rougeoyante » que Sohravardî voit surgir à l’aube ou au crépuscule, qui allège soudain le monde par l’étendue de ses ailes au moment ou la nuit et le jour, le crée et l’incréé, se livrent à leur joute nuptiale, - cet Ange n’est pas davantage une « invention » de l’esprit qu’une allégorie : il est exactement un Symbole, c’est-à-dire une double réalité, visible-invisible, sur laquelle se fonde la possibilité même de déchiffrer et de comprendre. « Il m’arriva, écrit Rûzbehân de Shîraz, quelque chose de semblable aux lueurs du ressouvenir et aux brusques aperçus qui s’ouvrent à la méditation. ».
Le monde imaginal, échappe aux catégories de l’objectivité, en tant que représentation comme à celle de la subjectivité en tant que « projection ». Le ressouvenir et les « brusques aperçus » donnent sur le même monde qui récuse les frontières de l’intérieur et de l’extérieur, du littéral et de l’ésotérique. Ce monde offert à l’expérience visionnaire non moins qu’à la spéculation n’est autre que le monde vrai, le monde dévoilé par les affinités de l’aléthéia et de l’anamnésis. Victor Hugo eut l’intuition de cette imagination créatrice : « L’inspiration sait son métier (…). Tel esprit visionnaire est en même temps précis, comme Dante qui écrit une grammaire et une rhétorique. Tel esprit exact est en même temps visionnaire, comme Newton qui commente l’Apocalypse. » Tout se joue sur le clavier des correspondances. A cet égard, le voyage intérieur n’est pas déplacement mais transmutation. « Le voyage intérieur, écrit Rûmî, n’est pas l’ascension de l’homme jusqu’à la lune, mais l’ascension de la canne à sucre jusqu’au sucre ».
Si le monde est bien créé par le Verbe, si la « sapience » est bien cet Ange qui s’éploie entre la lumière et les ténèbres, l’Appel et la mise en demeure sont adressés non à n’importe qui mais à chacun. La témérité sohravardienne, qui annonce la témérité rimbaldienne, le conduisit précisément à proclamer qu’en la permanence du créé et de l’incréé, dans le flamboiement de la sainteté reconquise de l’Esprit, la prophétie législatrice n’était point close, ni scellée, que d’autres prophètes pouvaient advenir. « Tout se passe alors, écrit Henry Corbin, comme si une voix se faisait entendre à la façon dont se ferait entendre au grand orgue le thème d’une fugue, et qu’une autre voix lui donnât la réponse par inversion du thème. A celui qui peut percevoir les résonances, la première voix fera entendre un contrepoint qu’appelle la seconde et d’épisode en épisode, l’exposé de la fugue sera complet. Mais cet achèvement, c’est précisément cela le mystère de la Pentecôte, et seul le Paraclet a mission de le dévoiler ». Le but du voyage est le voyageur, mais non pas le voyageur tel qu’il fut et chercha à se fuir mais le voyageur dévoué, selon la formule de Plotin « à ce qui est en lui plus que lui-même ». Le voyage répond à ces questions plotiniennes : « Qui étions-nous ? Que sommes-nous devenus ? Où étions-nous ? Où avons-nous été jetés ? Où allons-nous ? D’où nous vient la libération ? » Pour Plotin, ainsi que l’écrit Jean-Pierre Hadot, « l’âme est d’origine céleste et elle est descendue ici-bas pour un voyage stellaire au cours duquel elle a revêtu des enveloppes de plus en plus grossières, dont la dernière est le corps terrestre », si bien que dans notre voyage la fin devient le commencement et le retour est l’origine même.
Entre le ciel et la mer, entre le sensible et l’intelligible, entre le créé et l’incréé, entre l’intérieur et l’extérieur, entre ce qui fut et ce qui doit être, ce ne sont plus des discords, des « problématiques » qui surgissent mais de beaux mystères qui se déploient, se hiérarchisent et se nuancent. Nous devons à Gabriel Marcel cette parfaite distinction du mystérieux et du problématique : « Le problème est quelque chose que l’on rencontre, qui barre la route. Il est tout entier devant moi. Au contraire, le mystère est quelque chose où je me trouve engagé, dont l’essence est, par conséquent, de n’être pas tout entier devant moi. C’est comme si dans ce registre, la distinction de l’en-moi et du devant moi perdait sa signification ».
De la nécessité du dépassement du problème par le mystère et du mode opératoire de ce dépassement, nul sans doute ne fut mieux informé que Novalis : « Si vous pouvez faire d’une idée une âme qui se suffise à elle-même, se sépare de vous, et vous soit maintenant étrangère, c’est-à-dire se présente extérieurement, faites l’opération inverse avec les choses extérieures et transformez les en idées. » Si le problème, n’est jamais, selon la formule de Gustav Thibon qu’un mystère « dégradé », le passage de la sédentarité profane au nomadisme sacré nous ouvre à la vérité du « Logos intérieur » qui nous traverse et nous invite aux traversées. Ce passage toutefois peut-être aussi discret qu’éclatant. « Ce sont, écrit Jünger, les grandes transitions que l’on remarque le moins. ».
Le passage de la chevalerie héroïque, inscrite dans l’Histoire, à la chevalerie spirituelle qui ne connaît plus que des événements sacrés, des événements de l’âme, ce passage de la prophétie législatrice à l’amitié divine, peut aussi bien s’opérer comme une rupture radicale, ainsi que ce fut le cas dans la « Grande Résurrection d’Alamût » des Ismaéliens qui proclamèrent l’abolition de la Loi exotérique, que par des transitions presque imperceptibles. Si Ibn’Arabî, au contraire de Sohravardî, considère la prophétie législatrice comme scellée, et qu’il veut demeurer, au contraire des Ismaéliens, fidèle à la lettre de la Loi, il n’en annonce pas moins par son attente ardente, par son oraison devant le buisson ardent du sens, par son herméneutique amoureuse, une nouvelle manifestation de l’Esprit et l’advenue d’une clarté paraclétique.
Pour le voyageur « orienté », pour l’herméneute du Livre et du monde, quand bien même la totalité du sens est donnée dans l’ultime prophétie, récapitulatrice de toutes les autres, ce sens demeure encore caché et exige de nous que nous le délivrions de ses écorces mortes, que nous en accomplissions la gloire, par notre audace, notre attention et notre ferveur. « Le salut par la contemplation, écrit Christian Jambet, est un salut opéré par Dieu dans l’intelligence du contemplatif ». Toute la tradition soufie, héritière de l’herméneutique du chi’isme duodécimain et septimanien s’accorde sur cette annonce, cette attente : à la prophétie législatrice doit succéder le Paraclet, le décèlement du sens secret, la transparition dans la conscience humain ordinaire d’une conscience subtile, d’une « ascension nocturne » vers la lumière à travers les états multiples de la conscience qui sont autant de signes, à déchiffrer, de la multiplicité des états de l’être. Qu’il soit à l’origine d’une rupture, d’une « témérité spirituelle » ou de ces imperceptibles transitions chromatiques ou musicales que favorise la contemplation, le voyage suppose que nous quittions ce monde où nous n’étions que la représentation du jugement d’autrui. Ainsi que l’écrit Mollâ Sadrâ : « Je me libérai de leurs contestations autant que de leur assentiment, tenant pour équivalentes leur estime ou leurs injures et je tournais ma face vers le Causateur des Causes, je me fis humble, implorant celui qui rend aisée les choses difficiles. Comme je demeurais en cet état de retraite, d’incognito et de solitude, pendant un bien long temps, mon âme s’enflamma grâce à mes combats intérieurs prolongés, d’une flamme lumineuse, et mon cœur s’embrasa par la vertu des multiples exercices spirituels, d’un feu vif, et les lumières du Malakût effusèrent sur lui. Mon cœur reçut les secrets du Jabarût. » Ainsi, au voyage horizontal, qui va d’un horizon à l’autre horizon au voyage extérieur, qui nous éloigne du jugement d’autrui, doit succéder le voyage vertical, intérieur, qui nous donnera la clef véritable de l’extériorité, ou, plus exactement qui abolira toute distinction entre l’intérieur et l’extérieur et nous donnera accès au monde imaginal, au Jabarût.
Cette quête est si peu marginale que l’on serait presque tenté d’y voir l’un des enjeux majeurs de l’histoire humaine. Est-il ou non un voyage possible ? Quelle immobilité voyageuse pouvons-nous opposer à la sédentarité des représentations ? Quelle pérégrination peut surseoir à ce vagabondage ou pire encore, à ce tourisme qui transforme la chatoyante diversité du monde en un seul village médisant ? Au « tout est dit » s’oppose alors le pressentiment que tout reste à dire précisément parce que tout est dit, et que le Dire est voyage entre le créé et l’incréé.
Toute méditation sur l’origine suppose, lorsqu’elle ne se réduit pas une banale archéolâtrie, une eschatologie ; tout ressouvenir vole au vent du pressentiment. Croire que le Dire doit demeurer enclos dans l’administration vétilleuse de sa représentation, c’est idolâtrer l’archéon, vice au demeurant typiquement moderne, et nier l’eschaton qui est le véritable archéon de la métaphysique, de même que l’herméneutique est la véritable glorification et « salvation » de la lettre. Ne pas discerner l’orient de l’eschaton dans l’archéon lui-même, c’est refuser l’un et l’autre et finalement se soumettre à la doxa moderne, autrement dit à cette terrible idéologie du Progrès, qui, ainsi que le soulignait Péguy, révèle sa véritable nature fanatique, ou plus exactement fondamentaliste, en proclamant que « l’avenir reconnaîtra les siens ». L’anti-platonisme rejoint ainsi le fondamentalisme moderne, l’un et l’autre également acharnés à tuer, en même temps, la lettre et l’Esprit et à rendre impossible le langage, le tradere, qui conduit de l’une à l’autre .Ce qui s’oppose alors au fondamentalisme, ce n’est pas la modernité, qui est un autre fondamentalisme, mais bien la Tradition, ce voyage intérieur du tradere qui conduit le sens à travers la lettre et la lettre à travers le sens.
Refuser de traduire, refuser l’interprétation du sens qui est la condition de toute traduction, c’est refuser de transmettre. Etre fidèle à la Tradition, œuvrer la recouvrance de la lettre, c’est voyager, et même s’aventurer, non sans risques et périls, dans l’entrelacs du Logos. La signification schématique, la signification que l’on utilise, à des fins politiques ou instinctives, dans l’égoïsme individuel ou collectif, dans le culte du Moi ou du Nous, est pure idolâtrie. Au contraire, croire en la possibilité du tradere, c’est affirmer la réalité métaphysique et universelle du sens, qui n’est pas un problème mais un mystère. La seule possibilité de la traduction prouve la réalité du sens, de l’orientation de la pensée, de ce voyage vers les « lumière orientales ». Là où le jour se lève, dans le pressentiment d’une gnose aurorale, dans l’irisation de l’être à sa naissance, est cette fin du voyage où tout recommence. Qu’il soit subjugué par l’exotérisme dominateur, nié dans sa réalité, le sens qui oriente, le sens qui est invitation au voyage, exige bien de ceux qui lui veulent demeurer fidèles, un acte de rébellion.
Le rebelle est étymologiquement, celui qui retourne à la guerre, mais non pas, en l’occurrence, à une guerre à l’intérieur de l’Histoire, mais hors d’elle, non plus à une guerre qui est vacarme et destruction mais à une guerre silencieuse et germinative qui est celle de cette chevalerie spirituelle qui, dans un pressentiment paraclétique, doit succéder à la chevalerie héroïque. La grande guerre sainte de l’herméneutique reconduit à une solitude orphique, et ne dispose d’autres armes que son silence et son chant. Elle s’achemine vers le dénouement du sens, vers le pur secret du Logos. Le rebelle, dont Jünger sut admirablement définir l’éthique, n’est pas cet agité du bocal, ce publiciste hargneux et pathétique dont la modernité nous offre tant d’exemples, mais cet homme du retrait qui ose le pas en arrière au moment des marches forcées de l’Histoire, qui s’ingénie, envers et contre tous, à reprendre le fil de sa pensée lorsque tout conjure à la « distraction », au sens pascalien. Dans son retrait, le rebelle retrace le chemin parcouru et précise son orientation, tout comme le marin consulte le sextant, observe les signes du ciel et participe, dans l’intelligence sensible, du gonflement ou du claquement des voiles.
Les voyages dans le monde extérieur que décrit Hermann Melville sont ainsi l’exact équivalent des voyages dans le monde intérieur que décrivent Rûzbehân de Shîraz ou Farridodîn ‘Attar: « Nous servons de fourreau à nos âmes, écrit Hermann Melville. Quand un homme de génie tire du fourreau son âme, elle est plus resplendissante que le cimeterre d’Aladin. Hélas, combien laissent dormir l’acier jusqu’à ce qu’il ait rongé le fourreau lui-même et que l’un et l’autre tombent en poussière de rouille ! Avez-vous jamais vu les morceaux des vieilles ancres espagnoles, les ancres des antiques galions au fond de la baie de Callao ? Le monde est plein d’un bric-à-brac guerrier, d’arsenaux vénitiens en ruine et de vieilles rapières rouillées. Mais le véritable guerrier polit sa bonne lame aux brillants rayons du matin, en ceint ses reins intrépides et guette les tâches de rouille comme des ennemies ; par maints coups de taille et d’estoc il en maintient l’acier coupant et clair comme les lances de l’aurore boréale à l’assaut du Groenland. » Quitter les gras pâturages, la domestication de la nature pour s’aventurer sur la paradoxale aridité des mers, sous l’implacable souveraineté du ciel, n’est-ce point exactement la même chose que de quitter, dans la méditation d’un texte sacré, le sens acquis, subalterne, domestique, pour entrer dans une voie d’intersignes, de correspondances et d’analogies qui nous conduira vers « l’Ile Verte sur la mer blanche », dont parlent les mystiques persans, vers ce Groenland métaphysique où tout recommence ?
Les adversaires de l’herméneutique, qu’ils nomment du terme imprécis d’ésotérisme, ont beau jeu de faire valoir la folie ou le délire auxquels nous expose l’aventure, mais leurs arguties ne valent pas davantage que le « bon sens » des bourgeois qui eussent voulu dissuader Melville, Conrad ou Jack London de leurs voyages sous prétexte de « sécurité ». Au demeurant, ce que dénotent les « dangers » et la « folie » est moins l’éloignement de la mesure et de la vérité que leur extrême proximité. Le paradoxe du voyage et le paradoxe de l’herméneutique sont un seul et même paradoxe : une gnosis, selon la distinction platonicienne bien connue, au-delà ou en marge de la doxa, de la croyance commune. L’herméneutique, ainsi que l’écrit Heidegger « marque le pas sur le même » ; il en est de même du voyage qui débute à chaque instant. A chaque instant, le voyageur est présent à lui-même et au monde pour mieux aller vers la présence des êtres et des choses. Un voyage, c’est une immobilité qui se quitte et se retrouve à chaque instant.
Alors que dans la sédentarité profane nous sommes requis et liés par des significations extérieures, que ce que nous sommes à nous-mêmes est conditionné par les représentations que les autres se font de nous, représentations au demeurant fallacieuses auxquelles nous peinons à correspondre autant qu’à nous arracher, le voyage nous restitue à cette immobilité du Soi qui subsiste, glorieuse, lorsque se détachent de nous les écorces mortes du « moi ». Semblablement, l’herméneutique quitte la doxa, où les Symboles subordonnées à des représentations ne sont plus que des objets narcissiques, des figures de propagande et d’autocongratulation religieuse, pour s’acheminer vers la gnosis qui est elle-même pur cheminement, interprétation infinie. L’herméneutique et le voyage sont une préférence pour ce qui est, autrement dit pour ce qui vogue à travers le temps. Le texte, pour l’herméneute, le monde, pour le voyageur, sont préférés au mutisme et au néant. Dignes d’attention, leurs entrelacs sont un principe de connaissance et de ferveur. La louange et la science s’accordent dans le déplacement, cette rupture qui est retrouvailles. De même que la gnosis rompt avec le sens commun, le voyageur quitte son paysage familier. Entre le texte poétique ou sacré (tout texte sacré est, dans son archéon, un texte poétique) et le monde dans sa diversité et sa splendeur, l’analogie est loin d’être purement formelle. Si le monde procède de l’entrelacs essentiel du Logos ou du Verbe, parcourir le monde, c’est le lire et tel semble bien être le dessein, et même l’obligation, de tout voyageur qui n’est pas seulement un touriste.
Toute herméneutique, celle des pas perdus comme celle des étymologies héraldiques, a pour horizon une herméneutique générale du monde où le Logos et le réel se révèlent obéir aux même lois, ou, plus exactement, à la même musique. Le voyageur joue des apparences qu’il traverse, des rencontres qu’il fait, comme l’interprète de sa partition ; et ses clefs de sol ou de fa indiquent la gradation entre le ciel et la terre. Le Logos incréé et le monde créé sont de même nature. Notre langage et le langage du monde loin d’être disparates s’accordent en une même écriture musicale infiniment graduée.
Le discord entre le langage du monde et le langage humain nous précipite dans l’insolite et le désenchantement, dans l’établissement conjoint des normes profanes et du relativisme (ou, plus exactement d’un dogme relativiste), dans la désespérance de l’intraduisible non moins que dans l’affirmation péremptoire de l’opinion. Ce discord est cette ultime défaite de la pensée qui nous prédispose au nihilisme car, séparant le créé de l’incréé, il creuse la béance du néant, mais sans même en faire l’expérience : tel est le nihilisme qui adore un néant qu’il n’éprouve point mais dont il fait une sorte de règle méthodologique aboutissant à un « ni Dieu, ni Maître » qui n’est plus libertaire mais « bourgeois » au sens flaubertien, Monsieur Homais se substituant à Proudhon ou à Stirner. Or préférer ce qui est à ce qui n’est pas, ce qui est dans l’unité des règnes à ce qui se divise, se désagrège et se disloque ; préférer ce qui est, dans son unité ontologique parménidienne (prouvée par le paradoxe de Zénon) ou dans son unité métaphysique telle que surent la dire et la célébrer les ismaéliens, c’est non seulement comprendre, mais œuvrer à l’unité du créé et de l’incréé. Si le monde est l’herméneutique de l’Un selon la théologie du Verbe, si l’unité est le caractère de ce qui est, selon Parménide, ce à quoi nous oeuvrons, dans l’interprétation des textes et du monde, œuvre à travers nous.
Pas davantage que le monde n’est un spectacle le texte n’est, à proprement parler, un objet d’étude. L’implication qui doit être incluse comme un épicentre, dans toute explication est une implication créatrice, une « participation » platonicienne. Nous créons le monde que nous nommons et qui se nomme à travers nous. Toute herméneutique est créatrice, oeuvrante, située sur la lisière du créé et de l’incréé. Ce monde que nous traversons, nous le créons, mais à l’intérieur d’une plus vaste création. Le discord entre notre langage et le langage du monde, cette disjonction ou cette déchirure du Logos dont toute pensée occidentale porte la trace depuis la fin de la « Renaissance » (et par cette suite de réactions en chaîne que furent la Réforme, la Contre-réforme, la Révolution et la Contre-révolution) demeure remédiable par la compréhension de la louange, par l’herméneutique du chant.
Le poème de Shelley, Epispsychidion qui célèbre « l’âme de l’âme », l’élévation de l’âme à une toujours plus haute, plus intense, plus ardente subtilité, exigera, par exemple, pour que la puissions saisir dans son « intention », une nouvelle phénoménologie. Les œuvres des poètes se sont éloignées mais ainsi que l’écrit Heidegger à propos d’Hölderlin, elles demeurent « en réserve ». Cette procession ascendante de l’âme, nous pouvons, en certaines circonstances heureuses, l’éprouver, mais nous devons aussi la comprendre, si tant est que nos modi essendi, nos façons d’être, qui nous accordent ou nous heurtent au monde créé, ne se laissent point séparer, sans désastres, des modi intellegendi, des modalités de notre intelligence, - cette intelligence que nous voudrions tournée vers scintillement matutinal de l’incréé, semblable à l’alouette chantée par Shelley :
Je te salue, esprit allègre !
- Oiseau tu n’as jamais été -
Qui du ciel, ou d’auprès de lui,
Verse le trop plein de ton cœur
En accent jaillissants d’un art improvisé.
Plus haut encore, toujours plus haut,
De notre terre tu t’élances
Comme une vapeur enflammée ;
Ton aile bat l’abîme bleu
16:30 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
07/09/2024
Luc-Olivier d'Algange, De l'Ame:

Luc-Olivier d'Algange
De l’Ame
Il n'est rien de moins abstrait que l'âme. Lorsque presque tout en ce monde, selon le mot de Guy Debord, tend à « s'éloigner dans une représentation », à s'abstraire de sa propre immédiateté; lorsque notre entendement, dans son usage commun, se borne à n'être qu'une machine à abstraire (ce qu'il est peut-être par nature, sauf à se subvertir lui-même dans une conversion gnostique); lorsque notre corps, tel que nous nous le représentons dans le regard d'autrui est tout autant abstrait de lui-même, - l'âme seule, qui est intérieure à toutes les choses, s'y déploie, pour qu'elles soient là, qu'elle existent, et dans leur mouvement même. Qu'importe de savoir si nous croyons ou non en l'existence de l'âme, comme en une chose ou une notion, puisque ce qui existe, en s'éprouvant, est le mouvement de l'âme elle-même.
Pas davantage qu'une abstraction, l'âme n'est une « subjectivité »; elle n'est point la somme ou la synthèse de nos représentations et il serait presque trop de dire qu'elle est en nous, - cet « en nous » invitant à l'erreur de croire que notre âme serait emprisonnée dans notre corps, comme un moteur l'est dans une machine. Or la nature de l'âme est d'être impondérable et de franchir, légère, les limites et les frontières. Elle n'est pas seulement un bien intériorisé mais la circulation entre l'intérieur et l'extérieur, la fluidité même.
Notre peau n'est pas notre limite, ainsi que l’écrivais René Daumal, mais l'un des plus subtils organes de perception. Ce qui perçoit avant nous en fissions une représentation, c'est l'âme. « Peau d'âme » disait Catherine Pozzi. La formule est admirable de justesse. L'âme ne s'oppose pas au sensible comme le voudraient les morales puritaines; elle est ce qui le rend possible. Là où l'âme agit, le monde intérieur et le monde extérieur échangent leurs puissances et s'entrepénètrent amoureusement.
Que serait un monde sans âme ? Celui où nous avons la disgrâce ou la chance terrible de vivre. La disgrâce; parce que le monde moderne, le monde des hommes uniformisés et des objets de série, est cette machine à fabriquer de l'interchangeable et que la Grâce, comme le savait Al-Hallaj, ne vient qu'aux uniques. Mais chance terrible aussi, car la mise-en-péril de l'essentiel en révèle la splendeur cachée, l'inaltérable beauté sise au cœur des êtres et des choses.
L'âme humaine et l'Ame du monde sont une seule âme. L'âme des paysages est âme car elle est notre âme. Celui qui perçoit l'âme d'un paysage a la sensation de s'y perdre, à cet instant où, l'air, le ciel, les arbres et le vent affluant en lui, il vacille au bord de l'extase. Il fait plus, et mieux, que le voir. Ce qu'il voit n'est que le signe de l'âme qui regarde en lui.
Telle prairie dans son apothéose fleurie éveille en nous le printemps de l'âme. Tel océan nous rappelle à l'exigence de nos abîmes. Tel vol d'hirondelles est notre pensée même et ne se distingue en rien de ce qui la perçoit en nous. L'âme est la vive, l'avivante intersection entre ce qui perçoit et ce qui est perçu. Le sentiment qui en surgit est celui du Pays perdu, la sehnsucht des Romantiques Allemands, - l'orée tremblante de l'âme.
A certaines heures, particulièrement à l'aube et au crépuscule, le visible semble s'éloigner en lui-même, dans la profondeur du regard, jusqu'à l'orée d'où reviennent, en ressacs, les ressouvenirs du Pays perdu. Ce pays n'est perdu, en vérité, que parce qu'il est trouvé. Son absence est l'espace de son advenue.
Quiconque oublie le sens de l'exil vit dans l'exil de l'exil, - dans cette absence carcérale qu'est la représentation. La présence réelle, au contraire, est l'hôte de l'absence, son invitation, et selon la formule fameuse de Dante, sa « salutation angélique ». A l'orée du visible, l'absence du visible, l'invisible nous fait signe afin que nous cheminions vers lui. Toute vie qui n'est pas une quête du Graal est un avilissement sans fin.
Dans le fondamentalisme, tout se réduit à l'idolâtrie du signe extérieur, d'une apparence qui ne laisse rien apparaître. Apparence sans apparition, mur aveugle, sur lequel, tout au plus, on peut apposer des affiches de propagande haineuse. Le fondamentaliste veut bannir le doute, mais bannissant le doute, il détruit la Foi. A sa façon, c'est un « réaliste », il veut « du concret », c'est-à-dire de la servitude et de la mort concrètement réalisés. Il est aux antipodes, non du matérialiste ou du « mécréant », comme il se plait à le dire, et peut-être à le croire, mais du mystique et de l'herméneute, et de tout homme en qui s'élève un chant de louange en l'honneur de la Création.
Vindicatif, mesquin, obtus, il vient comme une menace, mais dans un monde qui lui ressemble. On le dit « archaïque » ou « barbare » mais il n'est ni l'un ni l'autre, - plutôt idéologue et publiciste, inscrit, et parmi les premiers rôles, au cœur de la société du spectacle. Il n'est pas ce qui s'oppose au monde moderne mais sa vérité de moins en moins dissimulée. Comment lui opposerait-on la société dite moderne dominée par la finance et la technique alors que ce sont les moteurs de sa guerre, que bien abusivement, il qualifie de « sainte » ?
La guerre de ces deux forces, antagonistes seulement par les apparences, car elles sont l'une et l'autre idolâtres des apparences, ne contient aucun espoir. Elle est la force même du péché contre l'espérance. Ce qu'il y eut de beau, de noble et libre dans la culture européenne est pris en tenaille entre ces frères ennemis qui obéissent au même Maître, - celui de la restriction de l'expérience sensible et spirituelle, celui du contrôle total.
En ces circonstances où le monde s'uniformise et s'attriste, l'âme est atteinte, blessée. Les poètes en seront les guérisseurs, au sens chamanique, et les héros, au sens d'une sauvegarde de certaines possibilités d'être. La question est cruciale et vitale car enfin, sans âme, tout simplement, on ne vit point, ou bien seulement d'une vie réduite à un processus biologique, - auquel s'intéresse précisément le « trans-humanisme », qui est sans doute la phase ultime de cet « interventionnisme » moderne qui veut ôter aux hommes la joie et le tragique, et la beauté même de l'instant éternel, pour en faire des mécaniques perpétuelles.
Le Moderne hait le donné. Rien n'est assez bon pour lui; et c'est ainsi qu'il détruit le monde et s'appareille. Les causes et les conséquences de ce processus, qui est avant tout une vengeance contre tout ce que l'on ne sait pas aimer, ont, au demeurant, été admirablement analysés par Heidegger et René Guénon. Le Moderne est un homme mécontent du monde et de lui-même et ce mécontentement, au contraire de l'inquiétude spirituelle, n'est pas une invitation au voyage, un consentement à l'impondérable, mais un grief qui se traduit par un activisme planificateur. Tout est bétonné, aseptisé, stérilisé, climatisé, - et finalement empoisonné. Plus rien n'est laissé au temps pour y éclore. Les incessantes exactions commises contre la nature, les paysages donnés par la création ou par le labeur intelligent de nos ancêtres, ne sont que la conséquence des atteintes continûment portées à l'âme des individus et des peuples qui pouvaient encore les comprendre, les honorer et les aimer.
L'âme est ce qui relie. Toute atteinte à l'âme nous sépare du monde, de nos semblables et de nos dissemblables, pour nous jeter dans l'abstraction, dans cette subjectivité morbide qui s'exacerbe devant les écrans. Les écrans, par définition font écran; ils sont des instances séparatrices et l'on reste, pour le moins, dubitatif devant ces injonctions gouvernementales qui prescrivent de les imposer dans tous les collèges et toutes les écoles, pour le plus grand bénéfice de ceux qui en font l'industrie.
L'homme irrelié, séparé des influx de toutes les forces sensibles et intelligibles, est le parfait esclave-consommateur. Irrelié, il ne peut plus recevoir, ni donner, - et symétriquement, une étrange outrecuidance s'accroît en lui, et il croit d'un clic pouvoir dominer le monde entier en le faisant apparaître et disparaître. Ses sens et la présence de l'Esprit s'altèrent en lui par cet usage. Vide d'Esprit, son cerveau s'encombre de fatras et de décombres, sa syntaxe et sa grammaire s'effondrent, ses affects s'hystérisent et sa peau devient imperméable à l'air et à la lumière, à ces forces immenses, sensibles et suprasensibles, qui embrassent, apaisent et sauvegardent.
Le propre de cette machine de guerre uniformisatrice est qu'elle s'exerce désormais non par une collectivité contre une autre, mais contre chacun, contre chaque âme éprise de l'Ame du monde. Dans ce combat, chacune de nos défaites a une conséquence immédiate pour chacun d'entre nous et par chacun d'entre nous.
A l'ensoleillement de l'âme qui naît dans la nuit dont elle révèle et fait resplendit le mystère, le Moderne a substitué l'éclairage scialytique, le néon commercial, la blafarde clarté de l'écran d'ordinateur. Il a remplacé la pensée méditante, qui délivre, par la pensée calculante qui emprisonne et infléchit les caractères vers la cupidité, l'envie et l'ennui. La fréquentation des humains en devient difficile. Les conversations, dans la plupart des cas, se ramènent à un « zapping » fastidieux; toute promenade devient une prédation touristique; toute relation humaine, une tractation pesante, voire menaçante.
Lorsque le monde disparaît, lorsque les femmes et les hommes n'ont plus conscience de faire partie de cette Quaternité, avec le ciel, la terre et les dieux, que Heidegger évoque en suivant Hölderlin, une affreuse incarcération commence, une peine illimitée dans ce « sous-sol » dont parle Dostoïevski, et d'où ne s'élèvent que des plaintes haineuses.
L'Enfer et le Paradis sont l'un et l'autre à notre portée ; cette belle énigme théologique, nommée le « libre-arbitre » trouve ici son mode d'application. Tel est l’alpha et l’oméga de la sapience : il est en nous, et donc ici-bas, un enfer et un paradis pris dans les rets du temps qui sont les reflets de l’Enfer et du Paradis éternel, et, non point en général, mais à chaque instant précis, il nous appartient de choisir l’un ou l’autre, de prendre le parti de l’un ou de l’autre. Même lorsque nous ne faisons rien en apparence, ou que nous ne faisons que songer et penser, il nous appartient que ces songes et ces pensées soient de la source vive ou de la citerne croupissante ; il nous appartient qu’elles chantent et se remémorent les heures heureuses, ou qu’elles s’aigrissent. Il nous appartient de boire à la source de Mnémosyne ou à celle du Léthé. Quiconque demeure encore quelque peu attaché à la spiritualité européenne peut se redire, dans le fond du cœur, en toute circonstance, ce qui est écrit sur la Feuille d’Or orphique trouvée à Pharsale :
« A l’entrée de la demeure des morts
Tu trouveras sur la droite une source.
Près d’elle se dresse un cyprès blanc
Cette source ne t’en approche pas.
Plus loin tu trouveras l’eau fraîche
Qui jaillit du lac de Mémoire, veillée par des gardiens.
Ils te demanderont pourquoi tu viens vers eux.
Dis-leur : je suis fils de la Terre et du Ciel étoilé.
Mon vrai nom est l’Astré. La soif me consume.
O laissez-moi boire à la source ».
Les Symboles ne sont pas seulement des allégories, des représentations, ils sont des actes d’être. Ce qu’ils donnent à voir est l’invisible dont ils sont l’empreinte visible. Le sensible et l’intelligible ne sont pas seulement des catégories de l’entendement, mais des pôles entre lesquels se déploie une gradation infinie, que nos sens et notre entendement seuls ne peuvent parcourir. Entre le corps et l’esprit, l’âme est cet instrument de perception du « monde imaginal » qu’on ne saurait réduire à la fantaisie ou à ce que l’on nomme ordinairement l’imaginaire, lequel appartient à la pure subjectivité. Les œuvres de Sohravardî, de Ruzbéhân de Shîraz, ou d’Ibn’Arabi, admirablement commentées par Henry Corbin, donnent à comprendre en quoi le mundus imaginalis est bien ce « suprasensible concret », cette Ile Verte ou ce Château Tournoyant qui s’offrent à tous les hommes, par l’expérience visionnaire, aussi objectivement qu’un paysage réel.
L’Archange Empourpré qu’évoque Sohravardî, qui apparaît au crépuscule, est le messager ce qui dans la pensée fut et n’est pas encore, l’aube en attente dont le crépuscule révèle la splendeur et le sens caché. Ainsi, oui, l’âme est l’Ange, elle est ce qui en dispose en nous la présence entre les mondes, le miroitement, l’orée, l’attente, l’attention.
Il y eut dans les grandes œuvres persanes du Moyen-Age une attention extrême et précise à ces gradations, à ces variations chromatiques de l’âme allant à la rencontre de son ange, à cette multiplicité des états d’être et de conscience, sans laquelle nous demeurons emprisonnés dans des représentations sommaires et réduits à un exercice de la vie purement utilitaire et avilissant, mais cette attention se retrouve tout aussi bien chez Hildegarde de Bingen ou Maître Eckhart, et plus en amont, dans les Ennéades de Plotin.
Une catena aurea néoplatonicienne, quelque peu secrète, traverse la culture européenne fort différente du « platonisme » selon sa commune définition scolaire de « séparation entre le monde sensible et le monde idéal ». L’Idée n’est pas séparée de la forme sensible, elle est la forme formatrice de cette forme. Le monde sensible n’est pas « séparé », et encore moins « opposé », au monde des Idées, mais empreinte héraldique des Idées. Ce n’est que dans l’oubli de l’âme que s’opposent le corps et l’esprit, qui deviennent ainsi l’un à l’autre leur propre enfer. Or voici Marsile Ficin, qui parle du « rire de la lumière », voici Shelley, qui nous invite au voyage de « l’âme de l’Ame », Epispsychidion, voici Saint-Pol-Roux et ses ensoleillements, « symboliste comme Dante », voici Oscar Wenceslas de Lubicz-Milosz, dont l’Ars Magna et les Arcanes décrivent le surgissement, par le Verbe, d’un « autre espace-temps » non point irréel mais à partir duquel toute réalité s’ordonne, s’éclaire ou s’obscurcît, selon l’attention déférente que nous savons, ou non, lui porter.
Tout ce qui importe se joue dans notre perception du temps. Est-il un autre temps que le temps de l’usure et de la destruction ? Sous quelles conditions s’offre-t-il à notre attention, dans quelles incandescences ? La plus haute intensité, celle qui délivre, ne vient pas dans la hâte, l’agitation et le tumulte, mais dans le calme et le silence : « regard de diamant » comme disent les taoïstes.
L’âme est ce qui éveille, derrière les yeux de chair, les « yeux de feu ». « C’est au yeux de feu seuls qu’apparaît ce qui unit Proclus à Botticelli et l’Empereur Julien à Franz Liszt » disait Jean-Louis Vieillard-Baron, dans l’une de ses belles conférences de l’Université Saint-Jean de Jérusalem. Par l’exercice herméneutique, un arrière-plan apparaît, une conscience dans la conscience, antérieure à toute analyse et à toute explication historique, qui, si elle ne peut se prouver, selon les lois de la science reproductive, s’éprouve et se dit. En amont, dans une immensité antérieure, dans un ressac de réminiscences se tient une Sapience, qui est le bonheur même, une région paradisiaque, cet « invincible été » que l’on porte en soi au cœur de l’hiver, comme disait Camus, une gnose soleilleuse, si merveilleusement figurée dans le fameux traité d’Alchimie, intitulé précisément Splendor Solis, et qui nous revient, non de façon planifiable mais à la venvole, et pour laquelle il convient donc de se tenir prêts à chaque instant.
Tel est exactement le sens de la chevalerie spirituelle, de ce cheminement vers le Graal ou la Jérusalem Céleste, entre la Mort et le Diable, comme sur la gravure de Dürer. Le combat pour l’Ame du monde oppose un sacrifice à un gâchis. Le moderne ne voulant rien sacrifier gâche tout. A tant vouloir opposer le corps et l’esprit, il perd le bon usage de l’un et de l’autre. Nous conquerrons, ou nous perdrons, en même temps et du même geste, la beauté de l’instant et la splendeur de l’éternité, le frémissement sensible et les lumières secrètes de l’Intellect, la présence immédiate, l’éclosion de l’acte d’être et la fidélité à la Tradition qui nous en donne les clefs. A la fine pointe de la seconde advenante, à l’aube de la fragile et fraîche éclosion, le beau récitatif nous vient en vagues depuis la nuit des temps par l’intercession d’Orphée et de Virgile.
Contre les armes dont le monde moderne use contre nous afin de nous épuiser et de nous distraire, reprenons sans ambages le Bouclier de Vulcain tel qu’il apparaît, en figuration de l’Ame du monde, dans l’Enéide : feu primordial et cœur du monde. « Par lui, écrit Yves Dauge, s’enracinent dans l’histoire les Idées pensées par Jupiter, formée par Apollon, transmise par Mercure et vivifiées par Vénus ». Telle est exactement l’âme avivée, l’âme sauvegardée : une voie vers la pensée intérieure des êtres et des choses, au point où elles se forment en se délivrant de l’informe, et voyagent vers nous par des ambassades ailées, celle des poètes et des herméneutes, pour finalement être touchées et vivifiées par l’amour.
Luc-Olivier d'Algange
Extrait de Propos réfractaires, éditions de L'Harmattan, 2023.
19:19 | Lien permanent | Commentaires (2) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
06/09/2024
Un cartulaire héraldique, notes sur l'oeuvres de Fernando Pessoa:
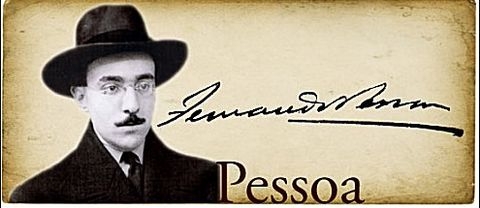
Luc-Olivier d’Algange
Un cartulaire héraldique, notes sur l'oeuvre de Fernando Pessoa
A André Coyné
L'idée d'Empire domine l'œuvre diverse de Fernando Pessoa. Le désir d'embrasser la multiplicité, de ressaisir les innombrables aspects de l'âme, d'être, enfin soi-même, le masque de toute vie et de toute chose, de s'en approprier l'essence par les communions et les ruses du personnage,- tout cela témoigne d'un dessein littéraire qui commence avant la page écrite et s'achève après elle, en des oeuvres vives, ardentes, que l'on peut dire philosophales. De l'Alchimie et, d'une manière plus générale, de la tradition hermétique et néoplatonicienne occultée par le triomphe des théories matérialistes, les poètes demeurent, en Europe, les ultimes ambassadeurs. L'œuvre de Pessoa ne fait pas exception à cette règle méconnue qui associe la grandeur poétique, l'audace visionnaire et la fidélité à la plus lointaine tradition.
Alors que la science profane travaille par déductions sur le mécanisme et les quantités du monde sensible, la science hermétique œuvre, par l'analogie, au sacrement des qualités et des essences. L'une s'interroge sur le comment, l'autre donne réponse au pourquoi. La différence est capitale, et ce n'est pas le hasard si tant de poètes modernes, enclins à la spéculation, retrouvèrent, dans la tradition hermétique, les grandes lignes de leur dessein poétique.
« Avec l'aide et l'assistance de Dieu, écrivit Pic de la Mirandole, l'Alchimie met en lumière toutes les énergies cachées de par le vaste monde. Comme le vigneron greffe le cep sur l'orme et sur l'espalier, le mage, l'Alchimiste sait unir et pour ainsi dire marier terre et ciel, énergies inférieures et énergies supérieures ». Cette coïncidence des contraires, qui dépasse également l'opposition philosophique du réalisme et du nominalisme, il est facile de comprendre en quoi elle séduisit Fernando Pessoa. La hiérogamie cosmique, le dépassement du dualisme en des noces miroitantes, impériales, apparente ici la nostalgie de la conquête et le pressentiment des retrouvailles, la poésie et l'Empire. Par le Grand-Oeuvre solaire, le regret de l'Age d'Or devient l'annonce du Retour, l'adepte se substituant au temps, et disposant du pouvoir de transfigurer la nature :« L'eau céleste et indestructible, écrit Bernard Gorceix, le feu intangible de l'empyrée, se trouvent finalement unis, par le ciel cristallin, par la sphère des astres, par la flore, la faune, par les pierres et les mines, à l'eau corporelle, lentement distillée et volatilisée, pour l'édification de ces cieux nouveaux et de cette terre nouvelle dont rêve l'Alchimiste. » Il ne s'agit donc pas seulement de repérer dans les poèmes de Pessoa des images alchimiques mais bien de montrer que le principe de l'œuvre, en ses ramifications hétéronymiques, s'identifie à la genèse et à l'accomplissement d'un secret d'or impérial, « identique à l'or de la nature, non seulement comme effet mais aussi comme cause ».
« De même, écrit Pessoa, que l'intelligence dialectique, que l'on nomme raison, régente et ordonne tous les éléments de la connaissance scientifique, de même, l'intelligence analogique, qui n'a aucun nom particulier, régente et ordonne tous les éléments de la connaissance ésotérique. La perfection de l'œuvre matérielle est un tout parfaitement constitué, dans lequel chaque partie a sa place et concourt selon son mode et son grade à la formation de ce tout; la perfection de l'œuvre spirituelle est l'exacte correspondance entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'âme et le corps. » Le Grand-Œuvre consiste alors à trouver, dans le temps, par la science analogique des astres et de la lumière, l'angle prophétique s'ouvrant sur l'au-delà du temps, qui est le cœur du temps, tel l'instant, île de cristal se tenant immobile dans la déroute universelle.
Ainsi, par fidélité au dieu dorique de la lumière, l'alchimiste défie le règne de Kronos, afin de vaincre la durée profane et l'histoire elle-même, par le sens semblable à une lance de feu qui l'interrompt et la transcende pour la très grande gloire de l'Esprit dont il est dit dans L'Apocalypse d'Hermès (traité anonyme du dix-septième siècle) : « Il vole vers le ciel par le monde intermédiaire. Nuage qui monte vers l'aurore, il introduit dans l'eau son feu qui brûle, dans le ciel il a sa terre clarifiée. »
Sans doute sommes nous fondés à voir dans l'intelligence analogique qui, précise Pessoa, « n'a aucun nom particulier » une exigence de la poésie en tant que moyen de connaissance et imagination créatrice, pour reprendre l'expression rendue célèbre par les magistrales études de Henry Corbin sur Ibn'Arabi, Sohravardî ou Ruzbehân de Shîraz. L'imagination créatrice, on le sait, est cet espace médiateur entre le sensible et l'intelligible, entre la multiple splendeur du monde sensible et l'unificente clarté des Idées, où s'inscrivent les signes, les Symboles, les silhouettes ou les icônes de la sagesse divine. Car l'Idée est avant tout une chose vue dans le matin profond et les promesses de l'intelligence « qui n'a encore aucun nom particulier »; elle advient comme un scintillement sur la surface des eaux, comme une vision que l'on reconnaît, l'expérience visionnaire n'étant rien d'autre que le moment de la plus haute intensité, dans l'épopée de la réminiscence.
A l'exemple des poètes-philosophes néoplatoniciens, tels que Jamblique ou l'Empereur Julien, Fernando Pessoa ne juge pas exclusives l'une de l'autre la réflexion philosophique et l'expérience visionnaire. Tout au contraire, il entreprend d'éclairer l'une par l'autre afin de retrouver, en amont, l'expérience originelle de la pensée, l'ingénuité primitive de l'accord parfait, d'une sagesse qui, dans sa plénitude, renonce à s'affirmer pour telle : « Lorsque viendra le Printemps, écrit Alberto Caiero, si je suis déjà mort, les fleurs fleuriront de la même façon, et les arbres ne seront pas moins verts qu'au Printemps passé. »
De l'arbre généalogique des hétéronymes de Fernando Pessoa, Alberto Caiero serait en quelque sorte le tronc. De lui se réclament l'érudit et subtil Ricardo Reis et le sauvage et futuriste Alvaro de Campos. D'Alberto Caeiro à Alvaro de Campos, la distance est la même que celle qui sépare Héraclite et Proclus, le présocratique et le néoplatonicien,- le « découvreur de la nature » et le chantre de la violence « ultimiste », gnostique païen aspirant sans doute à la même « innocence des sens », pour reprendre l'expression de Nietzsche, mais devant, pour l'atteindre, passer par toutes les outrances de la révolte, de l'imprécation et de l'apostasie. En ce sens Alvaro de Campos est plus proche de nous. Son inquiétude et son tumulte sont davantage à notre ressemblance que la sérénité de Caiero, infiniment désirée mais perdue comme sont perdus pour nous, « affreusement perdus », l'Age d'Or dont parlait Hésiode et la silencieuse enfance, et l'Empire.
L'Idée d'Empire, en ouvrant une troisième voie entre l'isolement égotiste et le nivellement collectif, ressuscite aussi une certaine forme d'espoir métapolitique ». Diversité ordonnée, hiérarchie au sens étymologique du terme, fondant le principe de l'Autorité sur le sacré et non plus sur le pouvoir temporel, l'Empire dont rêve Pessoa est à la ressemblance du beau cosmos miroitant, de cette « terre clarifiée ». Obscurcie par ses parodies successives, l'Idée d'Empire est devenue aujourd'hui presque incompréhensible. « Tout Empire qui n'est pas fondé sur un impérialisme spirituel est un cadavre régnant, une mort sur un trône » écrit Fernando Pessoa. Il importe ici de retrouver le sens du discernement et ne plus confondre totalité et totalitarisme, unité et uniformité, autorité et pouvoir, gloire et réussite, métaphysique et idéologie, intransigeance et fanatisme, principes et valeurs.
Alors que les valeurs et les idéologies concernent, selon la formule de Raymond Abellio « l'espèce humaine en tant qu'espèce, dans son ensemble ou ses sous-ensembles », les principes concernent l'être humain dans sa solitude et dans sa communion. Les valeurs relèvent d'une appartenance grégaire et utilitaire. Les principes obéissent à l'unique souveraineté de l'Esprit et témoignent d'une vocation héroïque, ascétique, ludique ou contemplative : « En créant notre propre civilisation spirituelle, écrit Pessoa, nous subjuguerons tous les peuples; car il n'y a pas de résistance possible contre les forces de l'Esprit et des arts, surtout lorsqu'ils sont organisés, fortifiés par des âmes de généraux de l'Esprit. »
Comment définir exactement cet impérialisme ? Pessoa propose la formule: « Un impérialisme de poètes ». En effet, écrit-il, « l'impérialisme des poètes dure et domine; celui des politiciens passe et s'oublie s'il n'est rappelé par le chant des poètes. » L'avenir du Portugal, et, par voie de conséquence, de l'Europe, sortie enfin de la pénombre de son activisme somnambulique, est déjà écrit pour qui sait lire dans les strophes de Bandarra. Cet avenir, explique Pessoa, c'est d'être tout: « Ne tolérons pas qu'un seul dieu reste à l'extérieur de nous-mêmes. Absorbons tous les dieux ! Nous avons déjà conquis la Mer; il ne nous reste qu'à conquérir le Ciel en laissant la Terre aux autres... Etre tout, de toutes les manières, parce que la vérité ne peut exister dans la carence. Créons ainsi le Paganisme Supérieur, le Polythéïsme Suprême ! »
La rimbaldienne « alchimie du Verbe » la quête de « l'étincelle d'or de la lumière nature » s'anime ainsi d'une impérieuse exigence d'étendre le domaine du sens. Vasco de Gamma des mers et des cieux intérieur, Pessoa ne cherche point à se perdre dans les abysses de l'indéterminé ou de l'absurde, mais de conquérir. En son dessein cosmogonique et impérial, il suit l'orientation du Soleil-Logos. De même que Sohravardî voulut réactualiser la sagesse zoroastrienne de l'ancienne Perse tout en demeurant fidèle à la plus subtile herméneutique abrahamique, Pessoa nous promet le retour de Dom Sébastien, un matin de brouillard, précédant le triomphe du Cinquième Empire : « Par matin, précise Pessoa, il faut entendre le commencement de quelque chose de nouveau,- époque, phase ou quelque chose de similaire. Par brouillard, il faut entendre que le Désiré reviendra caché et que personne ne s'apercevra de son arrivée et de sa présence. »
Le retour au « paganisme » que suggérait Alvaro de Campos pour en finir avec le matérialisme « qui exprime une sensibilité étroite, une conception esthétique réduite, puisqu'il ne vit pas la vie des choses sur le plan supérieur » n'est en rien un refus de la transcendance mais un appel aux vastes polyphonies de l'Ame du monde, écharpe d'Iris et messagère des dieux : « Inventons, écrit Pessoa, un Impérialisme Androgyne réunissant qualités masculines et féminines; un impérialisme nourri de toutes les subtilités féminines et de toutes les forces de structuration masculines. Réalisons Apollon spirituellement. Non pas une fusion du christianisme et du paganisme, mais une évasion du christianisme, une simple et stricte transcendantalisation du paganisme, une reconstruction transcendantale de l'esprit païen."
« Une reconstruction transcendantale de l'esprit païen ». La formule qui n'est paradoxale qu'en apparence mérite d'être méditée. Elle nous reporte directement à cette période faste du néoplatonisme païen qui, de Plotin à Damascius, œuvre comme l'écrit Antoine Faivre « à poser une procession intégrale, une transcendance intransigeante, alliée à une immanence mystique ». Et cela tout en opérant la convergence des Arts sacrés et des religions du Mystère héritières de l'Egypte pharaonique. Il ne s'agit donc nullement ici d'une régression vers une religiosité naturaliste, ou panthéïste, mais, tout au contraire, de l'édification, selon les hiérarchies platoniciennes d'une véritable métaphysique établissant clairement la distinction entre la nature et la Surnature. Mais là encore distinction ne signifie point séparation. La dualitude est nuptiale; et si le soleil que l'on célèbre n'est point le soleil physique mais, à travers lui le soleil métaphysique du Sens, du Logos, alors l'ascendance matutinale de l'astre est l'image de l'exhaussement de la conscience humaine hors de sa gangue naturelle, son élévation glorieuse, impériale. Le projet de reconstruction de Fernando Pessoa s'éclaire ainsi des subtiles couleurs du monde antérieur.
Messages, cartulaire héraldique du drapeau portugais, égrène, pour reprendre l'expression de Armand Guibert « un rosaire où s'enchaînent les grains du Merveilleux: le roi Jean Premier, fondateur de la dynastie des Aviz y est adoubé Maîtredu Temple; Dona Filipa de Lancastre, son épouse, saluée Princesse du Saint-Graal; apostrophant le Saint-Connétable Nun'Alvarès, le poète évoque Excalibur, épée à l'onction sainte, que le roi Arthur te donna. » L'anamnésis, le ressouvenir de la Parole Délaissée est la seule promesse.
Luc-Olivier d’Algange
00:05 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
01/09/2024
Hommage à Stefan George, extrait de L'Ame secrète de l'Europe, éditions de L'Harmattan.

Luc-Olivier d’Algange
Hommage à Stefan George
La poésie est un combat. Aussi sereine, désinvolte ou légère qu’on la veuille, si éprise de songes vagues ou du halo des mots qui surgissent, comme l’écume, de l’immensité houleuse de ce qui n’est pas encore dit, la poésie n’existe en ce monde que par le dévouement, le courage, l’oblation martiale de ses Serviteurs. A ce titre, toute poésie est militante, non en ce qu’elle se voudrait au service d’une idéologie mais par la mise en demeure qu’elle fait à ceux qui la servent de ne servir qu’elle. Nul plus que Stefan George ne fut conscient de cette exigence à la fois héroïque et sacerdotale qui pose la destinée humaine dans sa relation avec la totalité de l’être, entre le tout et le rien, entre le noble et l’ignoble, entre l’aurore et le crépuscule, entre la dureté du métal et « l’onde du printemps » :
« Toi, toujours début et fin et milieu pour nous
Nos louanges de ta trajectoire ici-bas
S’élèvent Seigneur du Tournant vers ton étoile… »(1)
Le cours ordinaire des jours tend à nous faire oublier que nous vivons brièvement entre deux vastitudes incertaines qui n’appartiennent point à ce que l’homme peut concevoir en terme de vie personnelle, et qu’à chaque instant une chance nous est offerte d’atteindre à la beauté et à la grandeur en même temps que nous sommes exposés au risque d’être subjugués par la laideur et la petitesse. Depuis que nous ne prions plus guère et que nos combats ne sont plus que des luttes intestines pour le confort ou la vanité sociale, ce qu’il y a de terrible ou d’enchanteur dans notre condition nous fait défaut. Nous voici au règne des « derniers des hommes » dont parlait Nietzsche. Pour Stefan George, la poésie est un combat car le monde, tel qu’il se configure, n’en veut pas. La poésie n’est pas seulement le combat de l’artiste avec la matière première de son art, elle est aussi un combat contre le monde, un « contre-monde » selon la formule de Ludwig Lehnen, qui est, pour des raisons précises, le contraire d’une utopie. Pour Stefan George, ce n’est pas la poésie qui est l’utopie, le nulle part, mais ce monde tel qu’il va, ce monde du dernier des hommes auquel la poésie résiste :
« Ainsi le cri dolent vers le noyau vivant
Retentit dans notre conjuration fervente » (2)
On peut, certes, et ce sera la première tentation du Moderne, considérer cette majestueuse, hiératique et solennelle construction georgéenne comme une illusion et, de la sorte, croire la récuser. Il n’en demeure pas moins que cette illusion est belle, que cette illusion, si illusion il y a, entraîne en elle, pour exercer les pouvoirs du langage humain, le sens de la grandeur et du sacrifice, l’exaltation réciproque du sensible et de l’intelligible. Force est de reconnaître que cette « illusion » si l’on tient à ainsi la nommer, est à la fois la cause et la conséquence d’une façon d’être et de penser plus intense et plus riche que celles que nous proposent ces autres illusions, ces illusions subalternes dispensées par les sociétés techniciennes ou mercantiles, voire par les idéologies dont les griseries sont monotones et fugaces :
« Et renferme bien en ta mémoire que sur cette terre
Aucun duc aucun sauveur ne le devient sans avoir respiré
Avec son premier souffle l’air rempli de la musique des prophètes
Sans qu’autour de son berceau n’eût tremblé un chant héroïque. » (3)
L’éthique s’ordonne à des Symboles et à une discipline qui resserre l’exigence autour du poïen. Ascèse de la centralité, du retour à l’essentiel, de l’épure, cette éthique rétablit la précellence d’une vérité qui se laisse prouver par la beauté en toute connaissance de cause. Pour Stefan George, rien n’est moins fortuit que la poésie. Loin d’être le règne des significations aléatoires ou de vagues divagations de l’inconscient, la poésie est l’expression de la conscience ardente, de la lucidité extrême. L’Intellect n’est point l’ennemi de la vision, bien au contraire. L’Image n’advient à la conscience humaine que par le miroir de la spéculation. Toute poésie est métaphysique et toute métaphysique, poésie. On peut considérer cette poésie métaphysique comme une illusion, Stefan George se refusant à en faire un dogme, mais cette illusion demeure une illusion supérieure dont la supériorité se prouve par la ferveur et la discipline qu’elle suscite :
« Seul peut d’aider ce qu’avec toi tu as fait naître –
Fais retour dans l’image retour dans le son ! » (4)
Notons, par ailleurs, que ceux-là mêmes qui « déconstruisent » et « démystifient » avec le plus d’entrain les métaphysiques sont aussi ceux qui s’interrogent le moins sur les constructions et les illusions banales comme si, du seul fait d’être majoritaires à tel moment de l’Histoire, elles échappaient à toute critique, voire à toute analyse. La pensée de Stefan George se refuse à cette complaisance. Peu lui importe le jugement ou les habitudes de la majorité. Plus humaniste, au vrai sens du terme que des détracteurs, Stefan George prend sa propre conscience comme point de référence à la conscience humaine. Il éprouve la conscience, la valeur, la volonté, la possibilité et la création à partir de son propre exemple et de sa propre expérience : méthode singulière où l’on peut voir aussi bien un immense orgueil qu’une humilité pragmatique qui consisterait à ne juger qu’à partir de ce que l’on peut connaître directement, soi-même, et non par ouïe dire, précisément à partir d’un « soi-même » dont l’exemplarité vaut bien toutes les représentations et tous les stéréotypes du temps :
« Seuls ceux qui ont fui vers le domaine
Sacré sur des trirèmes d’or qui jouent
Mes harpes et font les sacrifices au temple..
Et qui cherchent encore le chemin tendant
Des bras fervent dans le soir – d’eux seuls
Je suis encore le pas avec bienveillance
Et tout le reste est nuit et néant. » (5)
Pour Stefan George, croire que sa propre conscience ne puisse nullement être exemplaire de la conscience humaine, ce serait consentir à une démission fondamentale, saper le fondement même du « connais-toi toi-même » c’est-à-dire le fondement de la pensée grecque du Logos qui tient en elle le secret de la liberté humaine. Si un seul homme ne peut, en toute légitimité, donner tort à ses contemporains, fussent-ils en majorité absolue, toute pensée s’effondre dans un établissement automatique et général de la barbarie, voire dans une régression zoologique : le triomphe de l’homme-insecte. Toutefois, à la différence de Stirner, George ne s’appuie pas exclusivement sur l’unique. Sa propre expérience de la valeur, il consent à la confronter à l’Histoire, ou, plus exactement à la tradition. Son « contre-monde » se fonde à la fois sur l’expérimentation du « connais-toi toi-même » et sur la tradition qui nous juge autant que nous la jugeons. L’humanitas, en effet, ne se réduit pas aux derniers venus quand bien même ils s’en prétendent être l’accomplissement ultime et merveilleux. Ce que le dépassement de sa propre conscience exige de lui, ce qu’exige son sens de la beauté et de la grandeur, son refus des valeurs des « derniers des hommes », Stefan George le confronte à ce que furent, dans leurs œuvres, les hommes de l’Antiquité et du Moyen-Age, les Prophètes, les Aèdes, les moines guerriers ou contemplatifs, non pour être strictement à leur ressemblance mais pour consentir à leur regard, pour mesurer à l’aune de leurs œuvres et de leurs styles, ce que sa solitude en son temps lui inspire, ce que sa liberté exige, ce que son pressentiment lui laisse entrevoir :
« Nommez-le foudre qui frappa signe et guida :
Ce qui à mon heure venait en moi…
Nommez-le étincelle jaillie du néant
Nommez-le retour de la pensée circulaire :
Les sentences ne le saisissent : force et flamme
Remplissez-en images et mondes et dieux !
Je ne viens annoncer un nouvel Une-fois :
De l’ère de la volonté droite comme une flèche
J’emmène vers la ronde j’entraîne vers l’anneau » (6)
Si la joie de Stefan George n’était que nostalgie, elle ne serait point ce salubre péril pour notre temps. La nostalgie n’est que le frémissement du pressentiment, semblable à ces ridules marines qui, sous le souffle prophétique, précèdent la haute vague. Il ne s’agit pas, pour George, de plaindre son temps ou de s’en plaindre mais de le réveiller ou de s’en réveiller, par une décision résolue, comme d’un mauvais rêve. La décision georgéenne n’est nullement une outrecuidance ; elle a pour contraire non point une indécision, qui pourrait se targuer de laisser les hommes et le monde à eux-mêmes, mais une décision inverse, également résolue :
« Possédant tout sachant tout ils gémissent :
‘’Vie avare ! Détresse et faim partout !
La plénitude manque !’’
Je sais des greniers en haut de chaque maison
Remplis de blé qui vole et de nouveau s’amoncelle –
Personne ne prend… » (7)
De même que l’on ne peut nuire à la sottise que par l’intelligence, on ne peut nuire à la laideur que par la beauté. Les promoteurs du laid sous toutes ses formes sont si intimement persuadés que la beauté leur nuit qu’ils n’ont de cesse d’en médire. La beauté, selon eux, serait archaïque ou élitiste et, quoiqu’il en soit, une odieuse offense faite à la morale démocratique et aux vertus grégaires. Le plus expédient est de dire qu’elle n’existe pas : fiction aristocratique et platonicienne dépassée par le relativisme moderne. Sans entrer dans la dispute fameuse concernant l’existence ou l’inexistence de la beauté en soi (et devrait-elle même exister pour être la cause de ce qui existe ?) les démonstrations en faveur de l’une ou de l’autre hypothèse tiennent sans doute plus à ce que l’on éprouve qu’à ce que l’on raisonne. La beauté telle que la célèbrent Platon ou Plotin est moins une catégorie abstraite qu’une ascension, une montée, une ivresse. Cette beauté particulière, sensible, lorsqu’elle nous émeut, lorsque nous en éprouvons le retentissement à la fois dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit, nous la voulons éternelle. La pensée platonicienne, surtout lorsque s’en emparent les poètes, autrement dit le platonisme qui n’est laissé pas exclusivement à l’usage didactique, est une ivresse, une extase dionysienne qui, par gradations infinies, entraîne l’âme du sensible vers l’intelligible qui est un sensible plus intense et plus subtil. Entre le Sens et les sens, Stefan George refuse le divorce. Sa théorie de la beauté, et le mot « théorie » renvoie ici à son étymologie de contemplation, dépend de ce qu’elle donne ou non à éprouver à travers ses diverses manifestations. Eprouvée jusqu’à la pointe exquise de l’ivresse, la beauté devient éternelle. On peut certes discuter de la relativité des critères esthétiques, selon les temps et les lieux, il n’en demeure pas moins que par l’expérience que nous en faisons, la beauté nous arrache à la temporalité linéaire pour nous précipiter dans un autre temps, un temps rayonnant, sphérique, harmonique, qui n’est plus le temps de l’usure, ni celui de la finalité. Confrontée à cette expérience, la pensée platonicienne édifie la théorie de la beauté comme splendeur du vrai qui n’exclut nullement l’exclamation rimbaldienne : « O mon bien, ô mon beau ! » car cette beauté en soi n’est « en soi » que parce qu’elle se manifeste en nous. Elle nous doit autant que nous lui devons et réalise ce que les métaphysiciens nomment une « unité supérieure à la somme des parties » :
« … Instant intemporel
Où le paysage devient spirituel et le rêve présence.
Un frisson nous enveloppa… Instant du plus grand heur
Qui couronnait toute une vie terrestre en la résumant
Et ne laissait plus de place à l’envie de la splendeur
De la mer parsemée d’îles de la mer divine. »(8)
La beauté n’appartient ni à l’Esprit, ni à la chair mais à leur fusion ardente. Sauver la cohésion du monde, son unité supérieure pour garder en soi la multiplicité, la richesse des contradictions, la polyphonie des passions, ce vœu exactement contraire à celui des Modernes, Stefan George en appellera pour le réaliser « aux Forts, aux Sereins aux Légers », qu’il veut armer contre les faibles, les excités et les lourds, autrement dit les hommes grégaires, acharnés à peupler le monde de leurs abominations sonores non sans, par surcroît, être de pompeux moralisateurs et les infatigables publicistes de leur excellence, au point de considérer tous les génies antérieurs comme leurs précurseurs. Tout Moderne imbu de sa modernité est un dictateur en puissance éperdu d’auto-adulation mais en même temps extraordinairement soumis, soucieux de conformité sociale, « bien-pensant », zélé, esclave heureux jamais lassé de s’orner des signes distinctifs de son esclavage. Le Moderne « croit en l’homme », c’est-à-dire en lui-même, mais ce « lui-même », il consent à ce qu’il soit bien peu, sinon rien ! Rien ne lui importe que d’être, à ses propres yeux, supérieur à ses ancêtres. La belle affaire ! Ceux-ci étant morts, il s’en persuade plus aisément.
« Ne me parlez d’un Bien suprême : avant d’expier
Vous le ravalez à vos existences basses…
Dieu est une ombre si vous-mêmes pourrissez !
(…) Ne parlez pas du peuple : aucun de vous ne soupçonne
Le joint de la glèbe avec l’aire pavée de pierres
La juste co-extension montée et descente –
Le filet renoué des fils d’or fissurés. »(9)
L’œuvre est ainsi un rituel de résistance à l’indifférenciation, c’est-à-dire à la mort : rituel magique, exorcisme au sens artaldien où la sorcellerie évocatoire et l’intelligence aiguë s’associent en un même combat contre Caliban. Pour Stefan George, rien n’est dû et tout est à conquérir, ce qui relève tout autant d’une haute morale que d’une juste pragmatique. Chaque espace de véritable liberté contemplative ou créatrice est conquis de haute lutte contre les autres et contre soi-même. Il n’est d’autre guerre sainte, pour Stefan George, que celle qui sauve, qui sanctifie la beauté de l’instant.
A l’heure où l’Europe fourvoyée se désagrège, on peut voir en Stefan George l’œuvre ultime de la culture européenne. Cet Allemand nostalgique de la France, disciple de Shakespeare et de Dante, ce poète demeuré fidèle dans ses plus radicales audaces formelles aux exigences et aux libertés de la pensée grecque nous donne à penser que l’Europe existe en poésie. Une idée, une forme européenne serait ainsi possible mais qui ne saurait se réaliser en dehors ou contre les nations. Pour Stefan George, l’Idée européenne jaillit des profondeurs de l’Allemagne secrète, autrement dit de ces puissances cachées, étymologique, ésotériques qui gisent dans le palimpseste de la langue nationale. Evitons un malentendu. Certes, la poésie, comme nous en informe Mallarmé, est composée non avec des sentiments ou des significations mais avec des mots, mais ces mots participent d’une poétique qui engage la totalité de l’homme et du monde. La poésie qui n’est point confrontation avec la totalité de l’être n’est que babil, « inanité sonore ». Toute chose possède son double hideux ; celui de la poésie est la publicité.
La poésie de Stefan George est militante, mais en faveur d’elle-même, où, plus exactement, en faveur de la souveraineté du Symbole dont elle témoigne, du dessein dont elle est l’accomplissement. La poésie est au service de son propre dessein qui, loin de se réduire aux mots, s’abandonne aux resplendissements de l’Esprit dont les mots procèdent et qu’ils tentent de rejoindre sur ces frêles embarcations que sont les destinées humaines. Stefan George dissipe ainsi le malentendu post-mallarméen. Son œuvre restitue aux vocables leur souveraineté. On distingue d’ordinaire dans l’œuvre de Stefan George deux époques, l’une serait vouée à « l’art pour l’art », dans l’influence de Villiers de l’Isle-Adam et de Mallarmé, l’autre, qui lui succède, serait militante, au service de l’Idée et de l’Allemagne secrète. L’une n’en est pas moins la condition de l’autre. Mallarmé et Villiers sont pour Stefan George, « les soldats sanglants de l’Idée ». Villiers est un écrivain engagé contre le « progrès » et contre l’embourgeoisement du monde. Mallarmé poursuit une « explication orphique de la terre ». C’est en accomplissant l’exigence de la poésie, en amont, que la poésie et la politique se rejoignent. Toute politique procède de la poésie. Rétablir la souveraineté de la poésie, c’est aussi rétablir celle de la politique contre le monde des insectes, contre le triomphe du subalterne sur l’essentiel.
Luc-Olivier d’Algange
-
L’Etoile de l’Alliance, éditions de la Différence, page 9
-
Ibid., page 19
-
Ibid., page 29
-
Ibid., page 37
-
Ibid., page 49
-
Ibid., page 43
-
Ibid., page 51
-
Ibid., page 139
-
Ibid., page 59
Stefan George, L’Etoile de l’Alliance, Traduit de l’allemand et postfacé par Ludwig Lehnen (éditions de la Différence)
Article extrait de L'Ame secrète de l'Europe, éditions de L'Harmattan, collection Théôria.
23:05 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook


