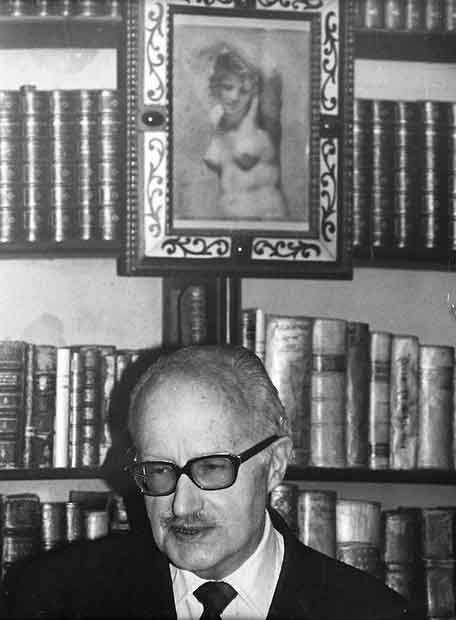27/08/2024
Chant de l'étoile polaire, poème

Luc-Olivier d’Algange
Chant de l’Etoile polaire
Maudites, les apparences ?
Il fallait un jour en finir avec ce mensonge dont les conciles d'azur et d'or
assistaient au péril de nos royaumes...
Jadis, il m'en souvient, toute chose était dite en cet honneur.
La Gloire, et les certitudes philologiques,
l'empire et la tristesse des conquérants salutaires...
Toute chose, oui, s'il m'en souvient, était ainsi dévouée à cette rive sablonneuse,
toute chose en vain
tout en bas de l'escalier de la nuit et des millénaires,
toute chose évanouie dans l'illusion de l'heure
dans cette flamme inextinguible
sous le regard le plus clair, le coursier le plus blanc,
telle cette Ode Olympique dont l'aube
encore peuplée d'astres mystérieusement
nous ôtait le sommeil.
Et nous demeurions ainsi les yeux ouverts,
nous demeurions
immobiles,
comme la descendante de l'ultime prodige
sur les degrés du temple taurique
- doucement elle feignit de s'endormir...
Or, tout cela revint
à ma mémoire comme une libation de la vive nature.
Tout cela m'enjoignait à comprendre la joie et la douleur
l'épreuve des enfers et la pieuse tristesse
d'un jour pluvieux,
l'automne...
Car il était dit
que nous devions douter de notre victoire,
douter du Chœur
et de cette saveur subtile de l'âme,
alors même que la beauté
en sa chantante terrestreïté,
devisait avec la Mer et nos tempes !
Et nous rêvions alors
d'un envol prodigieux, d'une race du libre ciel et de l'essor, car l'Ether,
l'Ether toujours
nous fut,
entre toutes,
l'éblouissante promesse...
Quelle légèreté alors nous saisissait dans le miroir
argenté des feuilles d'olivier,
et de quel promontoire auguste
nous entendions la voile frémir
et se défaire l'emprise des tristes générations !
Ainsi, la belle philosophie des hauteurs
s'offrit à nous comme une jeune fille.
Comme une nuit
portée dans le sein du jour le plus vaste,
notre âme
s'éveillait à l'entendement divin,- car longtemps silencieuse
elle fut,
comme des forêts, des steppes
dans le déclin crépusculaire d'invisibles civilisations...
Longtemps elle ne fut qu'une ombre dans l'Hadès, une
incertaine traversée
de l'Ombre dans une Ombre... Longtemps elle ne fut
qu'un murmure indistinct sur l'ardoise où agonise l'été.
Mais voici
qu'à travers l'immanence de la joie
l'immanence du Signe qui fulgure comme un diamant
sur l'eau ensoleillée
comme un feu clair dans le Jour
le plus vaste,
voici qu'advient la puissance nouvelle
issue d'une avant-région encore sans nom,
issue d'un nous-même dont nous ignorions
l'existence et le sens,
voici
comme une brûlure, une folie, une parfaite constellation,
la synthèse parfaite.
Toute chose ne débute-t-elle point, strophe céleste,
dans le prodige d'un voyage
dans les Jardins de la Mer
dont les roses tardives
sont les plus douces légendes
de l'Hellade rêvée ?
Que l'illusion soit
dans cette profondeur détruite !
Et qu'elle soit le recommencement.
Tant d'errances dans les villes et les siècles en seront rédimées,
tant d'espérances exaucées,
et le thème de l'ultime citation,
en majesté concise
dédiée à la patience du malheur
dont le sens désormais nous sera vain !
Notre grâce était si légère dans notre combat contre Chronos
que le ciel soudain
fut envahi
d'un turquoise d'une musique si belle
que des larmes coulaient sur tes joues
et les temps passés refleurissaient et se mariaient
à ces ombres si délicates que le ciel nous dispensait
comme si
dans le décret de cette heure fière
tout devait nous être donné
et au-delà,
car telle était la récompense de notre fuite amoureuse...
Plaignons un instant ceux qui sont resté en arrière et oublions,
sous l'arc immense du dernier jour du monde
tous les déchirements seront des retrouvailles
et songes, fumées, seront toutes les misères humaines.
C'est pourquoi, en cet instant qui nous emporte
en ce vaisseau
qui nous éloigne
de ce que nous étions
en cette seconde salvatrice,
cet élan vers l'Ether où nulle ombre défunte ne sourit,
j'ai osé refuser ,- et volent les fragments célestes dans l'urgence du Chant !
Et gloire à Eros qui donna le diapason à ces mélodies !
Mon histoire est l'histoire du monde,
ma mémoire est au-delà de moi.
J'ai souvenance
de plus vastes empires dans l'aube inconnue
et le destin des couleurs s'unissait à mon chagrin
de voir disparaître
la patiente et lente science
des nuages empourprés dont les métamorphoses
en dehors de moi-même
semblaient en vérité n'être plus
que l'inexplicable adoration de l'émoi le plus secret,
de l'émoi
le plus intime
et dont jamais, jamais je n'eusse deviné, ni espéré qu'un jour
il fût
ainsi offert à la théâtralité et l'évidence infinie du Ciel,
véritable patrie...
Oui, je bénissais cette heure, ce firmament, ce chant
et la plus profonde pensée
qui jamais ne s'achève et chante en moi sans cesse
le regain de la puissance
de l'invisible et sainte puissance des mots
dont j'ignorais alors
qu'ils viendraient une aube au devant de la plénitude...
Car en ces temps-là
j'ignorais l'unisson et la différence,
j'ignorais l'histoire et même les voiles blanches des rituels,- ceux là mêmes
que nous allions inventer
en notre occidentale conjuration de l'Etoile Polaire,
notre société secrète des pensées et des transparences...
En ces temps-là, oui, j'ignorais tout, car les dieux
ne m'avaient pas encore gratifié de splendeur.
Tout n'était que pressentiment...
Que personne
jugeant cette douleur de l'être où je subsistais
n'en vienne à dire le naufrage et la mélancolie
car elles sont encore des récompenses destinées
aux grandes audaces consacrées du lointain.
Que nul
ne vienne s'approprier cette déréliction
qui fut la mienne
et ce combat absurde où périssent les plus beaux dialogues !
Le Ciel s'abreuve à l'incertitude qui me hante.
Le Ciel connaît le sens de ces batailles et de ces bannières
dont je parlais jadis en d'autres poèmes orageux.
Ce que j'aime est d'une plus imprévisible douceur.
Tout ce que j'aime est dans cette fidélité à l'Instant
source créée et incréée
des millénaires qui dorment dans mes phrases
et que ton souffle éveille dans la consolante aube sororale,
Ides perdues et retrouvées.
Ma mémoire est un ciel d'été.
Elle est dans le bleu et la chair ensoleillée de l'amante
cette éternité conquise
à jamais,
dans la délicatesse des ombres et des baisers
dans la clarté de vitrail
de la seconde magicienne.
... Et les feuilles furent légères dans l'obscur abri
du crépuscule. C'était un labyrinthe
où je découvrais
le Sel et la Somme du Dieu sans nom. Quelle pure pensée
alors nous éblouissait
dont nous entendions la voix sur les rochers,
Quelle silencieuse et limpide fureur nous saisissait
et nous arrachait au pouvoir de la douleur
comme une sentence marine.
Fils du Ciel et du soleil,
l'audace était notre devise. Elle devançait nos rires
sur l'abîme et l'océan ardent
et cette joie d'être à soi-même la proie
du plus secret désir des apparences,
du plus secret désir des transparences...
Cette ivresse était sans égale.
Devant les portes consacrées et les forêts de l'aube pâle,
devinant le sens des cendres et des empreintes,
nous devancions le cri et l'enfer,
et de larges voiles se faisaient accueillantes à notre ferveur.
De larges voiles comme des Anges,
de larges voiles
sous un ciel plus sombre que la Mer...
Que la limpidité soit le Mystère, et l'allusion,
cette transparence offerte aux sens,
à la sagesse cardinale du désir qui sait
que toute chose donnée par amour
est inépuisable dans le Sens
et dans la profondeur des cieux et de la nuit...
Se peut-il que l'ignorance domine
au point de laisser déroutées et hostiles des âmes humaines
à l'approche du chant mystérieux ?
Que le souvenir du saphir des mers les plus lointaines
vienne à notre secours
- et la fraîcheur et les embruns,-
pour dire
que jamais le Sens n'est obscur car la ténèbre toujours
est dans le cœur délaissé des hommes...
Que le souvenir du scintillement du Sel alchimique
vole à notre secours
pour dire que jamais le Sens
n'est interdit
sinon par timidité ou paresse humaine.
Le Chant du poète
est la Gloire retrouvée, sa patience infinie,
retrouvée,
son image divine,
retrouvée,
son audace,
retrouvée,
et cette immense puissance bienheureuse,
ce soleil somptueux, retrouvé dans le cœur et l'être
que nous sommes
de toute éternité,
dans la présence.
Toute chose dérive d'une source unique,
et mes pensées et mes rêves...
Comment ne pas voir
que nos rencontres étaient écrites
dans les registres de la lumière ?
L'amour de notre belle trinité amoureuse
nous sauvait de l'insignifiance, de l'insensibilité et de l'Insensé
dont l'otage
était le monde.
Notre rencontre fut l'eau castalienne
pour notre soif que seule
comble une soif nouvelle...
Elle fut le rêve silencieux,
le rêve dont la profonde et douce et calme lumière lavande
abreuve
l'âme et l'esprit
tandis que le corps exulte entre tes bras.
Elle fut
ces larmes de bonheur dans tes yeux.
L'Etre cependant
fulgure dans la mathématique des transparences.
l'Etre,
dont l'exactitude s'émeut des plus lointaines litanies
dont l'adoration
dore le front d'un Christ Vainqueur...
L'Etre, qui n'est point
le Tout,
exige le divin qui le fonde,- de même que la raison
oublieuse du Verbe n'est plus qu'une pitoyable superstition.
Ainsi, il m'en souvient, d'amples considérations
déployaient leurs arcs au-dessus de nos têtes...
Telle fut pour nous l'interprétation infinie du monde
cette impétuosité
du Sens ailé
cette conflagration céleste et silencieuse en nous
dont l'œuvre
s'attardait en notre souvenir,
avec la solennité acquise
de l'assouvissement et de la pensée, qui transparaît,
de la pensée
advenue dans la trace comme une promesse
d'accomplissement...
Telle fut pour nous la Saison divine
la Saison de l'heure adonnée au rivage
d'une plus haute légitimité,
la Saison amoureusement éperdue
sous le triomphe multicolore des Anges.
Telle fut pour nous l'Anadyomène
éternellement surgie des eaux pour nous ceindre
de sa clarté et de sa fougueuse juvénilité...
Ainsi débutait
l'épopée
heureuse de la Sagesse, l'aventure hauturière
sous le Signe de la Conjuration de l'Etoile Polaire.
C'était un éloge de la vie et des plus hauts reflets de la vie,
un éloge des temporalités secrètes en nous
dont l'aube et le crépuscule divulguaient les splendeurs...
Bénies étaient les apparences dans le ciel d'été de ma mémoire.
La métaphysique du Jour
stylisait nos gestes en perfection.
Sous le ciel ordonné
notre destin était un empire,
et la beauté devineresse...
Pourquoi vivre dans la banale confusion
alors que la métaphysique du Jour
précisait le site de nos envols
écartant de nous
les malentendus et les équivoques,-
et nous offrant la désinvolture de surcroît .
Celui
qui parle
au vif de l'instant
sauve ce qui est dit et ce qui n'est point dit,
en un seul geste
dans la subtile justice de la métaphysique du Jour.
Qu'elles osent l'azur attique
de la pure pensée...
Qu'elles y reviennent, avec leurs danses
comme dans un temple d'enfantement:
ce furent
les germinations de la Saison divine. Il fallait bien
que nous fussions vengés de connaître ce premier don
cette première cadence véhémente
dont la limite était un front de lumière.
Il fallait bien que nous eussions secoué le poids
des attentes vaines,
oublieuses,
pour que sans armes visibles
l'on nous jugeât dignes d'accéder aux présages,-
ce serait, disaient les devineresses,
ce serait sur une autre terre
et sous un autre ciel...
Ecumes, Muses, printemps, vertus, vols dans l'aube éternelle.
Ecoutez cette rumeur de mes jours,
comme des ondes...
Telle fut pour nous la Saison divine,
en ce septentrion léger d'une traversée,
d'une saveur,
soudain, prés des fontaines de Thèbes
là où la pureté ressemble
à tes chevilles fines...
Telle fut pour nous
le belle espérance romaine,
la folie solaire
dans le cercle de plus en plus vaste
dont elle honore la beauté
sonore.
Offertes nous furent
tant de richesses inconnues, tant de vigueurs.
Les Cités
étaient lentes sous nos regards
et nous connaissions
le signe de la justice infinie
et le trident marin.
Qu'elle fût touchée, par la mystérieuse parabole des reflets
qu'elle fût nommée,
je devinais
cette éblouissante théurgie...
Son nom
s'éveillait à l'angle des apparences,
dans la ligne brisée
de la transparence,
entre l'ordre du monde et son abîme,
entre le rêve et le sommeil...
Là, je pressentais une feuille frémissante
et le royal accord
de nos contrées et de nos âmes.
Au bord de cette Mer, le sable
est la blonde pensée des dieux...
Infinie si l'on songe
et salvatrice
et mortelle si l'on
compte.
En ces temps-là, nous nous laissions griser
par les scintillements de l'eau et de la lumière.
Le crépuscule était
une immense promesse.
Notre allégresse précédait les événements du récit.
Notre âme
était forte de sa vision
et notre compréhension de la bataille.
Quel souvenir de ciel
austral étendait alors
ses ailes sur nos refuges,
nos ancêtres ?
Et de quel autre souvenir cette âme humaine fut détruite ?
Etait-ce d'un seul refus la croyance cruelle ou bien
dans l'exactitude d'un compas géant
la rosace d'un univers
dont les architectes seraient
la nécessité et le hasard ?
Pieux mensonge !
Toute chose dément cette triste habitude
et même notre honte à nous y résigner
et notre nostalgie d'une certitude plus haute
et la branche de laurier dans l'azur profond
et l'immobilité vibrante
de la pierre: toute chose dément...
Toute chose devine
et j'en détiens la connaissance mélodieuse.
Mais nous connûmes aussi de sombres clameurs,
les déchirements,
le soliloque de l'effroi...
Instants irrespirables,
haines, mélancolies,
à l'intérieur de ces ténèbres en tentation
où toute chose
ressemble à une confuse prostitution,
à une misère machinale,
sous les affreuses évaluations du Règne de la Quantité...
Les temps modernes avaient cette allure qui ne pardonne
et quand bien même
nous n'eussions rien connus d'autre
l'imperfection
était visible
spectre visible
outrance banale
où toute chose n'est qu'un autel de la vengeance,
une idole du ressentiment.
Fuir ! C'était la seule éclatante destinée !
Aller vers les cieux verts et les feuilles brillantes
et les chevaleries
irréelles d'une gloire oubliée...
Fuir cet inavouable rétablissement de Chronos
et cette triste et banale barbarie...
Ainsi notre sillage inventait
une subtile civilisation de lueurs et de caresses
entre nos regards et nos corps
ainsi l'instant méditait
en nous la victoire de cette exquise énigme
qui portait
en nous
ce nom de la Conjuration de l'Etoile polaire.
L'Instant
dont jadis nous écrivîmes le Sacre
portait en nous ce nom
qui nous unissait,
ce nom qui nous destinait
aux plus vertigineuses et calmes ivresses,
Isis voilée et dévoilée...
Et que de monstres frappés d'inconsistance !
Que de belles victoires sur le front du resplendissement,
la large absence farouche de quelle vie antérieure !
Etait-ce
un zénith moins pur,
un bec d'azur
dans la présence majeure ?
Notre audace devenait pensive
et Sphinx dans le péril...
Et dans le grand théâtre des châtaigniers
dans l'ample dramaturgie de ces phrases,
nous inventions le tourment délicieux d'une liberté
injustifiable...
Le Soir évanouissait en nous un trône transfiguré
par les nombres somptueux de la Mer.
Et pourtant
de ces folies
il ne resta
que la haute abstraction du Ciel, et la louange angélique.
Car nous savions que la souffrance,
était une fausse nudité de l'être,
et Virgile riait avec ses épreuves claires
dans ce jour pluvieux que nous traversions sans y croire
dans cet effondrement du monde
que nous subissions sans y croire,
sombres clameurs,
déchirements,
soliloques de l'effroi... Pieux mensonges !
Il était dit que nous ne nous laisserions point encombrer
de ces écorces mortes...
La messagère était trop belle
en sa présence perpétuelle,
la séduction de sa bouche et de sa hanche,
car l'éternité est dans cette heure qui ressemble
à la grande distance du bonheur
et du malheur
telle qu'elle nous touche dans le silence de notre enfance
dans ce silence d'aigue-marine
qui prédit à notre première espérance
le ciel nocturne et pur
où chante l'écume prodigieuse des astres...
Vous qui étiez de la jeunesse perdue l'éloge et le conseil,
cette mémoire
dont l'accueil
eût tari mes paroles
vous seules, vêtues de l'Aube
profonde comme la contemplation,
n'ai-je aimé que votre réalité passive ?
Quel esseulement
et quelle fierté navrée se courbait
sous la funèbre incertitude...
Vous étiez, il m'en souvient, douce de lassitude apprise
avant que ne surgisse
l'autre merveille !
Un char brillant hors de la brume
vous regardait
et vous n'osiez dire,
vous n'osiez acclamer
cette étincelante finitude...
Jadis l'Inanimé effarouchait
l'Esprit,- mais notre course fut
plus rapide !
Plutôt que l'ombre, c'était la vie,
la cathédrale sonore de notre amour !
Vous qui étiez le soleil d'hiver, l'humeur tragique,
la précipitation
des illustres blancheurs, des ancêtres et des alliances,
de ce flot assombri que d'autres que moi choisirent !
Tout cela fut-t-il autre chose
qu'une capricieuse beauté
à moins que l'encre et le sang n'eussent le même emblème ?
Et quelle excellence nous bénissait
quelles allégories ? Où donc
débutait ce monde qui nous abandonnait ainsi sans remord ?
Où donc débutait l'enfance de cette jeunesse sans nom, où donc
le vain repos ?
Où donc le fanatisme des mers ingouvernables, les gestes d'Ossian ?
Tout doit-il encore une fois retourner dans la nuit ?
Devons nous, une fois encore, nous perdre dans ce face-à-face ?
O vous qui étiez l'éternité immanente, le message
et le témoignage
du sommeil et des yeux ouverts dans le sommeil ?
Vous qui étiez la réprimande et la tragédie,-
aujourd'hui notre conjuration
nous éloigne de vous
car nous sommes l'instant, le miroir,
où brille l'éclat du dieu dorique de la lumière...
Et de ce Songe que fut le monde en son bonheur,
et de ce Songe singulier comme un vœu
exaucé
avant toute formulation, nous étions les devins
de même que nous fûmes princes pour nos amantes...
Alors les constructions florales de l'été
rayonnaient
dans l'intemporel...
Le Songe gardait en lui ces légendes
comme des semences
et nos mains
dansaient dans les mosaïques de l'air
comme des voyelles, des oiseaux
dont l'extrême courtoisie céleste s'emparait
de nos erreurs passées...
Car tout cela était déjà loin de nous
dans cette extrême proximité
où toute chose brûle
dans la distance infinie de l'immédiat.
Ainsi,
nous exercions notre raison à comprendre
l'euphorie,
l'eau tranquille, et cet éros cosmogonique
dont les apparences dévoilaient la corolle... C'étaient
des images sauvées,
un orient où l'illusion s'abandonnait
au ravissement du Jour
et la maxime de l'Instant nous éblouissait...
Et de ce Songe que fut le monde en son bonheur,
l'équilibre fut l'atteinte du Jeu,
sa figure de splendeur
surgie dans l'audace souveraine d'une ronce,
ultime logique d'une histoire sainte encore inconnue...
Ce Songe, en vérité,
hantait
le signe du dauphin,
scintillante perfection volant
dans le bleu du ciel et de la mer
Les dieux seuls connaissent les rougeoyantes
feuilles
du Songe
cette immense Atlantide
abandonnée à l'emphase
de la destruction. Mais qui donc disait:
« La destruction est un rêve »-
quel écho de nos propres paroles
dans la lente connaissance de soi-même
où tout commence et recommence.
Et nul ne saurait en contester la classique pudeur !
Les dieux seuls
connaissent l'automne du Songe.
Les dieux seuls peuvent parler de destruction et de fin,
d'achèvement
et de disparition.
Aux hommes qui ne vivent qu'un instant,
qu'un battement de paupière
il est prescrit
de connaître l'éternité vivante,
la présence auguste d'Atlantis,
sa beauté,
dans la seconde qui nous ravit.
Toute notre existence est
dans cette certitude parcourue de pluies et de clartés,
dans cette certitude
dont le cours, l'embouchure et la source témoignent
de l'illimitée
prière du désir
et ses métamorphoses
dont l'ultime ivresse me rédime.
O sainte simplicité du message,- ce que je veux dire s'éveille dans la légèreté:
les dieux seuls connaissent la mort parfois.
Le pur espace est le deuil où le semblable
va à la rencontre du semblable...
Mais autour de nous et du monde
ce sont d'éternelles tragédies et les paroles du bonheur
et le sens dont l'ardeur nous unit
dans l'interprétation infinie de la naissance de l'être...
Que peuvent les dieux contre notre ignorance altérée,
contre la recherche infinie qui nous porte
au-devant
des empires de la terre et du ciel
de la mer
et du feu.
Les dieux seuls connaissent le crépuscule.
A nous
l'aube fleurie
où la frémissante attente s'accorde
à l'accomplissement des gestes,
à l'éclairement du monde sous les savantes caresses et les baisers
qui s'attardent
en ces belles impudeurs de chevelures et de lèvres,-
et l'aube du visage humain
reconnaît l'éternité qui le songe
dans un tumulte ondoyant.
Extrait de Le Chant de l’Ame du monde, éditions Arma Artis.
23:30 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
26/08/2024
L'Ange de la Face, poème, en hommage à Ezra Pound:

Luc-Olivier d'Algange
L'Ange de la Face
Et comme jamais, la syzygie de la lumière;
elle chantera de nouveau
regardant la mer inoubliable de la cinquième dynastie
et dans le souvenir de la forme dorienne d'Hélios
ou encore au coeur du nocturne végétal....
Alors ils arrivèrent à Oxalhunca,
mais ce furent eux qui donnèrent les noms aux districts, aux puits, aux villes...
Dépouillés des insignes, nous errions
sous les aspects ténébreux, les surplis de la flamme noire
car les temps sont venus de tout dire !
" Anna Livia ! je veux tout savoir d'Anna Livia !"
Et de la liturgie astrale des Sabéens,
et d'Amon-Ré
et des prêtres de Hiéropolis...
Issus du labyrinthe des clartés et des fraîcheurs
du deuxième crépuscule avant la fin,
nous souvenant
des hommes-lumière de la Sveta-dvipa, l'Ile blanche
dont l'éclat ressemble à la
splendeur manifestée du soleil lorsqu'approche le moment
de la dissolution de l'univers.
Et plus loin de nous encore, de quelque obscure superstition,
la fragile cosmogonie de notre amour.
Alors les Anges sont venus
posant sur nos fronts l'aube de leurs ailes...
en d'autres temps.
Dans l'île de Chio, il y avait autrefois un visage
de Diane qui paraissait triste à ceux qui
entraient et joyeux à ceux qui sortaient...
Il y avait un laurier planté sur le tombeau de Bribia roi du Pont.
Les morts sont plus nombreux et nos souvenirs sont plus anciens.
Ils passent au-dessus des ruines de notre mémoire.
Et voici, dit Corneille-Agrippa,
les 72 Anges porteurs du nom de Dieu,
Schemhamphoras
et leur Table.
" Tout ce que j'avais vu jusqu'ici n'était rien en comparaison de ce que l'on
promettait de me faire voir".
Et de plus loin encore, les Anges sont venus sur l'horizon doré
au-dessus des villes de Toulouse et de Bordeaux
ce 12 Janvier 1986, en prophétie
des chevaleries de l'Aurore
et dans la profonde mélancolie échue de la couleur verte
à notre destin,
couleur de la juste doctrine...
Venus de l'orée miroitant, ils nous entourèrent
tandis que, vers la place Gemme de Dioscure,
je marchais dans la rue paramnésique
reconnaissant, je le jure, chaque visage.
Et, lentement, dans nos habits de fête, avec le pressentiment
d'une Loi incompréhensible, nous devenions inoubliables
sauvés par l'aurore boréale de la Mémoire !
Car n'est-il point venu, clair, d'une déconcertante clarté
le temps des derniers empires
dont les chants nous accompagnent avec le déclin
du derniers dieu souffrant ?
Où donc, l'interstice des mondes ?
A Göttingen, où je suis né, dans l'heure blanche qui précède
Aurora Consurgens, je relisais la Götzen Dämmerung
et les Dionysos dithyramben
dans l'Alfred Krönx Verlag,
en me souvenant des liturgies zoroastriennes de Sohravardî
"suspendu au tabernacle de l'Exaltation et de la Gloire",
et j'entendais bruire
au dessus de moi
dans l'heure bleue sombre
les Ailes de Gabriel
n'y pouvant rien.
Mais l'été à son tour disparaît à une puissance nouvelle
et les eaux claires sont le pardon.
Tout est vrai, rien n'est permis.
Nous arrivions en des Pays qui portaient déjà
les noms de notre pressentiment...
Les horloges de dissolvèrent en une écume noire
sous les phases lunaires et les rêves
inquiétants. Mais pour conjurer
le Sort,
j'offris à Vénus, la verveine, à Mercure, le quintefeuille
et à Saturne, l'asphodèle.
Nous vivions dans l'inquiétude, la lucidité et l'espoir.
Etait-ce le "commencement perpétuel"
dont parle Jacob Böhme (Mystérium Pansophicum)
ou bien la toute dernière chance des épithalames ?
Qui saurait le dire ?
" L'esprit de profondeur ne meurt point".
Nous eussions aimé que les idées devinssent des icônes;
non plus des fins
mais des aurores
comme la Maison-Dieu ou l'Impératrice des Tarots.
Hommage à vous, cathédrales, obscurités, symboles -
en ce non-pays aux terrasses d'or,
belles comme l'affabulation spectrale d'un paon nocturne,
sur la soleilleuse tragédie de l'horizon...
Et la resplendissante chorégraphie des nuages...
Tu me regardes encore à l'angle du dyptique de la nature
et de la Surnature, belle comme l'Eurydice platonicienne
dont parle Ange Politien.
La Magie Naturelle précise qu'entre les pierres
dépendent de Vénus,
le béril, la chrisolithe, l'émeraude, le saphir,
le jaspe vert, la cornaline,
"et toutes celles
qui ont une couleur belle, changeante, blanche ou verte".
Ainsi, Fluvia d'Eliasem me reçut dans sa mémoire,
vaste palais ardent disjoignant le songe du sommeil...
Venus de l'autre côté de l'horizon avec les tendres feuillages de l'enfance, nos yeux se
heurtèrent aux fenêtres inhabitées...
Les Pâques du silence vivaient dans la pierre de nos mains.
O Agathe au démon, une ombre bleue sur ton front
présageait la terreur
de la grande nuit de l'été.
Au dessous de Tiphéreth, l'Eclair étincelant allumait
les piliers de la Miséricorde et de la Rigueur,
entre Netsach l'Eternité, et
Hod, la Réverbération.
Tout cela se passait à Toulouse pour une heure
il punto a cui tutti li tempi son presenti.
Un cercle de feu tournait autour de nous,
Ariel me souriait, et dans la ténébreuse
béance de ses pupilles, mon image pour la première fois
délivrée de ses miroirs parjures
montrait
un visage d'éternité.
Et l'ombre bleue sur mon front présageait les temps venus de tout dire
et la grande nuit polaire
et la fragile cosmogonie de notre amour.
O lîlâ, jeu des nesciences dont nous fûmes délivrés -
et le souvenir d'Amon-Râ, au-delà des appartenances
de l'espace et du temps
dove s'appunta ogni ubi ed ogni quando
car Il dit: "ne vous souciez pas du lendemain" -
par les labyrinthes d'air d'un feuillage.
Il dit: "laissez les morts enterrer les morts" - et l'aube diadémée exile
au front noir des roses de sel l'ultime apparence des plus nombreux....
tandis que les rares marchent à légers pas de fantômes
vers l'Etoile Flamboyante.
Nous nous souvenions de la Loi des Ages dont parlait Hésiode.
" Et plût au ciel que je n'eusse pas à mon tour à vivre au milieu de ceux de la
cinquième race... Alors,
quittant pour l'Olympe la terre aux larges routes,
cachant leurs beaux corps sous des
voiles blancs,
Conscience et Vergogne, délaissant les hommes, monteront vers les
Eternels".
Le bondissements cadencé
des lignes télégraphiques
me rapprochait des bleuïssantes seigneuries de la mer.
En ces temps lointains - l'Age d'Or dont parlait Hésiode...
Car je suis né avant la victoire des Titans
in Héliopolis Magna
Et comme Hermès-Thoth-Mercure, sous le signe Gemme de Dioscure,
je fus le scribe de l'Ennéade divine,
créateur de langues,
Grand Magicien des Sphères au côté de Ptah
et Maître des cycles du Temps, il me souvient...
" Dans les espaces éternels
Se voient de toutes parts les traces
de l'écroulement des mondes".
Ainsi vivions-nous dans le siècle de l'arc-en-ciel,
gardant mémoire d'elles de pluies claires maudites...
De hautes ombres précédaient notre déroute. Au coeur de la nuit
s'ouvrait l'Aigle des transparences.
Et la blancheur d'or dans la cartographie des songes...
fenêtres boréales ouvertes sur le front du ciel -
Le sommeil nous fut un jardin prophétique,
une arborescence de lumière....
car il était dit, enfin,
que nous allions tomber hors du Temps.
" Dans l'étendue infinie des planes de Saturne...",
soudain je me souviens du poème d'Hermann Broch,
les longues phrases du Feu ( la Descente) et de la beauté,
une fois atteinte la limite du Temps...
Et Virgile soudain
éclaire la mémoire, après l'Alighieri,
dans ce train, entre deux villes natales
entre deux mondes - où vers les bleuïssantes seigneuries d'Annabel Lee.
" l'épaule penchée contre son genou, et il avait lu l'Egloge de la Magicienne..."
Au-dehors, des champs de tournesol se glorifiaient dans le bleu crépusculaire
et ma compagne souriait dans son sommeil.
O Geilissa, des noms de dieux appris dans l'enfance
venaient à ma rencontre
peuplant le grand espace désert de notre espoir...
Atrée, Camira, Astypalaea...
Nous cheminions avec douceur, et sans crainte vers l'ancienne cité.
1986.
23:05 | Lien permanent | Commentaires (2) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
Philippe Barthelet, Luc-Olivier d'Algange, le premier des onze entretiens de "Terre Lucide", éditions de l'Harmattan
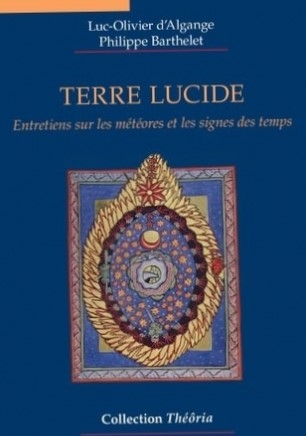
Philippe Barthelet, Luc-Olivier d'Algange
Entretiens sur les météores et les signes des temps
PREMIER ENTRETIEN :
C’était à Paris, non loin de la Bourse, dans une brasserie pleine de lustres et de cristaux, où les tabliers blancs des garçons, leurs serviettes amidonnées, les têtes dorées des bouteilles de champagne empilées dans la glace d’une vasque d’argent sur le comptoir, faisaient chercher malgré soi, sur les banquettes voisines et dans les miroirs alentour, la silhouette frileuse de Marcel Proust, seul et curieux devant son œuf à la coque et ses mouillettes ou bien le rire bedonnant de Léon Daudet, attablé la serviette au col devant des escargots, la bouteille d’anjou-villages dûment fleurdelysée à portée de la main dans le seau couvert de buée.
L’un des commensaux, sans doute parce qu’il était en retard, n’en finissait pas de s’émerveiller de la relativité du temps :
- Imaginer un temps où toutes les choses sont à la même date est une illusion de professeur, c’est-à-dire une imbécillité d’étudiant monté en graine… Qui déciderait si nous sommes ici au début du XXIe siècle ou plutôt à celui du XXe ? Si le « temps est gentilhomme », comme disent les Italiens, il peut bien ménager à qui les perçoit ces coïncidences intemporelles…
- Cher ami, repartit son compagnon, encore un effort, comme dirait le divin marquis… Que si il tempo è galentuomo, sa galanterie ne s’arrêtera pas en si bon chemin, et peut encore nous remonter d’un siècle… Imaginez-vous dans la première année du règne de « Napoléon, empereur de la République », pendant cet été où l’on rêvait encore à l’invasion de l’Angleterre… Toutes les pensées allaient au camp de Boulogne ; ici, la Bourse, dont nous apercevons les colonnes en nous penchant, n’existait pas encore : on l’avait installée dans le ci-devant basilique Notre-Dame des Victoires. Tout le monde n’avait pas encore eu le temps de lire le Génie du christianisme…
- Ces propos sur la comète, repartit le retardataire, d’autres que nous les ont tenus à ce moment-là : ils sont un exemple bien intimidant. Je veux parler des trois interlocuteurs des Soirées de Saint-Pétersbourg, le Comte, le Sénateur et le Chevalier. Si parva licet prenons-les comme modèles, le temps d’une conversation. Nous laisserons le troisième siège, que l’on n’espère pas trop périlleux, à l’ami de passage qui voudra bien tenir sa partie dans notre conversation, s’il vient ; à défaut de la Néva, la Seine n’est pas trop loin et surtout, nous avons mieux que le Pierre Ier de Falconet : le cavalier royal de la place des Victoires.
- Prenons garde que le cheval de Louis XIV, au contraire de celui du Czar, n’a pas besoin d’un serpent pour se cabrer : on oublie toujours le serpent d’airain au pied du cheval, le comte de Maistre lui-même semble ne pas l’avoir vu. Alexander Blok prophétisait quant à lui la victoire du serpent…
- Convenons donc de tout cela, et que notre brasserie parisienne fait une acceptable terrasse pétersbourgeoise. Et partons donc de Joseph de Maistre, et de ce qui est sans doute le schibboleth de toute son œuvre - comme sans doute de tout effort véridique de déchiffrement des temps nouveaux nés de 1789 - : que ce qu’il faut faire c’est non pas une révolution contraire, mais le contraire de la révolution : devons-nous dire de la même façon, en transposant à peine, que ce qu’il faut écrire c’est non pas de la littérature contraire mais le contraire de la littérature ?
Philippe Barthelet :
- Les inventeurs de la « littérature », du mot et de la chose, les soi-disant « philosophes » du XVIIIe siècle, il faudrait les appeler une secte, ce qu’ils étaient. L’étymologie du mot est bifide, et cumule les disgrâces : « sector » (de sequor ), suivre et « seco », couper. On erre en troupeau. La littérature, par la volonté de ses inventeurs, est une coupure, une rupture (une roture, c’est le même mot) d’avec ce qui nourrit et vivifie – d’avec l’origine. D’où ce gigantesque oubli de l’âme du monde pour finir par ne plus connaître que les moindres replis de la conscience individuelle. On passe ainsi d’Homère à Henry James, lequel est sans aucun doute un horloger d’une prodigieuse minutie, mais enfin il faut bien convenir que c’est une minutie stérile… (les biographes d’Henry James supposent d’ailleurs qu’il n’avait aucune expérience de la chair, ce qui, eu égard à son œuvre et, comment dire, à l’intention de celle-ci, n’est peut-être pas sans écho ni importance). Vous me direz que nous sommes désormais très loin de ces joyaux inféconds, et que nous avons chu depuis belle – ou laide – lurette dans les limbes de l’infra-psychologie. Julien Gracq, pour l’opposer au sentiment cosmique des romantiques allemands, déplorait le côté « fleur coupée » du roman psychologique à la française : la fleur coupée peut faire illusion quelque temps, dans un vase ; mais elle devient vite fleur fanée, puis encore plus vite fleur pourrie. Nous en sommes là : au fumier, lequel, malgré toutes ses prétentions exagératrices, et d’un ennui accablant…
Luc-Olivier d’Algange :
- L’oubli de l’âme du monde, de la source vive, nous condamne à vivre dans le délétère des citernes croupissantes. La secte immense, - et je rejoins ici ce que vous nous disiez à propos de l’identité foncière du sectaire et du démagogue, - la secte globalisée, « universelle », se paye de mots, élève les mots en abstractions vengeresses pour obstruer le ciel. Jadis Dieu était le Verbe ; désormais les mots sont divinisés, on sacrifie et se sacrifie pour eux, on cède à leur force d’expropriation. C’est avec des mots que l’on nous chasse et que l’on nous tue. Nous étions là, entre la courbe du ciel et celle de la terre, entre l’angélus et les rumeurs du vent, entre le fleurissement de la terre et celui des Idées, dans la haute et profonde légitimité du silence, dans un vaste assentiment aux êtres et aux choses, dans la louange et la gratitude, et voici que nous sommes dans le nulle part, expropriés, et contraints à guerroyer avec des armes qui ne sont point les nôtres : il n’y a plus que des mots pour lutter contre les mots idolâtrés – à la façon dont Paracelse recommande l’usage du venin.
Vous nous disiez aussi tout le mal que vous pensiez de la « reconstruction » programmée des Tuileries, hyperbole de l’adoration moderne pour l’antiquaille, pour la manie rénovatrice, pour ce folklore inepte de salle des ventes qui ont, pour aboutissement logique les « parcs d’attraction » (mieux vaudrait dire de répulsion !). Ces choses dépourvues de sens, coupées, gagneraient peut-être à être ruinées par le temps, qui honore autant qu’il détruit, à disparaître enfin, à redevenir idées, au lieu d’être ravalées, et ravalées au rang de décors pour touristes, au point que l’on en vient presque à comprendre, mais sans vraiment les croire, ces futuristes italiens qui, gorgés de cocaïne, en arpentant les riches tapis de leurs hôtels de luxe, rêvaient de nous débarrasser de ce fatras ! La reconstruction est le pendant de la « déconstruction » chère à la critique universitaire qui ne fut jamais rien d’autre qu’une ruse consistant à traiter les œuvres de telle sorte à n’en rien recevoir ; autrement dit à changer l’or en plomb, dans une alchimie à rebours, l’œuvre en « texte » dont on dépouille administrativement les procédés et les rhétoriques. D’où l’importance d’opposer l’œuvre au travail, l’otium à toute activité utile, c’est-à-dire asservie.
Si l’œuvre est une relation avec tout ce qui est, le texte est une expérience à l’intérieur de ce qui n’est pas, du néant. À cet égard, le mérite d’Henry James est d’avoir fait, en matière de psychologie, le tour de la question, si bien qu’il rend par avance obsolètes les romans « psychologiques » qui lui succèderont et feront ainsi figure de trottinettes après l’invention de la Bentley ! Raison de plus pour se désintéresser de la psychologie. Les hommes sont universellement mus par l’amour, le ressentiment, le désir de reconnaissance : la belle affaire ! Mais seul est intéressant ce qui les différencie, ce qu’ils explorent. L’instrument importe moins que la musique. Il faudra bien un jour cesser de détailler ce qui est semblable pour s’intéresser au dissemblable, où gît le véritable secret de la ressemblance avec nous-mêmes ; autrement dit, avec le « Soi » dont parle Ramana Maharshi. Ce qui différencie les hommes, ce qui les rend aimables n’a rien d’individuel : ce sont les langues, les religions, les civilisations. L’œcuménisme est à la mode mais c’est aux disputes théologiques que l’humanité (mais j’ose à peine employer le mot !) doit d’avoir été moins bête qu’elle ne l’eût été ou qu’elle ne l’est actuellement. L’universalité métaphysique, ésotérique, ne dissout ni ne dissipe les différences exotériques mais leur donne une signification heureuse, non sans circonscrire cette signification à un espace précis, infranchissable, sinon au péril d’outrecuider. C’est en ce sens que l’on peut dire que le contraire de la littérature, qui est l’ésotérique, le chemin intérieur de la littérature, contient la littérature, que le cœur, dans son possible, est plus vaste que la périphérie, que toute intériorité est comme le disait Novalis « extériorité véritable ».
Philippe Barthelet :
- Novalis nous a rappelé que le chemin véritable conduit vers l’intérieur. C’est une évidence à la fois topologique et physiologique ; une autre de ces évidences enfantines (au sens où Novalis définissait les enfants comme « des êtres antiques », où l’antiquité est tout ce qu’il y a d’intemporel nourricier dans le temps) a été proférée quelques années plus tard par Victor Hugo, dans la préface de ses Odes et Ballades : « La poésie est tout ce qu’il y a d’intime dans tout ». Ayant dit cela il avait tout dit, il ne lui restait plus qu’à épiloguer pendant soixante ans. Je hasarderais, pour user d’une opposition facile mais tout de même significative, que la « littérature » est au rebours tout ce qu’il y a d’extime en tout (si l’on me passe ce latinisme en l’occurrence bien utile). La « littérature » caresse cette utopie délirante, tentatrice à beaucoup d’égards, d’une vérité de l’homme objective (pour reprendre un adjectif qui fit fureur au temps de la tyrannie intellectuelle du marxisme) ; autrement dit, elle postule cette idée folle (et certes reposante, follement reposante) que la vérité de l’homme est extérieure à l’homme… Que si « le royaume des cieux est au-dedans de vous », le royaume de la terre est au-dehors de l’homme… c’est-à-dire nulle part, comme la Pologne du Père Ubu. À dire vrai il n’y a pas de psychologie, ou plutôt la psychologie devient un mensonge dès lors qu’elle s’érige en science séparée… Prenez par exemple les romans de Johan Bojer, que l’on a présenté comme le « Zola norvégien » : absurdité de l’étiquette, puisqu’il est précisément tout le contraire de Zola : s’il décrit minutieusement, comme lui, la vie quotidienne des petites gens, il échappe absolument à tout « naturalisme » : il ne farde rien des étroitesses, des petitesses, des noirceurs de ceux qu’il dépeint, mais il les présente de telle façon qu’il leur confère une grandeur cosmique : il ne connaît d’autre psychologie que celle de l’âme du monde, et tous ces pauvres hères qui ne sont chez Zola que des pantins répugnants, jouets des phantasmes et des obsessions de l’écrivain – du « littérateur » - acquièrent chez lui une dignité, une noblesse - c’est-à-dire une réalité non seulement « littéraire », on s’en moque bien, mais une réalité humaine - une réalité tout court. On sent que Bojer ne ment pas, et que Platon n’aurait pas à le mettre à la porte de sa République… Au rebours des paysans de Zola, qui sont des monstres – et les doubles ténébreux de l’écrivain – ses « Gens de la côte » sont naturellement nobles, instinctivement accordés au temps qu’il fait ; ils sont nobles par ce qu’ils sont, tout simplement, et que leur être est indiscutable, comme le soleil, l’arbre, la nuit. Sans remonter en Norvège – mais c’est la France qui découvrit Bojer – on pourrait dire cela aussi de Ramuz. Comme par hasard, les héros de l’un comme de l’autre sont pour la plupart des taciturnes ; or la psychologie moderne parle, et fait parler ; elle prétend que la vérité de l’homme est dans ce qu’il dit – toujours ce mouvement vers l’extérieur…
Luc-Olivier d’Algange :
- Il est parfaitement dans l’ordre des choses que le « naturalisme », en tant que mouvement littéraire, soit le plus éloigné de la nature, le plus « extérieur », comme le réalisme est éloigné de la réalité, comme la création l’est des « créatifs ». Éloigné, extérieur – et l’on pourrait dire hostile, comme l’individualisme de masse est hostile à cet « unique intime en chacun » que cherchaient Novalis et ses amis. Être libre extrêmement et sans illusions, sans idées générales, sur la liberté, telle fut sans doute la belle gageure des premiers romantiques allemands qui donnèrent de la nature une tout autre image que celle qui devait prévaloir avec les naturalistes : image enfantine et antique, mythologique et pythagoricienne, ingénue et savante.
C’est, je crois Jean Renoir qui disait qu’il ne fallait pas filmer la vie mais faire des films vivants ; la vie n’étant jamais en face, mais toujours à l’intérieur.
Pour odieux que soit le culte moderne de la nature, qui aboutit à une conception zoologique de l’espèce humaine, qui se voue à une conception non plus naturante, ni même naturée, mais représentée, telle un ombre parmi les ombres mouvantes au fond de notre caverne technologique ; et pour aimable que soit, par contraste, l’artifice des jardins à la française et de la bonne éducation, il n’en demeure pas moins que l’écrivain qui ne s’illusionne pas sur la réalité de l’extime, si épris qu’il soit du baroque ou du trompe-l’œil (et aussi « wildien » ou « nabokovien » qu’il se veuille), demeure, par la qualité et l’orientation de son attention non moins que par ce qui l’anime, en étroite relation avec la nature, avec les mystères et les fastes légendaires de la nature.
Je repense à ce que vous nous disiez, à propos de Cocteau et de ce fond de chasse sauvage qui frémit dans la France classique, cette proximité avec ce qui brille et ce qui brûle. Là encore la beauté et la plénitude sont données de surcroît, la nature étant offerte à l’art et l’art à la nature, comme dans l’entrelacs des figures scythes ou persanes. De même, le Bernin, ce comble d’artifice, rejoint, par ses excès mêmes, les efflorescences surabondantes de la nature. La métaphore, qui stylise ce que les critiques nomment, souvent péjorativement, l’écriture artiste, est au principe même des phénomènes naturels, où les plantes se déguisent en animaux et inversement, où les tournesols empruntent au soleil vers lequel ils se tournent sa forme rayonnante.
Au naturalisme de Zola s’oppose le naturalisme de Fabre et de Linné qui enchanta Jünger que l’on persiste à nous présenter comme un « esthète ». La nature métaphorise et se métamorphose par nature. Et elle écrit. Novalis parle de l’écriture des pierres, des branches, des feuilles, des cristaux de neige. Sitôt que l’on cesse de se laisser abuser par l’illusion de l’extériorité, écrire devient comme un prolongement du geste silencieux de la création. Nous lisons, nous déchiffrons le nuage et la pierre. En écrivant, nous continuons la lecture du monde à partir de son âme. Nous inventons des dieux qui sont les métaphores d’une réalité qui est en même intérieure et extérieure, nous suivons le bon vouloir du dieu tisserand qui entrecroise le fil de trame et le fil rapporté. De tous les objets qui sortent des mains humaines, les livres sont les plus proches de la nature, avec leurs feuilles et leurs signes, leur mémoire inscrite, feuilletée, leur temporalité devenue concrète. Nous écrivons dans le temps qui passe, et parfois pour passer le temps ; et ce temps demeure, comme dans la nature, en traces visibles et plus ou moins déchiffrables. L’art de l’écrivain entre alors en concordance avec la botanique, la géologie. Les arbres tombent en poussière ou se pétrifient, sont dévorés par les termites ou deviennent des livres. En écrivant nous perpétuons la nature, mais encore faut-il être assez naturellement métaphysiciens, c’est-à-dire orientés (comme la chenille l’est par son devenir-papillon, pour reprendre une métaphore de Rozanov) vers cet autre-monde qui n’est pas séparé de ce monde-ci mais distinct, mais relié par des gradations infinies. Le supra-sensible n’est jamais que la plus haute branche du sensible. Dès lors que l’âme du monde les unit, comme le sel des alchimistes unit le soufre et le mercure, le sensible et l’intelligible cessent d’être ces mondes séparés, hostiles. Le surnaturel est naturellement le cœur de la nature, la métaphysique couronne la physique. Ce qui apparaît d’évidence dans la littérature antique ou médiévale.
La psychologie moderne feint d’oublier tout ce qui nous apparente au monde. Elle feint de croire (ou croit, ce qui est pire) que nous pouvons être un objet d’étude. Moralement, cela ne vaut pas mieux que la vivisection ou les expériences des médecins fous dans les camps de concentration. Quiconque vous aborde en psychologue est un ennemi, et l’on peut être aussi, à soi-même, son pire ennemi. La psychologie, en littérature, c’est une façon de se voir déjà mort, mais sans renaissance immortalisante. Le dard du scorpion se retourne contre lui-même. L’écriture, disait Cocteau est du dessin dénoué et renoué. Ainsi l’écriture peut délier ; elle peut être aussi le collet qui nous étrangle. Si elle nous délie, elle délie notre âme de la croyance absurde de n’être pas un éclat (aussi insaisissable que la lumière qui bouge entre les feuillages) de l’âme du monde.
Philippe Barthelet :
- Vos remarques me rappellent la sinistre définition de Bichat, sur quoi repose toute la médecine moderne : “La vie est l’ensemble des forces qui résistent à la mort”. Aveu terrible : c’est la mort qui définit la vie, qui est première - et dernière ; et la vie n’est que ce qui lui oppose une résistance par nature provisoire. Le provisoirement vivant est du mort par destination, du mort anticipé - et d’ailleurs l’examen médical par excellence n’est-il pas l’autopsie ? Quand Léon Daudet, qui savait de quoi il retournait pour avoir étudié lui-même la médecine, appelait les médecins des “morticoles”, la vérité qu’il énonce en un mot va bien au-delà de la simple satire. La mort (de l’homme) est sans doute le vrai nom de l’objectivité dont la science moderne s’est fait un palladium (et, après elle, les idéologies qui se donnaient pour des sciences, comme le marxisme). Les fameuses questions que pose Kant (“Que puis-je connaître ? Que dois-je faire ? Que m’est-il permis d’espérer ?”), c’est par un coup de force à la fois métaphysique et grammatical qu’il en fait les annonciatrices de sa question fondamentale : “Qu’est-ce que l’homme ?” où tout à coup il passe de la première à la troisième personne du singulier, comme si cette substitution de personne était légitime, comme si elle était même possible... Cette simple petite question qui semble si pédagogique, pour tout dire si ennuyeusement anodine, en vérité ouvre la boîte de Pandore des temps modernes : elle résonne comme un écho inversé, sur le mode interrogatif, ironique (mais d’une ironie archangélique, plus luciférienne que kantienne...) de la réponse, de la seule définition qui tienne et qui a été donnée une fois pour toutes et pour tous les temps par le dernier prophète du Christ, le procurateur Pilate : Ecce Homo, “Voici l’Homme”. L’Homme, la seule fois d’ailleurs où la majuscule est admissible, est devenu depuis le jour de sa Passion l’un des noms du Christ. C’est Dieu Lui-même et Lui seul qui se charge de la définition de l’homme. Chercher l’homme en dehors de Lui, c’est-à-dire en Lui tournant le dos par présupposé de méthode, c’est ouvrir la porte au néant. Le fameux “humanisme” des Lumières aboutit à toutes les atrocités possibles dont les deux derniers siècles ont été saturés : Maurice Clavel avait très bien vu que le prétendu “pouvoir de l’homme” que l’on exalte se révèle très vite et fatalement pouvoir de l’homme sur l’homme... L’homme définissable, l’homme objectif c’est l’homme mort, le cadavre posé sur le marbre devant le docteur Tulp, qui le lacère pour les besoins de sa leçon d’anatomie... Encore une fois, curieuse perspective méthodologique : l’anatomie du vivant s’apprend par la dissection des cadavres... Je songe encore à cet adage de l’ancien droit, qui pour la science moderne doit s’entendre à la lettre : le mort saisit le vif...
L’automne où nous entrons est singulièrement triste et gris ; on a justement l’impression que c’est l’âme du monde qui est souffrante, décolorée, atteinte de mille façons invisibles et que tous, sans le comprendre le plus souvent, nous en souffrons… « Saison mentale », ô Apollinaire, pour le pire, comme si le ciel des météores devenait fou à proportion de la folie intime que l’on veut à toutes forces nous imposer…
Permettez-moi de revenir à cette remarque capitale que vous venez de faire : sur le supra-sensible qui est la plus haute branche du sensible. Il me souvient des diatribes de Zarathoustra contre les prédicateurs d’arrière-mondes, diatribes, au reste, plus antiprotestantes que véritablement antichrétiennes ; et à mon étonnement d’adolescent encore tout imbibé de nietzschéisme, découvrant dans la Somme contre les Gentils l’affirmation de cette tranquille évidence : Præter hunc mundum non est aliud, au-delà de ce monde il n’y en a pas d’autre. Voilà, par la plume du Docteur Angélique, la simple et véritable doctrine de l’Église…
Le grand secret de toute poésie, qui peut enivrer les poètes jusqu’à l’enthousiasme – la possession par un dieu - , lequel ne va pas sans un péril immense, et toute la poésie des temps modernes en est le martyrologe – le grand secret de toute poésie, retrouvé aussi bien par Novalis que par Hölderlin, comme s’il appartenait à l’Allemagne de nous sauver de la « littérature », avant d’ailleurs de nous perdre avec la « philosophie »… - ce grand secret, qui a l’enfantine simplicité de l’évidence, c’est que « l’autre monde » et ce monde-ci ne sont qu’un, reliés par les gradations infinies qu’évoque Edgar Poe dans son Colloque de Monos et Una ; c’est l’échelle de Jacob, ou encore l’arc-en-ciel, « arche d’alliance » ou écharpe d’Iris, la messagère des dieux…
C’est l’intuition cardinale de Baudelaire : les correspondances, clef de la réalité, qui fondent aussi bien la lecture (avec ses différents degrés d’intellection, telle qu’on la pratiquait au moyen-âge) que la science héraldique : chaque chose est au-delà de soi, le signe et la figure de quelque chose d’un autre ordre, et c’est cette annonciation d’un autre ordre – d’un plus hault sens – qui donne à chaque chose l’essentiel de sa réalité ; sans quoi les choses, comme dirait Rostand, « ne seraient que ce qu’elles sont » : ne seraient plus que leur écorce ; leur abstraction, leur prose : ce qui est précisément le cas des choses modernes, lesquelles, comme par hasard, ne peuvent trouver place dans le blason. L’annonciation d’un autre ordre, c’est tout bonnement la définition du symbole, et pour bien comprendre l’enjeu, comme diraient nos contemporains, de cette question, il faut redire cette définition en quelque sorte physiologique de Léon Bloy que « c’est dans l’exacte mesure où un être est symbolique qu’il est vivant ».
Sur la plus haute branche, un rossignol chantait…
Luc-Olivier d’Algange :
- Si nous perdons l’âme du monde, ou, plus exactement, si l’âme du monde est perdue pour nous (« Aurélia était perdue pour moi » écrit Gérard de Nerval), nous perdons en même temps notre âme, et le monde. Un monde sans âme, définition la plus laconique et peut-être la plus juste du monde moderne, est un monde qui n’est pas. Si l’âme du monde est perdue pour nous, nous perdons tout : le sensible et l’intelligible, le royaume de la nature et le royaume plus vaste de Dieu, ce qui nous distingue et ce qui nous unit, l’immobilité et le mouvement.
Évoquant l’Âme du monde, Platon parle d’une « sorte de substance intermédiaire comprenant la nature du Même et celle de l’Autre » et dépasse ainsi ce que nous percevons ordinairement des Éléates et des « héraclitéens ». En perdant l’Âme du monde, nous perdons à la fois l’être et le devenir. Ceux qui veulent, nietzschéens improvisés tels M. Onfray, « renverser le platonisme », non sans prétendre se mesurer avec saint Thomas d’Aquin, ne renversent que leurs propres constructions et semblent avoir oublié de lire Platon : « S’il n’y a qu’immobilité, écrit Platon, il n’y a d’intellect nulle part, en aucun sujet, pour aucun sujet (…) Par contre, si nous acceptons de mettre en tout, la translation et le mouvement, ce sera encore pour supprimer ce même intellect au rang des êtres. » L’âme, ce qui anime, est ce mouvement qui sans cesse renouvelle la parenté du Même et de l’Autre, de l’être et du devenir. La « déconstruction » de l’Âme du monde coïncide avec le triomphe de l’explication mécaniste, elle–même principe de « l’homme-machine », désacralisé et « démystifié », dont tous les actes se trouvent alors explicables par la sociologie, la biochimie ou la génétique. Le sens commun le plus élémentaire, « l’enfantine simplicité de l’évidence », nous instruit déjà de la différence entre l’animé et l’inanimé ; différence qui n’a peut-être jamais été aussi perceptible qu’aujourd’hui ; car si, pour Hugo, « tout a une âme », si, pour Nerval « un pur esprit s’accroît sous l’écorce des pierres », en revanche, entre l’homme et le robot demeure cette distinction décisive, métaphysique, que le monde moderne tend à abolir, et qu’il nous révèle précisément en voulant l’abolir. Ces hybridations cauchemardesques que les Tribulat Bonhomet modernes expérimentent, par les nanotechnologies, entre la cybernétique et la vie confirment aussi cet autre trait de génie de Platon qui affirme, contre Parménide, qu’il y a bien un « être du non-être ». Or, nous y voici : l’homme-machine dans un monde-machine ; ce qui prouve assez que tout ce que l’homme conçoit, il le réalise, fût-ce à l’intérieur de « l’être du non-être ». M. de La Mettrie voyait l’homme comme une machine, prédisposant ainsi la machine à se substituer à l’homme. Il ne restait plus à Mary Shelley, douée d’une belle intuition, qu’à décrire le Prométhée moderne sous les aspects du docteur Frankenstein, qui est le véritable mythe de notre temps, son « idéal », son aspiration fondamentale à fabriquer de la vie avec de la mort, c’est-à-dire à inventer une vie morte, atroce caricature de la renaissance immortalisante.
À tant vouloir se « libérer » de Platon et de la Théologie médiévale, les modernes ne semblent plus disposer des instruments intellectuels qui leur permettraient de comprendre ce qu’il en est du « non-être » où ils s’agitent et s’évertuent, si bien que les uns demeurent « parménidiens » ( mais de caricature, il va sans dire), enfermés qu’ils sont dans leurs « identités » et que d’autres, les « festifs » dont se moque Philippe Muray, se veulent « héraclitéens », dans un individualisme de masse, un relativisme dogmatique (« rien n’est vrai, tout est relatif ») qui tendent au pire grégarisme. Les « réactionnaires » et les « post-modernes » s’opposent dans un théâtre où le divin brille par son absence. Mais qu’en est-il de ce qui brille dans l’absence ?
On en vient à croire que ceux qui nous annoncent la fin du monde sont d’incurables optimistes. La fin du monde, et non seulement la fin d’un monde, est derrière nous. Nous n’existons plus que dans la rémanence de ce qui fut ; et celle-ci commence à s’évaporer. Derrière ces décors, ces silhouettes, ces fantômes scintille le beau néant, l’éblouissement de la fin qui annule tout commencement. Le monde s’est entièrement dédit ; et ce dédire est « défaire », défaite et défection. Nous sommes vaincus, les fils ne tiennent plus à la trame mais virevoltent au hasard. Cette fin du monde, au demeurant, n’est pas un mal. La conséquence du mal échappe au Mal. Ce monde, emprisonné à l’intérieur de « l’être du non-être » n’est qu’un immense « faire-semblant » inconscient, pas même une supercherie ou une usurpation : un théâtre d’ombres. Cette fin du monde, on pourrait presque la dater, si donner une date à l’intérieur d’un temps aboli pouvait avoir un sens. Il y eut bien ce moment où le monde existait encore dans une haute dimension tragique et ce moment où il n’existe plus. Notre cas de figure est des plus étranges, car presque tous nos contemporains sont nés dans ce monde qui n’existait plus, autrement dit dans le néant, qui est, pour citer une de vos expressions, « la parodie du vide, lequel est un autre nom de Dieu ».
Philippe Barthelet :
- L’optimisme que vous nous offrez, le seul recevable qui est ontologique (Deo optimo maximo, et comment l’essence du Bien pourrait-elle être autre chose que le meilleur ?) tient tout dans votre remarque capitale : « la conséquence du mal échappe au Mal ». Autrement dit, le Prince de ce monde, qui comme tout prince appelle un surnom, pourrait être surnommé l’Inconséquent… (Définition là encore purement ontologique, Dieu nous garde de conjecturer sur la psychologie satanique…) Il est fatalement inconséquent, par définition même, et cette impuissance finale l’enrage… D’où tant de proverbes (« le diable porte pierre ») et de contes où le diable se révèle, bien contre son gré, l’ouvrier et l’auxiliaire de Dieu…
Tribulat Bonhomet, disciple rationaliste (et français) du Dr Frankenstein, siège aujourd’hui en tant que « sage » dans les divers « comités d’éthique » qui ont remplacé, sur le mode collectif, nos anciens directeurs de conscience. C’est un lointain neveu du Dr Faust, dont, faut-il le dire, les exaltations et rêveries préscientifiques l’impatientent un peu. Son postulat, qu’il a fait passé pour une évidence, laquelle est aujourd’hui la mieux reçue, aussi bien dans les académies que dans les magazines, est que le vivant n’est que l’étape préparatoire au technologique, qu’il n’existe qu’en fonction des prothèses dont on le perfectionnera pour donner enfin naissance au véritable homme-machine, selon une assomption mécanique de l’humain dont n’aurait osé rêver M. de La Mettrie. L’homme biologique n’est que le brouillon de cette merveille déjà dans les cornues. Il s’agit bien de « fabriquer de la vie avec de la mort », comme vous le dites ; ce qui nous ramène curieusement à la définition de Bichat – la vie comme mort anticipée, la vie étalonnée à la mort. Philippe Muray nous rappellerait peut-être que Bichat et Frankenstein étaient condisciples à la faculté…
Des générations d’apprentis bacheliers ont ânonné comme une évidence – encore une - , comme un requisit de la démarche scientifique, c’est-à-dire comme une condition du Progrès, l’allégation de Max Weber sur la science moderne qui doit « désenchanter le monde ». On n’a pas pris garde que ce parti-pris de désenchantement n’était rien d’autre que la négation – en pensée et en acte – de l’âme du monde ; autrement dit un suicide, ce que les plus lucides parmi les écologistes commencent à entrapercevoir. Le 4 juillet dernier, jour comme on sait de leur fête nationale, les Américains ont percuté une comète avec un de leurs engins. On en a énormément parlé, pour s’en réjouir presque toujours. Voilà un bon indice pour mesurer le degré d’irréalité où nous sommes parvenus : combien d’hommes ont ressenti cette prétendue « prouesse technologique » pour ce qu’elle était : un attentat misérable, non tant contre le cosmos que contre l’intelligence du cosmos, un enfantillage odieux et la preuve la plus atterrante de notre aveuglement et de notre débilité ? Et combien, parmi ceux qui l’auront ressenti, auront eu le courage de le dire – sauf à passer pour d’aimables excentriques ?
Luc-Olivier d’Algange :
- « Enfantillage odieux », - l’expression recouvre parfaitement tout ce que le monde moderne tient pour important et pour sérieux, tout ce qui exalte son lyrisme et son ingéniosité. Parmi ces enfantillages, l’un des plus récents a été de fabriquer un robot sur le modèle du cafard ! L’article de Science et Vie qui relate cette glorieuse incongruité précise que ce cafard-robot possède, je cite, « la faculté d’interagir avec les cafards vivants et même de devenir leur leader ». Nous ne nous offusquerons pas, pour cette fois, de l’anglicisme…
Le génie de Villiers de L’Isle-Adam est d’avoir pressenti, par d’infimes détails, non seulement la logique moderne mais encore son style, sa bouffonnerie sinistre, son mélange de comique accablant et d’horreur latérale. Ce robot-cafard est, en soi, une métaphore admirable de notre temps ; il me fait penser à cette autre invention bonhomesque : le poulet génétiquement modifié pour être sans plumes et nous épargner par conséquent l’effort d’avoir à le plumer. On songe bien sûr au « bipède sans plumes » des philosophes et à l’avenir possible d’un humanisme au service d’une humanité déjà plumée. Ce que René Guénon, en métaphysicien, nomma le Règne de la Quantité, nous pourrons, en poètes, le nommer le Règne du cafard-robot et du poulet sans plumes. Notre avenir est bien tracé dans le néant, à moins de partager l’optimisme des punks qui vociféraient des « no future » sur leurs comptines électrifiées. Tout y conjure : nous serons dirigés par un cafard géant, maître d’une armée de cafards contrôlant et surveillant tout, le propre du cafard étant de cafarder.
Le plus terrible, comme vous le remarquez, n’est pas la chose en soi mais l’inconsciente inconséquence avec laquelle elle est accueillie. Tout se passe comme si de rien n’était, par inadvertance comme dans un mauvais rêve. L’ouvrier de l’homme-machine est le trafiquant d’organes, on ne fabrique de la vie avec de la mort que parce que l’on sait fabriquer de la mort avec de la vie de façon industrielle. La modernité activiste débute avec les tanneries de peaux de Vendéens sous la Révolution française et ne laissa point, de décennies en décennies, d’être plus abominablement inventive. Et il reste des Modernes pour tenter de nous effrayer avec le Moyen-Âge… Vous avez remarqué l’insistance des ordinateurs à nous souhaiter la bienvenue. Il y a quelque chose d’effrayant dans la politesse des machines, surtout en des temps où les humains rivalisent entre eux en goujaterie. Bienvenue donc, dans ce monde qui « bouge », qui évolue, qui se modifie sans entraves…
Donc le contraire de la littérature, comme un appel à un « contre-monde » à ce monde. Un contre-monde non comme une batterie d’artillerie face à une autre mais comme « l’ombre bleue des amandiers » dont parlait André Suarès, cette ombre bleue qui nous éveille du mauvais rêve, en tombant, par les interstices de la terre, dans la crypte du Temple détruit.
Le « contre » cesserait ainsi de sembler en appeler à je ne sais quelle vaine dialectique mais indiquerait un « retrait », un recours au « Logos intérieur », une architecture souterraine, alors qu’en surface, il n’y a plus rien. Comment dédire ce qui déjà s’est dédit ? Comment défaire la défaite ? L’ontologie de ce contraire de la littérature expérimenterait ainsi par son « retrait » ce que Heidegger nommait « l’ expulsion-répulsante du néant ». Elle redonnerait à ce qui n’est pas l’éclat aveuglant de ce qui n’est pas et à ce qui est la ténèbre douce où pointe l’étincelle incréée, le « iota » de lumière qui demeure en nous alors que nous n’existons plus.
Philippe Barthelet :
- Ce cafard-robot mérite d’être notre totem. Je songeais d’ailleurs, en feuilletant les « grands écrivains » qu’on propose maintenant à notre admiration, que nous étions passés de la « littérature pour mulots » - celle que Dominique de Roux trouvait chez Maurice Genevoix à la littérature pour cafards ; ne manquait, pour être très exact, que la touche technocybernétique que vous ajoutez. Cafard-robot, donc, prouesse et enseigne des fameuses « nanotechnologies », dont on n’attend rien de moins que le salut solitaire du nouvel homme ; « nanotechnologies » qu’il faut sans doute entendre, avec l’aphérèse de l’o initial, comme un perfectionnement de l’onanisme. Sous le totem de l’insecte, le cafard est à la fois celui qui rapporte, qui dénonce - qui cafarde ; celui qui prend les apparences de la religion pour mieux duper ses victimes et enfin, le climat psychologique d’affaissement, de lâcheté, de veulerie qui est la forme ordinaire de la « déprime » dont nos contemporains ne sortent pas - et peut-être dont ils ne veulent pas sortir. Selon les grimoires, le mot vient de l’arabe « kafir », traître à la vraie foi, lui-même emprunté à l’hébreu « cafar », renier. Les cafards, ou cafres, sont les infidèles. Comme les mots disent tout, si l’on prend la peine de les écouter, on notera que dans l’ancienne langue « cafarder » se disait pour parler beaucoup, et à tort et à travers. Assez bonne définition de la littérature parvenue à son stade terminal.
Luc-Olivier d’Algange :
- L’enfant qui pleure dans les ruines est l’âme qui nous sauve : elle qui nous appelle à la sauver est notre salut, notre âme. Cette âme est séparée de nous par des éons, par des siècles de siècles, par la nuit des temps, par des déluges infinis… Et cependant cet « hors d’atteinte » scintille dans la proximité extrême, sur le duvet d’une feuille ou dans l’onde lumineuse d’une pupille : cette ténèbre voyante ! La crypte du temple détruit est partout où la prière se recueille pour se déployer, - et à chaque instant. Telle est la sapience, qui affleure, la sagesse à fleur de peau, non l’abstraction mais la sainteté qui possède le don d’ubiquité, à la fois absente et présente, cachée et révélée, qui, selon la formule d’Héraclite, « nous fait signe ».
Je repense souvent à ce qu’écrivait Léon Bloy, lui aussi en révolte contre les « binaires » : « Le temps n’existant pas pour Dieu, l’inexplicable victoire de la Marne a pu être décidée par la prière très-humble d’une petite fille qui ne naîtra pas avant deux siècles ». On peut ainsi espérer qu’une prière viendra pour nous aussi, dans deux siècles ou dans deux millénaires ; on peut croire que cette prière déjà nous sauve, que sans elle nous serions réduits au silence. Maistre nous apprend que l’injustice n’est jamais que provisoire et ne se perpétue que par notre ignorance. Il n’est point question ici de bons sentiments, mais seulement de bonne foi et de réalité. L’injustice est impossible : le repons surgit là où notre intelligence seule ne peut l’attendre. En témoigne l’œuvre et le destin impondérable de Sœur Yvonne-Aimée de Malestroit, si haute dans la douceur de son sacrifice que l’espace et le temps furent pour elle, et par elle, et pour de nobles causes, frappés d’inconsistance. C’est ne rien comprendre au sens des mots que de ne pas voir que la nature n’est qu’une dimension de la surnature, de même que l’espace et le temps ne sont que des éléments de la grammaire de Dieu, que Dieu peut joindre et disjoindre à sa guise.
Il est à craindre que ces dernières décennies ne furent pas sans contribuer grandement à nous faire oublier que le christianisme n’est pas seulement une morale vaguement « conviviale » ou « humaniste » mais aussi, mais surtout, une métaphysique et une poétique. Les gnosimaques modernes ne haïssent tant ce qu’ils nomment la « gnose » (où ils confondent tout et son contraire, Marcion, le New-Age, René Guénon et Henry Montaigu) que parce qu’ils ont abandonné la sapience chrétienne au milieu des ruines, et leur haine n’est autre que le masque de leur mauvaise conscience à l’égard de cette sapience, de cette âme enfantine perdue et délaissée.
Si, pour Umberto Eco, la « gnose » est, je cite, « le fascisme éternel », si, pour les nostalgiques du maréchal Pétain, elle est une variation du « complot judéo-maçonnique », pourquoi ne pas tenter de la comprendre, à rebours de ces « binaires », tout simplement comme la Parole Perdue ? Non certes la parole de Marcion, qui tente vainement d’arracher le Christ à la royauté davidique, ou celle des puritains de toutes obédiences, qui méprisent l’héritage grec, mais bien la parole perdue (car elle est perdue hélas !) de saint Augustin, de Jean Scot Érigène, de saint Bernard de Clairvaux, d’Hugues de Saint-Victor, de Jean de Salisbury, d’Angèle de Foligno ou de Maître Eckhart…La véritable gnose n’est pas outrecuidance, mais humilité. Ce n’est pas le savoir péremptoire du chrétien qui parle « en tant que » chrétien, du chrétien soucieux de sa « spécificité » chrétienne, mais l’humble sapience du Bien et du Vrai qui, je cite Scot Érigène, « surpasse la perception de tout esprit et de toute raison ».
Les moralisateurs modernes, eux, rivalisent à parler de « l’Autre ». C’est à qui sera le plus fort dans « le respect de l’Autre ». Concours d’« altérophiles » ! Mais qu’en est-il de leur propre cœur ? Qu’est-ce que le respect de l’Autre sans la connaissance qui nous rend identiques à lui, sans l’amour qui de cet Autre fait un Même ? Ce « respect » est une grimaçante caricature d’amour à quoi il faut opposer non une contre-caricature, comme le font certains intégristes, perdus en des combats subalternes, mais le contraire d’une caricature. Ce contraire-là donne tout son poids, toute sa vérité, à la voix seule, et même esseulée. Les Évangiles sont le récit d’une révolte contre l’esprit grégaire. Quel est le sens de la Passion du Christ si une seule voix ne peut contredire toutes les voix et tous les silences ?
Philippe Barthelet :
- Le point commun de la droite et de la gauche intellectuelle, c’est cette complicité objective et à beaucoup d’égards, spéculative, au sens étymologique : c’est un double miroir, et l’une renvoie à l’autre sans fin, puisque chacune ne se justifie que par son opposition à son opposée. Cette complicité de fait est beaucoup plus importante que leurs très contingentes divergences d’opinion. Elles s’entendent sur le fond pour exclure, et pis : décréter d’inexistence tout ce qui ne se passe pas entre elles : le théâtre de leur mascarade est le théâtre du monde, c’est même le monde tout court, rien n’existe en dehors du champ clos de leur parade d’affrontement. Il suffit de voir avec quelle unanimité instinctive la droite et la gauche se retrouvent pour condamner, par exemple, « la gnose » : il me souvient à ce propos d’un livre d’entretiens avec divers auteurs catholiques, venant de tous les points de l’éventail, de la gauche la plus conciliaire à la droite la plus intégriste. Tout en apparence les opposait, sauf un point, sur lequel ils se retrouvaient tacitement comme un seul homme : la dénonciation de l’entreprise « gnostique » de René Guénon. Guénon est à cet égard une pierre de touche merveilleuse qui, en abolissant les fausses querelles et les débats en trompe-l’œil, nous fait gagner beaucoup de temps…
Si je puis ajouter mon expérience toute chaude : un journal catholique m’a censuré au motif que je voulais parler des Saints de l’Islam d’Émile Dermenghem : j’aurais dû savoir qu’il n’y a pas de saints en dehors de l’Église – et que l’Islam est la cité du diable… On pense avec soulagement au vers de Péguy : « Moi qui ne suis pas un saint, dit Dieu »…
Quant au « respect de l’Autre », qui pour nos grandes consciences est le dernier mot de la morale sociale, il n’éveille en moi qu’un souvenir, plutôt fâcheux : l’Autre, pour les auteurs ascétiques de jadis, c’était le nom de l’Adversaire, celui qu’on ne voulait pas nommer. Nos grandes consciences ne croient donc pas si bien dire. Le langage est toujours étymologique : il dit toujours la vérité, même à notre insu – surtout, peut-être, à notre insu. Nos moindres paroles sont des aveux ; des paroles manquées, l’équivalent des « actes manqués », c’est-à-dire comme on sait parfaitement réussis, du Dr Freud…
Luc-Olivier d’Algange :
- Le comique (de répétition) est à l’œuvre dans les débats entre la Droite et la Gauche. On songe aux « petiboutistes » et aux « groboutistes » des voyages de Gulliver, qui disputaient de la façon d’attaquer l’œuf à la coque. Faut-il diminuer le chômage pour augmenter la consommation ou augmenter la consommation pour diminuer le chômage ? Le dilemme est peu cornélien et possède la tristesse qui caractérise le fond du comique.
Il faut croire que la « folie » d’Artaud se confond avec la plus brûlante lucidité lorsqu’il nous parle d’envoûtements. Comment expliquer sinon que cette merveilleuse disposition de la rencontre du monde avec l’entendement humain, avec ses preuves innombrables et étincelantes d’amour humain et divin, soit réduite à ces tristes mascarades ? Qu’en est-il de ce monde de forêts, de sources, de cathédrales, ce monde où la beauté s’enchevêtre à la beauté sur la terre et dans le ciel ? Notre monde, divisé en une Droite et une Gauche, qui n’ont plus rien à voir avec les colonnes de Rigueur et de Clémence de l’arbre séphirotique, apparaît de plus en plus comme un traquenard. Et la Droite et la Gauche sont également adroites (en usant de leurs extrêmes réciproques comme repoussoirs) à s’associer en une tenaille propre à broyer toute pensée. Toute pensée débute là où les opinions se déprennent. Mais elles s’accrochent, comme des pièges à loups.
Cioran, dans cette préface fameuse où il passe à côté de Joseph de Maistre, veut nous donner un « plaidoyer pour l’hérésie ». Mais c’est faute d’avoir compris la nuance maistrienne dont procède notre entretien. Or, j’y reviens, cette nuance, jugée spécieuse par certains, est avant tout logique. « Non une révolution contraire, mais le contraire d’une révolution ». Si donc, dans cette proposition on substitue le mot « négation », ou le mot « caricature » au mot « révolution », la logique de la phrase de Maistre éclaire la notion même d’hérésie. À la négation s’oppose non une négation contraire mais le contraire d’une négation, autrement dit une affirmation. De même nous faut-il opposer à la caricature du religieux non une caricature contraire (comme le fait par exemple Michel Onfray) mais le contraire d’une caricature. L’hérésie est moins une « déviance » qu’une caricature.
Les « gnosimaques », littéralement les « ennemis des connaissances », sont hérétiques en ce qu’ils caricaturent, dans un ordre inférieur, la nature inconnaissable de la Vérité. Ils ne consentent pas à la docte ignorance ; ils déclarent d’emblée ne pas vouloir savoir. On pourrait ainsi dire, non sans pertinence étymologique, que les gnosimaques sont des agnostiques péremptoires. L’hérésie gnosimaque, « l’exotérisme dominateur », pour reprendre la formule de Jean Tourniac, suppose un asservissement de la métaphysique, une instrumentalisation de la Théologie, une subjugation de l’autorité par le pouvoir qui veut interdire l’accès à la perspective intérieure, ésotérique, « bâtinienne ».
Le combat n’est pas d’aujourd’hui. Les hérétiques dominants imposent leur hérésie en se prévalant du nombre, de la quantité, de la force brute. De même, les spiritualistes « new-age » veulent faire servir leur « spiritualité » au mieux-être de la société ou de l’individu, comme si l’Esprit devait être à notre service, et non le contraire ! Lorsque la métaphysique n’est plus que la valeur ajoutée, la plus-value de l’économie générale du monde, elle n’est plus rien. Les Modernes sont perpétuellement à la recherche de recettes pour mieux « fonctionner », comme ils disent. Mais c’est la navigation qui est nécessaire, et non la vie, comme semble répondre le proverbe latin. Nous ne naviguons pas pour mieux vivre, mais nous vivons pour naviguer. La sainteté est universelle ou elle n’est pas. Ne la concevoir que reliée à une appartenance spécifiante, c’est précisément nier sa catholicité, au sens premier d’universalité. Les Saints de l’Islam, qui furent grandement persécutés par leurs gnosimaniaques, témoignèrent, en toute connaissance de cause, de la sainteté universelle qui sait distinguer l’eau de l’aiguière, pour reprendre la métaphore de Rumî. Ne confondons pas la transparence de l’eau avec la couleur du flacon ! On se souviendra aussi d’Héraclite parlant du « feu mêlé d’aromates ». C’est toujours le même feu, qui seul importe !
Philippe Barthelet :
- Qu’est-ce qu’un auteur ? Je songe à ce que disait un de nos amis perdus : un auteur est celui qui fait des volumes. On me passera ce jeu de mots fondé non seulement en raison, mais, j’oserais le dire, en grâce (après tout, ou plutôt avant tout, Dieu Lui-même nous a montré l’exemple de ces calembours qui ne sont en réalité que le déguisement de vérités profondes - que l’on songe au suprême : « Tu es Pierre… »). L’auteur est voué par nature aux trois dimensions créées, et surtout à la plus mystérieuse, telle que saint Paul la spécifie : la profondeur. C’est précisément la profondeur qui distingue le volume du plan. Dans sa Vie de Proudhon, Daniel Halévy rapporte une conversation qu’il avait eue à la fin du XIXe siècle avec un ébéniste du faubourg Saint-Antoine. Il lui demandait pourquoi eux, les ébénistes, étaient anarchistes quand les tailleurs du faubourg Saint-Marcel étaient communistes. L’ébéniste lui a répondu : « À cause du volume ; les tailleurs travaillent dans le plan, qui n’a que deux dimensions, alors que nous autres travaillons dans les trois dimensions, ce qui change tout ». Ce qui change tout, en effet.
On notera en passant que le plan, surface plane, appelle le plan, programme économique ou politique : c’est la même logique géométrique, les planificateurs sont des tailleurs… On retrouve ici « l’exotérisme dominateur » dont vous rappeliez les ravages en tous domaines. Les tailleurs ont pour patron Procuste… L’exotérisme est en définitive une illusion d’optique.
… Et quand on y songe, la « littérature » aussi… Car enfin, une grande œuvre est un accès immédiat à…, je ne sais comment dire, à une certaine dimension originelle qui s’impose comme une évidence (c’est d’ailleurs le seul sens précis de « génie », dont la littérature abuse tant : le génie est le sens de l’origine, l’évidence de son immédiateté : la caractéristique du génie est d’annuler a priori les scoliastes. À quelqu’un qui lui demandait un jour je ne sais quelle annotation qui « renouvellerait » l’œuvre de Simone Weil, Gustave Thibon avait répondu : « Depuis quand faut-il rafraîchir les sources ? »). Donc une grande œuvre (Sophocle, Dante, Shakespeare…) est une porte. On ne voit pas pourquoi il faudrait afficher dessus : « Ceci est une porte »… Comme disait Péguy qui à un examen avait dû expliquer Molière, et qui était resté sec, « c’est l’explication qu’il faudrait expliquer »… La porte, donc : me hante je ne sais pourquoi ce vers de Simone Weil, puisque nous parlions d’elle : « Ouvrez-nous donc la porte et nous verrons les vergers ». Toute grande œuvre est une porte, je ne sais pas, Don Quichotte, Moby Dick, elle nous ouvre les vergers. Arrivent un jour les spécialistes des portes : ils ne s’intéressent pas aux vergers (au début, par politesse ; puis très vite ils mettent en doute leur accessibilité, puis leur existence) ; en revanche ils n’en finissent pas de mesurer les portes sous toutes les coutures, de les comparer entre elles, etc. Ils pensent ou feignent de penser (pensent-ils encore ?) que les portes servent à cela… et ils appellent « littérature » la connaissance précise, documentée, de toutes les portes qu’ils recensent. Vous me pardonnerez cet apologue un peu grossier, mais il n’est tout de même pas très loin de la définition quasi canonique que donne de la littérature l’excellent Marmontel : « la littérature est la connaissance des belles lettres ; (…), lorsque, aidé de ses lumières, (l’homme qui cultive les lettres) a acquis la connaissance des grands modèles en poésie, en éloquence, en histoire, en philosophie morale et politique, soit des siècles passés, soit des temps plus modernes, il est profond littérateur ». Sans doute Marmontel prend-il soin de distinguer le littérateur de l’érudit : « Il ne sait pas ce que les scoliastes ont dit d’Homère, mais il sait ce qu’a dit Homère ». Sur le fond et à plus de deux siècles de distance (cette définition originelle date des Éléments de littérature de 1787, où Marmontel reprend l’essentiel de ses articles pour l’Encyclopédie), sur le fond, disais-je, il n’est pas sûr qu’il y ait aujourd’hui grand-chose à distinguer : il ne s’agit pas de préférer la connaissance des grandes œuvres à celle de leurs scoliastes, il s’agit de constater que l’on ramène tout à la même aune esthétique (dans le meilleur des cas), avec plus ou moins de science. Une grande œuvre est un véhicule, au sens à la fois religieux et… mécanique ; un véhicule est ce qui permet un transport, c’est sa raison d’être ; pour la « littérature », le véhicule est un objet, dont la fonction est simplement d’être là – d’être un objet d’étude… Imaginez une automobile ou un carrosse sans roue, un bateau sans rame et sans voile ou mieux, un oiseau empaillé…
La littérature, j’en reviens à ma première image, ou l’étude des portes qui ne s’ouvrent pas : puisque s’ouvrir est la dernière des choses que l’on demande à une porte, on peut même se suffire de fausses portes, de portes en trompe-l’œil – et l’on pourra même soutenir qu’elles ont plus de qualités – de qualités littéraires – que les portes véritables, qui n’ont d’autre raison d’être que de se faire oublier au bénéfice de ce dont elles gardent l’accès. Le souvenir des vergers – et que les portes ne sont que des portes, que diable ! (si je puis dire…) - et ici, le mot de souvenir redevient le parfait synonyme le réminiscence – le souvenir des vergers, donc, quand il vient poindre et ardre les cœurs vivants, et bien cela donne le meilleur de la « littérature » qui précisément, n’a rien de la littérature au sens marmontélien dégradé : cela donne Rozanov, ses « Feuilles tombées » contre toutes les feuilles mortes « littéraires », ou Dominique de Roux, ou qui vous voulez de lisible qui soit pour son lecteur un accès, un passage – et non une porte close, ou pis, une porte peinte sur un mur. La « littérature » ne mérite une heure de peine – et il en a toujours été ainsi – qu’à cause de ce qu’elle contenait de véridique ; qu’à cause, si vous voulez, de ce « contraire de la littérature » dont elle est l’écorce, ou l’excipient… C’est exactement ce que veut dire Villiers de l’Isle-Adam, quand il s’écrie : « Je me fous de la littérature, je ne crois qu’à la vie éternelle ». Eh bien précisément, la littérature, si elle n’est pas un moyen de vie éternelle - ce qu’elle n’est presque plus depuis qu’elle a pris conscience d’elle-même comme connaissance médiate, sous ce nom dangereux – devient, et je pèse mes mots, un moyen de perdition. Il ne s’agit pas, bien entendu, de recomposer les listes de l’abbé Bethléem le si mal nommé : là encore, contresens évident : ce n’est pas par son contenu que la « littérature » est pernicieuse, mais par cette perspective spirituelle qu’elle nous dérobe ; elle est « intrinsèquement perverse », et dans cet ordre, Chateaubriand est peut-être bien pire que Sade…
C’est quand la littérature retrouve la vie éternelle, ou plutôt le service de la vie éternelle, quand elle n’usurpe plus l’attention, c’est alors qu’elle mérite qu’on s’y attarde. Mais alors les critères qui seront les nôtres ne seront pas forcément ceux que manipulent les spécialistes des portes : c’est au nom de ce « contraire de la littérature » qu’Henry Montaigu soutenait que « Zévaco est plus important que Proust »…
Ce qui brouille évidemment un peu les pistes et les habitudes des auteurs de manuels… À mesure que les choses devenaient plus littéraires, c’est-à-dire plus desséchées, plus extérieures – les klippoth ou écorces mortes de la Kabbale, qui nous étouffent – cette voie du contraire de la littérature s’offrait plus escarpée, plus âpre, plus polémique (au sens littéral de la lutte pour la vie). Et les spécialistes des portes de stigmatiser benoîtement ces affreux « polémistes », qui se disqualifiaient eux-mêmes en haussant le ton : là encore, la définition du genre (où l’on enferme celui qu’on a ainsi défini) permet de ne pas se prononcer sur le fond : démarche éminemment littéraire. Encore un mot, et j’en aurai fini, je suis terrifié par cette inondation de paroles dont je vous prie de m’excuser : un mot de Drieu La Rochelle. Il dit un jour que sa génération était la dernière génération littéraire (et quelle ! songeons à tous les écrivains français nés entre 1885 et le début du siècle, entre Mauriac et Malraux) : « Après nous, il n’y aura plus le choix qu’entre la métaphysique et le bavardage ». Nous y sommes…
Luc-Olivier d’Algange :
- La métaphysique et les jeux de mots sont des instruments de connaissance. Toute métaphysique tient ses pouvoirs et ses vertus éclairantes des mots et des choses qu’elle fait parler. Ce que vous dites de la porte en trompe-l’œil, qui pourrait servir de définition à la littérature bien-pensante, « citoyenne » (plus fallacieuse, sinon plus opaque, que la porte simplement close du « travail du texte », de ce formalisme pur qui fut à la mode vers le milieu du siècle passé) nous donne à comprendre la nature de notre « post-modernité » qui n’est sans doute rien d’autre qu’un peinturlurage du nihilisme. Certains eurent ainsi l’idée de repeindre, en banlieue, les immeubles couleur de sorbet, sans pour autant en rendre l’architecture plus rafraîchissante. Nous sommes au comble de l’opacité lorsque les apparences précisément ne sont plus des apparences, lorsqu’elles ne laissent plus rien apparaître ni transparaître. Sans doute l’ésotérisme n’est-il rien d’autre que la restitution de l’apparence à son essence, à sa liberté d’apparaître, ce mouvement d’apparition (« tout fut jadis apparition d’esprits », dit Novalis), que la véritable théologie honore par l’herméneutique et dont le sens est tout entier dans le mot révélation.
Ce qui me fait penser à cette trouvaille de Marcel Duchamp qui dissimule peut-être une intuition : la porte angulaire qui s’ouvre lorsqu’elle se ferme, et inversement. Cette intuition serait alors alchimique, en référence au traité d’Eyrénée Philalèthe, L’Entrée ouverte au Palais fermé du Roi. Il n’est pas exclu, au demeurant, que Duchamp s’en soit inspiré. Celui qui vise le contraire de la littérature serait ainsi celui qui franchit le pas, mais il peut aussi, et c’est la principale et peut-être la seule vertu de la polémique, claquer la porte derrière lui. Alors, il disparaît. Il me semble que les auteurs que nous aimons écrivent en quelque sorte pour disparaître dans ces paysages qui apparaissent quand ils écrivent, dans ces vergers soleilleux, ou, s’ils inclinent au taoïsme, dans ces « montagnes vides »…
La porte qui ne donne sur rien sinon sur elle-même est à l’image de notre temps de fausses promesses : la liberté, par exemple, n’est plus qu’un argument publicitaire pour la servilité rigoureusement planifiée. Les scoliastes des portes cultivent une ingéniosité frivole à quoi il faut opposer, selon l’étymologie que vous rappelez du mot génie, l’ingénuité profonde des vergers.
L’exotérisme dominateur, le littéralisme morose, au demeurant, ne sont nullement « fanatiques » ou « médiévaux » comme feignent de le croire nos journalistes : ils sont frivoles, principalement occupés de modes vestimentaires, de foulards, et d’activités sexuelles. « Morale de midinette » disait Montherlant, les midinettes réduisant pareillement leurs curiosités. Et le littérateur est au diapason lorsqu’il devient sa propre commère ou celle des autres, non sans prétendre conférer à ses potins narcissiques ou fureteurs une « portée » psychologique ou sociologique. Mais à quoi se réduit cette portée ? À la désillusion érigée en fin mot de tout. La flèche tombe à ses pieds et voici le littérateur de s’enorgueillir de sa perspicacité : tout se peut réduire à une sacro-sainte banalité, le supérieur toujours s’explique par l’inférieur, le hasard et la nécessité régentent nos destinées et la Providence est un leurre. Ce qui manque à ces Messieurs, ce n’est plus la dialectique, c’est l’archée, autrement dit le sens de la profondeur qui naît de la vitesse de la flèche.
Il nous reste à nous désillusionner des spécialistes de la désillusion, à démystifier les démystificateurs qui sont les grands marabouts de notre temps. Que cache leur jubilation dépréciatrice, ce cri de victoire : « Ce n’est que cela ! » Quelle ruse du pouvoir s’exerce dans ce ricanement qui veut être le dernier mot ? Que nous veulent ces ingénieux de la dérision ? D’où procède, et vers quelles fins, cette méthode procustéenne ? Rien ne semble autant réjouir le Moderne que de savoir que nous ne serons bientôt qu’une carcasse vermineuse selon le hasard et la nécessité. Toute générosité est donc bien inutile et vaines la grandeur d’âme, la beauté sise dans l’instant. Le moindre signe de ferveur est considéré par nos « sceptiques » comme un ridicule ou un danger, mais c’est la vie même, pour ces censeurs, qui est ridicule et dangereuse. Si la littérature contraire n’est rien d’autre que le protocole de la désillusion, il revient au contraire de la littérature, qui n’est autre que la littérature hauturière, de retrouver les ingénuités magnifiques de la poésie et de la métaphysique, en précisant que la métaphysique inclut la physique, de même que l’âme inclut le corps. Il nous faudra donc pousser le pessimisme jusqu’au bout, traverser, comme le préconisait Nietzsche, tous les champs du nihilisme pour retrouver ce qui jamais ne cessa d’être là, le Royaume.
Or le Royaume, à la différence de la nation, invention littéraire qui ne concerne que les hommes, s’ouvre sur les volumes de la terre, du ciel, et de Dieu. Ce qui insatisfait dans la nation, qu’il faut pourtant parfois défendre bec et ongles, c’est bien cette absence de volume, cette subjectivité abstraite que l’on nomme « identité » mais où le « culte du nous », de la nation, n’est jamais que la transposition du « culte du moi ». Celui qui appartient au Royaume n’a pas besoin d’identité : il appartient au Royaume, la question ne se pose plus. Et le Royaume lui-même n’a pas besoin d’identité, étant l’empreinte d’un sceau invisible, d’un plus haut Royaume dont l’autorité nous désillusionne du hasard et de la nécessité.
Philippe Barthelet :
- Oui, il faut en finir avec le nationalisme, où s’est fourvoyée la pensée royaliste au XXe siècle. Nous a-t-on assez répété que « nation » voulait dire naissance ! Eh bien précisément ce n’est pas naître qui nous intéresse, mais renaître ; non pas le corps de chair passible et mortel mais le corps glorieux, ne soyons pas si modestes… Que la pensée royaliste s’achève dans la cuisine de M. Renan m’a toujours révulsé… « Qu’est-qu’une nation ? » Je vous répondrai comme aurait peut-être répondu un homme du XIIe siècle : je n’en sais rien – et moi qui suis du XXIe j’ajouterai que je n’en veux plus rien savoir. Bien sûr je n’oublie pas, comme vous le rappelez, que la nation est une réalité première, immédiate qu’il faut parfois défendre bec et ongles, comme il l’a fallu au début du dernier siècle, quand Maurras et quelques autres ont fondé « l’Action française ». Mais au fait s’agit-il tellement de « nation », en l’occurrence ? Un autre supposé « nationaliste » (voire « maurrassien », selon la vulgate médiatique), le général de Gaulle, n’emploie presque jamais ce mot : ce fut une surprise pour quelques politologues qui avaient passé ses discours à la moulinette informatique. Le mot « nation » n’apparaît presque jamais ; de Gaulle parle de « France », naturellement, et de « patrie ». Rappelez-vous l’appel du 18 juin : « Notre patrie est en péril de mort : luttons tous pour la sauver ! » Au lieu que la « nation » est une invention révolutionnaire, la réduction biologique et pour tout dire la perte du Royaume. Allez donc voir dans une vitrine du métropolitain, sur le quai de la station Odéon et à côté du buste de Danton l’un de ses signataires, le décret n° 222 (pourquoi pas 666 ?) en date du 21 septembre 1792, « an quatrième de la liberté » : « La convention nationale décrète à l’unanimité que la royauté est abolie en France ». Le décret a pour en-tête un blason aux trois fleurs de lys entre lesquelles court en capitales le nom du nouveau souverain, « LA NATION FRANçAISE » et en dessous le millésime, « 1789 ». Pierre Boutang, qui a fait de ce nom le titre de son journal, n’a pas dû prendre souvent le métro à Odéon…
Vous me permettrez ici de vous citer en rappelant l’opposition capitale que vous faite (capitale, j’insiste, et s’il y a un jeu de mots, eh bien c’est qu’il a peut-être un sens) entre les deux titulatures à quoi les historiens et les politologues prennent d’ordinaire si peu garde : entre “roi de France” et “roi des Français”. C’est Louis XVI le premier, rappelons-le, qui a accepté de n’être plus que le “roi des Français”, c’est-à-dire le roi de ses contemporains, des hommes actuels vivant au même moment que lui, à l’exclusion des morts et des hommes à naître, à l’exclusion des bêtes, des fées, des anges et des démons, à l’exclusion des arbres, des pierres, des rivières, de la terre et du ciel, en un mot de tout ce qui fait que la France excède infiniment sa réduction nationale… La “nation” est ici la réduction du “royaume” aux deux dimensions du plan… Louis XVI avait parjuré, je sais qu’il n’est pas bien vu de critiquer le roi-martyr, mais enfin, être “roi des Français”, ce n’est pas ce qu’il avait promis à son sacre… Il fallait bien qu’il meure pour expier, rétablir un équilibre mystérieux qu’il avait perturbé – et le vrai roi-martyr est le petit Louis XVII, véritable dernier roi de France, mort Dieu sait quand…La disparition de la royauté en France est le secret de Dieu – et j’entends “disparition” comme mouvement inverse à l’apparition, au sens où l’emploie Novalis.
Après, il y eut les rois restaurés, “de France” (et même “… et de Navarre”) pour rire, car enfin, la royauté ne se restaure pas plus que les têtes ne se recollent (on prétend que les saints de la cathédrale de Reims, décapités par les révolutionnaires et que l’on avait replâtrés en hâte pour le sacre de Charles X, ont reperdu leur tête au moment de la canonnade…) Enfin Louis-Philippe a cru pouvoir assumer la révolution en reprenant la titulature de 1791 : “roi des Français”, où le baiser de La Fayette remplaçait l’onction de Reims. Sans doute son petit-fils, au moment de devenir, à la mort du comte de Chambord, le chef de la maison de France, a-t-il voulu prendre en charge tout l’héritage capétien – c’est pourquoi il a tenu à s’appeler Philippe VII et non Louis-Philippe II. Il n’en reste pas moins que la cause royale a été dévoyée, au XXe siècle, par le nationalisme… C’est si vrai que Maurras a fini par se brouiller avec son prince et lui préférer un quelconque Franco ou Pétain – un régent qui préparerait les voies à la restauration, mais qui les préparerait à n’en plus finir (on réédite Mac-Mahon). La moindre ganache étoilée fait l’affaire mieux qu’un prince : on croit dire “vive le Roi !” quand on a dit “à bas la république !”. Les monarchistes (si peu royalistes, au fond) de 1870 à 1950 auront tout perdu à cause de leur nature profondément timorée – à cause de leur nationalisme. Quand Pierre Boutang (pourtant l’un des plus fols – l’un des moins à l’abri de la sagesse calculatrice de M. Renan qui compte ses hommes, ses rois (“les quarante rois qui ont fait la France” !) ses sous et ses abattis – quand Pierre Boutang, donc, appelle son journal, par quoi il veut refaire l’Action française, la Nation française, il dit tout : il manifeste aussi que tout est dit, que le cycle du nationalisme français (et de la confusion nationalisme-royalisme) se referme. Il a cru que le général de Gaulle serait un Monk possible – encore un, et cette fois-ci le bon ; et puisqu’il y avait un prince, qui s’apprêtait nous disait-on à “remonter à cheval”… On sait comment tout cela a fini, de catastrophe en catastrophe jusqu’à la faillite personnelle… Aujourd’hui, Dieu merci sans doute, la confusion politique n’est plus permise : la cause royale n’a même plus d’apparence…
Je ne veux pas m’acharner contre Maurras, mais enfin est-ce qu’il est absolument nécessaire que les royalistes partagent le goût des nationalistes pour les uniformes ? Ce n’est certes pas Joseph de Maistre qui aurait soutenu Mac-Mahon, ou Boulanger, ou Pétain, lui qui disait que le pire des gouvernements est le gouvernement militaire… Le fond du problème est que ces monarchistes des deux derniers siècles n’étaient que très peu royalistes…Aujourd’hui, le malheur des temps est comme toujours simplificateur : nous ne pouvons plus nous leurrer avec je ne sais quel “pays réel”, qui attendrait que l’on remette en place le trône renversé, une fois liquidé le malentendu de la République. La république n’est pas un malentendu : c’est l’écorce morte de la royauté, la chair méhaignée du Royaume, qui attend la question de Perceval…
Luc-Olivier d’Algange :
- La liberté, mot infiniment galvaudé, ne vaut que lorsqu’elle est, non une abstraction, une généralité, mais un envol qualifié. Sinon elle est ce “partout”, exact équivalent de “nulle part”, autrement dit un “sur-place” désespérant. Il nous faut des libertés qui soient autant de qualités. Or, la seule expérience est un leurre publicitaire. La liberté ne s’expérimente pas en laboratoire, elle se vit, elle s’établit comme on établit une relation. Ainsi on ne tarde pas à s’apercevoir que les expériences de la liberté qu’on nous propose sont autant de chausses-trapes, de faux-semblants qui s’apparentent plus ou moins au tourisme organisé, cette utopie réalisée du moi qui perdure “tel quel” mais ailleurs…
Ce qui importe, c’est de passer de l’autre côté du miroir, avec les gants, comme dans le film de Jean Cocteau, de l’autre côté de cette onde sombre et frémissante… Dans ce franchissement du miroir, je vois la définition même du mot “relation”. La relation haussée au mystère devient translation orphique. Et l’on voit bien, alors, à quel point le monde où nous sommes ne veut rien savoir de la liberté, à aucun prix ! Ce monde modernisé est un monde où chaque individu est l’ennemi personnel de l’homme libre. D’où ce terrifiant grégarisme, cette socialisation extrême (toujours au seuil du lynchage ou de la lapidation) qui est le propre de la démocratie fondamentaliste dont la devise demeure : “Pas de liberté pour les ennemis de la liberté”.
Mais revenons à Cocteau, et à ce que l’on pourrait nommer son hypnosophie et distinguons d’emblée cette hypnosophie, en tant que science orphique, de cette sorte de culte de l’inconscient où se complurent parfois les Surréalistes. J’y reviens précisément en écho à ce que vous disiez de l’Incarnation. Ce qui s’incarne, ce qui prend chair, est semblable à ce sommeil qui nous prend. L’incarnation est un ensommeillement de l’âme, mais il faut distinguer le sommeil léthéen, le sommeil des vagues noires de la surface du sommeil lumineux des tréfonds où retentit la clarté de l’incréé (de l’En-Sof, pour user du langage des kabbalistes). Il y aurait donc deux sommeils, l’un n’étant que la houle ténébreuse de notre état de veille ordinaire, - qui n’est lui-même qu’un état somnambulique ; l’autre étant le sommeil bruissant de clartés, le sommeil d’enfance, le sommeil enchanté qui s’ouvre sur l’éveil véritable, sur ce matin philosophal dont la rosée rafraîchit les mains et les joues. La chair alors n’est plus ce qui sépare de l’âme, mais le sommeil et l’éveil de l’âme. Le somnambule moderne livré à son activisme technomorphe ou lucratif ne peut ni dormir ni s’éveiller, ni s’incarner. Il est cette abstraction, cette virtualité errante, insomniaque et jamais éveillée, cette réalité spectrale manipulée par les logiciels, ce déni absolu de la réalité douce ou tragique, de cette “tache bleue du Pacifique” que vous évoquiez, et qu’il appartient aux hypnosophes, autrement dit aux poètes, de nous restituer.
Toute chose ne cesse de s’endormir et de s’éveiller ; nous avons oublié cette inspiration et cette expiration. On mesure les vertus de l’hypnosophie, dont Nerval et Jünger furent les intercesseurs, dès lors que l’on considère la littérature née de son absence. Nous évoquions, dans une conversation à la fin du précédent millénaire, s’il m’en souvient, cette héraldique du songe à propos de Jünger… Toute œuvre digne de ce nom est un armorial, - dont elle possède aussi les lignes fermes et les couleurs éclatantes et profondes. Toute œuvre est un éloge de la lumière qu’elle capte et qui vient de plus loin qu’elle-même pour aller ailleurs, à travers la prunelle du lecteur.
Les œuvres héraldiques sont les œuvres où l’on se perd, et parfois une seule phrase y suffit, mais l’on s’y perd comme on se perd dans le Grand Ordre, dans une cathédrale, dans une forêt. On s’y perd pour s’y retrouver dans la clairière, comme l’éveil au sommeil succède. Le progressisme, qui favorise la pire régression, n’est autre que la méconnaissance des contrées du sommeil, de cet “au-delà des portes de corne et d’ivoire” qu’évoque Nerval aux premières lignes d’Aurélia (qui est sans doute le texte fondateur de ce que nous nommons ici le “contraire de la littérature”.) Ne jamais se recueillir, ne jamais s’abandonner, être dans le faux-jour perpétuel de la technique, abolir toutes les distances dans une omniprésence somnambulique… - rien d’étonnant alors à ce que les Modernes veuillent éperdument le “changement”, et même la mort : leur monde est invivable. Observons qu’à l’inverse les hommes des sociétés dites traditionnelles craignaient et même détestaient le changement : signe, peut-être, qu’ils se trouvaient dans un monde heureux ?
Nietzsche ne dit rien d’autre dans son chant des Douze Coups de Minuit : “D’un rêve profond je me suis éveillé / Le monde est profond / Et plus profond que ne le pensait le jour / Profonde est sa douleur / La joie plus profonde que l’affliction / La douleur dit: Passe et finit / Mais toute joie veut l’éternité / Veut la profonde éternité.”
Philippe Barthelet :
- Mutantur non in melius, sed in aliud… Sénèque le remarquait déjà à propos ses contemporains, « modernes » avant la lettre, qu’ils voulaient changer non pas en mieux, mais en autre chose… Les modernes sont mal assis, « mal perchés », comme disait Baudelaire de son éditeur, et ce prurit de changement sans fin ni cesse et à tout prix est, en effet, à la fin des fins et même s’il se méconnaît comme tel, une aspiration à la mort… (D’ailleurs il serait facile – et lugubre – d’énumérer tout ce que notre monde a de thanatocratique… L’enfer du décor, pour reprendre une autre de vos expressions qui a la concision – et la complétude – d’une devise héraldique…)
L’héraldique me fait songer à un autre vieux mot, du vocabulaire d’avant le déluge, et qui connaît aujourd’hui une vogue singulière, celui de « médiatisation ». C’est l’office des “médiateurs” : on désigne sous ce nom tous ceux, journalistes, intellectuels, oracles divers, qui parlent ou écrivent dans « les médias » pour nous, c’est-à-dire à la fois pour notre gouverne et à notre place. Le mot est révélateur. On ne pourrait donc avoir accès à la réalité que par la médiation des medias… On parlait autrefois, en droit germanique, des princes « médiatisés » : c’était ceux qui, relevant directement de l’Empereur, voyaient leurs États incorporés dans un autre État vassal. Nous voilà tous, désormais, médiatisés – privés d’une relation directe avec l’empire de nous-mêmes et soumis à la tutelle pédagogique de tous ceux qui pensent et qui parlent pour nous…
« Vous avez mis les peuples au collège », ô Bernanos, qui aviez flairé l’imposture d’instituteur de la démocratie… La pédagogie universelle, panacée à tous les maux de l’homme et de la société, thérapeutique efficace du péché originel… On devrait s’interroger un peu sur le cousinage de « pédagogie » et de « démagogie »… On devrait rappeler aussi, en passant, qui est l’inventeur de l’expression « éducation nationale », cette formule de la démocratie comme pédagogie perpétuelle : le marquis de Sade, dans Français, encore un effort si vous voulez être républicains, un intermède théorique de la Philosophie dans le boudoir… Eh oui, le texte fondateur de la République française est un chef-d’œuvre de la pornographie. On peut d’ailleurs tout reprocher à Sade, sauf de manquer de conséquence ; « l’éducation nationale » est pour lui le combat contre la religion des « imposteurs chrétiens » et la propagation de l’athéisme : « Français, vous frapperez les premiers coups ; votre éducation nationale fera le reste ». Il réclame donc d’enlever au plus tôt les enfants à leurs parents : « N’imaginez pas de faire de bons républicains tant que vous isolerez dans leurs familles les enfants qui ne doivent appartenir qu’à la république ». D’ailleurs, pour lui, la communauté des enfants répond de la communauté des femmes. « L’amour » doit être une passion commune, et c’est faire injure à ses semblables que d’aimer quelqu’un en particulier, puisque c’est leur retirer un objet de jouissance possible… Les enfants naîtront sans père, tous fils de la « patrie » : on reconnaît là la théorie des Lebensborn hitlériens. Hitler, en bon Allemand, a pris au sérieux la « grande Révolution française », dont il avait annoncé dès son arrivée au pouvoir que « la révolution nationale-socialiste » serait l’accomplissement (mais on s’est bien gardé de le répéter, surtout en France…)
Autre point sur lequel le divin marquis est un précurseur du nazisme : l’élimination des « enfants difformes » : il explique que la dépense des hôpitaux, asiles et maisons de charité, « richement dotés pour conserver cette vile écume de la nature humaine (sic) » doit être « réformée par la nation » ; en effet, « tout individu qui naît sans les qualités nécessaires pour devenir un jour utile à la république n’a nul droit à conserver la vie, et ce qu’on peut faire de mieux est de la lui ôter au moment où il la reçoit ». Voilà qui est clair, et surtout qui est logique ; encore une fois, au contraire des « républicains » à qui il s’adresse, Sade à l’éminent mérite de la cohérence. Il ne recule devant aucune conséquence des principes qu’il défend. Son culte de la nature – la « loi de la nature » qui est pour lui la loi suprême n’est rien d’autre que la loi du plus fort, au sens de Hobbes – le pousse à conclure en souhaitant la mort de l’homme : en effet, la nature est sainte, rien n’est crime à ses yeux et la seule fausse note du concert universel est apporté par l’homme et toutes les chimères, « impostures » et « superstitions » qu’il enfante sans cesse. Que si la nature nous enseigne la Raison, elle nous désigne fatalement le seul obstacle au règne incontesté de celle-ci – et cet obstacle, c’est l’homme lui-même. Quand Sade dit que le triomphe de la nature serait la mort de l’homme, il ne fait que pousser le sophisme « humaniste » jusqu’à ses dernières conséquences. Je ne vous cache pas que j’ai pour le marquis de Sade une inavouable tendresse ; et que je donnerais pour son œuvre – y compris tout ce fatras ergastulaire qui est à peine fait pour être lu – tout Voltaire, tout Diderot et même tout Jean-Jacques, sans compter tous les petits maîtres… il n’a manqué à tous ceux-là que de vivre quinze ou vingt ans de plus, pour connaître – et croyez que ça n’aurait pas manqué ! – le sort de ce pauvre Condorcet : celui-là, la conséquence qu’il n’avait pas dans l’esprit, les événements se seront chargés de la lui enseigner… Ce que j’aime par dessus tout chez M. de Sade, c’est ce « plaisir aristocratique de déplaire » qu’il manifeste quasi à son insu. Ce n’est pas un fils de notaire ou de marchand de couteaux, il n’a rien de ce pharisaïsme chafouin, de cette prudence petite bourgeoise des « philosophes » : lui s’expose, « se mouille », joint le geste à la parole et soutient les conséquences de ce qu’il dit, même si ce qu’il dit est délirant – même, ou surtout, peut-être. Pierre Klossowski observait que deux hommes seulement auront compris la Révolution pour ce qu’elle était : une « communauté caïnite », et il les place de part et d’autre de son allégorie, comme deux soutiens héraldiques : le marquis de Sade et le comte de Maistre.
Le soleil de l’après-midi faisait briller les vitrines ; les deux causeurs étaient les derniers convives, et les serveurs échangeaient entre eux des regards appuyés. Ils ouvrirent soudain de grands yeux quand le dernier qui avait parlé, un cigare à la main qu’il humait, les interpella : “Garçon ! la guillotine !”.
L'ouvrage entier, naguère publié par les éditions Arma Artis, est réédité aux éditions de L'Harmattan, dans la collection Théôria.
« Ce qui manque le plus à notre temps, c'est une aristocratie de l'esprit » déclarait le grand Bernanos comme le rappelle Philippe Barthelet au cours de l'un de ces onze entretiens avec Luc-Olivier d'Algange placés sous le signe des Soirées de Saint-Pétersbourg de Joseph de Maistre dont ils reprennent le protocole, ce qui est audacieux, mais non pas présomptueux tant le résultat se révèle édifiant et comble à merveille ce vide désigné par le prophète de La France contre les robots.
Réédition d'un livre publié en 2010, Terre Lucide n'a rien perdu de son urgente actualité puisque les deux écrivains s'y attaquent à l'époque en tant qu'ère métaphysique, autant dire que les années qui passent ne cessent d'en révéler davantage la nature profonde ; une ère qui fait du vivant avec du mort, dont la perspective est mécanique, déliée, absurde, et l'humeur dépressive et grimaçante. Se référant aux grands mystiques, à la théologie médiévale, à Novalis, Hölderlin et Jünger, Maistre ou Bloy, nos contemplatifs armés lui opposent un symbolisme supérieur où la vie, l'art et le surnaturel retrouvent leurs connexions, leurs vibrations et leur puissance. Une cure d'altitude, le temps d'une promenade au bord de la Seine ou de quelques verres devant le Louvre, tandis que tout s'effondre. Salutaire, voire salvifique.
Romaric SANGARS, L'INCORRECT, décembre 2022.
元
Deux hommes en quête de l'âme du monde
Les dialogues de Philippe Barthelet avec Luc-Olivier d'Algange, réunis dans Terre lucide, ne sont pas des colloques d'intellectuels, Ils nous offrent cette chose presque unique aujourd'hui, un art de vivre, et quelques indices et pistes pour retrouver des chemins trop longtemps abandonnés ou simplement oubliés.
Notre époque est assourdissante. La musique du monde et ses rythmes sont recouverts par la mitraille incessante des fausses paroles et des slogans. Les voix essentielles ne trouvent aujourd'hui qu'un très faible écho, brouillé par le bavardage des sectes intellectuelles, les novlangues idéologiques et le vacarme des industries culturelles. Et nous avons parfois le sentiment accablant que tout est tout est vain, que tout est joué, et que c'est à la fin la "panmuflerie sans limites" ( Charles Péguy) qui l'emportera dans le tintamarre et le brouhaha.
C'est dire que j'ai lu avec bonheur et soulagement Terre lucide, une conversation en onze entretiens entre Luc-Olivier d'Algange et Philippe Barthelet que publie aux éditions de L'Harmattan et dans son excellente collection Théôria notre ami Pierre-Marie Sigaud. Je me suis en effet promené dans ce livre comme dans un vaste jardin isolé en bord de mer. Une brise rafraîchissante y souffle, qui nous tient en éveil, et l'on y cueille des fleurs des fruits rares ou trop négligés. D'Algange et Barthelet sont aimables, courtois et érudits, d'une amabilité et d'une courtoisie qui m'ont semblé presque médiévales, et d'une érudition qui vient toujours à point nommé, dont ils n'usent jamais pour flatter ou épater leurs lecteurs. Les deux auteurs de ces denses et libres propos sur la littérature, la politique, la poésie, l'histoire, les rois, les peuples, les dieux, Dieu et le monde, feront fuir les "ennuyés, les grincheux, les puritains, les commères, les censeurs, les faiseurs de système et les accusateurs" et toutes les légions d'assommeurs et d'abrutisseurs. Les autres, en arpentant cette Terre lucide et en écoutant attentivement les deux amis, trouveront de quoi se ragaillardir et se remettre en selle.
Philippe Barthelet et Luc-Olivier d'Algange sont-ils des antimodernes, m'a demandé un amateur de définitions qui a lu le manuel d'Antoine Compagnon. Ils sont assurément les sujets de cette France souterraine dont parle Nicolas Berdiaev dans son autobiographie spirituelle, de ce pays secret qui compte parmi ses paladins Joseph de Maistre, Charles Baudelaire, Barbey d'Aurevilly, Villiers de l'Isle-Adam et Léon Bloy. Et ce n'est pas pour eux une posture littéraire. Barthelet et d'Algange mènent le combat pour ce royaume contre les idoles et les impostures de l'immonde moderne, contre ses cliques, ses nations et ses sociétés anonymes. On trouve dans les pages de ces entretiens sur les météores et les signes des temps des charges et des assauts. Les misères et les ridicules du temps y sont bien nommés, et les agents du néant et du désastres, et les plus tristes et les plus dangereux, y sont justement fustigés. Luc-Olivier d'Algange écrit par exemple ces phrases: " Les hommes de ce temps sont abaissés, humiliés, ratiboisés selon une méthode procustéenne si efficace qu'elle donne à leurs revendications hédonistes, profiteuses ou festives, un ridicule frôlant sans cesse le pathétique. La société est-elle en proie aux individus ? Mais quelle société ? Quels individus ? Je vois, plutôt qu'un éclatement, une concentration de laideur, un monde concentrationnaire, comme une parodie théocratique de laquelle on ne peu s'échapper que par une sorte de ruse animale" Voilà qui touche au coeur, n'est-ce pas ?
Mais les beautés de Terre lucide ne sont pas seulement des beautés d'offensive et de contestation. J'ai dit plus haut qu'on pouvait y cueillir des fruits rares ou trop négligés. Parmi ceux-là, et c'est au fond l'essentiel, la seule chose nécessaire, j'y ai découvert une invitation à renouer avec les oeuvres, les paysages et les Muses. Ces oeuvres, ces paysages et ces Muses sont aujourd'hui aussi bien ensevelis sous des tonnes de béton que sous des montagnes de gloses et de commentaires. Ils attendent leur libération. Il suffirait sans doute que nous nous prêtions à nouveau à leurs jeux et à leurs entretiens.
Olivier François, article paru dans la revue Eléments.
元
22:33 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
25/08/2024
Chant du serment, poème de Luc-Olivier d'Algange:

Luc-Olivier d'Algange
Chant du Serment
Jamais, non jamais, nous ne renoncerons à dire
ce qui nous enchante, à nommer
les Anges et les dieux
et cette jeunesse perpétuelle
qui se dit en nous- même avec la jeunesse du monde...
Les censeurs,
les puritains, je leur laisse leurs abstractions mesquines
leurs médisances, leurs travaux
pour aimer les paroles belles dites
pour le Songe et l'Extase et le Désir... Les paroles
belles et grandes,
les paroles anadyomènes
car elles viennent du Grand-Large
sur ce rivage,
élite fervente et rêveuse,
elles viennent,
de cette césure de l'horizon, entre le paradis et l'enfer,
elles viennent de cette source du temps...
Nulles jamais ne furent plus désirables
dans ce cercle du ciel qui écarte la multitude
Nulles jamais
ne furent plus emportées
que ces paroles dites dans le Songe, il m'en souvient;
j'errais dans ces richesses inconnues,
orchestres, arômes, torrents... J'errais
dans cette fastueuse incertitude, ces conjonctions imprévues,
cette mémoire à la tombée de la nuit;
et ces belles paroles s'attardaient dans l'admiration de leurs ombres
dans le ruisselant miroir de leurs chevelures dénouées, paroles
vivantes, belles
et légères
dont il m'appartient aujourd'hui de porter témoignage...
Il était dit que nous traverserions cette terre en Aède !
Ce fut la seule morale à notre goût !
La source du temps était ce silence
au-delà du bien et du mal,
et nous rêvions d'en divulguer le secret par nos chants, gloire promise...
Nous rêvions d'atteindre le secret de la source du temps, silence d'or
source de tous les chants,
aube des paroles grandes et belles dites dans le Songe
du Soleil, sous le feuillage étonné
et le battement du cœur qui ne renonce pas !
Soir qui ne s'achève pas,
autel où se pose l'oiseau du serment,
j'aimais cette couronne,
cet éternel destin de la lumière. La nuit
s'inclinait sur le frémissement d'ailes de mon anxiété,
enseignement d'une solitude donnée,
d'un égarement des maximes
et autres saintes prophéties,
elles s'obscurcissaient à mes yeux, s'éloignaient, funèbres dans l'exil,
les vents adverses, les plaintes...
Et l'amertume desséchait ces feuilles ardentes,
ces feuilles dolentes...
Que la belle parole des dieux
me fut alors cette impétueuse transparence
cette compagne aux confins des cieux,
cette ardente fidélité,
cette blancheur embrasée
dans la lumière du sens de toute chose, cette caresse...
Que la haute parole me fut cette aube inconnue,
cette promesse, que rien jamais
ne viendra dédire/
Est-il âme assez basse pour ne point oser nommer ces dieux qui nous sauvèrent ?
Est-il âme assez basse
pour dédire la hauteur du Soleil et de l'Azur... Ame assez basse
pour ne point célébrer avec les noms anciens
les dieux et les anges
qui vivent dans les secrets du désir et de la miséricorde ?
O noms anciens, météores
dans notre ciel,
météores
dans ce sommeil de la présence oublieuse de la brûlure immémoriale,
dieux
que nomme en moi
la splendeur naissante,
l'eau rieuse de la lumière qui l'éveille,
dieux que je nomme
avec une très-subversive ingénuité, avec une connaissance
des rythmes intérieurs de la vie des arbres, des pierres
avec une science ondoyante, dieux que je nomme par éclair,
messagers de ma vertu aurorale,-
ce fut mon grand dessein que de garder cette distance,
mon grand dessein
d'aimer ce vent de sel et d'allégresse
contre toutes les apparences et pour toute la vie,
dieux nommés
par moi éveillés,
race furibonde et sereine.
Divers est de monde que nous aimons,
excellentes ses lois,
treilles, femmes très-douces,
feu clair, sang qui chante sous les paupières...
Solitude sacrée d'un été sur la mer,
certitude adamantine...
Les dieux furent en moi
cette grandeur de la gratitude, cette ampleur de l'âme,
cette volonté pure comme un regard sur la mer,
cette vie universelle,
ce face-à-face !
J'aimais ce resplendissement dont ils fécondent la diversité du monde
j'aimais, éperdument cette immense roue des saisons,
des éléments,- et comment la dire
sans nommer les dieux ?
Au-delà de l'extrême des hauts
glaciers énigmatiques, ces clartés transversales,
l'air du pôle
l'Ether limpide et sauvage du premier jour
de notre sainte conjuration
furent nommés dans le secret de notre cœur
avec les nombres occultes des dieux,
leurs noms invisibles
neige et flamme,
leurs noms,
rythmes fondamentaux
battant dans notre veine jugulaire
s'épanouissant dans notre poitrine,
leurs noms
que nomment dans le secret du secret
les Sept Silences majestueux du Dire
dont la transparence est un torrent dans nos âmes...
Au-delà de ce froid, de cette blancheur
de ce silence,
nous entendîmes,
au-delà: cette strophe incendiée de soleil, cette scintillante mémoire à l'infini,
le chœur des mondes, l'immensité qui s'immobilise
dans la bataille sonore,
l'immensité saisie sous l'ouragan,
coursier d'une ivresse
plus rapide que la mort,
ainsi furent dans notre poème
les dieux,
ainsi furent
comme une espérance plus ancienne
les dieux
dont la ténacité nous sauve de n'être pas
dont la transparence merveilleusement nous éloigne
du monde qui n'est pas,-
les dieux aimés, chantés, loués, oubliés, présents,-
ainsi furent brûlants dans l'invisible citadelle de notre amour,
ainsi furent frisson, ainsi furent sommeil,
ainsi furent cadence
car nous savions entendre dans nos cœurs
les concordances mathématiques et musicales de leurs noms
nous savions ces infaillibles architectures,
hauteur et profondeur de l'Instant,
véritable demeure des dieux,
nous savions et nous acceptions l'empire que ces noms
- nombres et chants, couleurs et clartés,-
sur le destin exercent, et sur les jours, ces beaux jours
qui tournoient comme un ciel
sous le maillet de l'Etre et de la Puissance...
Nous consentions à cette grandeur
où nous nous perdions en nous- mêmes
car notre âme était ample de ces noms qui la nommaient,
notre âme était vive
de ces appels,
ces invocations
ces batailles, notre âme était ardente de ces attentes,
compagne fleurie de l'immensité des ciels,
compagne légère, notre âme s'enchantait à se dire
dans le sable sans fin des dieux,
écume, sel de l'enfance
âme fluente
âme qui regarde les dieux.
En ses Yeux s'ouvrait le mystère d'une aube profonde
un jardin profond, comme l'orgueil d'être
et de n'être pas, une promesse,
j'en rêvais comme d'une fortune sans espoir,
une hymne belle comme la voile carrée,
détachée
sur l'abîme bleu,
détachée, sur la victoire du bleu profond,
sur le triomphe des yeux de l'âme...
Et d'être ainsi contemplée
comme un mystère véridique et sans fin, les dieux
s'envolaient,
les dieux hantaient le ciel, et toute chose
en ce monde
palpitait de joie,
toute chose était saisie à la nuque, et nos mains suscitaient d'invisibles trésors.
Les heures devenaient spacieuses et royales,
les heures s'accordaient à cette neuve mythologie
des regards,
- car l'âme regardait les dieux !-
et notre joie sise dans l'Instant fut l'essor
notre joie d'être ou de n'être pas dans l'âme,
ce Silence; la joie
déployait ses ailes dans la spacieuse et royale présence de notre âme,
notre âme qui regardait les dieux...
A grandes gorgées
nous buvions la saveur secrète du ciel,
nous saisissions
les lyres de la pluie et du soleil,
et l'ombre lavande d'un dieu rare sur notre front
bénissait notre audace, bénissait notre peur
et notre audace,
comme une pure pensée, une corolle fraîche sur notre front
encore brûlant de la guerre sainte qui nous sauva...
Sainte paix, sérénité d'azur et de feuilles, vous êtes notre mérite.
- Car ici il n'est point de hasard et les couronnes sont conquises
sur l'orée tremblante du Jour
- l'ai-je assez dit ?-
Point de hasard mais en toute chose aimée le retour
de l'unité de l'Etre
car tout se tient,
le haut
et le bas.
Tout se tient dans le rêve premier,
dans la belle philosophie lyrique d'Hermès-Thoth,
tout
se tient et tout s'éveille selon nos intentions les mieux accordées à la joie
au plaisir qui donne
aux portes éblouissantes de l'été nocturne
tout se tient,
la ténèbre et la clarté,
dans cette aube divine de l'âme où les regards se perdent et se retrouvent
en l'impétueuse douceur de l'empire du monde !
La promptitude fut notre triomphe, notre puissance.
Des cendres d'une vie profanée
notre âme ressuscita
cette fleur, cette flamme
création d'une aube d'orgueil brûlant
d'une aube sonore et profonde et lointaine
dans le Songe du Chœur !
Rougeoyante dans la poitrine de l'espace que disperse la beauté de temps,
bleuïssante dans le temple de l'Ode
que dissémine
la mélancolie de l'heure
toute chose en vérité divine,
toute chose me fut prière.
Ma prière fut cette alliance entre le monde et moi,
cet échange tournoyant, et je répondais à l'appel du monde en le nommant,
dans le visible et dans l'invisible,
nommant
le Sens qu'à mesure j'y devinais
en devenant transparent à moi-même
Ainsi m'éveillais je
au cœur du sommeil
et rêvais je dans la plus haute lucidité conquise.
J'étais paisible dans ma violence
et ardent, vif, joyeux dans l'ensommeillement délicieux
dans les bras de l'amante prédestinée
dont les yeux s'ouvraient sur le clair abîme...
Sagesse du jour, temple de saphir,
le monde se transfigurait en moi dans le silence des mots,
le monde, j'en devinais le Sens,
dans la lumière que rien ne saisit
mais que toute chose
voile et révèle,
j'en devinais le Sens
dans ce clair abîme de tes Yeux
les prunelles divulguaient le secret de la nuit la plus noire en moi,
ténèbres désespérantes...
Toutes ces choses éparses, objets, idées, actes, décrets, peuples,
renaissaient dans une plus pure essence,
s'enchantaient soudain
d'être en proie d'une telle légèreté
et d'une telle densité
que nous pouvions soudain rire de cette divine transfiguration...
Esprit qui sauve, rire d'or, rire des dieux,
science olympienne formée dans le cristal des cieux,-
et c'est un rire cristallin que je cueillais sur tes lèvres, mon amante...
Ainsi les dieux résonnaient infiniment en moi dans l'immémoriale perfection de ma prière.
Ainsi les dieux, dans l'abîme, dans la prunelle,
dans l'aube, dans le saphir, dans l'amante,
les dieux naissaient de ma prière
et ce paysage du monde devient un paysage de notre âme.
00:57 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
22/08/2024
Luc-Olivier d'Algange, A propos des "Scolies pour un texte implicite" de Nicolás Gómez Dávila, suivi d'une traduction en espagnol:
Luc-Olivier d'Algange
A PROPOS DES "SCOLIES POUR UN TEXTE IMPLICITE"
« Les deux ailes de l’intelligence sont l’érudition et l’amour. »
Nicolás Gómez Dávila
Nicolás Gómez Dávila est de ces rares auteurs qui tiennent leur lecteur en assez haute estime pour ne lui offrir que le meilleur d’eux-mêmes. Le véritable titre de ces formes brèves, qui ne sont ni des aphorismes, ni des sentences, rassemblées sous le titre Les Horreurs de la Démocratie (choix d’éditeur non dépourvu de roborative provocation) est « Escolios a un texto implícito », Scolies pour un texte implicite. Ces « scolies » ont pour règle de ne laisser apercevoir de la pensée que la fine pointe et pour vertu, la générosité de supposer au lecteur l’intelligence et l’art de déployer, à partir de ces fines pointes, un texte qui est à la fois absent et présent, implicite, c’est à dire donné, sans être pour autant révélé.
Toute œuvre digne que l’on s’y attarde ressemble à la part émergée de l’Iceberg : ce qu’elle dit n’est que le signe de ce qu’elle ne dit point. L’implicite est, plus généralement, le propre de la haute littérature ; ce qui la distingue de l’information, des sciences humaines et du bavardage où ce qui n’est pas dit vaut encore moins que ce qui est dit. Lorsque l’écrit s’élève au rang de parole, lorsque les pages sont comme la réverbération du Logos-Roi, le moindre scintillement témoigne du gouffre lumineux du Ciel. Ce qui est dit est comme soulevé par la puissance de ce qui n’est pas dit, comme le roulement de la vague accordée au magnétisme des marées. Or, cette puissance-là, l’éminente générosité de Nicolás Gómez Dávila est de l’accorder d’emblée à son lecteur, sans se soucier d’aucune autre qualification extérieure. Ce réputé « antidémocrate » pose en a priori théorique à son œuvre, à sa « méthode » (au sens où Valéry parle de la « méthode » de Léonard de Vinci) la possibilité pour tout homme soucieux d’une vie intérieure de le comprendre. « Les hommes sont moins égaux qu’ils ne le disent mais plus qu’ils ne le croient. » La logique est ici exactement inverse à celle du « démocrate » fondamentaliste qui affirme théoriquement l’égalité de tous non sans s’accorder le magistère de la définition de l’égalité et, par voie de conséquence, une supériorité absolue qui ne saurait se traduire, en Politique, que par la généralisation des méthodes policières. « L’État moderne réalisera son essence lorsque la police, comme Dieu, sera témoin de tous les actes de l’homme. »
Les Scolies de Gómez Dávila sont une œuvre de combat. Ce qui est en jeu n’est rien moins que la dignité et la liberté humaines, mais à la différence de tant d’autres qui mâchonnent les mots de « dignité » et de « liberté », Gómez Dávila ne pactise point avec les forces qui les galvaudent et les ruinent. Ne nous attardons pas sur les roquets-folliculaires qui furent lancés aux basques de ce livre magnifique : ils n’existent que pour en illustrer la pertinence : « Le démocrate ne considère pas que les gens qui le critiquent se trompent, mais qu’ils blasphèment. » Cette figure du Moderne, que Gómez Dávila nomme le « démocrate » (non, précise-t-il, en tant que partisan d’un système politique mais comme défenseur d’une « perversion métaphysique ») peut, en effet, être définie ici comme fondamentaliste dans la mesure où elle ne louange le « débat », la « discussion », le « polémos » que sous l’impérative condition que ceux avec qui il est permis de débattre, discuter et polémiquer fussent déjà, de longtemps et notoirement, du même avis qu’elle ; et qu’ils le soient, par surcroît, avec le même vocabulaire, les mêmes rhétoriques, et si possible, avec les mêmes intonations, le même style ou, plus probablement, la même absence de style. Le démocrate fondamentaliste ne « raisonne » ainsi que dans les limites de sa folie procustéenne ; son amour de l’humanité « en général » ne s’accomplit qu’au mépris du particulier ; la liberté d’expression ne lui vaut que strictement réservée à ceux qui n’ont rien à dire ; la « dignité » humaine ne mérite à ses yeux d’être défendue qu’en faveur de ceux qui s’en moquent et s’avilissent à plaisir.
« Aux yeux d’un démocrate, qui ne s’avilit pas est suspect ». Il n’est point d’écrivain un peu libre qui ne fasse chaque jour l’expérience de cette suspicion. Quand bien même se tiendrait-t-il à l’écart des idées qui fâchent, une simple tournure, un mot pris dans une acception un peu ancienne, une vague nostalgie, ou le refus de considérer le monde contemporain comme le parangon de toutes les vertus et la source de tous les bienfaits suffisent à le désigner comme suspect. La critique littéraire qui devrait se situer entre la métaphysique et l’hédonisme, entre la sagesse et le plaisir, le vrai et le beau, se réduit tristement à des rodomontades moralisatrices ou de fastidieuses rhétoriques de procureur ou d’avocat, comme si l’on ne pouvait plus lire un roman ou un essai sans en instruire le procès, comme si tout sentiment de gratitude s’était évanoui des cœurs humains pour ne plus laisser place qu’à des maniaqueries de Fouquier-Tinville sans envergure ni courage. « Les individus, dans la société moderne, sont chaque jour plus semblables les uns aux autres et chaque jour plus étrangers les uns aux autres. Des monades identiques qui s’affrontent dans un individualisme féroce. »
Le critique moderne est un homme qui, pour exercer son office, ne doit connaître ni remord, ni merci, mais s’enticher éperdument de la scie procédurière à quoi se réduit désormais toute forme d’Eris. Transposée dans la mesquinerie, l’agressivité moderne prend le visage patelin de la bien-pensance, c’est-à-dire de la « pensance » collective, grégaire, aussi revêche, obtuse et obscurantiste dans le « village planétaire » qu’elle le fut dans les « villages » imaginés par des bourgeois libéraux, peuplés, comme de bien entendu, d’une paysannerie torve et cruelle et d’affreux chouans ennemis de la liberté. Le Moderne lorsqu’il décrie son ennemi se décrit lui-même. Cet « archaïque », ce « superstitieux », cet « adversaire de la raison », c’est lui-même. Plus il se nomme « démocrate », et plus il méprise ce « peuple » auquel il n’accorde d’autre pouvoir que celui de l’état de fait, qu’il nomme « volonté générale », par pure tartufferie. « La volonté générale, c’est la fiction qui permet au démocrate de prétendre que pour s’incliner devant une majorité, il y a d’autres raisons que la pure et simple couardise. »
La composition pointilliste des Scolies, qui mêlent les aperçus éthiques, esthétiques et politiques, interdit que l’on traitât de chaque domaine comme d’une région séparée. Le bien, le beau et le vrai sont indissociables. L’esthète est toujours moraliste et politique. « Le monde moderne est un soulèvement contre Platon. » Il appartient donc au « réactionnaire » tel que le définit Gómez Dávila (dont la vocation est d’être « l’asile de toutes les idées frappées d’ostracisme par l’ignominie moderne ») d’œuvrer à la recouvrance du platonisme, non en tant que système philosophique (à supposer qu’il existât un « système » platonicien hors des aide-mémoires de quelques pédagogues trop pressés d’enseigner ce qu’ils ne savent pas pour lire les Dialogues) mais en tant qu’expérience métaphysique fondamentale de la lecture (lecture du monde non moins que lecture des livres). « Derrière chaque vocable se lève le même vocable avec une majuscule : derrière l’amour, l’Amour, derrière la rencontre la Rencontre. L’univers s’évade de sa prison lorsque dans l’instance individuelle, nous percevons l’essence. »
Le Politique, pour Gómez Dávila, n’est pas la fin de la pensée, ni même son commencement. Elle se tient dans une zone médiane, plus où moins fréquentable selon les époques, entre le métaphysique et le perceptible, entre la théorie et le goût. « Tout est banal si l’homme n’est pas engagé dans une aventure métaphysique. » Cette banalité toutefois n’est point banale, au sens où elle serait négligeable : elle est horrible. Elle nous livre à la servitude et à la laideur, pire à une servitude et une laideur toujours identiques à elles-mêmes, comme dans une catastrophe ou un cauchemar, sous couvert de « changement » et de « nouveauté ». « Le monde moderne est arrivé à institutionnaliser avec une telle astuce le changement, la révolution, l’anticonformisme que toute entreprise de libération est une routine inscrite dans le règlement de la prison. »
Ce « changement », c’est-à-dire cette haine de la Tradition, qui est le propre du Moderne, ce culte de l’amnésie, cet oubli de l’oubli est tel qu’il en oublie sa propre identité avec lui-même. L’oubli de l’oubli est ce pur néant immobile qui se rêve comme un changement perpétuel, autrement dit comme un présent sans présence. Ainsi, « les démocrates décrivent un passé qui n’a jamais existé et prédisent un avenir qui ne se réalise jamais. »
La politique se détruisant elle-même dans la lâcheté, le Logos se profanant en propagande et publicité, l’alchimie à rebours transformant l’or du pur amour en plomb de « convivialité » obligatoire, nous tombons sous le joug de cette caste qui prétend n’en point être une et dont l’amour de l’humanité en général est le prétexte pour n’avoir personne à aimer en particulier, dont la « tolérance » abstraite est la ruse pour n’avoir jamais à pardonner une offense, et « l’ouverture aux autres » la condition première à se dispenser de toute magnanimité. L’idéologie « citoyenne » fait office d’indulgences, sans que les Pauvres n’en profitent le moins du monde.
Si pour Gómez Dávila la politique est impossible, c’est une raison supplémentaire pour s’y intéresser, mais seul. « La lutte contre le monde moderne doit être conduite dans la solitude. Lorsqu’on est deux, il y a déjà trahison. » On songe ici à la phrase de Montherlant : « Dès que les hommes se rassemblent, ils travaillent pour quelque erreur. » Il n’en demeure pas moins qu’il y eut des temps où l’ordre politique semblait destiné à nous éviter le pire, autant que possible. Le pire, c’est à-dire, le nihilisme, le totalitarisme, la terreur. « La démocratie a la terreur pour moyen et le totalitarisme pour fin. » Toutefois, le « totalitarisme » et la « terreur » ne disent point l’entièreté du pire. Le démocrate ne cesse d’en parler, de s’en prétendre le rempart lorsqu’il s’en trouve être la condition, la prémisse. Le pire est ce que l’homme devient, ce que tous les hommes deviennent, lorsque la contemplation disparaît du monde, lorsque le commerce entre les hommes ne s’ordonne plus qu’à l’économie. « L’absence de vie contemplative fait de la vie active d’une société un grouillement de rats pestilentiels. » Ce par quoi le langage témoigne de la contemplation, et de cette joie profonde, ambrée et lumineuse du Logos-Roi, c’est peu dire que le Moderne ne veut plus en entendre parler. Son monde, il le veut sans faille, compact et massif, c’est-à-dire réduit à lui-même, à sa pure immanence, autrement dit à l’opinion que les plus sots et les plus irréfléchis se font de lui. « Le moderne se refuse à entendre le réactionnaire, non que ses objections lui paraissent irrecevables, mais parce qu’elles ne lui sont pas intelligibles. »
A mesure que s’étend cet espace de l’inintelligible, s’étend le malheur. La sagesse et la joie, la ferveur et la subtilité, les nuances et les gradations, reléguées aux marges de plus en plus lointaines, ou dans un secret de plus en plus profond, ne font plus signe qu’aux rares heureux dévoués à une règle d’art ou de religion. « Celui qui se respecte ne peut vivre aujourd’hui que dans les interstices de la société. » Mieux qu’une pensée « réactionnaire » au sens restreint du terme (dont on doit cependant oser, de temps à autre, se faire un étendard, mais le bon), les Scolies de Gómez Dávila rétablissent les droits immémoriaux d’une grande pensée libertaire et aristocratique, alliant, dans l’exigence de son style « la dureté de la pierre et le frémissement de la feuille. » Que dit cette dureté, qui n’est point dureté du cœur ? Elle nous dit que pour être, il nous faut résister à l’informe, aimer l’éclat, la justesse lapidaire, et peut-être encore la pierre qui triomphe de ce Goliath qu’est le monde moderne.
Gómez Dávila, cependant, n’envisage point une victoire temporelle. « Le réactionnaire n’argumente pas contre le monde moderne dans l’espoir de le vaincre, mais pour que les droits de l’âme ne se prescrivent jamais. » Comme le texte, la victoire est implicite, secrète. Car si les droits de l’âme demeurent imprescriptibles, le Moderne est bel et bien vaincu et ses triomphes ne sont que nuées. À l’imprescriptibilité des droits de l’âme, le Moderne voulut opposer les « droits de l’homme », autre marché de dupe, car le droit de quelque chose de général et d’abstrait fait piètre figure face à la force, ce que savait déjà Démosthène. Or, le droit de l’âme est, en chaque instant, ce qui s’éprouve. A commencer dans le ressouvenir plus vaste que nous-mêmes : « L’âme cultivée, c’est celle où le vacarme des vivants n’étouffe pas la musique des morts. » Au contraire des « droits de l’homme », les droits de l’âme, de cette âme qui emporte et allège, n’apportent aucune solution. « Les problèmes métaphysiques ne tourmentent pas l’homme afin qu’il les résolve, mais qu’il les vive. »
Sans doute y a t-il dans cette manie moderne à vouloir trouver des « solutions », à laisser les « problèmes » derrière soi, dans des époques révolues, à se croire plus avisé de ne s’intéresser à rien, une immense lassitude à vivre. Ce Moderne qui ne cesse de louanger la « vie » et le « corps » les réduit à bien peu de chose. Que lui est-elle cette « vie » s’il ne la voit comme le miroitement d’une gradation vers l’éternité, qu’est-ce que ce « corps » dont il a une si forte conscience, sinon un corps malade, et malade d’avoir oublié que ce n’est point l’âme qui est dans le corps mais bien le corps qui est dans l’âme ? Sous prétexte que certains crurent médiocrement en Dieu, nommant « Dieu » leur propre médiocrité, le Moderne ne veut plus croire qu’en « l’homme », mais « si le seul but de l’homme est l’homme, de ce principe dérive une vaine réciprocité, comme le double reflètement de deux miroirs vides. » C’est bien en vain que les Modernes et les antimodernes cherchent en amont, dans l’histoire de la philosophie, de dignes précurseurs au monde moderne. Laissons Spinoza, Hegel, et même Voltaire où ils sont. Le véritable précurseur du monde moderne est, bien sûr, Monsieur de La Palice. Le Moderne n’est point panthéiste, dialecticien ou ironiste, il est « lapaliciste. » Sa philosophie est des plus claires : l’homme n’est que l’homme, la vie n’est que la vie, le corps n’est que le corps. Voilà bien cette pensée moderne dans toute sa splendeur qui exige de nous que nous brûlions, comme obsolètes et néfastes, toutes les philosophies, toutes les religions, tous les arts qui durant quelques millénaires, de par le monde, firent à l’humanité l’affront abominable de lui enseigner la complexité, les nuances, les relations, les rapports et les proportions, toutes choses vaines, en effet, pour qui ne veut que détruire.
Ces Scolies à un texte implicite, se donnent à lire ainsi, non seulement comme une suite d’aperçus lucides en forme d’exercices de désabusement, dans la lignée des meilleurs d’entre nos Moralistes, tels que Vauvenargues ou Rivarol, mais aussi, comme un Art de la guerre, un traité de combat contre les « lapalicistes. » « Est démocrate, celui qui attend du monde extérieur la définition de ses objectifs. » Contre la passivité des tautologies et contre le règne de la quantité qu’elle instaure, c’est à la seule vie intérieure, à la seule âme imprescriptible du lecteur qu’il appartient, dans cette solitude essentielle qui est la véritable communion, de nuancer d’un imprévisible ensoleillement, autrement dit, d’une espérance implicite mais prête à bondir dans le monde, ces Scolies qu’un inattentif regard ordonnerait au seul pessimisme.
D’autant plus inquiétantes, roboratives et salubres, ces Scolies, que ce qu’elles ne disent pas chemine en nous à l’insu des censeurs ! « Seuls conspirent efficacement contre le monde actuel ceux qui propagent en secret l’admiration de la beauté. »
Ce qu’il en sera de cette beauté et de cette admiration, nous le savons déjà. « Il n’est jamais trop tard pour rien de vraiment important. » Gómez Dávila opère ainsi à une sorte de renversement du pessimisme, celui-ci n’étant plus seulement la fine pointe de la lucidité, mais celle d’une audace reconquise sur le ressassement sans fin de la vanité de toute chose. Certes, nous sommes bien tard dans la nuit du monde, dans la trappe moderne (« tombés dans l’histoire moderne comme dans une trappe »), mais s’il n’est jamais trop tard pour rien de vraiment important, n’est-ce point à dire que toute l’espérance du monde peut se concentrer en un point ? « Un geste, un seul geste suffit parfois à justifier l’existence du monde. » Cette pensée guerroyante et savante, polémique et érudite, est avant tout une pensée amoureuse. Le combat contre l’uniformité, l’étude savante qui distingue et honore la diversité prodigieuse sont autant de sauvegardes de l’amour. « L’amour est l’organe avec lequel nous percevons l’irremplaçable individualité des êtres. » Or cette « irremplaçable individualité » n’est autre que la beauté. « La beauté de l’objet est sa véritable substance. » Celle-ci n’appartient pas à la durée, de même que la tradition n’appartient pas à la perpétuité, mais à l’instant. « L’éternité de la vérité, comme l’éternité de l’œuvre d’art sont toutes deux filles de l’instant. » L’instant ne s’offre qu’à celui qui le saisit au vol, chasseur subtil, qui discerne dans le monde des rumeurs qui se font musique, en-deçà ou par-delà le vacarme obligatoire (le monde moderne étant bruyant comme le sont les prisons). « Les choses ne sont pas muettes, seulement elles sélectionnent leurs auditeurs. » L’utopie du « tout pour tous » renversée en réalité du « rien pour personne » en vient alors à médire des choses elles-mêmes, muettes ou parlantes. La véritable bonté n’est jamais générale de même que « Dieu n’est pas dans le monde comme un rocher dans un paysage tangible mais comme la nostalgie dans le paysage d’un tableau. » La véritable bonté advient dans l’imprévisible : « Pour éveiller un sourire sur un visage douloureux, je me sens capable de toutes les bassesses. »
De même que les Scolies sont les cimes du discours, leur « par-delà » salvateur, la véritable magnanimité est l’au-delà de la morale générale, le surgissement de la connaissance de l’Un dans l’instant lui-même, la fulgurance pure où la liberté absolue rejoint la soumission au Règne de Dieu. « Celui qui parle des régions extrêmes de l’âme doit vite avoir recours à un vocabulaire théologique. » Théologique, la pensée de Gómez Dávila n’en garde pas moins ses distances avec ce que Gustave Thibon nommait le « narcissisme religieux », cette inclination fatale à voir l’Église d’abord comme une communauté humaine, avec ses administrations, sa sociologie, et son opportunisme. « L’obéissance du catholique s’est muée en une docilité infinie à tous les vents du monde. » Peu importe au demeurant : « Un seul concile n’est rien de plus qu’une seule voix dans le véritable concile œcuménique de l’Église, lequel est son histoire totale. » Or, pour Gómez Dávila cette histoire totale inclut les dieux antérieurs. L’Iliade et Pythagore lui sont plus proches que cette Église « qui serre dans ses bras la démocratie non parce qu’elle lui pardonne mais pour que la démocratie lui pardonne. »
Le sacré doit « jaillir comme une source dans la forêt et non pas comme une fontaine publique sur une place. » Face au monde moderne « cette effrayante accoutumance au mal et à laideur », le discord entre paganisme et christianisme apparaît secondaire et artificieux. « Le christianisme est une insolence que nous ne devons pas déguiser en amabilité. » Cette insolence, il ne sera pas interdit de la retourner contre les « représentants » du christianisme lui-même : « N’ayant pas obtenu que les hommes pratiquent ce qu’elle enseigne, l’Église actuelle a décidé d’enseigner ce qu’ils pratiquent. » Le monde grec apparaît alors comme « l’autre ancien Testament » auquel il n’est pas malvenu de recourir car « entre le monde divin et le monde profane, il y a le monde sacré. » Tout, alors, est bien une question de timbre et d’intonation. La justesse du scintillement d’écume est dans le mouvement antérieur de la vague. « La culture de l’écrivain ne doit pas se répandre dans sa prose mais ennoblir le timbre de sa phrase. » Ainsi faut-il également entendre le monde, comme l’œuvre d’un écrivain « qui nous invite à comprendre son langage, et non à le traduire dans le langage de nos équivalences. » Cette leçon d’humilité et d’orgueil, humilité face au monde et orgueil apparent face à l’arrogance moderne, nous invite à la seule aventure essentielle qui est d’être au monde, comme l’écriture même du monde, nous mêmes Scolies du texte implicite du monde qu’il nous appartient de déchiffrer.
Le monde, disent les Théologiens médiévaux, est « la grammaire de Dieu. » C’est ainsi que nous perdons ou gagnons en même temps Dieu et le monde, de même que nous perdons en même temps (ou gagnons) la compréhension d’Homère et des Évangiles. « Lorsque le bon goût et l’intelligence vont de pair, la prose ne semble pas écrite par l’auteur, mais par elle-même. » Que nous dit le texte implicite sinon notre propre secret qui est le secret du monde ? Tout se joue alors dans la voix, la voix unique, irremplaçable, celle de l’amour divin (« Nous ne sommes irremplaçables que pour Dieu ») ; la plus irrécusable preuve de l’Un étant que toute chose, tant que demeurent les droits imprescriptibles de l’âme, est unique. Point de feuille dont les nervures fussent exactement semblables à sa voisine. Le grand mythe moderne, au sens de mensonge, tient dans cette lâcheté, cette paresse face à l’interprétation qui sans fin hiérarchise les êtres et les choses du plus épais jusqu’au plus subtil. Le Moderne veut croire à tout prix que le monde est inintelligible pour pouvoir le saccager à sa guise. Le bonheur et le malheur est qu’il en est rien. Tout est écrit, et nous ne faisons qu’ajouter la ponctuation. « Mes phrases concises sont les touches d’une composition pointilliste. » L’implicite ne serait alors que le non-encore ponctué. « Si l’univers est d’une lecture malaisée, ce n’est pas qu’il soit un texte hermétique, mais parce que c’est un texte sans ponctuation. Sans l’intonation adéquate, montante ou descendante, sa syntaxe ontologique est inintelligible. »
Il n’est point de question de sens qui ne soit une question de style, d’intonation. Or, les questions de sens sont sans solution, alors que les questions de style se prouvent à chaque instant. « Cohérence et évidence s’excluent. » Toute justesse ne saurait apparaître que sous les atours du paradoxe ou du scandale. Lorsque la pensée est justement ponctuée, elle heurte de front cette inclination unanimiste du démocrate pour qui seuls l’informe et l’indistinct sont aimables. « Maint philosophe croit penser parce qu’il ne sait pas écrire. » La quête de la juste ponctuation, de l’intonation adéquate dépasse non seulement l’opinion commune, et même l’opinion minoritaire, elle dépasse du même élan les idées, les théories, les systèmes. « Le malheur de celui qui n’est pas intelligent, c’est qu’il n’y a pas d’idées intelligentes. Des idées qu’il suffirait d’adopter pour se mettre à la hauteur de l’homme intelligent. » Le dessein de Gómez Dávila n’est pas de faire partager ses idées, de les mettre en circulation, comme une monnaie frappée à son effigie, mais de rendre possible une méditation sur la « cohérence » qui échappe à l’évidence, sur « implicite » que ses Scolies désignent et dissimulent. « Si l’on veut que l’idée la plus subtile devienne stupide, il n’est pas nécessaire qu’un imbécile l’expose, il suffit qu’il l’écoute. » Le silence autour du livre de Gómez Dávila serait donc d’excellent aloi s’il ne préjugeait toutefois à l’excès de l’écoute des imbéciles et de la surdité des intelligents.
« Je ne suis pas un intellectuel moderne contestataire mais un paysan médiéval indigné. » Si le mot rebelle voulait encore dire quelque chose, l’exégète des Scolies pourrait en faire usage ; tel n’est pas le cas. Demeure à travers ce qui est dit la possibilité offerte de n’être pas soumis au temps, d’imaginer ou de se souvenir d’une cohérence du monde, mystérieuse et sensible à « l’intonation montante ou descendante. » L’implicite des Scolies est une mise-en-demeure à la recouvrance de l’histoire sacrée, c’est-à-dire d’une histoire qui ne se réduit pas à « l’incertitude de l’anecdote » ni à la « futilité des chiffres. » En ce sens, « les ennemis du mythe ne sont pas les amis de la réalité mais de la banalité », le mythe n’étant pas alors le mensonge, mais bien la réverbération du vrai, la beauté suspendue entre l’immanence ingénue de notre race et la transcendance universelle. Tout écrivain digne de ce nom récite une mythologie d’autant plus réelle, au sens platonicien, c’est-à-dire d’autant plus vraie, qu’elle lui est plus personnelle, se proposant à lui presque par inadvertance, comme une fatalité heureuse. « Les penseurs contemporains sont aussi différents les uns des autres que les hôtels internationaux dont la structure uniforme se pare superficiellement de motifs indigènes. Alors qu’en vérité seul est intéressant le particularisme qui s’exprime dans un langage cosmopolite. »
La meilleure façon de favoriser la haine fanatique des hommes entre eux est de favoriser leur ressemblance, de les confronter en autrui à l’image détestée d’eux-mêmes. L’universalisme, ce péché qui, selon le mot de Gustave Thibon, consiste « à vouloir faire l’Un trop vite » devient alors, faute d’adversaire loyal, le principe d’une catastrophe immense, de même que « la libération totale est le processus qui construit la prison parfaite. »
Entre le principe universel du christianisme et l’héritage culturel, où bruissent encore les feuillages orphiques, les armes de l’Iliade et les écumes de l’Odyssée, les pensives sagesses pythagoriciennes ou la souveraineté intérieure de Marc-Aurèle, la liberté de Gómez Dávila sera de ne pas choisir. « La structure des relations entre christianisme et culture doit être paradoxale. Tension dynamique des contraires. Non pas fusion où ils se dissolvent mutuellement, ni capitulation d’aucun des deux. » On aura compris que ce « réactionnaire », dont les « saints patrons » sont Montaigne et Burckhardt, cet adversaire déclaré de la démocratie, en tant que « perversion métaphysique » est, par cela même, le contraire d’un fanatique. « Ne flattent le Peuple que ceux qui mijotent de lui vendre ou de lui voler quelque chose. » Face à la démagogie (« Démagogie est le mot qu’emploie les démocrates quand la démocratie leur fait peur »), il n’y a guère que l’aristocratie, celle-ci toutefois, étant définie, non en termes sociologiques, mais rigoureusement métaphysiques comme une possibilité universelle : « Le véritable aristocrate est celui qui a une vie intérieure. Quels que soient son origine, son rang ou sa fortune. L’aristocrate par excellence n’est pas le seigneur féodal dans son château, c’est le moine contemplatif dans se cellule. » Et ceci encore : « Au milieu de l’oppressante et ténébreuse bâtisse du monde, le cloître est le seul espace ouvert à l’air et au soleil. » Les Scolies apparaîtrons ainsi, à qui voudra bien en répondre, comme les signes de la présence de ces cloîtres détruits, de ces temples saccagés, mais dont les cryptes demeurent, textes implicites, de nos vies intérieures imprescriptibles.
Nicolás Gómez Dávila, Les Horreurs de la démocratie.
Éditions du Rocher, collection Anatolia.
圆
INTRODUCCIÓN A LOS ESCOLIOS DE NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA
«Las dos alas de la inteligencia son la erudición y el amor».
Nicolás Gómez Dávila es uno de esos raros autores que tienen a sus lectores en tan alta estima que sólo le ofrecen lo mejor de sí mismos. El verdadero título de estas formas breves, que no son ni aforismos ni sentencias, reunidas bajo el título de Los horrores de la democracia (elección de editor no exenta de un toque de sana provocación) es Escolios a un texto implícito. Esos «escolios» tienen por regla no dejar adivinar del pensamiento sino la afinada punta, y, por virtud, la generosidad de suponer en el lector la inteligencia y el arte de desplegar, a partir de esas afinadas puntas, un texto que está al mismo tiempo ausente y presente, implícito, es decir, que se brinda, sin por esto revelarse.
Toda obra digna de nuestra atención se asemeja a la parte emergente del iceberg: lo que dice es sólo una señal de lo que no dice. Lo implícito es, por lo general, el sello de la alta literatura, lo que la distingue de la información, las humanidades y la palabrería, donde lo que no se dice vale aún menos que lo que se dice. Cuando la palabra escrita se eleva al rango de la palabra hablada, cuando las páginas son como la reverberación del Logos-Rey, el más pequeño destello da testimonio del abismo luminoso del Cielo. Lo que se dice está, en cierto modo, exaltado por el poder de lo que no se dice, tal como el balanceo de la ola está en armonía con el magnetismo de las mareas. Ahora bien, en lo que atañe a ese poder, la eminente generosidad de Nicolás Gómez Dávila lo pone desde el principio en armonía con su lector, sin preocuparse por ninguna otra cualificación externa. Este supuesto «antidemócrata» plantea como un a priori teórico a su obra, a su «método» (en el sentido en que Valéry habla del «método» de Leonardo da Vinci), la posibilidad de que cualquier hombre preocupado por tener vida interior lo comprenda. «Los hombres son menos iguales de lo que dicen y más de lo que piensan». Aquí la lógica es exactamente la opuesta a la del «demócrata» fundamentalista que afirma teóricamente la igualdad de todos, no sin arrogarse el magisterio de la definición de la igualdad y, en consecuencia, una superioridad absoluta que, en política, sólo podría traducirse por la generalización de los métodos policiales. «El Estado moderno realizará su esencia cuando la policía, como Dios, presencie todos los actos del hombre».
Los Escolios de Gómez Dávila son una obra de combate. Lo que está en juego es nada menos que la dignidad y la libertad humanas, pero, a diferencia de tantos otros que machacan con las palabras «dignidad» y «libertad», Gómez Dávila no pacta con las fuerzas que las desnaturalizan y las arruinan. No perdamos el tiempo con los cuzcos del periodismo mediocre que se les echó a los faldones de ese libro magnífico: sólo existen para ilustrar su pertinencia: «El demócrata no considera que sus críticos desaciertan, sino que blasfeman». Esta figura del Moderno, a quien Gómez Dávila llama el «demócrata» (no como partidario, aclara, de un sistema político sino como defensor de una «perversión metafísica») puede, en efecto, definirse aquí como fundamentalista en la medida en que solamente alaba el «debate», la «discusión», el «pólemos» con la condición imperativa de que aquellos con los que está permitito debatir, discutir y polemizar sean ya, desde mucho tiempo atrás y de manera notoria, de la misma opinión que él; y que lo sean, además, con el mismo vocabulario, las mismas retóricas y, si es posible, las mismas entonaciones, el mismo estilo o, más probablemente aún, la misma falta de estilo. El demócrata fundamentalista sólo «razona», así, dentro de los límites de su locura procusteana; su amor por la humanidad «en general» sólo se realiza mediante el desprecio por el individuo; sólo estima la libertad de expresión cuando está estrictamente reservada a los que no tienen nada que decir; para él, la «dignidad» humana sólo merece que se la defienda cuando se lo hace en favor de quienes se burlan de ella y se envilecen por puro capricho.
«A los ojos del demócrata, el que no se envilece resulta sospechoso*». No hay ningún escritor un poco libre que no experimente a diario esa sospecha. Incluso si se mantuviera alejado de las ideas ofensivas, el simple giro de una frase, una palabra en un sentido un poco anticuado, una vaga nostalgia o el rechazo a considerar el mundo contemporáneo como el parangón de todas las virtudes y la fuente de todos los bienes bastan para designarlo como sospechoso. La crítica literaria, que debería situarse entre la metafísica y el hedonismo, entre la sabiduría y el placer, entre la verdad y la belleza, se reduce tristemente a meras fanfarronerías moralizantes o a una fastidiosa retórica de fiscal o abogado, como si ya no se pudiera leer una novela o un ensayo sin ponerlos en el banquillo de los acusados, como si todo sentimiento de gratitud se hubiera desvanecido de los corazones humanos para dar lugar únicamente a las manías de un Fouquier-Tinville sin relevancia ni coraje. «Los individuos, en la sociedad moderna, son cada día más parecidos los unos a los otros y cada día más ajenos entre sí. Mónadas idénticas que se enfrentan con individualismo feroz».
El crítico moderno es un hombre que, para ejercer su función, no debe conocer ni el remordimiento ni la misericordia, sino enamorarse locamente de la cantinela leguleya a la que se reducen ahora todas las formas de Eris. Traspuesta en mezquindad, la agresividad moderna toma el rostro zalamero del pensamiento políticamente correcto, es decir, del «pensamiento» colectivo, gregario, tan hosco, obtuso y oscurantista en la «aldea global» como lo fue en los «pueblos» imaginados por burgueses liberales, poblados, naturalmente, por un campesinado torvo y cruel, y por horribles chuanes enemigos de la libertad. El Moderno, cuando describe a su enemigo, se describe a sí mismo. Ese «arcaico», ese «supersticioso», ese «adversario de la razón» es él mismo. Cuanto más se llama a sí mismo «demócrata», más desprecia a ese «pueblo», al que no concede más poder que el de la situación de hecho, que él llama «voluntad general», por pura hipocresía. «Voluntad general es la ficción que le permite al demócrata pretender que para inclinarse ante una mayoría hay otra razón que el simple miedo».
La composición puntillista de los Escolios, que mezcla ideas éticas, estéticas y políticas, impidió tratar cada área como una región separada. Lo bueno, lo bello y lo verdadero son indisociables. El esteta es siempre moralista y político. «El mundo moderno es un levantamiento contra Platón». Por lo tanto, le corresponde al «reaccionario», tal como lo define Gómez Dávila (cuya vocación es ser «el asilo de todas las ideas desterradas por la ignominia moderna»), trabajar para la recuperación del platonismo, no como sistema filosófico (suponiendo que existiera un «sistema» platónico fuera de los apuntes de algunos pedagogos, demasiado ansiosos por enseñar lo que no saben, para leer los Diálogos) sino como una experiencia metafísica fundamental de la lectura (lectura del mundo tanto como lectura de libros). «Detrás de todo apelativo se levanta el mismo apelativo con mayúscula: detrás del amor el Amor, detrás del encuentro el Encuentro. El universo se evade de su cautiverio, cuando en la instancia individual percibimos la esencia».
Lo político, para Gómez Dávila, no es el fin del pensamiento, ni siquiera su comienzo. El pensamiento se sitúa en una zona intermedia, más o menos frecuentable según las épocas, entre lo metafísico y lo perceptible, entre la teoría y el gusto. «Todo es trivial si el universo no está comprometido en una aventura metafísica». Esa trivialidad, sin embargo, no es en absoluto trivial, en el sentido de que sería insignificante: es horrible. Nos libra a la esclavitud y a la fealdad, peor aún: a una esclavitud y a una fealdad siempre idénticas a sí mismas, como en una catástrofe o una pesadilla, con el pretexto del «cambio» y la «novedad». «El mundo moderno ha llegado a institucionalizar el cambio, la revolución, el anticonformismo con una astucia tal que cualquier intento de liberación es una rutina inscrita en el reglamento de la prisión*».
Ese «cambio», es decir, ese odio a la Tradición, que es lo propio del Moderno, ese culto a la amnesia, ese olvido del olvido, es tal que olvida su propia identidad consigo mismo. El olvido del olvido es esa pura nada inmóvil que se imagina como un cambio perpetuo, en otras palabras, como un presente sin presencia. Así es como «las democracias describen un pasado que nunca existió y predicen un futuro que nunca se realiza.»
Cuando la política se destruye a sí misma mediante la cobardía, cuando el Logos se profana mediante la propaganda y la publicidad, cuando la alquimia inversa transforma el oro del amor puro en el plomo de la «convivialidad» obligatoria, caemos bajo el yugo de esa casta que pretende no ser tal y cuyo amor por la humanidad en general es el pretexto para no tener que amar a nadie en particular, cuya «tolerancia» abstracta es la astucia para no tener que perdonar nunca una ofensa y la «apertura a los demás» es la primera condición para eximirse de cualquier magnanimidad. La ideología «ciudadana» hace las veces de indulgencia, sin que los Pobres se beneficien en lo más mínimo.
Si bien para Gómez Dávila la política es imposible, esto es una razón suplementaria para interesarse en ella, pero en forma individual. «La lucha contra el mundo moderno tiene que ser solitaria. Donde haya dos hay traición». Aquí pensamos en la frase de Montherlant: «En cuanto los hombres se juntan, trabajan para fomentar algún error». Sea como sea, hubo momentos en los que el orden político parecía destinado a evitarnos lo peor, en la medida de lo posible. Lo peor, es decir, el nihilismo, el totalitarismo, el terror. «La democracia tiene el terror por medio y el totalitarismo por fin». Sin embargo, el «totalitarismo» y el «terror» no lo dicen todo sobre lo que constituye lo peor. El demócrata nunca deja de hablar de lo peor, de afirmar que él es un baluarte contra este último, cuando resulta ser su condición, su premisa. Lo peor es aquello en lo que el hombre se convierte, en lo que todos los hombres se convierten, cuando la contemplación desaparece del mundo, cuando el trato entre los hombres no tiene otro objeto que la economía. «La ausencia de vida contemplativa convierte la vida activa de una sociedad en tumulto de ratas pestilentes». De aquello mediante lo cual el lenguaje brinda testimonio de la contemplación, y de esa alegría profunda, ambarina y luminosa del Logos-Rey, poco es decir que el Moderno ya no quiere ni oír hablar. Desea que su mundo carezca de fallas, que sea compacto y masivo, es decir, lo desea reducido a sí mismo, a su pura inmanencia, en otras palabras, reducido a la opinión que los más tontos e irreflexivos tienen de él. «El Moderno se niega a escuchar al reaccionario, no porque sus objeciones le parezcan inadmisibles, sino porque no le resultan inteligibles*».
A medida que ese espacio de lo ininteligible se expande, se expande la desdicha. La sabiduría y la alegría, el fervor y la sutileza, los matices y las gradaciones, relegados a márgenes cada vez más distantes, o sumidos en un secreto cada vez más profundo, sólo les hacen señas a los pocos afortunados que se consagran a una regla de arte o religión. «Quien se respeta a sí mismo sólo puede vivir hoy en los intersticios de la sociedad*». Más que un pensamiento «reaccionario», en el sentido restringido del término (el que sin embargo hay que atreverse, de vez en cuando, a alzar como estandarte, pero el correcto), los Escolios de Gómez Dávila restablecen los derechos inmemoriales de un gran pensamiento libertario y aristocrático, que combina, en la exigencia de su estilo, «la dureza de la piedra y el temblor de la rama». ¿Qué dice esa dureza, que no es dureza de corazón? Nos dice que, para ser, debemos resistir a lo informe, amar el brillo, la precisión lapidaria, y quizás incluso la piedra que vence a ese Goliat que es el mundo moderno.
Gómez Dávila, sin embargo, no prevé una victoria temporal. «El reaccionario no argumenta contra el mundo moderno esperando vencerlo, sino para que los derechos del alma no prescriban». Al igual que el texto, la victoria es implícita, secreta. Porque si los derechos del alma siguen siendo imprescriptibles, el Moderno resulta efectivamente derrotado y sus triunfos no son más que nubes. A la imprescriptibilidad de los derechos del alma, el Moderno quiso oponer los «derechos humanos», otra engañifa, porque el derecho a algo general y abstracto resulta irrisorio ante la fuerza, cosa que Demóstenes ya sabía. Ahora bien, el derecho del alma es, a cada momento, lo que experimentamos. Para empezar, en la remembranza, que es más amplia que nosotros: «Alma culta es aquella donde el estruendo de los vivos no ahoga la música de los muertos». Contrariamente a los «derechos humanos», los derechos del alma, de esa alma que exalta y aligera, no ofrecen ninguna solución. «Los problemas metafísicos no acosan al hombre para que los resuelva, sino para que los viva».
Quizás en esta manía moderna de querer encontrar «soluciones», de dejar atrás los «problemas», en tiempos pasados, de creerse más listo por no interesarse en nada, hay un inmenso cansancio de vivir. Ese Moderno, que nunca deja de alabar la «vida» y el «cuerpo», los reduce a muy poca cosa. ¿Qué significa para él esa «vida» si no la ve como el resplandor de una gradación hacia la eternidad, qué significa ese «cuerpo» del que tiene una conciencia tan fuerte, si no es un cuerpo enfermo, y enfermo de haber olvidado que no es el alma la que está en el cuerpo sino el cuerpo el que está en el alma? Con el pretexto de que algunos creyeron mediocremente en Dios, llamando «Dios» a su propia mediocridad, el Moderno no quiere creer más que en el «hombre», pero «si el hombre es el único fin del hombre, una reciprocidad inane nace de ese principio como el mutuo reflejarse de dos espejos vacíos». Es del todo vano que Modernos y antimodernos busquen río arriba, en la historia de la filosofía, precursores dignos del mundo moderno. Dejemos a Spinoza, Hegel, e incluso a Voltaire donde están. El verdadero precursor del mundo moderno es, por supuesto, el señor Perogrullo. El Moderno no es en absoluto panteísta, dialéctico o ironista, es «perogrullista». Su filosofía es de las más claras: el hombre no es más que el hombre, la vida no es más que la vida, el cuerpo no es más que el cuerpo. Éste es, realmente, el pensamiento moderno en todo su esplendor, que nos exige que quememos, como obsoletas y nefastas, todas las filosofías, todas las religiones, todas las artes que durante algunos milenios, en todo el mundo, le hicieron a la humanidad la abominable afrenta de enseñarle la complejidad, los matices, las relaciones y las proporciones, cosas todas ellas vanas, en efecto, para los que sólo quieren destruir.
Estos Escolios a un texto implícito deben ser leídos así, no sólo como una serie de lúcidas ideas en forma de ejercicios de desengaño, en la línea de nuestros mejores moralistas, como Vauvenargues o Rivarol, sino también como un Arte de la Guerra, un tratado de combate contra los «perogrullistas». «Es demócrata el que espera que lo exterior le fije metas.» Contra la pasividad de las tautologías y contra el reinado de la cantidad que ella instaura, es tan sólo a la vida interior, al alma imprescriptible del lector, a quien corresponde, en esa soledad esencial que es la verdadera comunión, matizar con un imprevisible rayo de sol, es decir, con una esperanza implícita pero dispuesta a entrar de un salto en el mundo, estos Escolios que una mirada distraída adjudicaría únicamente al pesimismo.
Tanto más perturbadores, fortificantes y saludables son estos Escolios, cuanto que lo que no dicen se abre camino en nosotros sin que lo sepan los censores. «Sólo conspiran eficazmente contra el mundo actual quienes propagan en secreto la admiración por la belleza*».
Ya sabemos qué será de esa belleza y de esa admiración. «Nunca es demasiado tarde para nada verdaderamente importante.» De este modo, Gómez Dávila opera una especie de inversión del pesimismo, que ya no es sólo la aguda punta de la lucidez, sino la de una audacia reconquistada contra la insistencia interminable en la vanidad de todas las cosas. Por cierto nos hemos adentrado mucho en la noche del mundo, en la trampa moderna («La humanidad cayó en la historia moderna como un animal en una trampa»), pero si nunca es demasiado tarde para algo realmente importante, ¿no quiere decir esto que toda la esperanza del mundo puede concentrarse en un punto? «Un gesto, un gesto solo, basta a veces para justificar la existencia del mundo.» Este pensamiento batallador y culto, polémico y erudito, es, sobre todo, un pensamiento amoroso. El combate contra la uniformidad, el estudio erudito que distingue y honra la prodigiosa diversidad son todas salvaguardas del amor. «El amor es el órgano con que percibimos la inconfundible individualidad de los seres». Ahora bien, esa «individualidad irremplazable» no es sino la belleza. «La belleza del objeto es su verdadera sustancia.» Ésta no pertenece a la duración, así como la tradición no pertenece a la perpetuidad, sino al instante. «La eternidad de la verdad, como la eternidad de la obra de arte, son ambas hijas del instante.» El instante se ofrece solamente a quien lo atrapa al vuelo, cazador sutil que discierne en el mundo ruidos que se transforman en música, por debajo o más allá del estrépito obligatorio (el mundo moderno es ruidoso como lo son las prisiones). «Las cosas no son mudas. Meramente seleccionan a sus oyentes.» La utopía del «todo para todos», invertida en la realidad del «nada para nadie», llega entonces al punto de calumniar a las cosas mismas, tanto las mudas como las que hablan. La verdadera bondad nunca es general, así como «Dios no está en el mundo como una roca en un paisaje tangible, sino como la nostalgia en un paisaje pintado.» La verdadera bondad ocurre en lo impredictible: «Para despertar una sonrisa en una faz adolorida me siento capaz de cualquier bajeza.»
Así como los Escolios son las cimas del discurso, su «allende» salvador, la verdadera magnanimidad es el más allá de la moralidad general, el surgimiento del conocimiento del Uno en el instante mismo, la pura fulgor donde la libertad absoluta se encuentra con la sumisión al Reino de Dios. «El que habla de las regiones extremas del alma necesita pronto un vocabulario teológico.» El pensamiento de Gómez Dávila, de naturaleza teológica, no deja de guardar la distancia con lo que Gustave Thibon llamaba «narcisismo religioso», esa inclinación fatal a ver en la Iglesia ante todo una comunidad humana, con sus administraciones, su sociología y su oportunismo. «La obediencia del católico se ha trocado en una infinita docilidad a todos los vientos del mundo.» Poco importa, por otra parte: «Un solo concilio no es más que una sola voz en el verdadero concilio ecuménico de la Iglesia, que es su historia total.» Ahora bien, para Gómez Dávila esa historia total incluye a los dioses anteriores. La Ilíada y Pitágoras están más cerca de él que esa Iglesia que «no estrecha a la democracia en sus brazos porque la perdona, sino para que la democracia la perdone.»
Lo sagrado tiene que «brotar como un manantial en el bosque y no como una fuente pública en una plaza*». Frente al mundo moderno, «ese espantoso acostumbramiento al mal y a la fealdad*», la discordia entre paganismo y cristianismo aparece como secundaria y artificial. «El cristianismo es una insolencia que no debemos disfrazar de amabilidad.» No estará prohibido volver esa insolencia contra los «representantes» del propio cristianismo: «No habiendo logrado que los hombres practiquen lo que enseña, la Iglesia actual ha resuelto enseñar lo que practican.» El mundo griego se presenta entonces como «el otro Antiguo Testamento», al que no es inoportuno recurrir porque «entre el mundo profano y el mundo divino, hay un mundo sagrado.» Todo, entonces, no es más que cuestión de matiz y entonación. La precisión del brillo de la espuma está en el movimiento previo de la ola. «La cultura del escritor no debe volcarse en su prosa, sino ennoblecer el timbre de su frase*». De igual modo, por tanto, hay que entender el mundo, como la obra de un escritor que «nos invita a entender su idioma, no a traducirlo en el idioma de nuestras equivalencias.» Esta lección de humildad y de orgullo, humildad ante el mundo y orgullo visible ante la arrogancia moderna, nos invita a la única aventura esencial, que es la de ser en el mundo, como la escritura misma del mundo, Escolios, nosotros mismos, del texto implícito del mundo que nos corresponde descifrar.
El mundo, dicen los teólogos medievales, es «la gramática de Dios». Así es como perdemos o ganamos, al mismo tiempo, a Dios y al mundo, tal como perdemos (o ganamos), al mismo tiempo, la comprensión de Homero y los Evangelios. «Cuando el buen gusto y la inteligencia conciertan, la prosa no parece escrita por un autor, sino por ella misma». ¿Qué nos dice el texto implícito sino nuestro propio secreto, que es el secreto del mundo? Todo se juega entonces en la voz, la voz única, irremplazable, la del amor divino («Tan sólo para Dios somos irreemplazables»); siendo la más irrefutable prueba del Uno que todo, mientras se mantengan los derechos imprescriptibles del alma, es único. No existe una hoja cuyas nervaduras puedan ser exactamente iguales a las de la hoja que tiene lado. El gran mito moderno, en el sentido de mentira, reside en esa cobardía, esa pereza frente a la interpretación, que jerarquiza sin cesar los seres y las cosas, de lo más basto a lo más sutil. El Moderno quiere creer a toda costa que el mundo es ininteligible para poder saquearlo a su antojo. La suerte y la desgracia consisten en que no es así de ningún modo. Todo está escrito, y nosotros sólo añadimos la puntuación. «Mis frases concisas son las pinceladas de una composición puntillista*». Lo implícito sólo sería entonces lo aún no puntuado. «El universo no resulta de lectura difícil porque sea texto hermético, sino porque es texto sin puntuación. Sin la entonación adecuada, ascendente o descendente, su sintaxis ontológica es ininteligible.»
No hay problema de sentido que no sea un problema de estilo, de entonación. Pero los problemas de sentido no tienen solución, mientras que los problemas de estilo se prueban a cada momento. «La coherencia y la evidencia se excluyen mutuamente*». Toda precisión sólo puede aparecer engalanada con la paradoja o el escándalo. Cuando el pensamiento está puntuado con precisión, choca de frente con la inclinación unanimista del demócrata, para el que sólo lo amorfo y lo indistinto resultan deseables. «Mucho “filósofo” cree pensar porque no sabe escribir». La búsqueda de la puntuación precisa, de la entonación adecuada, va más allá de la opinión común e incluso de la opinión minoritaria; va más allá, con el mismo ímpetu, de las ideas, las teorías y los sistemas. «La desventura del que no es inteligente es que no haya ideas inteligentes. Ideas que bastara adoptar para emparejar con el inteligente». El objetivo de Gómez Dávila no es compartir sus ideas, ponerlas en circulación, como una moneda acuñada con su efigie, sino hacer posible una meditación sobre la «coherencia» que escapa a lo evidencia, sobre lo «implícito» que sus Escolios indican y disimulan. «Para que la idea más sutil se vuelva tonta, no es necesario que un tonto la exponga, basta que la escuche». El silencio en torno al libro de Gómez Dávila sería por lo tanto algo excelente, si no previera, sin embargo, en exceso la escucha de los imbéciles y la sordera de los inteligentes.
«No soy un intelectual moderno inconforme, sino un campesino medieval indignado». Si la palabra rebelde aún significase algo, el exégeta de los Escolios podría usarla; pero no es así. Detrás de lo que se dice subsiste la posibilidad brindada de no estar sometido al tiempo, de imaginar o de recordar una coherencia del mundo, misteriosa y sensible a «la entonación ascendente o descendente». Lo implícito de los Escolios es una intimación a recuperar la historia sagrada, es decir, una historia que no se reduce a la «incertidumbre de la anécdota» ni a la «futilidad de los números». En ese sentido, «los enemigos del mito no son amigos de la realidad sino de la trivialidad», ya que el mito, entonces, no es la mentira, sino la reverberación de lo verdadero, la belleza suspendida entre la inmanencia ingenua de nuestra raza y la trascendencia universal. Todo escritor digno de ese nombre recita una mitología tanto más real, en el sentido platónico, es decir, tanto más verdadera, cuanto que le resulta más personal, que se le brinda, casi sin darse cuenta, como una afortunadda fatalidad. «Los pensadores contemporáneos difieren entre sí como los hoteles internacionales, cuya estructura uniforme se adorna superficialmente con motivos indígenas. Cuando, en verdad, sólo es interesante el localismo mental que se expresa en léxico cosmopolita».
La mejor manera de fomentar el odio fanático de los hombres entre ellos es fomentar su semejanza, confrontarlos en el otro con la imagen detestada de sí mismos. El universalismo, ese pecado que, en palabras de Gustave Thibon, consiste en «querer realizar el Uno demasiado rápido», se convierte entonces, a falta de un adversario leal, en el principio de una inmensa catástrofe, así como «la liberación total es el proceso que construye la prisión perfecta*».
Entre el principio universal del cristianismo y la herencia cultural, donde murmuran aún el follaje órfico, las armas de la Ilíada y la espuma de mar de la Odisea, las pensativas sabidurías pitagóricas o la soberanía interior de Marco Aurelio, la libertad de Gómez Dávila consistirá en no elegir. «La estructura de la relación entre el cristianismo y la cultura debe ser paradójica. Una tensión dinámica de los opuestos. Ni fusión donde se disuelven el uno al otro, ni capitulación de ninguno*». Ya se habrá comprendido que este «reaccionario», cuyos «santos patrones» son Montaigne y Burckhardt, este declarado adversario de la democracia como «perversión metafísica», es, por eso mismo, lo contrario de un fanático. «Al pueblo no lo elogia sino el que se propone venderle algo o robarle algo». Frente a la demagogia («Demagogia es el vocablo que emplean los demócratas cuando la democracia los asusta»), casi no hay más que la aristocracia, definida ésta, sin embargo, no en términos sociológicos, sino rigurosamente metafísicos, como una posibilidad universal: «Verdadero aristócrata es el que tiene vida interior. Cualquiera que sea su origen, su rango, o su fortuna». «El supremo aristócrata no es el señor feudal en su castillo, sino el monje contemplativo en su celda». Y, además, esto: «En el lóbrego y sofocante edificio del mundo, el claustro es el espacio abierto al sol y al aire». Los Escolios se presentarán así, a quien quiera dar fe de ellos, como los signos de la presencia de esos claustros destruidos, de esos templos saqueados, pero cuyas criptas subsisten; textos implícitos de nuestras imprescriptibles vidas interiores.
Traducción, autorizada por el autor, de Carlos Cámara y Miguel Ángel Frontán
NOTA de los traductores:
Hemos señalado con un asterisco las citas de Gómez Dávila que nos hemos resignado a traducir del francés, puesto que no hemos podido hallar el original en español.
00:04 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
19/08/2024
Luc-Olivier d'Algange, Heures et syrtes de de feu, poème:

Heures de syrtes et de feu, heures aimées…
En hommage à Maurice Scève
Heures de syrtes et de feu, heures aimées…
Des univers y battent leurs feuilles sous la pluie si claire,
Laudes écrites contre la brume et dans le marbre de l’air.
Quelle enfance en poussière dans le sommeil léger ? Les regards
Mystérieusement se rencontrèrent dans l’intimité du monde,
Et cet être du vent sur le dos des tempêtes nous emporte
Vers l’exquise incertitude qui nous laisse dans l’abandon
Comme une barque tardive, vaguement oscillante
Sous la blancheur du ciel, nous laisse être
Avec le seul souvenir des temps où nous n’étions rien,
Sinon cette ombre du chant qui nous précède, cette ombre
D’un temps où fleurissent les patries des terres dorées
Dites, de degré en degré, jusqu’aux fortins paradisiaque !
La nostalgie change les proportions du monde.
Depuis des temps immémoriaux, la nuit est mauve.
Les nuages se sont habitués aux cadrans des Jardins.
Notre tourment s’achève avec les grands vaisseaux du siècle
Qui pavoisent… La sagesse n’est point jalouse, mais éblouie.
Elle est l’hôte de l’heure déployée, de l’heure ardente,
De l’heure frémissante sous le joug des anciennes nuées…
Nous serons en elle, à jamais, et pour elle, et contre le monde !
Six feuilles entrelacées en épine dans l’incohérence des mots
Suffisent à notre bonheur, à notre gloire ! Six feuilles nervurées
D’un sang qui déchiffre les clartés de l’ombre
Lorsque nous marchons sur le profil de l’aube …
Ce furent ces aventures dites, où le double du firmament
S’abolit dans la nuit de l’azur, dans la ténèbre qui sauve la raison,
La seule qui nous dise la courbe claire de la musique, des navires…
Ainsi j’éveille doucement ce sommeil, je l’éveille de lui-même
Comme une lueur, comme un combat de pierres noires sur les rives nues.
Cela demeure, et ne nous quitte jamais. Cela demeure
Dans le passage du soleil comme l’apocalypse joyeuse
Des chants d’oiseaux au matin, dans l’entrelacs des six feuilles
Brodées d’absolutions et de chimères, mais seules vraies
Dans le bien qui nous est offert, dans la beauté de l’œuvre
Qui tient en elle la beauté du monde, tenue comme six feuilles
Du sommeil polaire entre les doigts, six feuilles insondables
Qui tressaillent des battements de la terre, où nous étions
De passage.
L’âme endure ces roseraies de tonnerre ! L’âme ne se lasse
D’être au seuil de l’effroi et de l’extase. Il n’y a que la bassesse qui se lasse,
L’infidèle à toute beauté, l’incessante traitresse aux oracles obscurs :
Les seuls qui vaillent. L’âme endure le sel de Typhon et la transparence
Qui brûle. Elle endure les abysses du bonheur, et les lentes processions
Vers la Somme incompréhensible des hauteurs. Elle endure,
Infaillible, et se forge, se gemme, sous le feu sifflant de la Sapience.
L’âme endure les désastres, mais devant l’âme, les désastres se courbent
Comme l’orgueil du vent sur la mer. De tant de siècles stellaires
Nous gardons mémoire, de tant de siècles de ravages : ils se courberont
Sur notre sein comme un jour se love dans le regard, comme une treille
Promise à d’autres ivresses inconnues s’établit dans le règne
D’un palais rouge crétois, comme encore ce qui passe dans ce qui demeure,
A l’infime : là où ce jour qui est nuit traverse le temps comme une vague ;
Nous y serons, à jamais, dans cette présence-là, sable fin et grandes aurores…
L’âme endure et l’espace des formes, et le soleil tournant
Qui démantèle le monde et le déploie comme une corolle
Eclose sous la caresse. Tant de violences l’âme endure,
Et tant de douceurs : comment y survivre, sinon dans l’Eclat ?
Luisent six feuilles entrelacées dans la pénombre qu’elles animent
Pointent six feuilles : le monde s’y tient.
Six feuilles sibyllines. De quel idiome, leurs nervures ? Il y eut
Ce mot comme une croix dans le ciel, cette marche vers la puissance
Que nomment les Parques, ce monologue sans fin dans la nuit
Qu’interroge le regard. Il y eut ces mots que ne disent ni la ruse
Ni le chancellement de l’existence dans la seconde aimée, rougeoyante
Comme d’elle-même devenue ce chiffre ordonné à la victoire !
Et cette bienheureuse doctrine des fougères, cette beauté infligée
Au théâtre sombre des heures, ce moment noir aux atours scintillants
De l’espace et du temps que nos prunelles, lumières gisantes ajournent
Pour de chant qu’il nous reste à dire… Six feuilles disparues, mais unies ;
Six feuilles dessinées sur l’arrière-pays où conduisent les routes colorées…
Six feuilles de vallées et d’étoiles. La terre vibrante comme un rubis
S’effondrait dans le vent du coucher comme un incendie, une ombre
Neuve à l’abordage du Soir où le sommeil dessine ses nervures, où l’attente
Dresse ses chapiteaux d’orage, où viennent se heurter les jardins et les guerres.
Cette folie était royale. Elle inondait nos larmes de lumière jaune. Elle élevait
Jusqu’au centre du monde ces routes, ces armées, ces noces prodigieuses.
Six feuilles d’or, six feuilles gravées par le feu dans l’air immobile,
Six feuilles, et voici que le jeu céleste obéit à nos cils, rumeurs donnée
Aux gorges vertes des aruspices. Les derniers empires vivent de cette clarté,
De cette sagesse claire. Les derniers empires appareillent au levant
Que détruisent les souvenir d’avoir aimé. Les derniers empires, les premiers,
Tombés sous la coupe transversale des règnes, en proie à leurs incertitudes,
Telles des strophes, des prairies renoncées au dieu inconnu…
Ces empires, sous l’aile double qui porte le mystère des vignes
Et des peuples affligés au nom des choses dernières ; ces empires
Qu’aucune trace sur les vagues à travers le temps, qu’aucune grandeur
Dans la genèse muette ne saurait dire, comme dans la gorge
Emprisonnée de ténèbres, le pôle de la voix s’exténue… Ces empires
Qui tiennent dans l’irisation de la goutte de rosée,
Mais que le monde, machine perpétuelle, ne contient ;
Ces empires de métamorphose et d’automne sans lune ; ces empires
Tropicaux et hyperboréens ; ces empires de baies rougissantes
Sur les mains ; ces empires qui passent doucement comme des songes,
Qui attendent avec des signes incertains ce point du jour suspendu
Au-dessus des forêts ; ces empires où l’obscur repos se mêle aux crinières
Foisonnantes des dionysies ; ces empires construits et détruits ; ces empires
Harassés, où des lumières siciliennes consentent à leurs dernières chances,
Il n’est pas un seul de leurs signes, un seul de leurs cris
Qui ne tiennent sur le Finistère de l’une des six feuilles que je dis.
L’intensité allège l’esprit. Point de fardeau qu’elle n’élève
Jusqu’à la plus haute branche du frêne du monde, où six feuilles frémissent.
Le vol prophétique clôt le crépuscule, et les ailes frôlent les feuilles ;
Les dieux irréversibles sont loin. Flèches ou flammes ? Qui devine ?
Encore d’autres violences, d’autres terreurs. Ne cesse le monde
Dans cette eau trouée par la bataille du jour : une colonne de gloire
Vers la profondeur ! Les dieux sont loin, mais je les nomme.
Quelque liturgie sabéenne cours dans la rumeur de mon sang.
Astarté fige le noir de ses roses d’ombre dans le détail de son tombeau.
Vive et tardive ! Des formes dansent sur les flots : elles se nomment Idées.
Le deuil ne trahit point la légende. L’intensité ne se dédit point :
Elle succombe à son propre bonheur et nous n’avons nul mal à en dire !
La première feuille fait signe dans l’orage. Proche, si proche, de son propre feu.
Le dieu de ses nervures hante la tristesse et le silence du serment :
Chaque fidélité dite témoigne de l’infidélité du monde.
La seconde feuille n’est point l’inconsolable : le Chœur est avec elle,
Et les voyages sur la mer calmée. Cette lueur de l’envers qui rédime
La douceur de l’avers, et la protège comme le bouclier de Vulcain,
Garde son blé en herbe. Mais la troisième feuille est comblée.
Sur elle la pluie ruisselle. La quatrième n’est point apostrophée par l’abîme.
La cinquième se tient entre une fille nue et l’étourdissante mémoire du monde.
La sixième, enfin, serait un mirage si le mirage n’était le monde.
Six feuilles mes Amis, pour ce long voyage… Six feuilles incorruptibles,
Six feuilles entrelacées sur les genoux, nouées
Dans la nuit turbulente, six feuilles vides comme le chagrin,
Et coupantes, six feuilles comme six flammes. L’une tient en elle
La mer qui va, l’autre le ciel qui tourne, l’autre encore la pensée qui domine,
L’autre une voix d’enfant, et l’autre encore ne tient que la brûlure de l’Ether…
De longtemps j’imaginais que la vie magnifique était écrite sur la sixième.
Funeste erreur : tout reste à dire. Soldat mérovingien, je tombe
Aux genoux d’Isis, s’il me plaît de nommer, comme en songe,
Cette présence immense. A la plus légère, mon destin ! Qu’il vague !
Elle se reconnaîtra, la rebelle au règne de Caliban, la jamais lasse
Pour bien et le vrai ; et que la beauté couronne
Comme un hiver d’Orient, le pâle azur !
Pour elle, ces feuilles de mon poème, ces ailes sixtes sises
Entre la perfection de l’aube et le sommeil de la terre.
Luc-Olivier d'Algange
21:40 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
17/08/2024
Luc-Olivier d'Algange, Antonin Artaud, toujours ardoyant:
Antonin Artaud, toujours ardoyant
Les plus profonds enseignements nous viennent sans doute des œuvres qui, adressant à notre entendement une mise-en-demeure radicale, se refusent à être édifiantes. Une défaillance, un refus, voire un effondrement, ou la conscience d'un effondrement collectif, sont alors la mesure, en précipices, de la plus haute exigence qui s'irise, comme en neiges éternelles, des hauteurs de l'âme, et interdit la réduction de l'écrit au rôle subalterne d'objet artistique.
« Nous ne sommes pas encore au monde », nous dit Antonin. Nous ne pensons pas encore dans une âme et un corps. Pire encore, nous pensons moins que nous ne pensions ; une force, une lucidité ont été perdues et toutes les évaluations, sciences, religions réduites à leurs écorces mortes, à leurs superstitions, travaillent encore à rendre impossible l'advenue du ressac de cette pensée entrevue par la brèche qu’Antonin Artaud décrit dans L'Ombilic des limbes et dans ses premières lettres à Jacques Rivière.
Ce que sa pensée ne peut faire — c'est-à-dire réduire son langage à l'édification d'une forme littéraire convenue — sera le principe de la puissance, d'une magie concrète qui débute par la conscience de l'œuvre-au-noir et dont le « théâtre alchimique » sera l'instrument de connaissance, non en termes scientifiques, mais rituels, selon l'ordre abyssal d'un sacré originel qui transparaît en feux noirs et feux de roue, selon la formule alchimique , à chaque ligne écrite.
Le livre que Françoise Bonardel vient de publier aux éditions Pierre-Guillaume de Roux, Antonin Artaud ou la fidélité à l'infini, se tient à la hauteur de cette mise-en-demeure. Plus encore que de parler de la vie et de l'œuvre d'Antonin Artaud, ce qu'elle fait admirablement, F. Bonardel nous parle de ce dont il est question dans cette vie et cette œuvre, « l'honneur vital » qui s'y trouve engagé, fidélité à l'infini.
Au-delà d'une analyse strictement universitaire qui prétendrait à une explication à partir d'analyses, l'auteur s'engage, et c'est ce qui rend ce livre passionnant, dans une interprétation, une herméneutique orientée vers une implication dans l'œuvre et dans la pensée agissante de l'œuvre, échappant ainsi au double écueil du mimétisme et de la distanciation.
Le diagnostic que fait Antonin Artaud est clair, sa critique du monde moderne, radicale. L'Occident moderne s'est effondré : « Nous vivons des temps tragiques et plus personne n'est à la hauteur de la tragédie ». Nous avons cessé de penser et d'être. Un envoutement pénombreux nous tient dans une abstraction restreinte, fallacieuse et mortifère, nous avons perdu « la culture cuivrée du soleil ». Seul, nous dit Antonin Artaud, « un homme en marche depuis toujours » peut dire la sapience perdue. À tant dénier la mort, et la dimension tragique qu'elle impose à chaque être et à chaque moment, l'Occident moderne a renié la Vie : « Réaliser la suprématie de la mort, n'équivaut pas à ne pas exercer la vie présente. C'est mettre la vie présente à sa place, la faire chevaucher divers plans à la fois, éprouver la stabilité des plans qui font du monde vivant une grande force en équilibre ».
L'Occident moderne est apostasie, reniement de ses ressources européennes, triste régression vers un état larvaire de docilité, « règne de l'On » comme disait Heidegger, ou du « dernier des hommes » dont parlait Nietzsche. De Nietzsche à Artaud, au demeurant, se tissent des affinités. « Quand le corps est blessé, écrit Artaud, c'est là qu'on trouve l'âme, l'Aigle et le Serpent ; totems protecteurs dont nous recevrons, ou non, la force de tout perdre ou de tout gagner — ce qui est peut-être la même chose.
Antonin Artaud dépossédé de tout — à commencer par l'usage utilitaire ou décoratif du langage — s'empare du “tout”, tellurique et ouranien, car ce “rien” qui lui reste n'est autre que la langue redevenue Soleil-Logos, puissance héliaque, fulgurance d'Apollon. On comprend mieux l'intérêt d'Artaud pour Apollonios de Thyane, Héliogabale ou le néoplatonisme solaire de l'Empereur Julien par lesquels il songera, je cite, à « retrouver et ressusciter les vestiges de l'antique culture solaire ».
Bien au-delà de la simple polémique antimoderne, la guerre d'Artaud est ontologique : « Ne jamais discuter, frapper avec ma richesse, ça se taira ». Le dénuement total est la richesse absolue. Tout est dans l'acte d'être qu'il faut révéler par une suite d'épreuves, au sens vrai initiatiques. La conscience aiguë de l'Hors d'atteinte de la pensée et de la défaillance du langage, la vision abrupte, fatale, de cet effondrement central, seront ainsi le principe de la reconquête, mot par mot, geste par geste, d'une intégrité et d'une pureté perdue par une civilisation d'individus que plus rien ne relie à un ordre supérieur. Civilisation envoûtée de l'intérieur par la représentation qu'elle se fait d'elle-même et qui la condamne à être tenue à distance, déportée, exilée à l'intérieur de l'exil lui-même, — là où la servitude volontaire nous installe, dans ce « partout-nulle-part », déraciné, où plus rien ne symbolise avec rien.
F. Bonardel, dans ce livre magistral, nous rappelle à cette évidence : si Antonin Artaud n'est pas “homme de Lettres”, si sa vie est, en soi, une insurrection et un cri, son œuvre ne saurait se réduire à un “cri” et s'avère être celle d'un très-grand écrivain français. Être « toujours ardoyant » dans le creuset philosophal où s'animent l'Aigle et le Serpent, tel fut le dessein gnostique d'Antonin Artaud, qui renouvelle à certains égard celui de Maurice Scève, en ses blasons et cosmogonies.
L'ouvrage de F. Bonardel approfondit magistralement ce dessein que l'on peut dire gnostique et alchimique, ce « voyage vers Tula », qui est aussi la mythique Thulée hyperboréenne, — autrement dit, le voyage vers ce qu'Antonin Artaud nomme la Vie, avec une majuscule, Mercurius alchimique. La Vie, pour Artaud, est magnétisation, émanation, irisation des dieux « qui jouent aux quatre coins sonnant du ciel, aux quatre nœuds magnétiques du ciel ».
Contre l'abstraction conceptuelle, Antonin Artaud ravive le spirituel concret dans la tradition de Paracelse, Böhme, Novalis, Hamann et Franz von Baader. La guerre est ouverte contre la pensée calculante, restrictive, pensée d'usure et de pénurie, capitalisante et profanatrice qui nous réduit à l'état de spectre dans les « cavernes de l'être ». Pour Antonin Artaud, rien n'est plus concret que le suprasensible : « J'ai de l'esprit une idée matérielle bien que j'aie une philosophie anti-matérialiste de la vie ». La magie est concrète et d'une exactitude « cruelle ».
Se déprendre de ce qui désincarne nos présences en représentations, de ce qui dégrade nos “actes d'être” en concepts abstraits, de ce qui avilit la tradition (qui est transmission ardente, transfusion) en coutumes bourgeoises, c'est enfin, pour Antonin Artaud, retrouver, en même temps, l'intensité et l'exaltation, les longitudes et les latitudes de l'âme et du monde, sans lesquelles les corps sont sans esprit et les esprits sans corps. La Thulée de l'âme est cette contrée murmurante, ce « voyage à travers son propre sang », comme l'écrit F. Bonardel, ce « Styx rutilant de tous les feux nocturnes » qui « nous invite à entreprendre dès ce monde-ci, l'ultime navigation vers et dans l'au-delà ».
L'œuvre sera cette « lame d'obsidienne », éclat solaire porté à la jonction des mondes qui donnera à Antonin Artaud le droit d'écrire : « Mais moi, je suis un être vrai, sans rien de phénoménal, et je me manifeste à tout instant, mort et vivant ».
Luc-Olivier d'Algange
23:22 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
05/08/2024
Dominique, suivi de Epectases de Sollers, éditions Le Clos Jouve, 2024:

21:32 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook