31/03/2024
Luc-Olivier d'Algange, la conversation d'André Suarès:

La conversation d'André Suarès
Qu’est-ce qu’une civilisation? Alors que la notion en devient incertaine, menacée par l’indifférence, ou des «déconstructions» pédantes et repentantes, un livre nous advient qui donne à cette question une réponse magnifique, tant par le style (dont on sait, par Buffon et Saint Pol-Roux, qu’il est l’homme, et l’âme, et sans doute la vie elle-même) que par une multiplicité d’exemples précis, de Suétone à Cézanne, en passant par Spinoza, Cervantès, Goethe, Chateaubriand, Dostoïevski, Tolstoï, Wagner, Stevenson, Péguy, Debussy, D’Annunzio, et bien d’autres.
Ce livre, intitulé Miroir du temps, rassemble les principaux inédits d’André Suarès. Il est le résultat de deux décennies de recherches, de voyages et de rencontres. Nous le devons à Stéphane Barsacq, auteur par ailleurs, entre autres, d’un beau recueil de pensées intitulé Mystica. Ce livre nous vient, comme une victoire du Kaïros, au juste moment. Plutôt que de nous perdre dans les remugles des romans du ressentiment, du grief et de la vindicte, dans ces récits d’hommes et de femmes incarcérés en eux-mêmes, qui haïssent leur passé et celui de l’Europe depuis la nuit des temps, voici que la chance nous est donnée de nous abreuver à la source de Mnémosyne grâce à une œuvre altière dont l’immédiate vertu est de nous rendre à ce qu’il y a de meilleur en nous-mêmes. Les plus grands d’entre ses contemporains et de ses successeurs, au demeurant, ne s’y trompèrent pas. De Claudel à Cendrars, de Malraux à Jankélévitch, tous reconnurent en André Suarès un des plus grands écrivains de la langue française.
Toute œuvre digne de ce nom est au service d’un grand dessein. Celui d’André Suarès est de délivrer l’âme de ses écorces mortes et de relever la vie, en lui donnant une hauteur oubliée et l’intensité d’une épice, «sel de Typhon», selon la formule virgilienne. Voici son adresse au lecteur, qui donne le ton de l’ouvrage, son orgueil, qui est pudeur, et son insolence, qui est amitié: «Tu as toujours de l’or pour boire, pour manger, pour te mettre au lit ou pour aller voir danser des oies pendant que des singes font de la musique en frappant sur des casseroles: soucie-toi un peu de ton âme, mon Lecteur, il est temps. Tu n’y penses pas, telle est ta négligence et nous le savons bien: c’est pourquoi nous y avons songé pour toi.»
De splendides journées de lecture seront données à celui qui, ouvrant ce livre, laissera André Suarès songer à son âme. L’incuriosité est souvent le fait de ceux qui, trop pleins d’eux-mêmes, ne laissent, dans leur ressassement égotiste, aucune place aux songes qui viennent de haut et de loin. Lire André Suarès, à cet égard, est un exercice spirituel; l’espace intérieur s’accroît, en longitudes et en latitudes, le temps s’approfondit comme une grotte marine, Pétrone et Suétone posent leur main sur notre épaule, et à lire ce qu’en dit André Suarès, voici qu’ils sont, depuis toujours, nos voisins de campagne, de chers amis. Un beau ressac gronde et chante, dont les crêtes sont des œuvres, non plus embrigadées, ou empoussiérées, non plus objets de la triste médecine légale des universitaires, mais toutes vives, ruisselantes d’écumes, aimables enfin, ou redoutables, comme l’Aphrodite Anadyomène. Chez André Suarès, l’Intellect, qui est particulièrement aiguisé, est toujours au service de l’Eros ou de la Philia. L’œuvre qu’il évoque, entre en vibration; il en parle, souvent en bien et parfois en mal, comme d’une amante; son esprit souffle à travers les ramures des phrases comme Eole par les cordes. «Mon œuvre, écrivait André Suarès à Stefan Zweig, est un vaste poème de la connaissance. Comme à un vieux Grec de l’Occident, tout est poésie à mes yeux, mais poésie de Psyché, qui cherche l’Amour dans le palais de la Métaphysique.»
André Suarès ne céda jamais aux facilités ni aux opportunités des idéologies, qui permirent à tant d’autres écrivains, avec l’usage d’une certaine mauvaise foi, de passer la rampe, comme on dit, et de toucher le gros public. À la doxa, Suarès préfère le paradoxe, - non, s’il faut préciser, le jeu d’un esprit enclin au sophisme mais la fervente délivrance de cette chape de plomb que font peser sur nous ces dévots, fussent-ils «matérialistes», auxquels précisément manque l’immémoriale piété, - paradoxe alors comme une brèche ouverte sur le Grand Large, là où tournoient les nuées, où règnent, en leurs impondérables puissances, les dieux. De plus en plus, écrit André Suarès, je me suis rendu compte de mon être véritable: un homme du sixième siècle avant Jésus-Christ, qui voit partout des dieux et qui ne peut voir qu’eux.
Libre d’allure, André Suarès est un classique incandescent. Aucun romantique ne le surpasse en fougue. S’il est classique, ce n’est point par atermoiements raisonnables, goût du passé, mais par une défiance à l’égard du mauvais infini, celui qui finit justement par tout uniformiser. L’indistinction n’est pas son fort; en toute œuvre il discerne, et retient, pour l’honorer, le trait sans ressemblance, la limite heureuse, l’accord de la pensée avec l’acte d’être, la sollicitude pour la nuance. La Grèce et l’Italie de ce classique dionysien ne sont pas celles, en blouse ou en habit, ou en mots d’ordre, des scolaires, des académiques ou des politiques. Son esprit veille mieux au bord du volcan d’Empédocle. Une transcendance le requiert, mais insoumise au Dogme, une conscience morale le hante, comme son ami Péguy, mais contre ces moralisateurs vaniteux toujours empressés à rabattre ce qui leur est supérieur à doses, de plus en plus létales, de moraline.
Sitôt croit-on saisir André Suarès qu’il est ailleurs. Le croit-on païen plus que Leconte de Lisle qu’il donne cette précision: «Comme je suis à l’aise entre Eleusis et Delphes; et d’Olympie à l’Hymette! Toutefois, Jésus, la Vierge et les autres dieux du cœur palpitant sont aussi dans mon Olympe.» Les autres dieux du cœur palpitant... peut-être ceux qui viendront, les dieux attendus, qui veillent sur l’orée, entre la parole et le silence, ceux qui annonceront le second souffle de l’Europe, le Paraclet. Par devers la société, qui n’est que «le masque de la convenance sur l’os nu de l’intérêt», Suarès évoque la Vierge du Paraclet «celle sans le savoir, qui est née pour le Paraclet, qui va d’un pas si léger, si doux et si tranquille sur la route sacrée». Quoiqu’il nous dise, tout, chez André Suarès, est toujours écrit à fleur de peau, mais cette peau est d’âme, comme le savait Karin Pozzi ; elle est ce qu’il y a de plus profond en nous. Toute surface lui est ainsi révélatrice. En platonicien d’instinct, en platonicien homérique, ce qui n’est point tant un oxymore, le beau lui fait resplendir le vrai, non comme une finalité, mais comme l’épiphanie de la lumière sur l’eau, «la mer allée avec le soleil», l’éternité rimbaldienne. Cependant le mot de Nietzsche lui conviendrait assez bien: «Je cherche non la vie éternelle mais l’éternelle vivacité».
Rien n’est plus vivace qu’une phrase d’André Suarès, et c’est à sa phrase qu’il faut juger un écrivain, non à sa thèse. Ses essais ne sont pas du «paratexte», mais un dialogue. Nous le voyons ainsi engager une conversation, parfois âpre, souvent rêveuse et admirative, avec des écrivains, des peintres, des musiciens dont les œuvres nous viennent, non comme des objets d’étude mais comme des voix vivantes, des sapiences nocturnes ou soleilleuses. André Suarès n’écrit pas sur Debussy, par exemple, il écrit à Debussy: «Rien d’ascétique en vous, ni d’un homme qui fuit le monde; mais beaucoup de celui qui n’y est pas sans y être étranger» ou ceci encore: «Votre imagination tournait en beauté musicale tout ce qui touchait vos sens et vos pensées». Nul mieux qu’André Suarès ne sait discerner ce qui dans une œuvre est profondément français, et qui, s’éloignant de nous, devient peu un mystère. Suarès, ce «grand européen», mais au sens de Nietzsche, a l’oreille et le cœur, pour reconnaître, dans la prose, dans la peinture, dans la musique, celles des Muses grecques qui veillent, avec une diligence particulière, aux œuvres françaises. Il y faut une alliance particulière, reconnaissable, mais difficile à analyser, entre la désinvolture et la vigueur, la liberté conquise et le goût des formes, une façon parfois de fluer au-dessus des apparences que la langue française favorise, et que le génie de Stendhal ou de Valéry illustra diversement. «La musique française, écrit André Suarès, à propos de Debussy, a trouvé dans Claude Achille son Watteau et son Racine, le maître qu’elle attendait depuis Rameau, celui qui enrôle la puissance dans la grâce et la profondeur dans la suprême élégance. Le Valois est une contrée de l’Attique: on l’a bien vu, cette fois. Un grand Français est toujours, quoiqu’il semble, ou presque toujours, un grand aristocrate. Le vrai peuple de France, jusqu’ici, a toujours été bien né, comme celui d’Athènes». Jusqu’ici, oui, mais qu’en est-il depuis? Où sont les hommes, bien nés, les Athéniens d’esprit, sinon relégués dans quelques marges extrêmes; mais nous savons qui ils sont, ces insoumis: lecteurs d’André Suarès, déjà, que nous espérons aussi nombreux que possible.
André Suarès parle de ce qu’il aime, certes; ses goûts sont, selon la formule de Philippe Sollers, «une guerre», qu’il lui convient de mener, non sans le beau fanatisme de celui qui est entré, un jour, dans le temple de la beauté, et s’en souvient; il parle aussi de ce qui nous regarde, si nous daignons ne point passer à côté sans le voir. André Suarès n’est pas esthète monomane, un Des Esseintes abîmé dans la contemplation de sa tortue coruscante; il s’adresse à nous, sa phrase est toujours orientée, flèche, hirondelle, vers nous, fut-ce au-dessus de nous, ses lecteurs, ou vers les dieux qu’il nous rend présents. Rien n’est moins morose que le monde d’André Suarès, tout y est vif, tragique et joyeux, la joie étant le bel envers du consentement au tragique. Tout ce que nous eussions été si nous n’étions pas passés à côté, dans nos sinistres affairements, se trouve, dans un air d’aurore, dans l’œuvre d’André Suarès: l’attente exquise, l’ombre bleue des amandiers, et dans toute chose discernable, une couleur, un accord, un mot, l’immense gradation qui va du sensible à l’intelligible.
André Suarès fut de ceux qui ne vécurent que pour la beauté, existence héroïque s’il en est, par laquelle le monde est moins laid qu’il ne l’eût été sans lui. André Suarès ne déroge pas au bel orgueil de le savoir, et même de le rappeler aux gendelettres qui, à ses yeux, galvaudent et souillent le Logos-Roi; mais lorsque la grandeur apparaît, hors de son œuvre, et dans la vie, dans l’Histoire, il est aussi le premier à lui rendre hommage. Excepté Albert Londres, peu nombreux furent en France, ceux qui reconnurent la grandeur de Gabriele D’Annunzio à Fiume, dont la reconquête, pour Suarès, dépasse la rébellion nationale, le refus d’un traité félon, voire l’utopie sociale, pour réinventer l’accord fondamental entre la poésie et la politique. «Faute de poésie, la politique n’est jamais qu’au jour le jour. Elle manque de but même lorsqu’elle y touche.» Ce qui nous est au plus proche vient de l’horizon inconnu, la force qui arrache au prosaïque comme l’aile arrache à la pesanteur. «Du balcon illustre, écrit André Suarès, trente siècles de culture et de pensée ont volé de sa bouche; sa parole a manié la foule, sans l’aduler; il a su la convaincre sans l’avilir jusqu’à la suivre; Il n’a jamais eu plus de raison dans l’ardeur, ni plus de sage magnanimité. Il les a ennoblis de sa propre noblesse.»
Luc-Olivier d'Algange
Extrait de L'Ame secrète de l'Europe, éditions de L'Harmattan, collection Théôria.
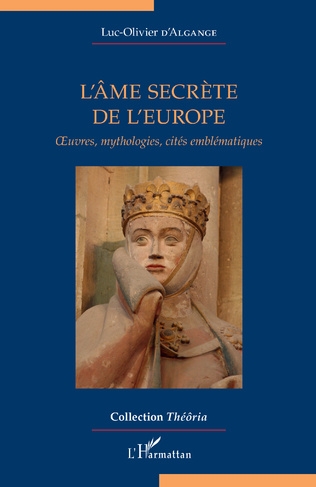
14:45 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook



Les commentaires sont fermés.