16/11/2025
Luc-Olivier d'Algange et la transparence de la mémoire, par Gabriel Arnou-Laujeac:
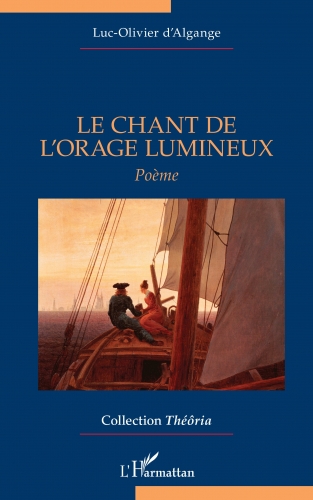
19:54 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
13/11/2025
Luc-Olivier d'Algange, notes sur La Musique intérieure, Maurras, Victor Nguyen:
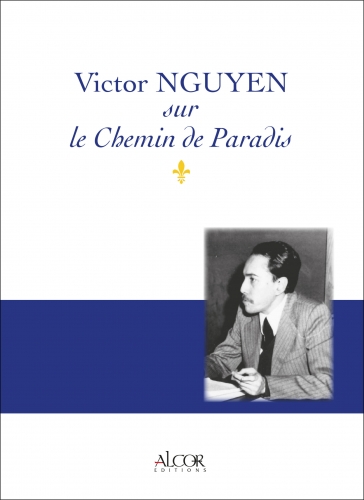
La Musique intérieure
« C’est alors qu’apparut la consolation divine des vers »
Charle Maurras
In memoriam Victor Nguyen
Pourquoi relire La Musique intérieure de Charles Maurras ? Sans doute, déjà, pour contredire tous les sophismes et fausses raisons qui voudraient nous en dissuader, - et qui suffisent à prouver que ces pages, rédigées il y a un siècle, demeurent d'une actualité permanente, - comme le sont les bons souvenirs et les serments de l'enfance. Ce « Grand Temps » de l'enfance, même s'il se situe en amont, - dans une relation encore intime avec les dons et les vertus impérissables, « image mobile de l'éternité » selon la formule de Platon, - ne sera pas étranger à l'Histoire qui viendra. Il y a en toute vie humaine pleinement vécue, une succession d'âges semblables à ceux qui ordonnent notre civilisation. A l'enfance chevaleresque, libre et médiévale, succédera la Renaissance, autrement dit l'adolescence aventureuse et philologique ; puis l'âge adulte, classique, qui prendra la juste mesure de l'inné et de l'acquis, - et enfin l'âge moderne, cette décrépitude où tout semble vouloir se défaire dans une lamentable cacocratie, telle que nous la voyons aujourd'hui, ostensible, arrogante et ridicule. Quelle admirable et nécessaire leçon alors que ce recours aux premiers dons ! Mieux encore est d'apprendre, par le poète intercesseur, que recevoir ne suffit point, et qu'il faut encore consentir et célébrer. La littérature, avant qu'elle ne devînt, par décret de la mode, un dévergondage victimaire, fut souvent une célébration des temps héroïques ou heureux. La Musique intérieure nous en fait souvenir : « Quand on demande ce que c’est que le bonheur — action ? passion ? ou l’un et l’autre ? —, il faut bien répondre que l’homme est un complexe animal. Tour à tour, il accueille avec de semblables transports le sentiment aigu de la nature des choses, la vue sereine des essences, pourvu qu’elles soient belles et dignes de désir, enfin l’essai hardi d’une puissance qui soumette l’idée du monde et de la vie à son idée propre, qui la lie à son cœur et à sa pensée pour la transfigurer tôt ou tard dans sa flamme… De tous ces biens, quand il y pense, l’homme voudrait ne faire qu’un. Les amoureux s’y essayent de temps à autre. Le poète y songe toujours. »
Etre moderne, c'est naître d'avance déshérité, non seulement par l'inconséquence de la génération précédente, et la main crochue de l'Etat subordonné à l'Economie, mais aussi, et surtout, dans nos souvenirs. Aux comptines se sont substitués les « tubes » radiophoniques, aux saveurs et paysages, les écrans ; rien de tout cela n'est assez fécond pour faire pousser un bel arbre et faire bruire les feuillages de la mémoire. Nous sommes livrés aux surfaces, à la platitude et ce que nous croyons être nous-mêmes, individus déracinés, n'est qu'un écho de la confusion des temps. Ce qui nous manque, et nous précipite dans l'affairisme le plus vain, est l'espace intérieur où toute chose chante et toute présence enchante. Nous, Modernes voulus modernes, croyons vivre hic et nunc, dans le mépris du « vieux monde » alors que nous vivons précisément dans un monde où il n'y a plus d'Ici ni de Maintenant. La présence réelle fait défaut. D'où l'importance du rappel : « Poésie est Théologie, affirme Boccace dans son commentaire de la Divine Comédie. Ontologie serait peut-être le vrai nom, car la Poésie porte surtout vers les racines de la connaissance de l’Être. Le savent bien tous ceux qui, sans boire la coupe, en ont reconnu le parfum ! »
Tout recommencera donc par les évidences les plus plus vastes et les plus fines. Un devoir nous incombe, qui est une joie : nous offrir à la recouvrance de ce que nous savions déjà mais dont l'accès nous était interdit par quelque noire magie, - ce que Villiers de L'Isle-Adam, nommait « l'hypnotisme du Progrès ». Mais en ces pages, soudain, une porte s'ouvre sur un jardin. Tout platonicien, de science ou d'intuition, sait qu'un jardin, une forêt, une mer, sont la réverbération, ou le reflet, du Jardin, de la Forêt ou de la Mer immémoriaux. L'enfance dispose de cette chance magnifique de faire une cosmogonie, voire une théodicée, de tout ce qui l'émerveille : « Aussi loin que j’y peux descendre, seul désormais, sans le secours des mémoires qui sont éteintes, je vois de longs jours filés d’or que l’hiver même éclaire d’un soleil luysant, cler et beau que nul printemps ne me ramène. Des saveurs, des parfums, des contacts de toutes les choses se dégage l’esprit de la surabondance accordé au jeune désir. L’événement et le souhait, la réalité et le rêve se tiennent et se suivent par des liens délicats qui ne rompent jamais ; tout a son sens, son lustre. Ah ! comme dit le Grec optimiste, il était bon et doux de voir la lumière ! »
Il n'est sans doute rien de plus universel que l'enracinement, rien qui ne révèle mieux, selon la formule de Maurras, « l 'humanité essentielle » dont la civilisation française lui semble une preuve particulièrement heureuse. Pour le comprendre, il ne faut se vouloir juge, évaluateur ou comptable des vices et des vertus. Il ne faut pas mesurer les civilisations entre elles, comme si nous étions au-dessus d'elles dans quelque module spatial ; il faut entendre, de la nôtre, de là où nous sommes réellement, dans cet espace géo-poétique, et surtout dans cette langue, la musique intérieure, le secret du poème, divine consolation : « Sur ces confins légers des nuits et des matins où tout semble renaître, était-il déplacé de désirer plutôt des vers qui fussent, eux aussi, en voie de naître et de grandir, des vers à prendre et à reprendre, à user, à rouler, semblables aux galets qu’arrondissent les mers chantantes ?.
Charles Maurras, certes, a beaucoup parlé de la raison, mais ce ne fut guère la raison ratiocinante, la raison redondante, qui tombe comme une chape de plomb sur le secret conseil des Muses. La raison, fut, dans ce qu'il nous légua de plus libre, de moins subordonné à l'actualité confuse de son temps, d'abord une raison d'être, - expression française au suprême et presque intraduisible. Quant-à-la « raison » prônée par les Révolutionnaires, qui en voulurent faire une « déesse » alors qu'ils n'en firent qu'une idole, la raison des « rationalistes », nous avons vu qu'elle tranchait au lieu d'unir – et jusqu'à la tête de Lavoisier qui tomba au prétexte, la citation vaut son pesant de fanatisme, que « La République n'a pas besoin de savants » . L'actuelle collusion des néo-robespierristes avec le fanatisme exotique le plus obtus du monde le confirme, nihil novi sub sole.
Ne plus entendre la musique intérieure, soit qu'elle fût recouverte par le vacarme de l'époque, soit qu'elle fût niée, par fallacieuse repentance, dans le secret des cœurs, ne sera pas sans conséquences. Cette mélodie intime qui suit son cours, comme le Lignon de l'Astrée, entre ce que nous pensons et les phrases servantes qui viendront, comme elles peuvent, prouver notre fidélité, tient en elle la plus grande part de notre avenir, ou, du moins de l'espérance de notre avenir, - de sa possibilité. Nous reviendrons ainsi à La Musique intérieure par la conscience d'un enjeu qui dépasse largement la politique de celui qui devait proclamer «la politique d'abord » - les conséquences du désastre, les causes politiques, en effet, dépassant désormais l'aire où elles se manifestaient alors.
Perdre la musique intérieure, ce n'est plus seulement perdre la possibilité de la politique, rendre son retour impossible dans un monde impolitique gouverné par l'économie et la technique , c'est effacer sa raison d'être et même la raison d'être en soi qui nous fait être là et non ailleurs, bien vivants, avec selon la formule de Giono, « le chant du monde « . L'immensité du désastre requiert la riposte la plus intime, tel un iota de lumière incréée, étincelle dans la pupille, susceptible de toute recréer en regardant de nouveau le monde avec attention. C'est de ne plus rien voir ni entendre du monde, de rester là, derrière nos écrans, que nous sommes tués et que l'Ennemi remporte sa sinistre victoire.
Pour retrouver la musique intérieure, la rejoindre, y trouver l'accalmie de l'âme, qui est la promesse la force, sans doute faut-il faire silence, se taire, retrouver l'attente. Ne point se hâter ne signifie pas reporter ad infinitum, procrastiner, mais se rassembler, en soi-même d'abord, pour un nouvel assaut. Les forces déliées par le calme sont les moins incertaines, elles ont saveur et sapience d'enfance, pureté du feu, mots qui, par leurs étymologies, révèlent leurs actes, l'arbre et ses fruits ; et c'est bien la racine que la musique intérieure célèbre, « source sacrée » : « La joie est l’état qui déborde. Elle extravase, elle transmigre. Large ou bornée, brève ou durable, elle ne tient jamais dans son enceinte pure ; elle rayonne à proportion des puissances de son foyer. L’être y jaillit de soi, pour être mieux lui-même : ce n’est pas autrement que, retenu et précipité, emporté et fixé, il accède à sa plénitude. Allumée au bûcher natal, nourrie du feu qui l’engendra, Psyché prétend sans honte à la couche des dieux parce qu’elle peut dire à ses père et mère s’ils s’en étonnent : — Fîtes-vous autre chose que de m’élancer d’où vous retombiez ? »
Par le Mystère d'Ulysse, ensuite, nous saurons que rien n'est dit, que le règne des Prétendants n'a qu'un temps, et que nous reviendrons, de si loin, avec l'expérience, la traversée du danger, entre les dieux favorables et hostiles, par devers les fascinations funestes et les déroutes ; nous reviendrons, purement et simplement, dans notre pays d'enfance, peut-être méconnaissables (sauf d'Argos) dans un pays lui-même méconnaissable, mais dans une résolution renforcée par les épreuves et les errances. C'est dans l'enfance, dans la musique intérieure de l'enfance que nous aurons trouvé le courage de contrebattre le monde qui n'existe – dans toutes ses propositions, diatribes,- que pour répandre la peur. Nous retournerons d'où nous venons, naturellement et surnaturellement, nous reviendrons vers la source sacrée de notre mémoire, vers cette « simple dignité des êtres et des choses » tant cruellement oubliée ; nous y reviendrons après le terrible et ravissant périple, le cœur de bronze et les sens affinés. Le monde est une épreuve, et nos défaites, à nos victoire confondues, formeront quelque invisible couronne, ombre changeante sur nos fronts au bord d'une rivière française, dans le silence de toutes les musiques tues ou espérées : « Ferai-je le dénombrement de ces héros, que je voudrais suivre aux Enfers ? Rapporterais-je leurs discours, leurs chants et leurs plaintes ? Pas mal de strophes en existent, trop peu au point pour être écrites. Si vive que soit la passion de toucher au but dès que le désir se ranime, nulle hâte ne m’éperonne, il semble que nos morts sacrés, les seuls à qui je sois redevable de la pieuse offrande intermittente, surtout nos orateurs, nos philosophes, nos poètes, veuillent me tenir compte du long et fidèle essor de ma volonté : ils me laissent conduire le poème à loisir. Il pourrira sur pied ou bien, « comme mûrit le fruit » parviendra au terme tout seul. Mieux vaudrait le quitter inachevé, comme ce triste monde, que de le finir autrement qu’il ne se voit et qu’il ne se veut ».
Luc-Olivier d'Algange
°°°
Victor Nguyen, à l'honneur, et pour l'honneur de l'esprit, dans ce livre, Victor Nguyen sur le chemin de Paradis, qui vient de paraître aux éditions Alcor, au ressouvenir, du côté d'Antinéa, et de la France latine.
Présentation de l'éditeur:
"ALCOR ou la passion d’un éditeur Marseillais.
Petite étoile nichée dans la constellation de la Grande Ourse, nous l’avons adoptée pour donner son nom à notre maison d’édition.
Son nom, d’origine arabe signifie le Cavalier.
Elle servait jadis de test d’acuité visuelle pour les archers de Genghis Khan et de Charles Quint.
Alcor est aussi la clé du mystère du trésor des rois de France de Maurice Leblanc dans le roman « La comtesse de Cagliostro »
Le contenu de notre catalogue s’inscrit d’une manière large dans une perspective que nous appellerons traditionnelle : Esotérisme Chrétien, Alchimie, Tradition, Métiers, Histoire et Poésie…
Nous proposons soit des rééditions de précieux ouvrages anciens mais également des publications d’auteurs contemporains, avec comme souci permanent la recherche de la qualité des textes et de l’édition."
Quatrième de couverture:
Plus de quarante ans après la publication de l’ouvrage Aux origines de l’Action française, intelligence et politique à l’aube du XXe siècle, salué comme un chef d’œuvre par une critique quasi unanime, il peut paraître singulier de revenir sur ce qui l’a précédé, et tenter de suivre le regard porté par Victor sur la société française de son temps dans son ensemble. Le livre est unique et posthume alors que l’auteur avait publié des dizaines d’articles sur Maistre, Mistral, Vico, Dimier cofondateur de l’Action Française, Barrès, Péladan ou Guénon notamment. Toutes aussi singulières sont les circonstances de sa parution, il s’agit d’une thèse de Doctorat d’Etat refusée parce que hors délai. Pierre Chaunu a donné dans sa préface le récit qui a coûté la vie à l’auteur, son témoignage vient en tête du présent travail. Dès 1970 Victor avait créé dans le cadre de l’Université de Nanterre la revue Anthinéa en compagnie d’Elisabeth de Pusy La Fayette, Pierre Guiral, son directeur de thèse et Pierre Chaunu qui y avaient collaboré.
Il était également le fondateur des colloques Maurras dans le cadre du Centre Maurras qu’il anima de 1968 à 1976 avec Georges Souville. Politica Hermética avec Jean-Pierre Brach et Jean-Pierre Laurant enfin clôt le voyage en 1987, une naissance posthume également.
19:03 | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
02/11/2025
Luc-Olivier d'Algange, hommage à Jean Biès:
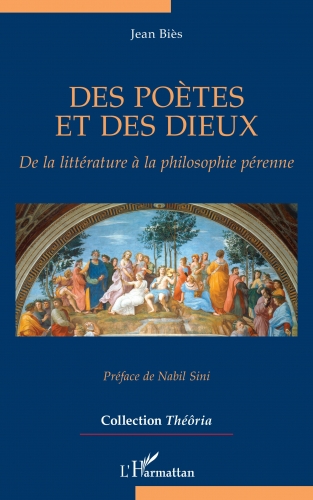
Hommage à Jean Biès
L'oeuvre de Jean Biès qui se place sous le signe du « retour l'Essentiel » - à la fois mot d’ordre, une devise héraldique et mise-en-demeure - suppose que nous nous sommes éloignés de l’essentiel, que ces dernières décennies, voire ces derniers siècles, furent propices à un éloignement de l’essentiel. Mais « éloignés » n’est pas assez dire, il faut préciser : à perte de vue ! Ce n’est plus seulement une distance spatiale ou temporelle qui nous sépare de l’essentiel. Les distances de cette sorte, l’obstination et la patience suffisent à les franchir. Il s’agit d’une distance elle-même essentielle qui nous sépare non seulement du plus lointain mais aussi du plus proche et du plus intime.
Retourner à l’essentiel, ce serait ainsi à la fois accueillir le plus lointain et dévoiler le plus proche, consentir à l’appel du Grand-Large qui rassemble en lui, comme une promesse, le Dire posthume, les gestes épiques et métaphysiques d’Orient et d’Occident, et le Dire anthume, - qui annonce ce qui doit être à la pointe exquise de l’Instant. L’essentiel serait alors le retour lui-même : retour sur soi, qui emporte avec lui le retour du monde en nous-mêmes. La modernité qui nous sépare de l’essentiel est catastrophe pure, répétition cauchemardesque, sur-place frénétique d’un « temps » qui a perdu, en même temps, l’archéon et l’eschaton, l’origine et la promesse.
Nous cheminons vers le retour, autrement dit vers l’Eveil : « Ulysse sommeille en chacun de nous ». Mais il ne saurait être de cheminement sans la conscience de l’écart, de la faillite, du désastre. Celui qui prend la mesure de ce qui sépare sa vie de la vie magnifique, celui qui constate la faillite de ce monde et qui ne se refuse point à voir les désastres pour ce qu’ils sont, est déjà en chemin. Tel est le sens de l'oeuvre de Jean Biès : un état des lieux qui définit, par contraste, un autre monde, extraordinaire présent, dont nous ne sommes séparés que par un battement d’aile de libellule.
Entre les possibilités prodigieuses de notre intellect, de notre âme et de nos sens et ce à quoi, dans nos activités quotidiennes, nous les réduisons, par torpeur, paresse ou soumission, sont tous les voyages. « La pire menace, écrit Jean Biès, n’est pas dans la vitrification atomique mais dans la désertification intérieure de l’humain, le lent oubli de toute transcendance, l’insensibilité au supra-sensible, l’absence de tout vibrato métaphysique. » Ce monde réduit à son mécanisme, cet individu réduit à son corps périssable dont l’âme et l’esprit ne seraient que les « épiphénomènes », le Moderne s’y tient en fanatique alors même que les sciences, en leurs ultimes avancées, les récusent. Toutes les collectivités sont religieuses, mais encore faut-il distinguer le religere de l’au-delà de celui, en forme d’amalgame, de l’en-deçà.
Certains livres, rares, gagnent en pertinence, en justesse, en profondeur à l’épreuve du temps. Les années qui se sont écoulées depuis leur parution loin d’en atténuer l’éclat le révèle. Résister au temps, ou, mieux encore, s’en affermir, sans doute est-ce là le propre des œuvres qui, ne s’étant point emprisonnées dans un « hic et nunc » illusoire, eurent l’audace de s’enquérir du passé le plus lointain et la générosité de songer à l’avenir. Ce que l’on nomme la grandeur et la beauté des œuvres tient en cette double exigence à la fois altière et tendrement humaine, que les auteurs servent selon leurs talents : la grandeur d’être l’hôte du plus lointain et la beauté trempée au feu lucide d’une intelligence qui se refuse à pécher contre l’espérance. L’oeuvre de Jean Biès nous invite à la recouvrance de ces vertus.
Ne cédons point à la vaine gageure de vouloir « résumer ». Disons seulement que, loin de toute vanité novatrice, l'oeuvre s’inscrit dans une tradition, celle des traités de résistance à laquelle appartiennent, à des titres divers, Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, de René Guénon, Le Traité du Rebelle d’Ernst Jünger ou Chevaucher le Tigre de Julius Evola. Il s’agit, pour l’auteur, non point d’illustrer sa subjectivité, de se livrer à quelque « auto-fiction », ni d’engager de vaines polémiques, mais de donner à ses lecteurs quelques unes de ces armes de l’intelligence et de l’art sans lesquelles toute révolte contre le monde moderne s’asservit à ce qu’elle croit récuser. Il ne suffit point, en effet, de se désillusionner du monde moderne, d’en percevoir la laideur et la lourdeur, d’en décrire les ridicules et les abominations, il faut encore trouver en soi, c’est à dire en dehors du « moi », les puissances heureuses qui feront de cette rébellion une voie spirituelle, un chemin orienté par la clarté matutinale, aurora consurgens de la réminiscence.
Toutefois, le « retour à l’essentiel » n’est pas un retour au passé, mais à la présence du passé, ce qui est tout autre chose. La Tradition, au sens guénonien, dont se réclame Jean Biès, n’est en rien muséologique. Le tradere de la Tradition est la source vive, paraclétique, le mouvement même qui nous porte à la fine pointe de l’élan au-delà du temps qui le rythme : cette temporalité pure, aurorale, délivrée de sa propre représentation dont la musique hindoue traditionnelle, par exemple, nous donne à entendre la vibrante immanence comme une résonance d’une transcendance pure. Le propre du Moderne, au contraire, est d’être emprisonné dans son temps et de s’en faire, par dépit, l’apologiste éperdu. Quoiqu’il en veuille, le véritable Maître à penser du Moderne ne sont plus Descartes ou Hegel, mais Monsieur de La Palice. Pour lui, en effet, la modernité est bonne car elle est moderne et inversement. Pour preuve, tout ce qu’il juge bon dans le passé est sans ambages qualifié de « moderne » et tout ce qu’il trouve de fâcheux dans le monde moderne est, sans davantage de scrupules, qualifié « d’archaïque ».
La voie que propose Jean Biès, fidèle à la perspective métaphysique, est plus difficile. Aux commodités des systèmes, elle oppose la subtilité des « approches ». Rien n’est moins systématique que la pensée traditionnelle. C’est ne rien comprendre à la « Doctrine » que de la confondre avec un système. Erreur comparable à celle qui confond le Symbole et l’allégorie ou celle qui confond l’Idée et le concept. Le concept se tient tout entier dans sa formulation discursive. L’Idée est la chose vue qui exige l’intuition intellectuelle, la profonde et limpide méditation de l’Un. Or, le Moderne, en refusant l’intuition intellectuelle, la possibilité directe de la perception des états multiples de l’être se prive non seulement de la connaissance, il se prive de la réalité elle-même dans sa beauté frémissante et diverse. Son refus de la transcendance lui ôte, par surcroît, le sentiment de l’immanence pure. D’où le despotisme de la laideur, de la répétition cauchemardesque, le clonage physique et mental, l’abolition du réel dans le virtuel cybernétique. L’étiolement du vrai implique le saccage du Beau et le désastre du Bien. L’art dit « moderne » qui, selon l’excellente formule de Baudrillard, revendique la laideur, l’insignifiance et le mauvais-goût alors qu’il est déjà insignifiant, laid et vulgaire dans une sorte de redondance ubuesque ; l’idéologie inepte de l’égalité entre tout et n’importe quoi ; l’offense permanente faite, sous couvert de « dérision » à toute solennité et à toute profondeur, exigent une riposte, ou, comme l’écrivait, Henry Montaigu une contre-attaque.
L'oeuvre de Jean Biès doit ainsi se lire comme une contre-attaque, mais sereine, la colère s’y trouvant comme transfigurée par la vérité qui la justifie, transmutée et convertie par les teintures abrasives et scintillantes de l’âme qui retrouve, dans l’élan de sa propre sauvegarde, les ressources du ressouvenir, c’est-à-dire d’une véritable présence, reçue autant que donnée, transparue, autant que conquise par une décision résolue, - présence qui tient en elle, repliées, des ailes de lumière et de nuit.
S’il y a dans l'oeuvre de JeanBiès quelque chose d’un traité de savoir vivre en temps de détresse à la manière de Sénèque ou de Marc Aurèle, on y trouve aussi des pages qui se donne à lire comme de nécessaires prolégomènes aux exercices spirituels sans lesquels tout ce que notre entendement nous propose est destiné à s’évanouir aux premières brises. Or, ce ne sont point des zéphyrs mais d’assourdissants ouragans de crétinisation auxquels nous sommes exposés chaque jour, lavages de cerveau en bonne et due forme, étayés par les technologies de pointe. Le retour à l’essentiel passe ainsi à travers les frondaisons d’un simple retour au monde, au cosmos, comme disaient les Grecs, à « la simple dignité des êtres et des choses » comme disait le poète roman, car ce monde, s’il ne suffit point à lui-même s’offre à nous comme l’enluminure de l’écriture de Dieu.
Cette enluminure ne dit point l’essentiel mais l’environne et l’essentiel n’est point si despotique qu’il veuille la disparition de l’enluminure où il apparaît. D’où ces textes sur l’Alchimie intérieure, sur la religion de la beauté, la philocalie, les couleurs et les chants, les parfums et l’élégance des signes dont la beauté, pour les plotiniens que nous sommes, est une approche du Vrai : « Garder le seul sens littéral des enseignements, écrit Jean Biès, c’est finir par perdre même le sens littéral alors que leur lecture symbolique, relevant de l’ésotérisme, déploie une pluralité infinie de sens, enrichit de nombreux apports. La parabole du vin nouveau et des outres neuves montre que l’ésotérisme, - le vin, symbole de la connaissance éternelle renouvelée ici dans son énonciation,- reste toujours le même, cependant que les outres désignent les modalités d’accès à l’ésotérisme, les structure rituelles, les cadres théologiques. »
La perspective ouverte à une « gnose » ou un ésotérisme chrétien ne manquera pas de choquer les gnosimaques, qu’ils soient intégristes ou progressistes (et enclins, de ce fait, à discerner dans la gnose ou l’ésotérisme un périlleux élitisme « fascisant »). Or, la gnose, loin de toute outrecuidance, n’est autre que la contemplation de l’Intellect et l’abandon de l’âme à la souveraineté divine. A égale distance de l’arrogance de l’entendement humain et de l’arrogance des « vertus » qui escomptent, par quelque étrange marchandage, une récompense aux « bonnes œuvres » ; à égale distance de l’approbation « réaliste » de l’état de fait et de la négation du monde, la gnose chrétienne qui « célèbre l’harmonie et le rythme qui émanent du monde comme d’une lyre, l’immobile fuite des vagues, les vastes fleuves, le chant du vent » ( Grégoire de Naziance) apparaît à celui qui l’approche sans prévention comme le combat sans cesse repris contre ce nihilisme qui solidifie la doctrine ou hâte sa dissolution.
Entre le narcissisme religieux où l’homme s’adore lui-même à travers sa religion qu’il juge, bien sûr, la meilleure de toutes, et le syncrétisme du tout et du n’importe quoi, la gnose chrétienne serait ainsi la tierce voie, la voie droite de la reconnaissance d’un Logos universel (mais nullement universaliste) à travers la multiplicité des « demeures ». « Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père » (Jean, XIV,2) A juste escient, Jean Biès cite l’Apologie de Justin : « Tous ceux qui ont vécu selon le Logos sont chrétiens, même s’ils ont passé pour athées, comme, chez les Grecs, Socrate, Héraclite et leurs semblables » ; ou encore Nicolas de Cuse : « A travers la diversité des Noms divins, c’est Toi qu’ils nomment, car tel Tu es, tel Tu demeure, inconnu et ineffable. »
Le passage entre ce « Dieu » qui n’est qu’un « Il », c’est à dire un « étant suprême » que rien, sinon son unité, ne distingue d’une idole, et ce Dieu, que nomme Nicolas de Cusa, qui est un « Tu », c’est là, exactement ce qui distingue la fausse gnose, l’arrogance du Moi, de la véritable gnose qui est effacement du Moi dans le resplendissement du Soi.
Jean Biès nous invite également à méditer, dans toutes ses conséquences, cette phrase de saint Thomas d’Aquin. « La puissance d’une Personne divine est infinie et ne peut se trouver limitée à quelque chose de créé. C’est pourquoi l’on ne doit pas dire qu’une personne divine ait assumé une nature humaine de sorte qu’elle n’ait pu en assumer une autre. » Loin d’être hérésiarque, la gnose chrétienne s’ordonne ainsi à cette phrase d’Origène : « Tout ce qui se voit est en relation avec quelque chose de caché, c’est-à-dire que chaque réalité visible est un symbole et renvoie à une réalité invisible à laquelle il se réfère. » L’apparence est apparition et cette apparition est l’acte d’être de Dieu qui est, selon la formule d’Angélus Silésius, comme « un Eclair dans un éclair ». Relevons encore cette citation de Saint-Ephrem de Syrie : « Une image du Père, tu l’as dans le soleil, du Fils dans son éclat, du Saint-Esprit, dans sa chaleur ; et pourtant, tout cela est un ».
Luc-Olivier d'Algange
Jean Biès, Des poètes et des dieux, De la littérature à la philosophie pérenne, éditions de L'Harmattan, 2025.
20:06 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook


