07/01/2024
Un texte de Stéphane Barsacq sur les "Propos réfractaires" de Luc-Olivier d'Algange:

Saint-Augustin raconte ses erreurs, Rousseau justifie les siennes, Stendhal a les impudences des masques, Gide est plus près du modèle que du tableau et de la pose que de la grâce. La sincérité de Luc-Olivier d'Algange est d'une exactitude nonchalante. L'observation n'y est pas au piquet ni figée et morte comme le glacier d'Amiel; ici l'oiseau rend des libertés avec son arbre. Il se retranche mais il tranche. Il a des fenêtres qui donnent sur la guerre, sur la sottise, sur l'Europe. Prudent, il ne bégaye pas; avisé, il n'est pas irrésolu. Il est assez original pour citer souvent parce que l'esprit naît dans une société d'esprits. S'il nous parle de lui, c'est qu'il nous connaît. On ne le range pas parmi les philosophes parce qu'il refuse leurs cages, leur jargon, leur pédanterie, leurs querelles de fantômes. Aussi quelle succulence de langage ! J'aime Luc-Olivier d'Algange comme il aime Paul Valéry. "Les fous nous rendent fous, les sages nous rendent sage sans le vouloir".
Stéphane Barsacq
Luc-Olivier d'Algange, Propos réfractaires, éditions de L'Harmattan.
19:52 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
Un article de Maximilien Friche paru dans "Zone critique":
Dans Propos réfractaires, Luc-Olivier d’Algange s’attaque au Moderne qui est contre tout ce que nous aimons. L’auteur nous propose tout simplement de partir au combat pour l’Âme du monde, mais avec un zeste de désinvolture et dans la joie de contempler les éternités chatoyantes.
 s
s
« Être réfractaire, ce n’est pas être révolté avec le pathos moderne, c’est rompre là, avec calme et le plus simplement du monde afin de demeurer fidèle à l’essentiel. » A la lecture du dernier essai de Luc-Olivier d’Algange, ne vous attendez pas à un énième pamphlet réac. Ce n’est pas du tout le genre de notre dandy métaphysique. Ce qui est en jeu dans Propos réfractaires relève de la raison d’être. Et nous entrons dans ce livre comme nous entrons en conversation avec un ami qui va à la rencontre de la pensée en cherchant ses mots. Quelques références sont parsemées comme des balises : Bloy, Blanchot, Guénon, Dominique de Roux, Nietzsche, Daumal, Dante. Pas de dialectique ici, on ne peut utiliser l’outil de celui que l’on veut combattre sans le rejoindre dans l’arène et devenir son simple reflet. Luc-Olivier d’Algange ne cherche pas à convaincre car il ne cherche pas à tromper. Comme Sainte Bernadette, il ressent juste le devoir de nous le dire. Qu’il est doux de fréquenter celui qui parle avec autorité… celui-là distribue les aphorismes comme on ouvre les fenêtres d’un monde sentant le renfermé. Ses phrases se changent presque en dictons mâtinés de sagesse orientaliste. Ce qu’il nous livre ressemble parfois à la morale d’une fable et cette fable, nous la connaissons bien, c’est la farce de notre monde. Dans cette farce, Luc-Olivier d’Algange a identifié le protagoniste, c’est le Moderne. Ce Moderne, comme l’Homo Festivus de Muray, devient le masque archétypal figé d’un théâtre antique pour nos jours. Ce qui fige ce masque dans une grimace, est tout ce qui l’empêche d’être : le monde du travail, l’ère de la technologie, la société du contrôle, le dogme de l’utilité, le culte de la quantité… « L’arme du barbare moderne étant la haute technologie. » Mais cela ne s’arrête pas là car d’Algange a bien identifié que cette modernité était aussi un virus de la pensée ou plus exactement un refus de penser qui ordonne jusqu’aux décisions politiques. « Les modernes ont cette passion, nier l’évidence. »
Un plaidoyer pour l’incarnation et la vie intérieure
Pour notre auteur, face aux attaques que subit l’être, l’enjeu est de demeurer humain dans un monde qui veut nous faire trans-humains dans un confort post-humain. Voilà, « Les modernes fabriquent du chaos… ». Lui se fait plutôt le chantre de la tradition en action : « Je n’aime pas le passé ; j’aime ce qui est présent du passé. » La subtilité est de taille pour échapper au conservatisme et au moralisme et mieux combattre toutes ses formes insidieuses du totalitarisme moderne. Via l’érotisme des phrases, des saisons, l’invitation à convertir notre regard aux épiphanies, aux éternités chatoyantes, à reconnaître les symboles, à entrer en contact avec l’âme du monde, Luc-Olivier d’Algange nous offre un plaidoyer pour l’incarnation et la vie intérieure. « Symboliser est un acte amoureux. Noces du visible et de l’invisible. » Tout est pourtant mis en place pour brouiller ces épiphanies. Il faut dire que « L’immense gratuité de la création inquiète et scandalise les calculateurs, les impies. » Le Moderne ayant la pensée courte se contente de croire en l’homme et finit par être contre tout ce que nous aimons. Notre auteur dandy se veut chevalier. « Le combat pour l’Âme du monde oppose un sacrifice à un gâchis. Le moderne, ne voulant rien sacrifier, gâche tout. » En refermant ces Propos réfractaires, nous avons bien envie d’épouser cette chevalerie spirituelle proposée pour échapper au monde policier, de l’épouser avec cette pointe de désinvolture nécessaire à la lettre et l’esprit. « Être réfractaire, ce serait alors se souvenir que nous avons reçu. »
-
Propos réfractaires, essai de Luc-Olivier d’Algange, L’Harmattan, 2023
18:50 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
16/12/2023
Luc-Olivier d'Algange, les inédits de Gustave Thibon:
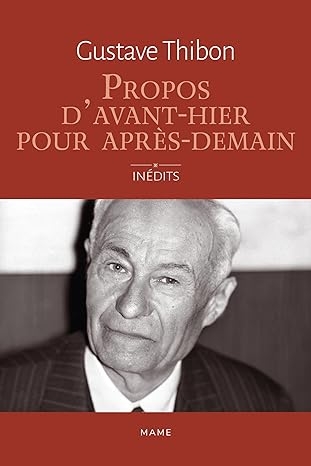
Propos d'avant-hier pour après-demain,
les inédits de Gustave Thibon
Le livre d'inédits de Gustave Thibon, qui vient de paraître aux éditions Mame, est un événement. L'ouvrage rassemble des notes, des conférences, « feuilles volantes et pages hors champs », lesquelles, pour les lecteurs non encore familiers constitueront une introduction du meilleur aloi, et pour les autres, une vision panoramique des plus instructives. Presque tous les thèmes connus de l'oeuvre sont abordés, et d'autres encore, où l'on découvre un philosophe dont la vertu première est l'attention. Il y est question de la France, des « liens libérateurs », formule qui n'est paradoxale qu'en apparence, des « corps intermédiaires », de Nietzsche et de Simone Weil, du mystère du vin, de l'âme du Midi, du Portugal, de la vie et de la mort. Ces « pensées pour soi-même », nous donnent la chance de remonter vers l'amont, vers la source d'une pensée qui ne se contente pas d'être édifiante et sauvegarde l'inquiétude, ce corollaire de la Foi, qui est au principe de toute aventure intellectuelle digne d'être vécue.
Encore qu'il eût, depuis plus d'un demi-siècle, des lecteurs fidèles, et, mieux encore, de ceux qui surent entrer en conversation avec lui et prolonger sa pensée et son œuvre, - tel Philippe Barthelet auteur d'un livre d'entretiens avec Gustave Thibon, et d'un magistral Dossier H consacré à l'auteur de L’Ignorance étoilée, aux éditions de L'Age d'Homme - il est à craindre que Gustave Thibon ne soit pas encore reconnu à sa juste valeur, et surtout, à sa juste audace. Une image s'interpose : celle du « philosophe-paysan » qui se contenterait de dispenser une sagesse traditionnelle appuyée sur le catholicisme et l'amour de la terre.
Forts de cette vision réductrice, sinon fausse, on se dispense de le lire, de confronter son œuvre à celles des philosophes, plus universitaires, de son temps, et l'on méconnaît ce qu'il y a de singulièrement affûté, et sans concession d'aucune sorte, dans sa pensée érudite, mais de ligne claire et précise, sans jargon. Gustave Thibon, dans ces pages « hors champs », adresse au lecteur, une mise-en-demeure radicale, non certes au sens actuel de radicalisme, mais, à l'inverse, par un recours aux profondeurs du temps, aux palimpsestes de la pensée, à cette archéologie, voire à cette géologie de l'âme, à cette géographie sacrée, celle de la France, qui est, par nature, la diversité même, qui se décline de la Bretagne à l'Occitanie, et n'en nécessite point d'autre, abstraite, importée ou forcée.
Certes, la terre est présente, et Gustave Thibon rejoint Simone Weil dans ses réflexions sur l'enracinement ; certes, il est catholique, sans avoir à passer son temps à le proclamer, - mais ces deux évidences sont, avant tout, l'expérience d'une transcendance véritable, qui ne cède jamais à la facilité revendicatrice, à ces représentations secondes qui nous poussent, sur une pente fatale parfois, à parler « en tant que ». Gardons-nous, dit Gustave Thibon, de nous reposer dans l'image que nous nous faisons de nous-mêmes ou dans le sentiment, d'être, par nos opinions et nos convictions, une incarnation du « Bien ».
Il existe bien un narcissisme religieux, une satisfaction indue, une façon de s'y croire, au lieu de croire vraiment, une pseudo-morale de dévots, une « charité profanée » (selon l'expression de Jean Borella) que Gustave Thibon, dans ces inédits, n'épargne pas de ses flèches. On se souviendra, en ces temps hâtifs et planificateurs que nous vivons, de sa formule qui ne cesse de gagner en pertinence : « Il ne faut pas faire l'Un trop vite ». Contre la fiction d'un universalisme abstrait, Gustave Thibon propose un retour au réel , celui du monde, avec ses limites et ses frontières heureuses ; celui de l'homme qui défaille et parfois se dépasse. Il suivra Nietzsche, pas à pas, dans son « humain, trop humain », dénonçant les leurres, la morale comme masque du ressentiment et de la faiblesse, non pour « déconstruire », et se livrer au désastre dans « un vacarme silencieux comme la mort » ainsi que l'écrivait Nietzsche, - noble naufragé qui en fit la tragique expérience, - mais pour comprendre que le vide qui se dissimule derrière nos vanités est appel à une plénitude infiniment proche et lointaine.
La faiblesse exagère tout. Son mode est l'outrance. Elle conspue, elle maudit, elle excommunie avec la rage de ceux dont la Foi est incertaine. Ces Propos d'avant-hier pour après-demain, le sont aussi pour notre pauvre aujourd'hui. Nous avons nos Robespierre, nos Précieuses ridicules, nos propagandistes du chaos, sous l'habit policé des technocrates, perfusés d'argent public, et tous ont pour dessein de faire table rase de notre héritage pour y établir leurs fatras, leurs encombrements de laideurs, de fictions lamentables, autant d'écrans entre nous et le monde ; écrans entre nous et un « au-delà de nous-mêmes », vaste mais autrefois familier, comme le furent les Rameaux, Pâques, Noël. - ces temporalités qualifiées où les hommes se retrouvaient entre eux et en eux-mêmes à la recherche de « la juste balance de l'âme » : « Existence simultané des incompatibles, balance qui penche des deux côtés à la fois : c'est la sainteté » écrivait Simone Weil, citée, dans ces pages, par Gustave Thibon.
Philosophe-paysan, Gustave Thibon le serait alors au sens où il nous intime de nous désembourgeoiser, de cesser, par exemple, de considérer l'argent comme le socle des valeurs et de retrouver le « dépôt à transmettre » : le fief, la terre, la religion. « Le socle dévore la statue (…), avarice bourgeoise, aucune magnificence, pas de générosité ; abaissement des valeurs : pour le marchand tout se chiffre – et mépris des valeurs artistiques ; mentalité étriquée (…) ; règne du Quantitatif. Les « gros » ont replacé les « grands ».
Où demeurer alors ? Gustave Thibon nous le dit, en forme de devise héraldique : « Contre l'espoir dans l'espoir ».
Luc-Olivier d'Algange
22:33 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
03/12/2023
Un article d'Eric Naulleau sur les "Propos réfractaires" de Luc-Olivier d'Algange:
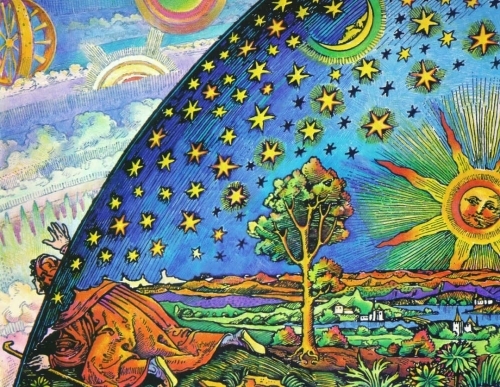
Un article d'Eric NAULLEAU sur les Propos réfractaires de Luc-Olivier d'Algange, Le journal du dimanche, 5 novembre 2023.
Pour une vie poétique
Révélation. Cioran et Philippe Muray ont un fils, commet l'appellent-ils ? Luc-Olivier d'Algange ! Ses Propos réfractaires plongent leurs racines plus profondément encore dans la tradition des moralistes du dix-septième siècle, que l'auteur prend soin de distinguer des moralisateurs : « Le moralisateur ne peut penser qu'en accord préalable avec son groupe : il ne pense pas ce qu'il pense, il pense ce qu'il faut penser, en obéissant à l'argument d'autorité des spécialistes. »
Dissipons d'emblée un possible malentendu, nous n'avons pas ici affaire à quelque scrogneugneu du « c'était mieux avant ». Sculptés dans une langue dépouillée jusqu'à l'essentiel, ces fragments désignent tous la même issue hors d'une existence ravagée par le matérialisme en roue libre et « l'individualisme de masse » - il s'agit de rétablir l'homme dans toutes ses souverainetés perdues, de choisir « la passation du feu » contre « le parti des éteignoirs ». Soit renouer les liens entre visible et invisible, entre tradition et modernité, réveiller par l'écriture et par la lecture le souvenir des textes fondateurs et des matins du monde : « Un Grand Large scintille du fond de nos mémoires, l'âme odysséenne nous revient dans cette épiphanie d'eau et de lumière qu'avive le cours de nos phrases françaises. »
Luc-Olivier d'Algange descend volontiers du ciel des illuminations pour revenir sur terre afin de distribuer les aphorismes comme autant de bourre-pifs à l'époque : « Les modernes ont cette passion, nier l'évidence », « Nous ne reprochons pas à la vulgarité d'être vulgaire, mais d'être totalitaire » ou « il faut plus de force pour résister à la meute que pour en manger les restes : le politiquement correct s'explique ainsi. »
Nuire à la bêtise, après Nietzsche, tel est le programme, ou plutôt, nuire à l'assotement, son synonymes jeté au rebut par l'Académie française et ainsi remis à l'honneur : « Se laisser assoter n'est rien d'autre que se laisser vaincre. On nous assote par la veulerie et la frayeur, la distraction et le travail, par l'ignorance et par le bourrage de l'information, par les généralités idéologiques et par les potins, par la musique d'ambiance et par le vacarme des rues, par la désolation des centres commerciaux et par le puanteur de l'air, et même par les bons sentiments. »
Sortie par le très haut, par la transcendance entendue dans son sens le plus large, par cette voie étroite frayée entre fanatisme et nihilisme. Nul n'est à l'abri de la révélation, quand un poème fait soudain tourner sur ses gonds une porte dérobée et suscite une présence accrue au monde l'espace d'un instant ou tout au long d'un passage sur terre.
Dès lors que celui-ci se trouve garanti par l'or littéraire, comme la monnaie d'autrefois par l'or tout court, dès lors que l'ici-bas et l'au-delà deviennent l'endroit et la doublure d'une même étoffe, « dès lors que nous comprenons que toute grande politique s'ordonne et s'est toujours ordonnée à la poésie, dès lors que notre stratégie se fonde sur Homère, la Bhagavad-Gîta ou la Geste arthurienne plutôt que sur un stage "force de vente". »
Lus d'une traite ou à raison d'un fragment chaque matin au réveil, peu importe la posologie, ces Propos réfractaires fortifient la santé de l'esprit.
Eric NAULEAU
Propos réfractaires, LUC-OLIVIER D'ALGANGE, L'Harmattan, 192 pages, 21 euros
15:51 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
01/12/2023
Olivier François. D'où parle luc-Olivier d'Algange ?
Olivier François
Eléments N° 205, décembre 2023
D'où parle Luc-Olivier d'Algange ?
Certaines révoltes contre le monde moderne, certaines charges contre le désordre établi viennent parfois moins d'une aspiration au vrai, au beau et au juste que d'un ressentiment ou du désir de s'anéantir dans la défense d'une bonne cause. Il ne s'y entend pas un chant profond, mais des grincements de dents, la clameur des slogans scandés par les militants ou les trémolos de tribuns qui cherchent à rallier la foule des humiliés. Cela est sinistre et vindicatif. Cela est gros déjà de futurs conformismes, de servitudes inédites, de nouvelles formes d'abaissement et de dégradation. Il n'y a rien à espérer de ces révoltes d'esclaves qui se rêvent tyrans. Je suis assuré que Luc-Olivier d'Algange n'a jamais été un esclave et qu'il ne se rêve pas tyran. Il suffit s'ouvrir son dernier livre pour s'en convaincre. Propos réfractaires, recueil de discours et d'aphorismes que viennent de publier les éditions de l'Harmattan, signale encore une fois que cet écrivain a su se préserver des atteintes de l'époque et incarner une dissidence qui ne cède jamais à cet esprit de lourdeur qu'évoque Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathoustra. C'est hélas aujourd'hui une chose bien rare quand se multiplient les espèces les plus invasives de culs-de-plomb et d'imbéciles plombés.
Les réfractions d'un réfractaire
On en voit désormais qui agitent des drapeaux, qui revendiquent et qui protestent, comme dit la chanson, et qui se font une estrade de la poutre qu'ils ont trouvée dans l'oeil de leurs adversaires. Agités par les passions les plus tristes, ils arborent des faces vengeresses et se saoulent de rages impuissantes. Et ils nomment cela "lutter pour un monde plus juste et plus humain" . Luc-Olivier d'Algange, lui, n'est pas un entrepreneur en bonheur public et en simplification sociale. Il émane de ses livres un air d'altitude . On ne s'y sent jamais confiné. Pour ma part, en lisant d'Algange, il me semble toujours être un peu en promenade, en promenade quelque part en montagne, loin, très-loin des zones soumises au règne de la quantité où s'entassent les ruines, « ruines des choses, ruines des dogmes, ruines des institutions ». je chemine, je m'arrête un instant pour contempler le paysage ou pour méditer sur les joies et les mystères que nous offre l'univers. Je respire.
« D'où parle Luc-Olivier d'Algange ? » me demande un ami qui aime à employer ironiquement le vocabulaire des anciens gauchistes. C'est là une excellente question, cher camarade ! A rebours de beaucoup de nos contemporains, disons que l'auteur de Propos réfractaires sait cultiver ces anciennes vertus que sont la piété et la ferveur. Il ne pratique pas cette mélancolie morbide et cette nostalgie incapacitante qui précède souvent les redditions. Il n'a pas renié les dieux. « Contre le pouvoir qui nous avilit, que nous le subissions ou que nous l'exercions, les deux occurrences étant parfaitement interchangeables, des alliés nous sont donnés, qu'il faut apprendre à discerner dans la confusion des apparences. Ces alliés infimes ou immenses, dans l'extrême proximité ou le plus grand lointain, les hommes, jadis, les nommaient les dieux. » écrit-il. Et, plus loin loin, ces phrases qui peuvent servir de viatique : « Tant que, dans l'aventure, les dieux et les déesses veillent, rien n'est dit. Les circonstances les plus hostiles ou les plus favorables peuvent tourner et se retourner. Ce toujours possible est la puissance même, celle qui nous porte à échapper au monde des planificateurs et des statisticiens ».
Nos temps sont hostiles à toutes les formes de méditation, et le silence est violé ou calomnié . Le découragement nous guette et nous colle à l'âme comme une mauvaise graisse. Nous sommes encombrés par des êtres aussi que par des choses surnuméraires. Et nous évoluons dans un grand fatras d'événements qui se succèdent pour nous désorienter, nous désorbiter, nous énerver c'est-à-dire nous priver de ces nerfs qui nous permettraient de nos ressaisir. Le livre de Luc-Olivier d'Algange vient justement à point. Il faut en savourer toutes les pages. Peut-être aurez-vous soudain l'envie, en achevant la lecture, d'emprunter certains chemins peu défrichés, de quitter la zone ou d'aller au large.
Olivier François
Luc-Olivier d'Algange, Propos réfractaires, éditions de L'Harmattan, collection Théôria. 178 pages. 21 euros.
22:18 | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
26/07/2023
"La métaphysique enchantée", un article de Rémi Soulié sur le dernier livre de Luc-Olivier d'Algange
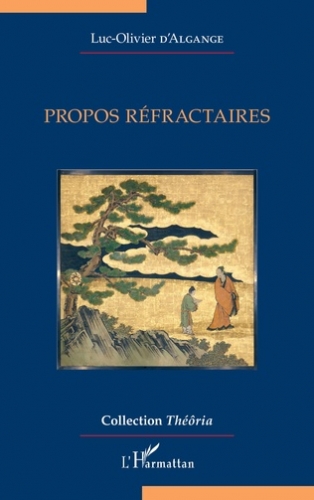
La Métaphysique enchantée
Il ne faut pas se méprendre sur le titre du dernier livre de l’admirable Luc-Olivier d’Algange, Propos réfractaires, en y entendant un écho, fût-il lointain, d’un ressentiment et d’une vengeance, ou en y soupçonnant un positionnement malencontreux qui le placerait sous la dépendance de ce qu’il observe de très loin mais, surtout, de très haut, soit, dirait Guénon, « la fin d’un monde », ou l’anéantissement d’une civilisation.
Si L.-O. d’Algange était un guerrier, je dirais qu’il a le calme des vieilles troupes ; comme c’est un brahmane ou, si l’on préfère, un métaphysicien-poète, je dirais plutôt qu’il a la sérénité du sage. Nul énervement, chez lui (dans tous les sens du mot), mais la paix de celui qui a séjourné au Centre (la « paix du Christ », dira-t-on préférentiellement sous nos latitudes) ou qui, sait-on jamais, a aussi la vertu platonicienne de force pour y demeurer.
L’ « Égout central », comme dirait Renaud Camus, est pourtant torrentiel – cette excellente formule désigne l’une des parodies modernes du Centre et l’une des inversions caractéristiques du Kali-Yuga, terme sanskrit que l’Évangile traduit par « abomination de la désolation » (βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως) et Heidegger par « détresse » (die Not) : destruction de la langue, envahissement de la laideur, démonie de l’économie (Julius Evola), propagandes publicitaires et idéologiques, mélange des castes (René Guénon) puis indistinction, uniformisation, planifications, etc.
Au chaos titanique, L.-O. d’Algange oppose non la rage – ce qui reviendrait à se placer sur le cercle infernal (Tartare) des Titans – mais « le sourire de la pensée la plus profonde » (ainsi Montherlant désignait-il le sourire du Bouddha) et, au vacarme caverneux qui, hélas non sans succès, essaie de recouvrir le son de la vibration initiale (AUM ou Fiat lux), l’écoute ou la contemplation attentive et précaire (priante, donc) du Logos resplendissant, le silence d’où surgit la parole, la vox cordis. Cela suppose donc de comprendre le temps tel qu’il est, en le relativisant (ce qui exclut toute religion de l’histoire) et de percevoir en lui, selon la formule platonicienne, l’image mobile de l’éternité immobile. Qui parvient, ainsi, à se centrer, devient littéralement hors d’atteinte – ce que nous sommes depuis toujours mais que nous avons le plus grand mal à réaliser tant nous sommes attachés à l’illusion phénoménale, laquelle a un versant obscur et lumineux, un ubac et un adret (l’essentiel étant de gravir la montagne, évidemment, sans perdre de vue le sommet).
Avec raison, L.-O. d’Algange insiste sur le second, ce qui est également ma pente, si j’ose dire, d’autant plus que dans l’Âge sombre, la splendeur phénoménale, naturellement, s’obscurcit et que les ténèbres paraissent tout recouvrir, interdisant (et, à travers ses agents, pénalisant) toute recouvrance. La métaphysique consiste à fermer les yeux pour voir, certes (la preuve par ces hauts métaphysiciens que furent Homère ou Tirésias), ou à les ouvrir jusqu’à l’éblouissement, ce qui revient au même (je songe au soleil platonicien). Quoi qu’il en soit, voir, c’est toujours savoir. La question se pose alors de savoir qui voit quoi.
Le poète, bien entendu, est le voyant (ou le clairvoyant) par excellence. Pour lui, dit Goethe, le bleu du ciel est la théorie (θεωρία), la contemplation même – ce pourquoi la couverture de la collection Théôria (dirigée par le non moins admirable Pierre-Marie Sigaud), dans laquelle le livre de L.-O. d’Algange est publié, est aussi bleue que le manteau de la Vierge. Il faut être aussi obtus qu’un Chinois de Königsberg pour ne pas voir que le phénomène est le noumène et qu’il n'y a même que lui qui soit (le Noûs, le νοῦς). Comment voulez-vous voir les formes si vous ne voyez pas les dieux ? Le sortilège est devenu si puissant que nos contemporains ne voient même plus l’envers de la Sainte Face, qui s’affiche pourtant sur tous les écrans et dont le nom est Légion. Ce livre est un pharmakon, mais au sens exclusif de l’antipoison. Autant dire qu’il est un enchantement et qu’il relève donc du réalisme le plus profond.
Un bref Propos, moins métaphysique en apparence, qui convaincra les plus politiques d’entre nous : « La Monarchie était sensiblement mieux une république que ne le sont nos démocraties. Plus nos démocraties liquident l’héritage royal et plus elles s’éloignent de la res publica : on s’afflige d’avoir à énoncer, contre l’opinion générale, de pareilles évidences ».
Propos réfractaires ? Certes, mais surtout, Propos réfracteurs de lumière.
Rémi Soulié
Luc-Olivier d’Algange, Propos réfractaires, L’Harmattan.
21:29 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
18/07/2023
Le "Nocturne" de D'Annunzio, pour la première fois en ce siècle, dans son texte intégral avec les gravures d'origine:
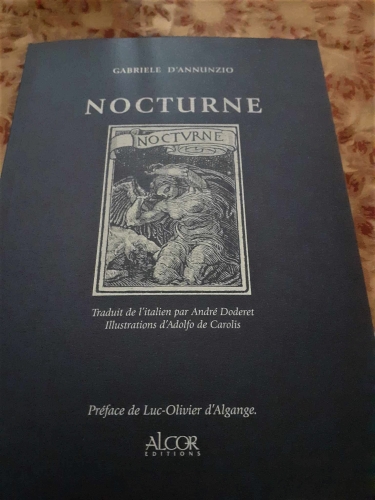
266 pages, 25 euros, aux éditions Alcor.
16:21 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
28/06/2023
Vient de paraître:
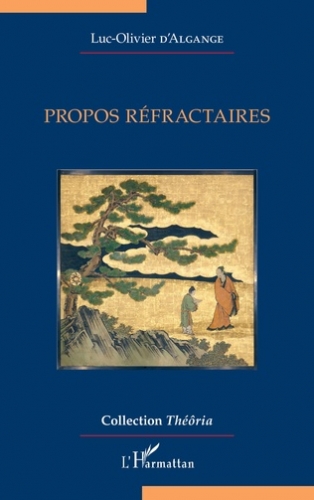
180 pages, 21euros
14:39 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
27/05/2023
Luc-Olivier d'Algange, Prologue aux "Propos réfractaires", nouvelle édition augmentée, à paraître en Juin, aux éditions de L'Harmattan:

Luc-Olivier d'Algange
Prologue aux Propos réfractaires
Le titre de cet ouvrage est venu de lui-même, et presque malgré nous. Quelques mots ne seront pas inutiles pour en dissiper le malentendu possible. Etre réfractaire n'est pas un projet, ni une vocation, et, à Dieu ne plaise, une pose. Le monde est assez achalandé de subversifs subventionnés, de marchands de libertés par procuration, de fortes gueules approximatives, de râleurs et de rabat-joie pour, au moins, hésiter de faire chœur avec eux.
Le monde moderne, certes, est sinistre, et sans en disconvenir, il convient de ne point trop mélancoliser et de tenir la bride courte aux nostalgies. Réfractaires, nous eussions préféré ne l'être pas, et recevoir le monde qui nous entoure, mais désormais nous enserre avec une idiosyncrasie carcérale , avec moins de réticences ; la ferveur et la piété sont plus aimables.
Une civilisation et une civilité s'effacent. Dans leur relativisme général, les intellectuels bien-pensant s'en indiffèrent. Mais la conséquence est là : voici le temps des calculateurs, des moroses, des jaloux, des agités et des dépités, qui ne savent ce qu'est servir plus grand que soi, ou plus vaste, - encalminés dans leurs subjectivités ulcérées, fermés à toute contemplation : rats traqués se dévorant entre eux dans les remugles du ressentiment, tandis que les barbares prennent la place.
Pour atteindre à une affirmation souveraine, si lointaine de nos conditions, de nos fragilités, de nos incertitudes réelles, sans doute faut-il passer par la « négation de la négation » et ne pas méconnaître, car elle agit sur nous, cette grande machine de guerre planificatrice, en mouvement contre tout ce que nous aimons, ici et ailleurs, dans la diaprure des êtres et des choses, dans leurs singularités vivantes, dans le ressac du passé qu'elles nous portent, tels des embruns de pointe océanique. N'opposons pas un système à un autre, qui en serait l'envers ou la grimace. Nous sommes fugaces, comme une allumette brûlée au cœur de la nuit, mais d'un unique éclat. Que peut nous chaloir d'être agrégé à d'autres dont on supposerait qu'ils partagent nos révoltes et nos malheurs ? Le collectivisme comme l'individualisme de masse participent l'un et l'autre de notre expropriation, du refus de qui nous est propre : tradition, flamme presque indiscernable, qui passe, de mains en mains. L'amitié est notre seule cause commune.
Les idéologues, ces dévergondés de l'abstraction, sont flatteurs et vivent aux dépens de ceux qu'ils prétendent défendre, ou, pire encore, « représenter », en les réduisant à leurs plus petits dénominateurs communs. Cette morne ruse n'est courue que par la presque infinie complaisance des hommes de notre temps à se faire plaindre et à vouloir « exister » non par leurs propres vertus, ou vices, dont ils héritent ou qu'ils inventent, mais par un statut de victime qui leur serait accordé d'office et sur lequel ils pourraient se reposer, - sans voir que ceux qui les encouragent à ce triste rôle se servent d'eux, et les avilissent. Le beau fromage de la reconnaissance sociale tombe ainsi du bec aux dents, et leur ultime bien, qui était leur irréductible singularité, leur est ôté dans une statistique.
Il sera donc question, dans ces digressions et ces formes brèves, de ce qui, dans la nature humaine, résiste à ce qui voudrait nous uniformiser et nous avilir. L'ambition, somme toute est modeste, mais parfois modestie est gageure : demeurer humain dans un monde qui ne songe qu'à nous appareiller pour nous faire « trans-humain » ou nous installer, devant nos écrans, dans la servitude volontaire d'un confort « post-humain ». La voie qui rechigne à de si vantées perspectives, est parfois capricieuse et risquée, mais souvent bienheureuse en ce qu'elle nous relie à des beautés oubliées. D'où vient notre pensée ? Elle vient d'autres pensées et du monde. De la séquence de Sainte-Eulalie; de la romance arthurienne; de nos promenades en forêt ou au bord de la mer ; des nuits traversées au long cours jusqu'au petit matin froid et rose; d'Héraclite d'Ephèse et de son feu mêlé d'aromates dans l'Obscur; de la délicatesse violente de Valéry Larbaud; des romans d'aventure qui disent la vraie vie; des orages dont parle Henry Bosco; du Sacre de la cathédrale de Reims; de l'Éclair dans l'éclair d'Angélus Silésius; de l'ermitage aux buissons blanc; du gaélique et de la kabbale des arbres; de l'épaule de cette jeune femme où j'ai posé mes lèvres; de la lumière qui est l'ombre de Dieu.
Etre réfractaire, ce serait alors se souvenir que nous avons reçu bien plus que nous ne pourrions jamais donner. Rompre là, pour mieux honorer, s'éloigner de ceux qui déprécient, qui se vengent, pour mieux s'approcher de l'éloge ingénu. Si l'on considère à quel point les moralisateurs, de nos jours, enlaidissent le monde par leurs griefs, leurs jalousies, leurs morosités, leurs hystéries, leurs récriminations, leurs censures, leurs menaces et leurs jugements, à quel point ils jettent, venimeuses vermines, une systématique suspicion empoisonnée sur toute forme de beauté et de grandeur, à quel point ils sont aveugles à la vérité et au réel en leurs nuances, leurs gradations et leurs variations, nous devons reconnaître que l'alliance immémoriale entre le vrai, le beau et le bien a, hélas, été rompue, collectivement et délibérément, et que seules les âmes légères, baroques, désinvoltes, rares heureux, fils de Roi, pourront en retrouver le goût, la saveur, qui est sapience.
La reconnaissance est la clef et sa mission, que résume propos du grand Latin, « naviguer est nécessaire mais il n'est pas nécessaire de vivre » offre aux réfractaires cet horizon d'enfance qui détient un secret de poésie : combattre l'indéfini, la confusion, l'indistinction avec les armes de l'infini et reconquérir enfin nos paysages et l'armorial des songes dans les étymologies de notre langue natale.
L-O.d'A.
Bibliographie
-
Manifeste baroque, Toulouse, Cééditions, 1981
-
Orphiques, éditions Style, 1988
-
Le Secret d'or, éditions des Nouvelles Littératures Européennes, 1989
-
La Victoire de Castalie, Aguessac, Editions Clapàs, 2000
-
Traité de l'ardente proximité, Aguessac, Éditions Clapàs, 2005
-
L'Étincelle d'or : notes sur la science d'Hermès, Paris, Les Deux Océans, 2006
-
L'Ombre de Venise, essai, Billère, Alexipharmaque, 2006
-
Le Songe de Pallas , suivi de De la souveraineté et de Digression néoplatonicienne, essai, Billère, Alexipharmaque, 2007
-
Fin mars. Les hirondelles, éditions Arma Artis, 2009
-
Terre lucide. Entretiens sur les météores (avec Philippe Barthelet), La Bégude de Mazenc, Éditions Arma Artis, 2010 ; rééd. revue et corrigé Editions L'Harmattan, coll. Théôria, 302 p., 2022
-
Le Chant de l'Ame du monde, poèmes, éditions Arma Artis, 2010
-
Lectures pour Frédéric II, Alexipharmaque, 2011
-
Lux Umbra Dei, éditions Arma Artis, 2012
-
Propos réfractaires, éditions Arma Artis, 2013
-
Au seul d'une déesse phénicienne, éditions Alexipharmaque, 2014
-
Apocalypse de la beauté, éditions Arma Artis, 2014
-
Métaphysique du dandysme, éditions Arma Artis, 2015
-
Intempestiva Sapientia, suivi de L'Ange-Paon, éditions Arma Artis, 2016
-
Notes sur L'éclaircie de l'être, éditions Arma Artis, 2016
-
Le Déchiffrement du monde : la gnose poétique d'Ernst Jünger, Paris, L'Harmattan, coll. Théôria, 2017 )
-
Sous la dir. de Pierre-Yves Rougeyron, Pourquoi combattre ?, Éditions Perspectives Libres, Paris, Janvier 2019, .
-
L'Âme secrète de L'Europe : Œuvres, mythologies, cités emblématiques, Paris, L'Harmattan, coll. Théôria, 2022.
-
Terre Lucide entretiens sur les météores et les signes des temps (avec Philippe Barthelet) Paris, L'Harmattan, coll.Théôria, 2023.
Propos réfractaires, édition revue et augmentée, Paris, L'Harmattan ( à paraître)
19:37 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
08/04/2023
Luc-Olivier d'Algange, Mythe et Logos:

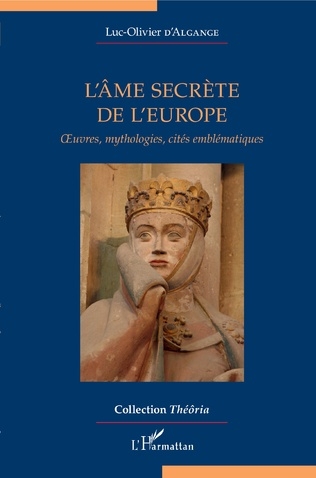
19:12 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
05/04/2023
Luc-Olivier d'Algange, Hommage à Roger Nimier:

Luc-Olivier d’Algange
Hommage à Roger Nimier
Roger Nimier fut sans doute le dernier des écrivains, et des honnêtes gens, à être d'une civilisation sans être encore le parfait paria de la société; mais devinant cette fin, qui n'est pas une finalité mais une terminaison.
Après les futilités, les pomposités, les crises anaphylactiques collectives, les idéologies, viendraient les temps de la disparition pure et simple, et en même temps, des individus et des personnes. L'aisance, la désinvolture de Roger Nimier furent la marque d'un désabusement qui n'ôtait rien encore à l'enchantement des apparences. Celles-ci scintillent un peu partout dans ses livres, en sentiments exigeants, en admirations, en aperçus distants, en curiosités inattendues.
Ses livres, certes, nous désabusent, ou nous déniaisent, comme de jolies personnes, du Progrès, des grandes abstractions, des généralités épaisses, mais ce n'est point par une sorte de vocation éducative mais pour mieux attirer notre attention sur les détails exquis de la vie qui persiste, ingénue, en dépit de nos incuries. Roger Nimier en trouvera la trace aussi bien chez Madame de Récamier que chez Malraux. Le spectre de ses affections est large. Il peut, et avec de profondes raisons, trouver son bien, son beau et son vrai, aussi bien chez Paul Morand que chez Bernanos. Léautaud ne lui interdit pas d'aimer Péguy. C'est assez dire que l'esprit de système est sans prise sur lui, et que son âme est vaste.
On pourrait en hasarder une explication psychologique, ou morale. De cette œuvre brève, au galop, le ressentiment qui tant gouverne les intellectuels modernes est étrangement absent. Nimier n'a pas le temps de s'attarder dans les relents. Il va à sa guise, voici la sagesse qu'il nous laisse. Ses quelques mots pointus, que l'on répète à l'envie, et que ses fastidieux épigones s'efforcent de reproduire, sont d'un piquant plus affectueux que détestateur. Pour être méchant, il faut être bien assis quelque part, avec sa garde rapprochée. Or le goût de Roger Nimier est à la promenade, à l'incertitude, à l'attention. Fût-ce par les méthodes de l'ironie, il ne donne pas la leçon, mais invite à parcourir, à se souvenir, à songer, - exercices dont on oublie souvent qu'ils exigent une intelligence toujours en éveil. Son goût n'est pas une sévérité vétilleuse dissimulée sous des opinions moralisatrices, mais une liberté exercée, une souveraineté naturelle. Il ne tient pas davantage à penser comme les autres qu'il ne veut que les autres pensent comme lui, puisque, romancier, il sait déjà que les autres sont déjà un peu en lui et lui dans les autres. Les monologues intérieurs larbaudiens du Hussard bleu en témoignent. Nimier se défie des représentations et de l'extériorité. Sa distance est une forme d'intimité, au rebours des familiarités oppressantes.
L'amour exige de ces distances, qui ne sont pas seulement de la pudeur ou de la politesse mais correspondent à une vérité plus profonde et plus simple: il faut aux sentiments de l'espace et du temps. Peut-être écrivons nous, tous, tant bien que mal, car nous trouvons que ce monde profané manque d'espace et de temps, et qu'il faut trouver quelque ruse de Sioux pour en rejoindre, ici et là, les ressources profondes: le récit nous autorise de ses amitiés. Nul mieux que Roger Nimier ne sut que l'amitié est un art, et qu'il faut du vocabulaire pour donner aux qualités des êtres une juste et magnanime préférence sur leurs défauts. Ceux que nous admirons deviendront admirables et la vie ressemblera, aux romans que nous écrivons, et nos gestes, aux pensées dites « en avant ». Le généreux ne jalouse pas.
Il n'est rien de plus triste, de plus ennuyeux, de plus mesquin que le « monde culturel », avec sa moraline, son art moderne, ses sciences humaines et ses spectacles. Si Nimier nous parle de Madame Récamier, au moment où l'on disputait de Mao ou de Freud, n'est-ce pas pour nous indiquer qu'il est possible de prendre la tangente et d'éviter de s'embourber dans ces littératures de compensation au pouvoir absent, fantasmagories de puissance, où des clercs étriqués jouent à dominer les peuples et les consciences ? Le sérieux est la pire façon d'être superficiel; la meilleure étant d'être profond, à fleur de peau, - « peau d'âme ». Parmi toutes les mauvaises raisons que l'on nous invente de supporter le commerce des fâcheux, il n'en est pas une qui tienne devant l'évidence tragique du temps détruit. La tristesse est un péché.
Les épigones de Nimier garderont donc le désabusement et s'efforceront de faire figure, pâle et spectrale figure, dans une société qui n'existe plus que pour faire disparaître la civilisation. La civilisation, elle, est une eau fraîche merveilleuse tout au fond d'un puits; ou comme des souvenirs de dieux dans des cités ruinées. L'allure dégagée de Roger Nimier est plus qu'une « esthétique », une question de vie ou de mort: vite ne pas se laisser reprendre par les faux-semblants, garder aux oreilles le bruit de l'air, être la flèche du mot juste, qui vole longtemps, sinon toujours, avant son but.
Les ruines, par bonheur, n'empêchent pas les herbes folles. Ce sont elles qui nous protègent. Dans son portrait de Paul Morand qui vaut bien un traité « existentialiste » comme il s'en écrivait à son époque (la nôtre s'étant rendue incapable même de ces efforts édifiants), Roger Nimier, après avoir écarté la mythologie malveillante de Paul Morand « en arriviste », souligne: « Paul Morand aura été mieux que cela: protégé. Et conduit tout droit vers les grands titres de la vie, Surintendant des bords de mer, Confident des jeunes femmes de ce monde, Porteur d'espadrilles, Compagnons des vraies libérations que sont Marcel Proust et Ch. Lafite. »
Etre protégé, chacun le voudrait, mais encore faut-il bien choisir ses Protecteurs. Autrefois, les tribus chamaniques se plaçaient sous la protection des faunes et des flores resplendissantes et énigmatiques. Elles avaient le bonheur insigne d'être protégées par l'esprit des Ours, des Lions, des Loups ou des Oiseaux. Pures merveilles mais devant lesquelles ne cèdent pas les protections des Saints ou des Héros. Nos temps moins spacieux nous interdisent à prétendre si haut. Humblement nous devons nous tourner vers nos semblables, ou vers la nature, ce qui n'est point si mal lorsque notre guide, Roger Nimier, nous rapproche soudain de Maurice Scève dont les poèmes sont les blasons de la langue française: « Où prendre Scève, en quel ciel il se loge ? Le Microcosme le place en compagnie de Théétète, démontant les ressorts de l'univers, faisant visiter les merveilles de la nature (...). Les Blasons le montrent couché sur le corps féminin, dont il recueille la larme, le soupir et l'haleine. La Saulsaye nous entraîne au creux de la création dans ces paradis secrets qui sont tombés, comme miettes, du Jardin royal dont Adam fut chassé. »
Hussard, certes, si l'on veut, - mais pour quelles défenses, quelles attaques ? La littérature « engagée » de son temps, à laquelle Nimier résista, nous pouvons la comprendre, à présent, pour ce qu'elle est: un désengagement de l'essentiel pour le subalterne, un triste "politique d'abord" (de Maurras à Sartre) qui abandonne ce qui jadis nous engageait (et de façon engageante) aux vertus mystérieuses et généreuses qui sont d'abord celles des poètes, encore nombreux du temps de Maurice Scève: « Ils étaient pourtant innombrables, l'amitié unissait leurs cœurs, ils inspiraient les fêtes et décrivaient les guerres, ils faisaient régner la bonté sur la terre. » De même que les Bardes et les Brahmanes étaient, en des temps moins chafouins, tenus pour supérieurs, en leur puissance protectrice, aux législateurs et aux marchands, tenons à leur exemple, et avec Roger Nimier, Scève au plus haut, parmi les siens.
Roger Nimier n'étant pas « sérieux », la mémoire profonde lui revient, et il peut être d'une tradition sans avoir à le clamer, ou en faire la réclame, et il peut y recevoir, comme des amis perdus de vue mais nullement oubliés, ces auteurs lointains que l'éloignement irise d'une brume légère et dont la présence se trouve être moins despotique, contemporains diffus dont les amabilités intellectuelles nous environnent.
Qu'en est-il de ce qui s'enfuit et de ce qui demeure ? Chaque page de Roger Nimier semble en « répons » à cette question qui, on peut le craindre, ne sera jamais bien posée par l'âge mûr, par la moyenne, - dans laquelle les hommes entrent de plus en plus vite et sortent de plus en plus tard, - mais par la juvénilité platonicienne qui emprunta pendant quelques années la forme du jeune homme éternel que fut et demeure Roger Nimier, aimé des dieux, animé de cette jeunesse « sans enfance antérieure et sans vieillesse possible » qu'évoquait André Fraigneau à propos de l'Empereur Julien.
Qu'en est-il de l'humanité lorsque ces fous qui ont tout perdu sauf la raison régentent le monde ? Qu'en est-il des civilités exquises, et dont le ressouvenir lorsqu’elles ont disparu est exquis, précisément comme une douleur ? Qu'en est-il des hommes et des femmes, parqués en des camps rivaux, sans pardon ? Sous quelle protection inventerons-nous le « nouveau corps amoureux » dont parlait Rimbaud ? Nimier écrit vite, pose toutes les questions en même temps, coupe court aux démonstrations, car il sait que tout se tient. Nous perdons ou nous gagnons tout. Nous jouons notre peau et notre âme en même temps. Ce que les Grecs nommaient l'humanitas, et dont Roger Nimier se souvient en parlant de l'élève d'Aristote ou de Plutarque, est, par nature, une chose tant livrée à l'incertitude qu'elle peut tout aussi bien disparaître: « Et si l'on en finissait avec l'humanité ? Et si les os détruits, l'âme envolée, il ne restait que des mots ? Nous aurions le joli recueil de Chamfort, élégante nécropole où des amours de porphyre s'attristent de cette universelle négligence: la mort ».
Par les mots, vestiges ultimes ou premières promesses, Roger Nimier est requis tout aussi bien par les descriptifs que par les voyants, même si « les descriptifs se recrutent généralement chez les aveugles ». Les descriptifs laisseront des nécropoles, les voyants inventeront, comme l'écrivait Rimbaud « dans une âme et un corps ». Cocteau lui apparaît comme un intercesseur entre les talents du descriptif et des dons du voyant, dont il salue le génie: «Il ne fait aucun usage inconsidéré du cœur et pourtant ses vers ont un caractère assez particulier: ils semblent s'adresser à des humains. Ils ne font pas appel à des passions épaisses, qui s'essoufflent vite, mais aux patientes raisons subtiles. Le battement du sang, et c'est déjà la mort, une guerre, et c'est la terre qui mange ses habitants ».Loin de nous seriner avec le style, qui, s'il ne va pas de soi, n'est plus qu'un morose « travail du texte », Roger Nimier va vers l'expérience, ou, mieux encore, vers l'intime, le secret des êtres et des choses: « Jean Cocteau est entré dans un jardin. Il y a trouvé des symboles. Il les a apprivoisé. »
Loin du cynisme vulgaire, du ricanement, du nihilisme orné de certains de ses épigones qui donnent en exemple leur vide, qui ne sera jamais celui des montagnes de Wu Wei, Roger Nimier se soucie de la vérité et du cœur, et de ne pas passer à côté de ce qui importe. Quel alexipharmaque à notre temps puritain, machine à détruire les nuances et qui ne connaît que des passions courtes ! Nimier ne passe pas à côté de Joseph Joubert et sait reconnaître en Stephen Hecquet l'humanité essentielle (« quel maître et quel esclave luttant pour la même cause: échapper au néant et courir vers le soleil ») d'un homme qui a « Caton pour Maître et Pétrone pour ami. » Sa nostalgie n'est pas amère; elle se laisse réciter, lorsqu'il parle de Versailles, en vers de La Fontaine: « Jasmin dont un air doux s'exhale/ Fleurs que les vents n'ont su ternir/ Aminte en blancheur vous égale/ Et vous m'en faites souvenir ».
On oublie parfois que Roger Nimier est sensible à la sagesse que la vie et les œuvres dispensent « comme un peu d'eau pris à la source ». La quête d'une sagesse discrète, immanente à celui qui la dit, sera son génie tutélaire, son daemon, gardien des subtiles raisons par l'intercession de Scève: « En attendant qu'à dormir me convie/ Le son de l'eau murmurant comme pluie ».
Luc-Olivier d'Algange
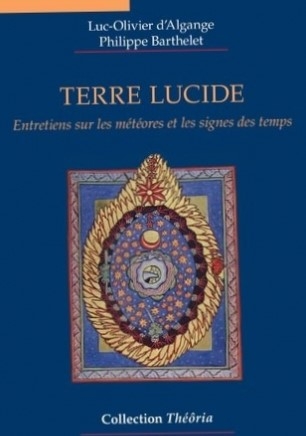
19:11 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
03/04/2023
Luc-Olivier d'Algange, notes sur Fernando Pessoa:

Luc-Olivier d’Algange
Hétéronymes et « états multiples de l’être »
Notes sur l’œuvre de Fernando Pessoa
Le dessein initiatique de Fernando Pessoa est de donner accès à ce paysage qui, bien qu'il soit à jamais, à l'exemple du poète, « tel qu'en lui-même l'éternité le change », offre des visages multiples. De même que change l'apparence de la mer et des feuillages selon la position du soleil, de même, dans l'œuvre de Fernando Pessoa, change, par l'usage des hétéronymes et en vertu des états multiples de l'être, le sens et l'orientation du poème.
Tout va se jouer dans cette autre conception de l'être et du temps dont la perspective non-utilitaire suffit déjà à nous délivrer des identités fixées par des déterminismes étrangers à la poésie et à la métaphysique. Il suffit que le désir de transmettre un message spirituel prime sur l'utilité de la « communication » pour que nous entrions dans cet espace limpide et incandescent où les « valeurs » du monde moderne ne sont plus que d'imperceptibles écorces de cendre. Le sens d'un poème, alors, s'avère identique, par essence, au sens d'une cathédrale, d'un cairn, d'une rune gravée sur la pierre qui contient l’audace de transcender le temps, la volonté d'abattre Kronos du trait de cette lance de feu que l'on nomme l'Instant. A cette exigence correspondent également une éthique et une esthétique.
L'initiation n'est pas une formalité. Elle n'est pas le résultat invariable de quelques lectures ou rituels choisis, mais avant tout, pour reprendre le mot de Malraux, le destin d'un « anti-destin », une rébellion, éternisée par l'Instant, contre les déterminismes et les normes profanes qui nous condamnent habituellement à la médiocrité, à la banalité hargneuse ou satisfaite, morne ou fanfaronne. Le monde moderne étant, par définition, un monde subverti (et particulièrement dans ses mœurs les plus bourgeoises), il ne saurait être question d'y prôner ces valeurs d'obéissance, de fidélité, d'enracinement, ou de civisme, qui seraient légitimes dans un ordre traditionnel. L'homme de la Tradition ne saurait obéir au chaos, être fidèle à l'ignorance, s'enraciner dans la parodie ni certes exercer les vertus civiques à l'endroit d'une société qui, à chaque instant, bafoue le Vrai, le Beau et le Bien.
Disciple sur une terre traditionnelle, l'homme de la Tradition se voudra, ainsi que l’écrit Fernando Pessoa, « indisciplineur » dans le monde moderne et bourgeois: « Le Portugal a besoin d'un indisciplineur... Travaillons au moins, nous les jeunes, à perturber les âmes, à désorienter les esprits... » Que ceci nous aide à dissiper une fois pour toute l'équivoque issue de l'usage ésotérique ou initiatique du mot Tradition. L'homme de la Tradition sera toujours, à l'égard des morales bourgeoises, travaillistes ou grégaires infiniment plus « libertaire » que ceux-là mêmes qui se revendiquent comme tels. L'initiation commence par une révolte contre l'identité profane, c'est-à-dire, comme l'indique le sens même du mot révolte, par un retour sur soi. L'aventure débute ainsi: il faut rompre les amarres, être fidèle, non aux convenances, mais à l'appel du Grand Large que décrit admirablement l'hétéronyme Alvaro de Campos, dans son Ode maritime:
« Mais mon âme est avec ce que je vois le moins
Avec le paquebot qui entre
Parce qu'il est avec la Distance, avec le Matin
Avec la signification maritime de cette Heure... »
Pessoa évoque ainsi, dans une splendide inspiration néoplatonicienne:
« Le Grand Quai Antérieur, éternel et divin,-
De quel port? En quelles eaux? Et pourquoi ainsi ai-je rêvé
Grand Quai, comme les autres quai, mais l'Unique
Plein comme eux de silences bruissant dès l'aurore... »
L’Idée est très-exactement une chose vue, ainsi que nous l'enseignent Jamblique, Proclus ou Porphyre. Le matin profond de la vision commence le temps sacré, le Grand Départ vers les jardins de la mer, et le vent est soudain annonciateur de la présence invisible, mais indubitable, de l'Ile Verte, refuge des dieux et des héros, qui n'est autre que le Soi:
« Plus je sentirai, plus je sentirai en personnes diverses,
Plus j'aurai de personnalités
Plus je les aurai avec intensité, avec stridence
Plus je sentirai simultanément avec elles toutes
Plus divers dans l'unité, attentif dans la dispersion
Je sentirai, je vivrai, je serai dans l'Instant et dans mon essence,
Plus je possèderai l'existence totale de l'univers
Plus je serai complet dans l'espace entier
Plus je serai analogue à Dieu, quel qu'il soit
Parce que, quel qu'Il soit, Lui à coup sûr, est Tout
Et hors de Lui il n'est que Lui, et tout pour Lui n'est guère.
Chaque âme est une échelle qui mène à Dieu
Chaque âme est un corridor-univers qui débouche sur Dieu... »
Nul mieux qu'Alvaro de Campos, dans son Ode Maritime, n'éclaire le sens même du dessein « hétéronymique » de Fernando Pessoa, qui, en aucune façon ne saurait se réduire à quelque jeu littéraire (du genre oulipiste) issu de quelque scepticisme philosophique, de même que l'on ne saurait réduire l'ésotérisme à un vague syncrétisme de croyances religieuses. « La religion, écrit René Guénon, considère l'être uniquement dans l'état individuel humain et ne vise aucunement à l'en faire sortir mais au contraire à lui assurer les conditions les plus favorables à cet état même, tandis que l'initiation a essentiellement pour but de dépasser les possibilités de cet état et de rendre effectivement possible le passage aux états supérieurs, et même, finalement, de conduire l'être au-delà de tout état conditionné quel qu'il soit. » La fonction de l'acteur, du personnage et du masque s'en trouvent singulièrement éclairée. « L'acteur, écrit encore René Guénon, est un symbole du Soi ou de la personnalité se manifestant par une série indéfinie d'états et de rôles différents, et il faut noter l'importance qu'avait l'usage du masque pour la parfaite exactitude de ce symbolisme. » Le propre de l'œuvre de Fernando Pessoa étant justement de se manifester « par une multiplicité de noms représentant autant de modalités de l'être », le théâtre spirituel dissimule et divulgue à la fois l'unité du dessein et du message.
Indissolublement liés, l'œuvre et la destinée de Fernando Pessoa semblent ainsi illustrer cet autre propos de René Guénon concernant les noms profanes et les noms initiatiques: « La désignation par un nom profane, même si elle est exacte matériellement, sera toujours entachée de fausseté, à peu près comme le serait la confusion entre un acteur et un personnage dont il joue le rôle et dont on s'obstinerait à lui appliquer le nom dans toutes les circonstances de son existence... On peut aller plus loin: à tous degrés d'initiation effective correspond encore une autre modalité de l'être; celui-ci devra donc recevoir un nom pour chacun de ces degrés. »
Un nombre considérable d'études se contentent de constater des similitudes symbologiques ou thématiques entre certains textes littéraires et le corpus des écrits dits « ésotériques » sans toutefois s'attacher à préciser la nature de la ressemblance, laquelle peut être d'ordre purement formel, et donc, sans aucune conséquence autre qu'ornementale, ou, au contraire, témoigner d'une expérience de la pensée qui réactualise véritablement l'esprit des Mystères. Il se peut aussi qu'un dessein ou un processus initiatique soient présents en des œuvres qui, par ailleurs, ne portent aucune référence explicite à la Tradition. On pourrait dire que, par définition même, les formes et les références sont toujours d’importance secondaire. Ainsi que l'écrit Joao Gaspar Simoes (in Vida e obra de Fernando Pessoa, qui publié en 1949, fut le premier livre consacré à Pessoa): « La grandeur de sa poésie ne réside pas tant dans ses extrêmes beautés de forme ou dans ses prodigieuses richesses de contenus, ou dans la complexité de l'âme même du poète qui l'a produite que dans le fait qu'elle se trouve toute entière réellement structurée sur une pensée métaphysique, métaphysique magique, métaphysique occultiste, si l'on veut mais non moins révélatrice, pour autant, d'une conscience qui vécut en communion avec l'insondable mystère. »
De même que la rigueur, qui tranche de façon systématique et puritaine, s'oppose à l'exactitude, qui discerne et respecte les nuances, de même les convenances, les conformismes et les fondamentalismes sont les ennemis de la Tradition. L'uniformité est la parodie et l'ennemie de l'unité. La théorie du corps des couleurs d'Oswald (que cite à juste escient l'auteur anonyme des Méditations sur les 22 arcanes majeurs du Tarot) éclaire cette idée. Ce corps de couleur est constitué de deux cônes et donc de deux pôles et d'un équateur. Le pôle « nord » est le pôle blanc, synthèse de toutes les couleurs. La lumière blanche se différencie de plus en plus à mesure qu'elle descend vers l'équateur. Les mêmes couleurs, en continuant leur descente de l'équateur vers le pôle sud perdent progressivement leurs distinctions, s'obscurcissent et deviennent toutes également noires. Le pôle blanc est la synthèse, le pôle noir la confusion de toutes les couleurs. Or, ce point lumineux de synthèse transcendante (qui correspond à l'En-Sof de l'Arbre séphirotique) se retrouve dans tous les ordres de la pensée et du monde. Il est, en quelque sorte, la clef de voûte de toute herméneutique du Livre et du monde. Ainsi, l'idée de Tradition primordiale correspond de toute évidence au pôle blanc alors que l'universalisme moderne, qui réduit tous les hommes au plus petit dénominateur commun, correspond au pôle noir. En tout ce qui concerne l'initiation et les sciences traditionnelles, voire les questions métapolitiques, il importe de garder présente à l'esprit cette distinction, sous peine de lâcher la proie pour l'ombre et se laisser abuser par des contrefaçons, les totalitarismes uniformisateurs s'opposant ici à l'unificence impériale. Aussi bien ne s'étonnera-t-on pas de trouver l'idée d'Empire au cœur même de la pensée de Fernando Pessoa dont l'œuvre, il faut le redire, ne vise point à charmer les loisirs mais se propose comme un instrument de transmutation de l'entendement.
« Tout Empire, écrit Fernando Pessoa, qui n'est pas fondé, sur un impérialisme spirituel est un cadavre régnant, une Mort sur un trône. Seule une petite nation peut véritablement réaliser un Empire Spirituel car en elle la croissance d'un idéal national ne saurait susciter nulle tentative d'annexion territoriale qui finirait par adultérer son impérialisme psychique initial et le détourner de son destin spirituel. » L'idée d'Empire pose ainsi la question de l'au-delà et de l'en-deçà de l'individualisme. « L'individu, c'est la masse » écrivait Ernst Jünger, s'en prenant à cet individualisme bourgeois où chaque individu se trouve uniformisé par un même idéal de réussite sociale et de confort matériel. Ce pourquoi, les prétendues élites du monde moderne, technocratiques ou financières, pas davantage que les masses ne sauraient prétendre à donner une orientation à nos destinées. Or, tel est le magnanime pressentiment de Fernando Pessoa: de la destruction nuptiale des identités naîtront de nouveaux règnes.
Au pôle transcendantal de l'unique souveraineté de l'Esprit s'oppose donc la sinistre parodie des « identités » soumises à un « ordre moral » que les classes dominantes, aussi bien que les subalternes, s'accorderaient à faire régner au détriment des poètes, des esthètes, des mystiques et des hommes de connaissance. On devine ainsi de quelles nostalgies et de quels pressentiments s'éclaire le dessein initiatique de Fernando Pessoa, ce dessein qui débute avant la page écrite et s'achève après elle en des oeuvres vives, ardentes, que l'on peut dire philosophales. En refusant, par le jeu des hétéronymes, le romantisme inférieur de l'individualisme psychologique, l'œuvre polyphonique de Pessoa entre d'emblée dans cette « impersonnalité active » condition impérieuse de l’expérimentation des états multiples de l'être. Comparable à l'Arbre séphirotique de la Kabbale, l'arbre généalogique des hétéronymes de Fernando Pessoa, avec ses colonnes de Clémence et de Rigueur, et ses stations opératoires que surplombe l’En-Sof (l'infini souverain d'où procèdent toutes les couleurs et toutes les valeurs sensibles ou intellectuelles), nous laisse entrevoir une anthropologie radicalement différente de celle de l'humanisme moderne. Encore faut-il, pour ne pas rester dans le vague, se familiariser quelque peu avec la pensée par analogie dont on peut dire qu'elle œuvre sur les qualités alors que la pensée par déduction travaille sur les quantités. « De même, écrit Fernando Pessoa, que l'intelligence dialectique, que l'on nomme raison, régente et ordonne tous les éléments de la connaissance scientifique, de même l'intelligence analogique, qui n'a aucun nom particulier, régente et ordonne tous les éléments de la connaissance occulte. La perfection de l'œuvre matérielle est un tout parfaitement constitué dans lequel chaque partie a sa place et concourt selon son mode et son grade à la formation de ce tout; la perfection de l'œuvre spirituelle est l'exacte correspondance entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'âme et le corps, de telle sorte que la connaissance de l'un englobe la connaissance de l'autre. Dans le Grand Oeuvre, le métal préparé selon la raison pour devenir l'or, perfection de la matière, doit, dans le même acte, être préparé selon l'Analogie pour devenir l'Or Spirituel symbolisé. Dans ces quelques mots réside ce qui fait l'intime distinction entre la production artificielle de l'or par l'alchimie et cette même production par la science. Dans les deux cas l'or matériel sera identique en tant que matière, mais l'or produit par la science ne sera rien de plus que de l'or, puisque dans la fabrication de celui-ci elle ne visait qu'à produire de l'or, tandis que l'Or produit par l'alchimie sera beaucoup plus que de l'or, puisque dans la fabrication de celui-ci elle cherchait non seulement à produire de l'or mais aussi le secret de l'or. »
Ce secret d'Or est le dessein de l'œuvre, sa vie intime, ardente, inextinguible. Le refus de l'ésotérisme n'est souvent que la haine du secret. Cette haine, comme le soulignait René Guénon dans ses Aperçus sur l'Initiation est un trait caractéristique de l'homme moderne. A cette haine du secret s'ajoute la haine de l'élite, présumée défendre jalousement ces secrets. La vérité est tout autre. Le secret initiatique n'est pas un secret bancaire. Secret par nature et non par convention, il relève du secret de l'Art, voire du secret de la jouissance du l'Art. A l'homme dépourvu de toute sensibilité musicale, l'Art de la fugue de Bach demeurera secrète; l'accès de cette beauté lui sera à jamais défendue, non par une volonté délibérée mais par la nature même de l'œuvre. Sans doute la haine du secret n'est-elle rien d'autre que la haine du Sens et du Sacré. Le Sens s'oppose à l'insignifiance comme l'ordre s'oppose au chaos. Séparé de l'insignifiance, pourvu de limites précises et claires, le Sens est retranché, secret. Il ne s'en révèle pas moins à notre conscience par un geste où la divulgation extérieure se confond à la réminiscence intérieure. La naissance du Sens est dévoilement, anamnèse. Elle nous donne accès à la « conscience de la conscience », où le Soleil du soleil s'exhausse des ténèbres antérieures, conscience aurorale et aurifère.
Ainsi, à la haine du secret Pessoa oppose un amour du secret qui serait d'abord un amour de la nuance, de la variation, de la transition infime, presque imperceptible, subtile. L'attente contemplative, l'ardente veillée précède les Retrouvailles du visible et de l'Invisible. « L'acte même de la foi, écrit Frithjof Schuon, est le souvenir de Dieu. Or se souvenir en latin est recordare, c'est-à-dire re-cordare, ce qui évoque un retour au cœur, cor. L'acte d'oraison, en tant qu'acte de foi actualise en effet la certitude immanente et quasi-paraclétique; le cœur est la foi immanente et incréée, il coïncide avec cette grâce naturellement surnaturelle qu'est l'Intellection. Le mystère de la certitude, c'est notre consubstantialité avec tout le connaissable, avec tout ce qui est. » Art hiératique, fidèle au dessein initiatique, la poésie, à la fois royale et sacerdotale, dépassera ainsi les dualités connues. L'archaïsme ingénu d'Alberto Caiero et le futurisme savant d'Alvaro de Campos, témoignent que, pour Pessoa, l'antérieur est la fleur ultime de l'ultérieur. « Inventons, écrivait Pessoa, un Impérialisme androgyne réunissant qualités masculines et féminines; un impérialisme nourri de toutes les subtilités féminines et de toutes les forces de structuration masculines. » Soit un Empire à l'image exacte du rebis alchimique, irisé d'une fulgurance apollinienne.
Le grand songe du Cinquième Empire fut, pour Fernando Pessoa, à n'en pas douter, la seule vision possible de l'avenir: « L'avenir du Portugal que je n'imagine pas mais que je sais est déjà écrit, pour qui sait lire, dans les strophes de Bandara et dans les quatrains de Nostradamus. Cet avenir c'est d'être tout. Qui donc, s'il est portugais, peut vivre dans l'étroitesse d'une seule personnalité, d'une seule nation, d'une seule foi ? » Qu'advienne enfin cet impérialisme des poètes ! « Absorbons tous les dieux, nous avons déjà conquis la Mer, il ne reste qu'à conquérir le Ciel, en laissant aux autres, la terre. »
Luc-Olivier d'Algange
Extrait de L'Ame secrète de L'Europe, éditions de L'Harmattan, collection Théôria.
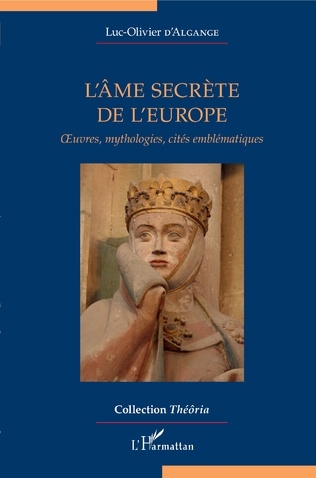
19:06 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
26/03/2023
Luc-Olivier d'Algange, Léon Bloy l'Intempestif, suivi d'une traduction en espagnol:
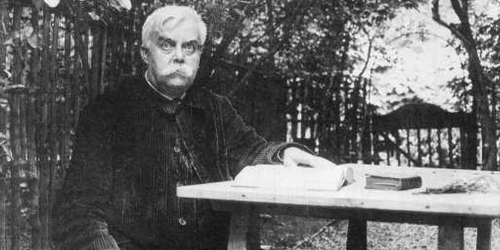
Luc-Olivier d’Algange
Léon Bloy l'Intempestif
« Il est indispensable que la Vérité soit dans la Gloire. »
Léon Bloy
A mesure que les années passent, avec une feinte ressemblance dans leur cours de plus en plus désastreux depuis la première parution du Journal de Léon Bloy, l'écart n'a cessé de se creuser entre ceux qui entendent cette parole furibonde et ceux qui n'y entendent rien. Certes, on ne saurait s'attendre à ce que les rééditions des œuvres de Léon Bloy fussent accueillies comme des événements ou des révélations par un milieu « culturel » qui ne cesse de donner les preuves de sa soumission à l'Opinion, de son aveuglement et de son mépris pour toute forme de pensée originale. Une sourde hostilité est la règle et je lisais encore des jours-ci un folliculaire récriminant contre « le douloureux labyrinthe narcissique » que serait à ses yeux le Journal de Léon Bloy. Certes, labyrinthiques et préoccupés de l'Auteur, tous les journaux le sont par définition, mais au contraire du fastidieux et potinier Journal de Léautaud, devant lequel maints critiques modernes pratiquèrent une ostensible génuflexion, le Journal de Bloy est d'une vivacité électrique. L'humour ravageur, les flambées de colère, les fulgurantes intuitions mystiques, un style d'une densité et d'une musicalité prodigieuse font de ce Journal un chef d'œuvre de la forme brève, aphoristique ou illuminative. Que lui vaut donc cette disgrâce où nous le voyons ? Sans doute la pensée qui s'y affirme et s'y précise sous la forme d'une critique radicale du monde moderne, dans la lignée de Barbey d'Aurevilly et de Villiers de L'Isle-Adam.
« Tout ce qui est moderne est du démon », écrit Léon Bloy, le 7 Août 1910. C'était, il nous semble, bien avant les guerres mondiales, les bombes atomiques et les catastrophes nucléaires, les camps de concentration, les manipulations génétiques et le totalitarisme cybernétique. En 1910, Léon Bloy pouvait passer pour un extravagant; désormais ses aperçus, comme ceux du génial Villiers de L’Isle-Adam des Contes Cruels, sont d'une pertinence troublante. L'écart se creuse, et il se creuse bien, entre ceux qui somnolent à côté de leur temps et ne comprennent rien à ses épreuves et à ses horreurs, et ceux-là qui, à l'exemple de Léon Bloy vivent au cœur de leur temps si exactement qu'ils touchent ce point de non-retour où le temps est compris, jugé et dépassé. Léon Bloy écrit dans l'attente de l'Apocalypse. Tous ces événements, singuliers ou caractéristiques qui adviennent dans une temporalité en apparence profane, Léon Bloy les analyse dans une perspective sacrée. L'histoire visible, que Léon Bloy est loin de méconnaître, n'est pour lui que l'écho d'une histoire invisible. « Tout n'est qu'apparence, tout n'est que symbole, écrit Léon Bloy. Nous sommes des dormants qui crient dans leur sommeil. Nous ne pouvons jamais savoir si telle chose qui nous afflige n'est pas le principe de notre joie ultérieure. »
Cette perspective symbolique est la plus étrangère qui soit à la mentalité moderne. Pour le Moderne, le temps et l'histoire se réduisent à ce qu'ils paraissent être. Pour Bloy, le temps n'est, comme pour Platon et la Théologie médiévale, que « l'image mobile de l'éternité » et l'histoire délivre un message qu'il appartient à l'écrivain-prophète de déchiffrer et de divulguer à ses semblables. Pour Léon Bloy, le Journal, loin de se borner à la description psychologique de son auteur a pour dessein de consigner les « signes » et les « intersignes » de l'histoire visible et invisible afin de favoriser le retour du temps dans la structure souveraine de l'éternité.
Pour Léon Bloy, qui se définit lui-même comme « un esprit intuitif et d'aperception lointaine, par conséquent toujours aspiré en deçà ou au-delà du temps », la fonction de l'auteur écrivant son journal n'est pas de se soumettre à l'aléa de la temporalité, du passager ou du fugitif, mais tout au contraire « d'envelopper d'un regard unique la multitude infinie des gestes concomitants de la Providence ». Le Journal, - tout en marquant le pas, en laissant retentir en soi, et dans l'âme du lecteur ami, la souffrance ou la joie, plus rare, de chaque jour, les « nouveautés » menues ou grandioses du monde, ne s'inscrit pas moins dans une rébellion contre le fragmentaire, le relatif ou l'éphémère. Ce Journal, et c'est en quoi il décontenance un lecteur moderne, n'a d'autre dessein que de déchiffrer la grammaire de Dieu.
Là où le Moderne ne distingue que des vocables sans suite, de purs signes arbitraires, Léon Bloy devine une cohérence éblouissante, et, par certains égards, vertigineuse et terrifiante. Léon Bloy n'est pas de ces dévots qui trouvent dans la foi et dans l'Eglise de quoi se rassurer. Ces dévots modernes, bourgeois au sens flaubertien, Léon Bloy les fustige ainsi que la « société sans grandeur ni force » dont ils sont les défenseurs. Il est fort improbable, quoiqu'en disent les journaleux peu informés qui voient en Bloy un « intégriste », que l'auteur du Désespéré et de La Femme Pauvre se fût retrouvé du côté de nos actuels, trop actuels « défenseurs des valeurs », moralisateurs sans envergure ni générosité,- et par voie de conséquence, sans le moindre sens de la rébellion. Or s'il est un mot qui qualifie avec précision la tournure d'esprit de cet homme de Tradition, c'est rebelle !
Pour Léon Bloy, quel que soit par moment son harassement, le combat n'est pas fini, il y retourne, chaque jour est le moment décisif d'une guerre sainte. Léon Bloy est un moine-soldat qui va son chemin d'écrivain, non sans donner ici et là quelques coups de massue, pour reprendre la formule évolienne. Ainsi le sport, objet, depuis peu, d'un nouveau culte national est-il, pour Léon Bloy « le moyen le plus sûr de produire une génération d'infirmes et de crétins malfaisants ». Quant à la Démocratie, bien vantée, elle lui suggère cette réflexion : « Un des inconvénients les moins observés du suffrage universel, c'est de contraindre des citoyens en putréfaction à sortir de leurs sépulcres pour élire ou pour être élus. » Cette outrance verbale dissimule souvent une intuition. Tout, dans ce monde planifié, ne conjure-t-il pas à faire de nous une race de morts-vivants, réduits à la survie, dans une radicale dépossession spirituelle. Que sont les Modernes devant leurs écrans ? Quel songe de mort les hante ? Les rêveries du Moderne ne sont-elles pas avant tout macabres ? Non, la religion de Léon Bloy n'est pas faite pour les « tièdes ». C'est une religion pour ceux qui ressentent les grandes froidures et qui attendent l'embrasement des âmes et des esprits. Le modèle littéraire de Léon Bloy ce sont les langues de feu de la Pentecôte.
Léon Bloy s'est nommé lui-même « Le Pèlerin de l'Absolu ». Chaque jour qui advient, et que l'auteur traverse comme une nouvelle épreuve où se forge son courage et son style, le rapproche du moment crucial où apparaîtront dans une lumière parfaite la concordance de l'histoire visible et de l'histoire invisible. Cette quête que Léon Bloy partage avec Joseph de Maistre et Balzac le conduit à une vision du monde littéralement liturgique. L'histoire de l'univers, comme celle de l'auteur esseulé dans son malheur et dans son combat, est « un immense Texte liturgique. » Les Symboles, ces « hiéroglyphes divins », corroborent la réalité où ils s'inscrivent, de même que les actes humains sont « la syntaxe infinie d'un livre insoupçonné et plein de mystères. »
Cette vision symbolique et théologique du monde en tant que Mystère limpide, c'est à dire offert à l'illumination (« l'illumination, lieu d'embarquement de tout enseignement théologique et mystique ») est à la fois la cause majeure de l'éloignement de l'œuvre de Léon Bloy et le principe de sa proximité extrême. Pour le moderne, la « folie » de Léon Bloy n'est pas dans sa véhémence, ni dans son lyrisme polémique, mais bien dans cette vision métaphysique et surnaturelle des destinées humaines et universelles. Pour Léon Bloy, qui n'est point hégélien, et qui va jusqu'à taquiner Villiers pour son hégélianisme « magique », les contraires s'embrassent et s'étreignent avec fougue. La nature porte la marque de la Surnature, mais par un vide qui serait l'empreinte du Sceau. De même, l'extrême pauvreté engendre le style le plus fastueux. C'est précisément car l'écrivain est pauvre que son style doit témoigner de la plus exubérante richesse. La pauvreté matérielle est ce vide qui laisse sa place à la dispendieuse nature poétique. Car la pauvreté, pour Bloy, n'est pas le fait du hasard, elle est la preuve d'une élection, elle est le signe visible d'un privilège invisible qu'il appartient à l'Auteur de célébrer somptueusement. La richesse verbale de Léon Bloy est toute entière un hommage à la pauvreté, à sa profondeur lumineuse, à la grâce qu'elle fait à la générosité de se manifester. Celui qui donne se sauve. Le mendiant peut donc, à bon droit être « ingrat ». Son ingratitude rédime celui qui pourrait s'en offenser. Mais qu'est-ce qu'un pauvre, dans la perspective métaphysique ? C'est avant tout celui qui récuse par avance toute vénalité. Or qu'est-ce que le monde moderne si ce n'est un monde qui fait de la vénalité même un principe moral, une cause efficiente du Bien et « des biens » ? Pour le Moderne, celui qui parvient à se vendre prouve son utilité dans la société et donc sa valeur morale. Celui qui ne parvient pas, ou, pire, qui ne veut pas se vendre est immoral.
Contre ce sinistre état de fait, qui pervertit l'esprit humain, l'œuvre de Léon Bloy dresse un grandiose et intarissable réquisitoire. Or, c'est bien ce réquisitoire que les Modernes ne veulent pas entendre et qu'ils cherchent à minimiser en le réduisant à la « singularité » de l'auteur. Certes Léon Bloy est singulier, mais c'est d'abord parce qu'il se veut religieusement « un Unique pour un Unique ». La situation dans laquelle il se trouve enchaîné n'en est pas moins réelle et la description qu'il en donne particulièrement pertinente en ces temps où face à la marchandise mondiale le Pauvre est devenu encore beaucoup plus radicalement pauvre qu'il ne l'était au dix-neuvième siècle. La morale désormais se confond avec le Marché, et l'on pourrait presque dire que, pour le Moderne libéral, la notion d'immoralité et celle de non-rentabilité ne font plus qu'une. Refuser ce règne de l'économie, c'est à coup sûr être ou devenir pauvre et accueillir en soi les gloires du Saint-Esprit, dont la nature dispensatrice, effusive et lumineuse ne connaît point de limite.
Contre le monde moderne, Léon Bloy ne convoque point des utopies sociales, ni même un retour au « religieux » ou à quelque manifestation « révolutionnaire » ou « contre-révolutionnaire » de la puissance temporelle. Contre ce monde, « qui est du démon », Léon Bloy évoque le Saint-Esprit, au point que certains critiques ont cru voir en lui un de ces mystiques du « troisième Règne », qui prophétisent après le règne du Père, et le règne du Fils, la venue d'un règne du Saint-Esprit coïncidant avec un retour de l'Age d'Or. Lorsqu'un véritable écrivain s'empare d'une vision dont la justesse foudroie, peu importent les terminologies. Sa vision le précède, elle n'en précède que mieux les interprétations historiographiques. « Aussi longtemps que le Surnaturel n'apparaîtra pas manifestement, incontestablement, délicieusement, il n'y aura rien de fait. »
Léon Bloy, el Extemporáneo
“Es indispensable que la Verdad esté en la Gloria.” Léon Bloy.
“Todo lo moderno pertenece al demonio”, escribe Léon Bloy el 7 de agosto de 1910. Fue, según nos parece, mucho antes de las guerras mundiales, las bombas atómicas y las catástrofes nucleares, los campos de concentración, las manipulaciones genéticas y el totalitarismo cibernético. En 1910, a Léon Bloy se lo podía tomar por un extravagante; hoy en día sus vislumbres, como los del genial Villiers de L’Isle-Adam de los Cuentos crueles, son de una pertinencia turbadora. Aumenta, y cada vez más, la distancia entre los que dormitan al margen de su época y no comprenden nada de las pruebas y los horrores a los que nos somete, y los que, a ejemplo de Léon Bloy, viven tan precisamente en el centro mismo de su época que alcanzan ese punto de no retorno en el que se la comprende, se la juzga y se la supera. Léon Bloy escribe a la espera del Apocalipsis. Todos esos acontecimientos, singulares o característicos, que se producen en una temporalidad aparentemente profana, Léon Bloy los analiza en una perspectiva sagrada. La historia visible, que Léon Bloy está lejos de desconocer, sólo es para él el eco de una historia invisible.
“Todo es pura apariencia, todo es puro símbolo”, escribe Léon Bloy. “Somos durmientes que gritan durante el sueño. Nunca podemos sabes si algo que nos aflige no es el principio de nuestra dicha ulterior.”
Esta perspectiva simbólica es la más ajena posible a la mentalidad moderna. Para el Moderno, el tiempo y la historia se reducen a lo que parecen ser. Para Bloy, el tiempo sólo es, como para Platón y la teología medieval, “la imagen móvil de la eternidad”, y la historia comunica un mensaje que al escritor-profeta le toca descifrar y divulgar entre sus semejantes. Para Léon Bloy, el Diario, lejos de limitarse a la descripción psicológica de su autor, tiene por objetivo el de dejar registrados los “signos” y los “intersignos” de la historia visible e invisible, a fin de favorecer el retorno del tiempo en la estructura soberana de la eternidad.
Para Léon Bloy, que se define a sí mismo como “un espíritu intuitivo y de apercepción lejana, y, por consiguiente, siempre arrastrado más acá o más allá del tiempo”, la función del autor al escribir su diario no es la de someterse a la temporalidad fugitiva sino, muy por el contrario, la de “abarcar con una mirada única la multitud infinita de los gestos concomitantes de la Providencia”. El Diario —al mismo tiempo que marca el paso, dejando resonar en sí mismo, y en el alma del lector amigo, el sufrimiento o la dicha, menos frecuente, de cada día, las “novedades” modestas o grandiosas del mundo— no deja de inscribirse en una rebelión contra lo fragmentario, lo relativo o lo efímero. Este Diario, que en esto desconcierta a un lector moderno, no tiene otra finalidad que la de descifrar la gramática de Dios.
Allí donde el Moderno sólo distingue vocablos inconexos, puros signos arbitrarios, Léon Bloy intuye una coherencia deslumbrante y, en ciertos aspectos, vertiginosa y aterradora. Léon Bloy no es uno de esos devotos que encuentran en la fe y en la iglesia con qué tranquilizarse. A esos devotos modernos, burgueses en el sentido de Flaubert, Léon Bloy los fustiga al igual que a la “sociedad sin grandeza ni fuerza” que defienden. Es altamente improbable, digan lo que digan los periodistuchos poco informados que ven en Bloy a un “integrista”, que el autor de El desesperado y de La mujer pobre hubiese estado en el mismo campo de nuestros actuales, demasiado actuales “defensores de los valores”, moralizadores sin envergadura ni generosidad —y, por consiguiente, sin el menor sentido de la rebelión. Ahora bien, si hay una palabra que define con precisión la mentalidad de este hombre de Tradición, esta palabra es “rebelde”.
Para Léon Bloy, por más extenuado que esté por momentos, el combate no ha terminado, vuelve a él, cada día es el momento decisivo de una guerra santa. Léon Bloy es un monje soldado que sigue su camino de escritor, no sin dar acá y allá algunos mazazos, para emplear la expresión de Julius Evola. Así es como el deporte, objeto, desde hace poco, de un nuevo culto nacional, es para Léon Bloy “el medio más seguro de producir una generación de inválidos y de cretinos dañinos”. En cuanto a la Democracia, tan ensalzada, le sugiere esta reflexión: “Uno de los inconvenientes menos observados del sufragio universal es el hecho de obligar a ciudadanos en estado de putrefacción a salir de su sepulcros para elegir o ser elegidos”. Esta desmesura verbal a menudo disimula una intuición. ¿Acaso no conspira todo, en este mundo planificado, para hacer de nosotros una raza de muertos vivos, reducidos a sobrevivir en una radical desposesión espiritual? ¿Qué son los Modernos delante de sus pantallas? ¿Qué sueño de muerte los posee? ¿Las Ensoñaciones del Moderno no son, ante todo, macabras? No, la religión de Léon Bloy no está hecha para los “tibios”. Es una religión para quienes sienten los grandes fríos y esperan el incendio de las almas y los espíritus. El modelo literario de Léon Bloy son las lenguas de fuego de Pentecostés.
Léon Bloy se llamó a sí mismo “El Peregrino del Absoluto”. Cada día que llega, y que el autor atraviesa como una nueva prueba en que se templan su coraje y su estilo, lo acerca al momento crucial en que aparecerán con perfecta claridad la concordancia entre la historia visible y la historia invisible. Esta búsqueda, que Léon Bloy comparte con Joseph de Maistre y Balzac, lo conduce a una visión del mundo literalmente litúrgica. La historia del universo, tanto como la del autor aislado en su desdicha y en su combate, es “un inmenso Texto litúrgico”. Los Símbolos, esos “jeroglíficos divinos”, corroboran la realidad en que se inscriben, así como los actos humanos son “la sintaxis infinita de un libro insospechado y lleno de misterios”.
Esta visión simbólica y teológica del mundo como Misterio límpido, es decir, alcanzable por la iluminación (“la iluminación, punto de embarque de toda enseñanza teológica y mística”), es, al mismo tiempo, la causa principal de lo alejado de la obra de Léon Bloy y el principio de su cercanía extrema. Para el moderno, la “locura” de Léon Bloy no reside en su vehemencia ni en su lirismo polémico, sino precisamente en esta visión metafísica y sobrenatural de los destinos humanos y universales. Para Léon Bloy, que no es en absoluto hegeliano, y que hasta llega a burlarse de Villiers de l’Isle-Adam por su hegelianismo “mágico”, los contrarios se abrazan y se estrechan con ardor. La naturaleza tiene la impronta de la Sobrenaturaleza, pero por medio de un vacío que fuese la marca del Sello. De igual modo, la extrema pobreza engendra el estilo más fastuoso. Es precisamente porque el escritor es pobre por lo que su estilo debe dar testimonio de la riqueza más exuberante. La pobreza material es el vacío que le cede el lugar a la dispendiosa naturaleza poética. Ya que la pobreza, para Bloy, no es el resultado del azar: es la prueba de una elección, es el signo visible de un privilegio invisible que le incumbe al Autor celebrar suntuosamente.
La riqueza verbal de Léon Bloy es toda ella un homenaje a la pobreza, a su profundidad luminosa, al favor que le hace a la generosidad permitiéndole manifestarse. El que da, se salva. El mendigo puede entonces, con toda razón, ser “ingrato”. Su ingratitud redime al que podría tomarla como una ofensa. Pero ¿qué es un pobre, en la perspectiva metafísica? Es, ante todo, aquél que rechaza de antemano toda venalidad. Ahora bien, ¿qué es el mundo moderno sino un mundo que hace de la venalidad misma un principio moral, una causa eficiente del Bien y de “los bienes”? Para el Moderno, el que logra venderse prueba su utilidad en la sociedad y, por lo tanto, su valor moral. El que no logra o, peor aún, no quiere venderse, es inmoral.
Contra esta siniestra situación de hecho, que pervierte el espíritu humano, la obra de Léon Bloy lanza una grandiosa e inagotable acusación. Ahora bien, es precisamente esta acusación lo que los Modernos no quieren oír y tratan de minimizar, reduciéndola a la “singularidad” del autor. Por cierto, Léon Bloy es singular, pero esto es, en primer término, porque elige ser, religiosamente, “un Único para un Único”. La situación en que se encuentra encadenado no es por esto menos real, y la descripción que da de ella es particularmente pertinente en estos tiempos en que, ante la mercancía mundial, el Pobre se ha vuelto aún mucho más radicalmente pobre de lo que lo era en el siglo XIX. La moral, ahora, se confunde con el Mercado, y casi podríamos decir que, para el Moderno liberal, la noción de inmoralidad y la de no rentabilidad no son más que una y la misma. Rechazar este reino de la economía es, con toda seguridad, ser o volverse pobre, y acoger en uno mismo las glorias del Espíritu Santo, cuya naturaleza dispensadora, efusiva y luminosa no conoce límite alguno.
Contra el mundo moderno, Léon Bloy no llama a ninguna utopía social, ni siquiera a un regreso a lo “religioso” o a alguna manifestación “revolucionaria” o “contrarrevolucionaria” del poder temporal. Contra este mundo, “que pertenece al demonio”, Léon Bloy invoca al Espíritu Santo, hasta el punto de que algunos críticos han creído ver en él a uno de esos místicos del “Tercer Reino” que profetizan, para después del Reino del Padre y del Reino del Hijo, el advenimiento de un reino del Espíritu Santo que coincidirá con un retorno a la Edad de Oro. Cuando un auténtico escritor se apodera de una visión de exactitud fulminante, poco importan las terminologías. Su visión le precede y, por lo mismo, mejor aún precede a las interpretaciones historiográficas. “Mientras lo Sobrenatural no se muestre de modo manifiesto, indiscutible, delicioso, nada estará hecho.”
Traducción de Carlos Cámara y Miguel Ángel Frontán.
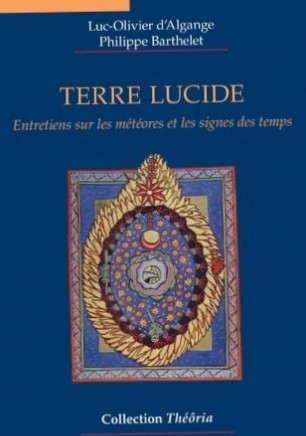
19:49 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
19/03/2023
Luc-Olivier d'Algange, Maurice Magre, fidèle de Mélusine:

Luc-Olivier d'Algange
Maurice Magre, fidèle de Mélusine
« Je percevais dans l’air des forces en suspens »
Maurice MAGRE
De Maurice Magre, on serait tenté de dire, les oxymores seuls pouvant définir les êtres entiers, qu’il fut un hédoniste spiritualiste (ou un spiritualiste hédoniste), espèce qui fut moins rare jadis que naguère et qui devient, par les temps qui courent, rarissime. De nos jours, les spiritualistes sont, en général, d’austères pions et les hédonistes, des gorilles. Il demeure cependant dans nos civilisations, et ailleurs, de merveilleux dispositifs, tels que la philosophie plotinienne ou le premier Romantisme allemand, celui de Schlegel ou de Novalis, conjuguant le frémissement sensible et l’ardeur de la connaissance, le bouleversement à fleur de peau et l’audace à franchir « les portes de corne et d’ivoire qui nous séparent du monde invisible » (Nerval)
Avant de désirer la vie éternelle, à laquelle Maurice Magre croyait en toute liberté, c’est-à-dire en dehors de tous les dogmes, encore faut-il, selon la formule de Pindare, traduite par Valéry, « épuiser le champ du possible ». Cette vie si passagère, si troublée, si incertaine que nous traversons est un appel à la plénitude, une convocation, ainsi que l’écrivait Montaigne, à « jouir loyalement de son être ». Or, nos temps sont à la restriction ; ils ne supportent plus ces alliances subtiles, ces noces philosophales entre le souffre et le mercure, la volupté et la sagesse, entre ce qui flambe dans les hauteurs et disparaît et ce qui roule et se divise dans le miroitement de l’immanence.
Le puritanisme s’est substitué aux ascèses et la pornographie aux jeux de l’Eros : triomphe de la marchandise sur la gratuité heureuse qui n’est autre que la part divine dans un monde humain, trop humain. Maurice Magre célèbre ainsi d’un même mouvement l’ascèse et le plaisir, la quête d’une transcendance, d’un Idéal, et le consentement à la beauté féminine, la recherche de la grandeur et l’amour des humbles. Son sens du grand art, subtil et savant, ne lui interdit pas de faire sienne la juste revendication des pauvres. Ses premières œuvres, comme la Prière au Soleil appartiennent à la tradition du socialisme français, d’inspiration libertaire, unanimiste et païenne :
« Un esprit Fraternel frémissait dans chaque herbe ;
Les Vieux arbres avaient des voix d’êtres aimés ;
Et nous sentions le soir assis parmi les gerbes
La poussière des morts mêlée au sol sacré. »
Proche, à cet égard, de Péguy, Maurice Magre sut dire, au-delà de l’éminente dignité des pauvre, « l’éminente pauvreté des dignes », dont il fut l’un des premiers : « J’ai voulu écrire la chanson des hommes d’aujourd’hui, de ceux que font souffrir l’affaissement des énergies, la pauvreté du cœur, toutes les misères morales et matérielles. » Loin de l’orienter vers un rigorisme aux inclinations totalitaires, cette révolte anti-bourgeoise le conduisit jusqu’aux frontières mêmes de l’invisible, qui n’est point l’abstraction, mais la puissance d’une âme libre, l’au-delà de l’orée qui enchante toutes les apparences du monde :
« Le monde est un secret que soudain je comprends :
Notre corps est léger et notre esprit fidèle »
Ce prosateur qui connaît l’art des longues périodes et de la « rhétorique profonde » fut particulièrement sensible à l’éclat de la soudaineté, qu’elle soit dans l’emportement de la compassion, dans la conversion ou la rencontre des regards. Les « choses vues » lui sont des Symboles, les Cités qu’il habite ou parcourt lui deviennent peu à peu emblématiques, tels le Londres de Thomas de Quincey, dont il partagea le goût de l’Opium, ou l’Ispahan des poètes persans dont les « jardins d’émeraude », suspendus entre le sensible et l’intelligible, sont familiers à ses voyages intérieurs. Ses spéculations et ses rêveries se lovent également dans les lieux de gloire ou de misère. Ses amantes sont haussées au rang de déesses ; ses rares amis lui apparaissent comme des héros ou des saints. De ses ennemis, il ne garde que le souvenir de l’inaccomplissement. Maurice Magre est de ces auteurs sur lesquels la médiocrité n’a aucune prise, quand bien même il s’en accuse, et par cela même. Loin de se croire parfait, ce qui est précisément le propre de la médiocrité forte de son nombre, Maurice Magre mesure, avec autant de précision que possible, l’écart entre son vœu et sa réalisation ; et cet écart n’est autre que l’espace même de son œuvre. Ses regrets ne sont pas moralisateurs : ils sont le secret de la musique des mots, non point contrition mais persistance amoureuse, consentement au « beau secret ».
Ses Confessions sur les femmes, l’amour, l’opium, l’idéal, disent cette soudaineté du secret, cette pointe exquise où le plaisir et la sapience se ressemblent, cette légèreté du corps (car, pour Maurice Magre, c’est bien le corps qui est dans l’âme et non l’âme qui est dans le corps), cette fidélité de l’esprit à l’émotion de ses premières épreuves et de ses premiers émerveillements. Rien ne lui est plus étranger que le reniement ou cette versatilité du consommateur, qui se croit libre pour brûler le lendemain ce que la veille il adora. Ses Confessions s’achèvent sur des « Remerciements à la destinée », d’une hauteur goethéenne, et qui ne sont point sans évoquer, aussi, l’émouvant « Bonsoir aux choses d’ici-bas » qui furent les derniers mots de Valery Larbaud : « Je remercie la loi qui préside à la destinée. Elle a placé mon enfance dans une maison de banlieue toulousaine, dans un jardin où il y avait un pin, un buis et une île de noisetiers… »
Par le don de la gratitude, devenu si rare, toute beauté devient frissonnante. Ni l’habileté technique « qui se manifeste par la glorification du laid », ni les cités industrielles « qui remplacent les antiques cités de pierre qui abritaient jadis des bonheurs paisibles et lents, où les hommes avaient la possibilité de pratiquer la rêverie et l’étude » ne donnent, ou plutôt, ne restituent, à la beauté du monde ce que nous lui devons. Le monde moderne apparaît à Maurice Magre comme « ces pyramides dressées par les esprits du mal ». Or, rien ne nous interdit, sinon quelque mauvais sort jeté à grands renforts de puissance et d’argent, de saisir la seconde heureuse, de retrouver le resplendissement de ce qui est :
« Un frisson de beauté circule une seconde.
Je sens qu’un beau secret dans l’atmosphère passe.
Un bal mystérieux s’éveille dans les choses. »
L’œuvre de Maurice Magre se propose ainsi comme un viatique contre la tristesse et le nihilisme qui nous privent à la fois de la vérité sensible et de la beauté intelligible. Cet hérésiarque de belle envergure, qui trouve son bien chez les gnostiques albigeois, non moins que dans le néoplatonisme des ultimes résistances païennes (qui lui inspira l’admirable roman intitulé Priscilla d’Alexandrie) n’a d’autre ambition que de nous nous enseigner une liberté dont l’apogée serait la fidélité même. Fidélité aux premières rencontres, aux premiers amours, aux premières lectures et aux premières ivresses ; fidélité aux moments d’intensité et de grâce. Priscilla d’Alexandrie, publiée en 1925, qui se situe dans l’Egypte tourmentée entre le christianisme et la paganisme, du quatrième siècle, nous invite, et c’est un genre d’invitation qui ne se refuse pas, à fréquenter les philosophes d’Alexandrie, tel Olympios, ermite néoplatonicien, ou Aurélius qui accomplira un pèlerinage « à l’ombre de l’arbre bodhi ». Priscilla qui sera la réincarnation d’Hypathie, après avoir participé à sa lapidation, médite, en compagnie de ses amis philosophes sur l’accord possible entre la volupté et la sagesse, entre l’assentiment au monde sensible et l’aspiration au monde invisible. Le sceau et l’empreinte, ce qui symbolise et ce qui est symbolisé ne sont-ils pas une seule et même réalité ? « Toute la nature avec ses soleils et ses nuits douces ne serait alors qu’un vaste piège pour empêcher l’homme, par le réseau des désirs, de parvenir à la plus haute spiritualité. Ce n’est pas possible. Il doit y avoir une conciliation entre la splendeur de la matière et le règne de l’esprit. Il doit existe une sagesse qui aime, une vérité qui a du sang ».
On songe à cet autre livre, de Mario Meunier, qui fut un éminent traducteur de Platon et de Sophocle, Pour s’asseoir au Foyer de la Maison des Dieux : « Etre volupteux : c’est entendre en son sang bouillonner tous les vins ; c’est aimer le besoin de multiplier ses amours, ses sympathies et ses admirations ; c’est participer à l’infini de l’Etre, collaborer à son éternité et aimer la vie jusqu’au désir de souffrir pour mieux vivre, et de mourir pour changer et revivre. » Pas davantage que le sensible ne s’oppose à l’intelligible, le multiple ne s’oppose à l’Un, ni le provincial à l’universel : « Ne te scandalise donc pas de la multiplicité des dieux. Si les morcellements de la divinité ne nous apprennent rien sur la vérité de son être insondable, ils affirment néanmoins, en tous temps et partout, sa souveraine présence (…) Une des plus nobles activités de l’esprit est de surprendre, en chacun des dieux des nations, la parcelle d’infini qu’il contient. En cette interminable théorie de déités, ma pensée reconnaît et adore les rayons divers d’un soleil identique. »
Libertaire, par goût de la légèreté, hostile aux pomposités et au puritanisme bourgeois, dont il se moque sans amertume mais avec une sereine ironie, Maurice Magre demeure avant tout fidèle à l’esprit des lieux. L’esprit des lieux, comme toutes les choses difficiles à définir et qui échappent aux ensembles abstraits (dont certains voudraient nous voir dépendre exclusivement) exerce sur nous une influence profonde. Simone Weil évoquait la persistance d’une science romane, d’une gnose occitanienne, Raymond Abellio, Joë Bousquet vinrent à la rencontre du reste du monde à partir de Toulouse, cette Thulée cathare. Il en fut de même pour Maurice Magre. Ne méprisons point le sens de l’universel, mais sachons qu’il n’est jamais que la fine pointe d’une réalité provinciale, d’un cheminement à partir d’un lieu, d’une méditation sur une configuration historique et sensible, d’une tradition dont on ne saurait s’exclure à moins de saccager en nous le Logos lui-même.
Nous existons à parti d’un lieu, et qu’importent nos pérégrinations ou nos errances, une fidélité demeure inscrite dans notre langage même, dans le ressouvenir de nos rencontres, dans la lumière. L’esprit des lieux est un composé de culture et de nature ; le cosmos et l’histoire y ourdissent ces admirables conjurations où nous trouvons nos raisons d’être. L’auteur du Sang de Toulouse et du Trésor de Albigeois donne le sens de son cheminement par l’incipit, cher au cœur des toulousains évoquant le second âge d’or de la cité palladienne : « Par les quatre merveilles de Toulouse, par la beauté de ses clochers et la jeunesse de ses jardins ; par Clémence Isaure, la virginale et la protectrice, par Pierre Goudoulin aux beaux chants, par l’hôtel d’Assezat aux belles sculptures… ».
Ainsi débute la quête du Graal pyrénéen, par cette voix qui s’adresse une nuit de septembre à son héros Michel de Bramevaque : « Lève-toi ! Marche dans le pays toulousain, Retrouve le Graal qui est caché et les hommes seront sauvés ! » La quête du héros sera de retrouver les descendants des quatre chevaliers « portant sous leur manteau l’héritage de Joseph d’Arimathie, l’émeraude en forme de lys ». Ne divulguons pas davantage de ce roman, sinon qu’il y figure une « Nuit des loups » qui est l’un des hauts moments de la littérature fantastique. Evoquons encore, parmi les innombrables romans de Maurice Magre, Jean de Fodoas, qui fut réédité sous le titre La Rose et l’Epée où, ainsi que l’écrit Robert Aribaut, dans son ouvrage sur Maurice Magre, « la fleur royale n’est plus offerte au héros par quatre cavaliers noirs mais par Inès de Saldanna, sœur du vice-roi de Goa ! ». C’est bien la profonde méditation sur le « sang de Toulouse », qui circule d’un mouvement invisible dans l’architecture de la Cité ; c’est bien l’accord du promeneur avec les rues de sa ville, où les temps se superposent et transparaissent les uns dans les autres, qui donne sa vertu poétique à sa conquête du monde, à son amour baudelairien des cartes et des estampes, à sa nature prodigue et accueillante aux merveilles de l’étrange et du lointain.
Dans cette œuvre immense, d’une imagination vive, colorée et voyageuse, où l’art d’écrire n’est ni trop ostensible ni trop caché, où la beauté consent à se manifester, mais comme sous une injonction supérieure dont l’auteur ne serait que l’intercesseur, les romans d’aventures, tels Les Aventuriers de l’Amérique du Sud ou Les Frères de l’or vierge, les récits de voyage aux Indes, alternent avec les romans poétiques ou initiatiques tels Mélusine, où, sous l’égide des Lusignan, et de la reine Chypre, qui hantent aussi un célèbre poème de Gérard de Nerval, Maurice Magre annonce, en le précédant de quelques années, l’Arcane 17 d’André Breton : « Avec quel incommensurable amour étaient attentifs les êtres vivants de la terre et de l’air. Il flottait une pureté que je n’avais jamais ressentie. Elle était dans le dessin des nervures des feuilles, la cristallisation des gouttes de rosée, la fluidité de l’air pénétré par la prescience du soleil levant… ». C’est vers cette « fille de l’air et des songe » que va l’ultime passion de Maurice Magre. « Mélusine, notera Michel Carrouges, est en relation intime avec les forces de la nature et par conséquent avec l’inconscient ; mais elle a des ailes et par là elle est aussi en communication avec les mondes supérieurs, ceux d’où elle s’envole selon la légende ». Symbole de ce spiritualisme hédoniste, que nous évoquions plus haut, de ce supra-sensible concret qui appartient au monde imaginal, la Mélusine de Maurice Magre est la divulgatrice de l’enchantement des apparences, l’amie de ces « créatures messagères » que sont les grillons et les rossignols, elle qui fait de notre âme, non plus cet espace insolite, restreint, carcéral mais une nuit de Pentecôte peuplée de lucioles, de signes d’or, messagers d’une «connaissance cosmologique », à l’instar de ces « paroles profondes » qui étendent le royaume du secret et transfigurent le monde. A l’orée de sa mort, dans ses derniers écrits, Maurice Magre ne demandera plus au monde que d’être lui-même, mais en beauté : « Des milliers de petites gouttes de rosée, invisibles jusqu’alors, devenaient brillantes, s’allumaient comme les lampes d’une féerie minuscule, mais répandue à l’infini. Sortant du bain mystérieux de la nuit, le jardin émergeait, rajeuni et purifié. La lumière cependant continuait à naître d’elle-même. »
21:52 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
11/03/2023
Luc-Olivier d'Algange, Notes sur l'oeuvre de Juilen Gracq:

Luc-Olivier d’Algange
L'Envers de la vague
Notes sur l'œuvre de Julien Gracq
« Couchés au raz de l'eau, ils voyaient accourir de l'horizon le poids régulier des vagues, et dans un capiteux vertige il leur semblait que tombât tout entier sur leurs épaules et dût les écraser - avant de faire au-dessous d'eux un flux de silence et de douceur qui les élevait paresseusement sur un dos liquide , avec une sensation exquise de légèreté »
Julien Gracq, Au Château d'Argol
La solennité quelque peu funéraire des récits de Julien Gracq s'ouvre, pour certains d'entre nous, sur un printemps sacré.
Si la phrase de Gracq porte son charroi de métaphores crépusculaires et automnales; si la note lancinante d'une sorte de désespoir universel, comme la froidure d'une goutte de poison, ne cesse, au milieu du faste même, de faire entendre son consentement à la déréliction; si le désengagement, l'exil, le retrait, voire, pour user d'un mot naguère quelque peu galvaudé, le « pessimisme » semblent donner le ton à l'attente et au tragique qui blasonnent son œuvre, - ces majestueuses mises au tombeau d'un monde n'en demeurent pas moins traversées de pressentiments et ne rendent jamais leurs dernières armes au nihilisme ou au désenchantement.
Ce sont d'abord les paysages et leurs saisons, le palimpseste du merveilleux géographique, la puissance soulevante, de la nature elle-même qui nous apparaissent comme d'impérieuses requêtes, comme des portes battantes. Ce monde déserté de toute activité humaine, figé dans une arrière-saison éternisée, cet abandon, loin d'éteindre la beauté du monde en révèle les puissances jusqu'alors dédaignées. Ce qui meurt dans les romans de Julien Gracq, ce qui s'éteint, ce qui s'étiole n'est jamais que l'industrie humaine. Les personnages se trouvent jetés dans l'immensité d'une oisiveté, d'une attente qui seuls, en dignité, sont destinés à survivre à la vanité des commerces humains. La chapelle des abîmes d'Au Château d'Argol, les « journées glissantes, fuyantes de l'arrière-saison » d’Un Beau Ténébreux, définissent d'emblée le domaine que l'œuvre ne cessera de parcourir, un domaine où le Temps hiératique règne sans disputes sur les temporalités subalternes, où la société ne survit plus que par d'anciens apparats, où toute appartenance ne vaut et ne brille que de son obsolescence dans un monde d'après la fin.
Du Surréalisme, Julien Gracq ne retiendra ni l'automatisme, ni l'idéologie révolutionnaire, mais peut-être une subversion plus radicale: le refus catégorique et fondateur d'une humanité réduite aux seules raisons du travail et de la consommation. Si loin qu'il soit des enseignements de l'humanisme classique ou des Lumières, ce refus n'en fonde pas moins une façon d'être humain, un humanisme par-delà l'humanisme, relié aux puissances ouraniennes et telluriques, aux éclatantes preuves de l'être. La « liberté grande » sera d'abord, pour Julien Gracq la liberté d'être, le rayonnement de l'être dans la contemplation. Aussi délaissées que soient les grèves, elles s'ouvrent sur un « Grand Oui » et demeurent étrangères au nihilisme et à la « littérature du non », autrement dit à la littérature du travail, du soupçon et du ressentiment. La subversion, pour Julien Gracq, est affirmative; elle est une approbation à la beauté des choses laissées à elles-mêmes, comme engourdies, abandonnées, mais qui s'offrent, dans ce délaissement, à une vérité plus profonde: « J'ai vécu de peu de choses comme de ces quelques ruelles vides et béantes en plein midi qui s'ensauvageaient sans bruit dans un parfum de sève et de bête libre, leurs maison évacuées comme un raz de marée sous l'écume des feuilles. »
Le refus de Julien Gracq, où scintillent les dernières armes jamais rendues avant la mort, est bien le contraire du « non »: « Ce qui me plaît chez Breton, écrit Julien Gracq, ce qui me plaît dans un autre ordre chez René Char, c'est ce ton resté majeur d'une poésie qui se dispense d'abord de toute excuse, qui n'a pas à se justifier d'être, étant précisément et tout d'abord ce par quoi toutes choses sont justifiées. » Seules méritent que l'on s'y attarde les œuvres qui ne s'excusent pas d'être, qui consentent à la précellence du mouvement dont elles naissent, qui témoignent de cette « participation » de l'homme au monde par l'intermédiaire du Logos, soleil secret de toutes choses manifestées, « sentiment perdu d'une sève humaine accordée en profondeur aux saisons, aux rythmes de la planète, sève qui nous irrigue et nous recharge de vitalité, et par laquelle, davantage peut-être que par la pointe de la lucidité la plus éveillée, nous communiquons entre nous. »
Restituer à la littérature sa respiration, cette alternance de contemplation et d'action, n'est-ce pas retrouver le sens même, par étymologie réactivée, du mot grec désignant l'écrivain: syngrapheus, qui signifie littéralement, « écrire avec » ? Ecrire non point seul face au monde, ou seul dans le « travail du texte » mais écrire en laissant le monde s'écrire à travers nos mots et nos phrases qui, au demeurant, font aussi partie du monde, comme une pincée de cendres, un givre, un pollen.
Suivre selon le mot de Victor Hugo, « la pente de la rêverie », c'est écrire avec l'être: « Dans la rêverie, il y a le sentiment d'y être tout à fait, et même beaucoup plus que d'habitude. Pour ma part je la définirais certainement - plutôt qu'un laisser-aller - un état de tension accrue, le sentiment d'une circulation brusquement stimulée des formes et des idées, qui jouent mieux, qui s'accrochent plus heureusement les unes aux autres, facilitent le jeu des correspondances ». Syngrapheus est l'écrivain qui accorde à ce qui survient, à l'imprévisible, sa part royale; il est aussi celui qui s'y accorde, qui ne dédaigne point la « leçon de choses » que le réel, et plus particulièrement dans les zones frontalières entre la veille et le sommeil, prodigue avec une inépuisable générosité.
Julien Gracq se rapproche ainsi de nous en s'éloignant. Ce goût du lointain, qui caractérise son œuvre, s'est éloigné de notre temps qui affectionne les rapprochements, la maitrise de l'espace, le village planétaire, les communications instantanées. Mais ce lointain, ce lointain vertigineux, ce lointain d'abysses ou de hautes frondaisons, ce lointain de landes, de lointain de précipices, ce lointain disponible jusqu'à l'effroi, ce lointain voilé, ce lointain antique et alcyonien qui suscite ces « sensations purement spaciales logées au cœur de la poitrine », par « sa foncière allergie au réalisme », sa profusion de forêt mythologique, que semblent avoir fréquenté également Shakespeare et Perrault, ce lointain, par un sentiment d'imminence propre à la guerre, présente et voilée dans presque tous ses récits, nous détache des soucis économiques et domestiques pour nous précipiter dans la pure présence des choses menacées de nous quitter à chaque instant. Ce lointain redevient une nostalgie, un appel, une présence ardente.
Ces « grèves désolées », ces rivages hantés, ces ruines dont les crêtes semblent percer l'atmosphère pour atteindre à un éther immémorial nous apparaissent comme une vocation: elles rendent présentes à notre conscience (qui cesse alors d'être seulement conscience des choses représentées) un monde, que, nous autres modernes, ne percevions plus, une géographie mystérieuse, une géo-poétique, si l'on ose le néologisme, qui, pour s'être tue durant des générations, nous revient comme un chant de la terre, un langage profus, un entretien lourd de beauté à la fois concrètes et spectrales.
Dans sa hâte, dans son volontarisme obtus, le moderne ne voit rien. Il passe à côté des êtres et des choses, glisse sur les surfaces. Cependant l'oeil garde mémoire, - une sorte de mémoire héraldique, ancestrale, et les récits de Julien Gracq semblent témoigner de cette mémoire seconde, de cette réalité d'autant plus dense qu'ordinairement dédaignée. « Reste cependant, écrit Bernard Noël, à l'intérieur même de l'œil, un rond de ténèbres, oui, ce moyeu de nuit autour duquel il voit. Pupille, le puit noir, tour d'ombre renversée vers quelque ciel de tête. » Ces grandes houles de ténèbres concrètes, cette vaste nuit renversée déferlent à travers le monde, filtrent une lumière hors du temps, une lumière d'en haut, une lumière de vitrail... Cette requête du cosmos nous précipite dans un outre-monde dont seul nous sépare, selon le mot de Henry Miller, un « cauchemar climatisé ». Ce heurt des ténèbres er de la lumière rougeoie. Ce heurt est de feu et de sang. La nature servie par une prose qui consent à la lenteur révèle sa vérité; elle est le Graal, la coupe du ciel renversée sur nos têtes ! L'écriture accordée à ce drame de ciel, de mer, de forêts et de vent devient alors elle-même la rencontre d'Amfortas et de Parsifal: « Et, passant outre à une sacrilège équivalence, comme dans le délire d'une infâme inspiration, il était clair que l'artiste, que sa main inégalable n'avait pu trahir, avait tiré du sang même d'Amfortas, qui tachait les dalles de ses flaques lourdes, la matière rutilante qui ruisselait dans la Graal, et que c'était de sa blessure même que jaillissaient de toutes parts les rayons d'un feu impossible à tarir... ».
« Le monde de Julien Gracq, écrit Maurice Blanchot, est un monde de qualités, c'est-à-dire magique. Lui-même par la bouche de son héros: le Beau Ténébreux (deux adjectifs) reconnait dans la terre une réalité fermée dont il espère mettre en mouvement, par une espèce d'acuponcture tellurique, les centre nerveux, des points d'attaches à la vie ». Les réserves dont Maurice Blanchot, par ailleurs, témoignera à l'égard de Gracq (auxquelles répondront les réticences de Gracq à l'égard de Blanchot), tiennent tout autant à une question de style qu'au dessein même de l'œuvre. Sans voir directement, entre Gracq et Blanchot, l'affrontement de deux vues du monde irréconciliables, force est de reconnaître que Blanchot (héritier de Maurras pour le style et de Kafka pour la pensée) se trouve du côté d'une décantation classique, d'une clarté des lignes, - dussent-elles ouvrir les croisées à des vertiges métaphysique ! - alors que Julien Gracq, plutôt celte que roman ( avec de certaines inclinations romantiques et wagnériennes) s'acharne à forer et à forger la langue française dans le sens d'un continuum que l'incandescence de la vision soude en un métal baroque non dépourvu de volutes et d'efflorescences, mais dures, parfois, et tranchantes. Autant Blanchot répugne aux adjectifs, qu'il n'est loin de tenir de superflus, autant Gracq construit sa phrase pour les accueillir. Les adjectifs ne viennent pas, dans l'œuvre de Gracq, à la rescousse de la structure ou de l'idée, mais, outrepassant en importance les noms et les verbes, apparaissent comme l'essentiel de la chose à dire.
« La langue française, écrit Blanchot, où les adjectifs ne sont pas à leur aise, signifierait non seulement la volonté de bannir l'accident et de s'en tenir à ce qui compte, mais aussi la possibilité d'atteindre la vérité des choses en dehors des circonstances qui nous la révèle. » L'observation pertinente frôle ici, comme chez Maurras, un jugement de valeur plus général, et peut-être abusivement général. Le génie de la langue française n'est-il pas assez grand pour s'exercer avec un égal bonheur dans la maxime sèche de Vauvenargues, dans la profusion coruscante de Rabelais, les énigmes aigües de Mallarmé, les cabrioles félines de Colette ou les suavités violentes de Barrès, - où les adjectifs ne semblent point si déplacés ? Mais peut-être la question est-elle bien plus philosophique qu'esthétique ? Blanchot n'eût sans doute pas contredit à ce philosophe de l'altérité pure qui écrivait: « Médire de la technique au nom de la poésie de la nature est une barbarie ». Dans cette perspective, une défiance morale, sinon moralisatrice, est sans doute possible à l'égard de l'œuvre de Julien Gracq, défiance pour les sortilèges pour les enchantements jugés coupables de dissoudre la conscience humaine... Sinon que depuis Au Château d'Argol, Un Beau Ténébreux, Le Rivage des Syrtes, les temps ont changés et que les sortilèges obscurs, les noirs ensorcellements qui menacent l'intégrité de la conscience humaine, les fascinations funestes où la raison périclite, où la barbarie redevient possible, se trouvent bien davantage dans les modernes techniques de communication, de contrôle et de destruction que dans la contemplation des forêts bretonnes, des « nuits talismaniques » ou des écumes sur les grèves.
Le monde vivant, le monde tellurique et météorologique ayant été déserté, ce n'est plus devant son règne jadis peuplé de dieux que cède la conscience humaine, si jamais elle céda, mais bien dans ce vide crée par son absence. « Là où il n'y a plus de dieux, disait Novalis, règnent les spectres. » Autrement dit l'abstraction, la planification et les « réalités virtuelles ». Si bien que le mot d'ordre classique (« Déteste les adjectif et chéri la raison »), ne vaut plus dans un monde où les pires déroutes de la raison sont la conséquence de la raison, où le « technocosme » est devenu un sortilège, une féérie dérisoire, certes, mais dont on ne peut d'évader, où le vide des qualités, corrélatif d'un appauvrissement du langage, est lui-même devenu une immense métaphore obstinée.
La « dissolution brumeuse et géante » évoquée par Julien Gracq est tout autant une expérience qu'une mise-en-demeure. Par ce monde arraché, in extremis, aux planificateurs, par ce monde effondré qui nous laisse face au retentissement de l'effondrement, nous nous trouvons désillusionnés d'une raison qui ne s'interroge plus sur sa raison d'être, d'une civilisation lisse et fuyante, qui nous maintient sans cesse en-deçà de nos plus hautes possibilités. Dans l'œuvre de Julien Gracq, nous voyons ce monde se défaire, mais cette défaite qui nous emporte comme un ressac nous révèle l'envers de la vague, l'envers du langage, la vérité étymologique, la réverbération antérieure aux mots et aux choses. La puissance de cette réverbération est une menace, mais une menace salvatrice.
•
Deux ouvrages de Luc-Olivier d'Algange, parus dans la collection Théôria, aux éditions de L'Harmattan, abordent certains thèmes évoqués dans l'article ci-dessus: Le Déchiffrement du monde, la gnose poétique d'Ernst Jünger; L'Ame secrète de l'Europe.
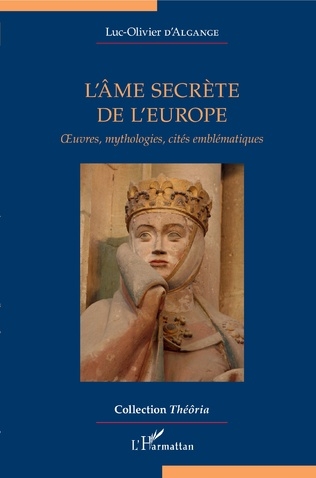
21:04 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
28/02/2023
Luc-Olivier d'Algange, Le peuplier à taille d'ogive, notes sur René Char:

Le peuplier à taille d’ogive
« Pour l’aurore, la disgrâce, c’est le jour qui va venir ; pour le crépuscule c’est la nuit qui engloutit. Il se trouva jadis des gens d’aurore. A cette heure de tombée, peut-être, nous voici. Mais pourquoi huppés comme des alouettes ? »
René Char
A Jacques Delort
Si la poésie est bien, selon la formule de René Char, de toutes les eaux claires celle qui s’attarde le moins au reflet de ses ponts, le commentateur, si pontifical qu’il se veuille, se trouve d’emblée récusé, à moins de se risquer à répondre à la mise en demeure matutinale, présocratique, de la pensée européenne, celle des « gens d’aurore », des « alouettes huppées » qui volent vers la pointe du jour, vers la source dont nous parle la rivière aimée, cette Sorgue héraclitéenne « rivière où l’éclair finit et où commence ma maison, qui roule aux marches d’oubli la rocaille de ma raison ». La rivière féconde les paysages où elle passe, - comme les mots eux-mêmes éveillent notre pensée, ravivée par leurs étymologies, leurs palimpsestes généalogiques, leurs figures héraldiques accordées aux pierres, aux arbres, aux essaims et aux éclairs.
De cette aurore de la pensée européenne, René Char fut le témoin, à l’égal d’Hölderlin, de Nietzsche ou d’Heidegger. Pour lointaine qu’elle soit, cette aurore nous dit cependant une proximité extrême, une souveraineté sise dans l’instant, dans l’éclair : « Nous sommes ingouvernables. Le seul maître qui nous soit propice, c’est l’Eclair, qui tantôt nous illumine et tantôt nous pourfend ». L’œuvre de René Char ne s’apparente pas seulement aux présocratiques par la vitesse, la concision et l’intensité aphoristique « Luire et s’élancer – prompt couteau, lente étoile » mais aussi par le refus de l’abstraction, de la logique linéaire ou binaire qui caricature l’éthique en « moraline » et nous livre, harassés et soumis, à la banalité mauvaise de la « pensée calculante » dont parle Heidegger.
Retour amont. Le titre de René Char, il faut l’entendre comme un mot d’ordre, non sans violence, ni précision. Ce n’est pas vers une origine vague que se tourne la pensée de René Char mais vers ce point (qui, pour quelques-uns n’a jamais cessé d’être) où le Mythe et le Logos n’étaient pas encore séparés, où le Tragique n’étant pas encore enseveli sous la fugace féerie publicitaire, les mots venaient à nous, « légers mots immortels, jamais endeuillés » pour exalter la beauté d’un devenir commun, d’une « commune présence ».
Ce qui s’est perdu perdure, l’aube oubliée, terrassée, s’accentue et délivre, le soir venu, sa vérité inaperçue dans le naufrage de la civilisation. La société peut triompher de la civilisation, les œuvres demeurent, et cet « en amont » dont elles surgissent : « Quand le navire s’engloutit, sa voilure se sauve à l’intérieur de nous. Elle mâte sur notre sang. Sa neuve impatience se concentre pour d’autres obstinés voyages. N’est-ce pas vous qui êtes aveugles sur la mer ? Vous qui vacillez dans tout ce bleu, ô tristesse dressée aux vagues les plus loin ? ».
De tous les poètes français de son temps, René Char fut sans doute celui qui demeura au plus près de sa conversation originaire avec Hölderlin. C’est « en touchant la main éolienne d’Hölderlin » qu’il devance en le récusant, en nous léguant sa « parole en archipel », un avenir où le Logos et le Mythe, disjoints, s’étioleront dans leur vaine spécificité, l’un ratiocinant dans son exil, son absence au beau cosmos miroitant, et l’autre glissant vers la pénombre des mondes virtuels. Or, pour René Char, s’il est un « au-delà nuptial », il ne peut être que parmi les choses du monde, dans les bruissements et les silences de la nature, dans son immanence irisée : « Ne permettons pas qu’on nous enlève la part de la nature que nous enfermons. N’en perdons pas une étamine, n’en cédons pas un gravier d’eau. »
Accordé l’un à l’autre, le Logos et le Mythe, la certitude de la raison d’être et les images qui la voilent et la révèle, disent une amitié, une entente sacrée entre la terre, le ciel, les hommes et les dieux : « Notre amitié est le nuage blanc préféré du soleil. Notre amitié est une écorce libre. Elle ne se détache pas des promesses de notre cœur ». Pour René Char, le discord entre le Logos et le Mythe ne persiste que par notre soumission à ce qu’il nomme « l’âge bas » qui nous incline à passer à côté de toutes les preuves étincelantes de l’être. Mais du scintillement, que l’ombre des ponts ne peut atteindre, la rivière, tradition et devenir, porte, en son courant, les inextinguibles vertus : « Rivière des pouvoirs transmis et du cri embouquant les eaux, de l’ouragan qui mord la vigne et annonce le vin nouveau… »
Ce rebelle, dont on voit mal ce que lui trouvent de si aimable les commémorations officielles, trouve son bien, son beau et son vrai, tantôt dans la douceur, tantôt dans l’anathème et ne cesse de s’interroger là où d’autres ne répondent plus de rien : « La lumière a un âge. La nuit n’en a pas. Mais quel fut l’instant de cette source entière ? ». Si, pour René Char, rompant avec le chauvinisme temporel qui nous fait apologistes mécaniques du siècle où nous vivons, l’homme fut, au vingtième siècle au plus bas, ce pessimisme toutefois, forgé par le tragique, n’ôte rien à la beauté de l’instant, bien au contraire : « La graduelle présence du soleil désaltère la tragédie ». L’amitié, l’amour, l’entente sacrée ne cèdent pas : « Où l’esprit ne déracine plus mais replante et soigne, je nais. Où commence l’enfance du peuple, j’aime »
Sans méconnaître les vertus éminentes de la stylistique et d’autres science du langage, force est de reconnaître (et nous préciserons de quelle nature est cette « force ») que loin d’être seulement le résultat d’un « travail du texte », d’un jeu de vocables et de syntaxe plus ou moins harmonieux ou original, le poème est le témoin d’une vue du monde et qu’il forge le poète au moins autant que le poète le compose. Le poète est le témoin de son poème, parfois son martyr, il doit en répondre ; d’où cette force, ce mouvement, qui, si bref qu’il soit, confond sa signature avec la signature des choses elles-mêmes. Entre le Dire et la chose à dire, entre la chose à dire et la chose dite, il n’y point d’espace, sinon d’un point : « Mon métier, écrit René Char, est un métier de pointe ». Point d’avant ni d’après, point d’écart entre le symbole et le symbolisé. L’un et l’autre adviennent en même temps, à la fine pointe du mot qui est pure éclosion. Mieux qu’à l’opinion, mieux qu’à la philosophie, mieux qu’aux divers préceptes de l’art littéraire, la poésie de Char s’accorde à la rose « sans pourquoi » d’Angélus Silésius.
Pour René Char dont la pensée, il faut y revenir, sans peine se hausse aux horizons présocratiques, horizons qui nous restituent aux embruns d’un « l’ici même », que nous persistons à ne pas déserter, le monde est un et chaque chose, en son irréductible singularité, en son écorce rugueuse, en son pollen impondérable, témoigne de cette unité compacte, resserrée, violente. Poème de résistance, autant que de désillusion, le poème de Char laisse revenir sur nous ces immémoriales houles européennes de la tragédie dans un monde qui s’évertue, par tous les moyens, à nier le Tragique, à nous emprisonner dans une dérisoire féerie publicitaire. Or, toute singularité est tragique, et l’on ne peut nier le Tragique qu’en inventant un règne d’hommes sans visages, un monde d’objets de série, dissocié des dieux et des morts. Pour René Char, toute conquête n’est que reconquête de ce qui est. Et c’est au cœur du temps que l’énigme heureuse nous empoigne. « L’Etre et le Temps » : la connivence de René Char avec Heidegger s’explique par ce mouvement de retour vers la source du temps, vers cette intelligence sensible du temps : « les tendres preuves du printemps » sont préférées aux « buts lointains».
Nous évoquions une « vue du monde ». Celle de René Char, tournée vers les frémissements du temps, les abysses, les palimpsestes, se distinguera radicalement de cette autre vue du monde qui aspire, par exemple, à la maîtrise de l’espace. Si l’homme du tradere est un homme qui ordonne et sanctifie le temps, le Moderne est l’homme de la maîtrise de l’espace. « L’homme de l’espace, écrit René Char en 1959, dont c’est le jour natal sera un milliard de fois moins lumineux et révèlera un milliard de fois moins de choses cachées que l’homme granité, reclus et recouché de Lascaux, au dur membre débourbé de la mort ». Toutes les phrases écrites par René Char (on serait tenté de dire gravées, comme des runes, sur des pierres offertes aux érosions du vent, du sel et de l’océan) témoignent de cette volonté farouche de sauvegarder la singularité immémoriale des êtres et des choses. Le poème est à ce service, s’il n’est pas un poème « engagé », au sens rhétorique ou idéologique, ni servile. Mais d’un combat à mener, la conscience aiguë, presque lancinante, poursuit le poème, le frappe, comme d’un sceau, voire comme d’une masse d’arme. Pour René Char, d’une certaine façon, la littérature et la philosophie doivent rendre l’âme pour que cette âme puisse rétablir le lien entre l’être et la vie : « Pourquoi poème pulvérisé ? Parce qu’au terme de son voyage vers le Pays, après l’obscurité pré-natale et la dureté terrestre, la finitude du poème est lumière, apport de l’être à la vie. »
Toute la poétique de René Char se joue dans ce rapport direct, immédiat, de l’être à la vie qui est à la fois la chose la plus ingénue du monde, la plus certaine, et la plus rare. Or de cette rencontre nuptiale de l’être et de la vie, tout nous détourne, à commencer par ces lieux communs philosophiques qui, par exemple, nous veulent persuader que le moment présent, aussitôt détruit que perçu, n’existe pas et que nul ne saurait y établir sa demeure. Tout nous détourne du resplendissement de l’être : ces morales serves qui prétendent que la fin justifie les moyens, ce temps linéaire, pure fiction, mais despotique, qui nous subjugue aux seules logiques de la production et de la reproduction. Pour René Char, l’existence ne précède point l’être, elle est pure disparition dans le contact éperdu de l’être et de la vie. « Obéissez à vos porcs qui existent. Je me soumets à mes dieux qui n’existent pas. Nous restons gens d’inclémence ». Mais ces dieux qui n’existent pas vivent et reviennent : « Les dieux sont de retour, compagnons. Ils viennent à l’instant de pénétrer dans cette vie ; mais la parole qui révoque, sous la parole qui déploie, est réapparue, elle aussi, pour ensemble nous faire souffrir ».
« A l’instant », cela n’est rien, cela n’existe pas encore, les porcs n’en sauront rien, mais c’est, déjà et à jamais, un monde, exactement présent et prodigieusement hors d’atteinte : « L’âge du renne, c’est-à-dire l’âge du souffle. O vitre, ô givre, nature conquise, dedans fleurie, dehors détruite ». De l’avers et de l’envers, de la floraison et de la destruction, le poète dit l’entre-deux. « Faire un poème, c’est prendre possession d’un au-delà nuptial qui se trouve bien dans cette vie, très-rattaché à elle, et cependant à proximité des urnes de la mort. » A ne point vouloir se défaire du Tragique comme le « dernier des hommes » dont parle Nietzsche, mais, au contraire à le renouer en soi jusqu’à la douleur exquise, le poème sauvegarde ce qui n’est, en aucune façon, interchangeable, cette seconde pure, cet instant où les dieux apparaissent, cet instant qui se tient, cet instant d’âge immense, soleil : « frais soleil dont je suis la liane ».
On répute les poèmes de René Char difficiles ou obscurs comme s’il fallait au lecteur des clefs extérieures au poème ou au monde, une science particulière, réservée. Il n’en est rien, sauf à prendre cette « science réservée » comme un privilège de la pauvreté, une simplicité d’âme et d’accueil qui consent à l’approfondissement de l’heure. C’est à ne pas approfondir le temps, qui est le temps du cosmos non moins que celui de notre âme à fleur de peau, que le poème de Char nous demeure scellé. Pour l’entendre et le voir, il faut s’attarder, non point jusqu’à l’hypnose ou la manie interprétative, non point au détriment de l’élan et de l’essor, mais juste le temps de rendre aux mots leur dignité concrète, de les laisser s’épanouir, choisir leurs courants intimes, leurs rapports de forces singuliers, leurs destinées florales, pierreuses ou brumeuses. Les mots sont là, avec leur halo, leur rugosité, leur éclat. Le poème de René Char n’exige de nous rien d’autre que ce consentement au temps qui laisse affleurer les étymologies, les analogies, et cette irréductible compacité de la chose dont le mot se revêt pour dire son immatérialité et peut-être, sa divinité. Cette divinité confond en une seule requête l’aurore et l’orée. Il vient un moment où le mot, redevenu l’égal de la chose qu’il nomme, comme un idéogramme ou un hiéroglyphe, nous précipite vers une connaissance première : « Seule est émouvante l’orée de la connaissance. » Le poème de Char est bien pur poème et non pas « poème philosophique » comme certains l’ont dit, dans la mesure où il apporte les réponses avant les questions : « Aucun oiseau n’a le cœur de chanter dans un buisson de questions ».
Si les dieux reviennent, ainsi que l’écrit René Char, c’est par les mots rendus à leur densité physique, à leur immanence enchantée. Tel est le beau paradoxe du poème que de nous offrir la transcendance du Sens, son ciel le plus haut à partir du mot revenu, après un long périple, à son immanence, à sa force de chose et de cause. Telle est exactement la « Recherche de la base et du sommet ». Point d’espace entre l’être et la vie, sinon celui de nos abandons, de nos craintes, de nos atermoiements, de nos illusions communicatives, de nos enrichissements factices. Le recueil de René Char, Pauvreté et privilège, dont le titre à lui seul est un manifeste, puisque tout privilège essentiel se paye désormais de pauvreté (comme le savait aussi Charles Péguy disant « l’éminente pauvreté des dignes »), s’ouvre sur une dédicace qui suffit à écarter d’emblée des meutes de tricheurs : « Pauvreté et privilège est dédié à tous les désenchantés silencieux, mais qui, à cause de quelque revers, ne sont pas devenus pour autant inactifs. Ils sont le pont. Ferme devant la meute rageuse des tricheurs, au-dessus du vide et proche de la terre commune, ils voient le dernier et signalent le premier rayon. ».
Aussitôt faut-il préciser que l’ontologie de René Char n’a rien de quiétiste, qu’elle n’ouvre pas à l’indifférence, à ce « pareil au même » qui, quelquefois, se prétend sagesse ! Ontologie guerroyante, impérative, ne résorbant pas le Tragique dans l’effusion vague mais le rendant à la guerre d’où il vient, à laquelle nous ne pouvons nous dérober, l’ontologie poétique de René Char s’accomplit dans la fidélité au foyer secret des mots et des choses, rendant caduque la querelle théologique du nominalisme et du réalisme. Entre le dernier rayon et premier, toute la nostalgie se change en pressentiment. Toutefois, René Char n’ignore pas que nous vivons un « cycle bas » où « l’essentiel est sans cesse menacé par l’insignifiant ».
« J’ai, de naissance, la respiration agressive. » Ce Résistant, qui ne fut ni de pacotille ni de dernière minute, tenait en réserve, dans sa fidélité inconsolée, ce regain de lucidité qui permet au pessimisme d’être actif sans se tromper : « Ce monde contemporain nous a déjà retiré le dialogue, la liberté et l’espérance, les jeux et le bonheur ; il s’apprête à descendre au centre de même de notre vie pour éteindre le dernier foyer, celui de la Rencontre. » Célébrer l’être et la vie en leurs resplendissements divers, ce n’est point alors se départir de la puissance du refus, ni de la brûlure de la lucidité, mais en ressaisir le chance imparable. Ce monde contemporain, moderne ou post-moderne, est illégitime. Son espace, en ce cycle bas, est strictement équivalent à ce qui nous fut arraché, dérobé, à ce qui fut souillé et pillé, à ce qui fut profané et détruit. Ce monde immonde dont le mouvement fondamental est l’expropriation de toute légitimité supérieure, René Char ne se contente pas de le déplorer, il lui oppose un autre monde, une cohérence ignorée, mais vivante encore, renaissante à la pointe du dernier rayon qui est peut-être aussi le premier : « Je me révolte donc je me ramifie. Ainsi devraient parler les hommes au bûcher qui élève leur rébellion » et ceci encore : « Nous sommes forts. Toutes les forces sont liguées contre nous. Nous sommes vulnérables. Beaucoup moins que nos agresseurs qui, eux, s’ils ont le crime, n’ont pas le second souffle. »
Donc, un combat fait rage, dont la plupart ne savent rien, et dont, méprisants, ils ne se soucient : « Pour un être de mépris, toutes les sources sont polluées et à sa charge, encore que leurs abords soient propices à son jeu ». Hostile au Tragique comme à la joie, l’être de mépris domine le monde en proclamant la relativité de tout, qui elle-même travaille à l’indifférenciation et à la planification. Or, Pour René Char, vivre en poète, c’est vivre au diapason des vertus irréductibles des êtres et des choses, de leurs singularités exaltées, sensibles autant que « talismaniques ». Le « multiple » dont parle René Char, est sacré, il est une manifestation dont les hommes ne peuvent disposer à leur guise, et dont le poète reconnaît la précellence : « De si loin que je me souvienne, je me distingue penché sur les végétaux du jardin désordonné de mon père, attentif aux sèves, baisant des yeux formes et couleurs que le vent semi-nocturne irriguait mieux que la main infirme des hommes. » Depuis, combien de paysages massacrés, d’arbres coupés au bon vouloir des êtres de mépris, pour satisfaire à leur inclination à jouer aux abords en ignorant la reconnaissance ? « Moi qui jouis du privilège de sentir tout ensemble accablement et confiance, défection et courage, je n’ai retenu personne sinon l’angle fusant d’une rencontre. »
Mais est-il encore possible de rencontrer quelqu’un, lorsque dans une société devenue la première ennemie de la civilisation, les êtres humains ne se rencontrent plus que par l’entremise de représentations abstraites ? Tout nous donne à penser que l’homme n’est plus au monde, que dissocié de son paysage sensible et intelligible, sa valeur, sa réalité même se réduisent à ce qu’il représente. Entre accablement et confiance brûle donc la lucidité qui honore le passé et l’exil : « Jadis l’herbe, à l’heure où les routes de la terre s’accordaient dans leur déclin, élevait tendrement ses tiges et allumait ses clartés. Les cavaliers du jour naissaient au regard de leur amour et les châteaux de leurs bien-aimées comptaient autant de fenêtres que l’abîme porte d’orages légers… » Ce passé, certes, on ne saurait le réduire à un passé historique ou, pire encore, sociologique. Passé, pour reprendre le mot de Heidegger, « historial » et poétique, il est cet « autre temps », cette temporalité féconde, ce « vent semi-nocturne » qui irrigue le paysage réel que l’aujourd’hui idéologique veut à tout prix ignorer. La résistance de René Char ne s’explique sans doute pas autrement ; il est l’homme d’un pays, c’est à dire qu’il consent à appartenir à une multiplicité vivante, à un cours parfois tumultueux, celui de la Sorgue : « Rivière des pouvoirs transmis et du cri embouquant les eaux, de l’ouragan qui mord la vigne et annonce le vin nouveau ». Nous sommes encore quelques uns à penser que la prière qu’un homme adresse à sa rivière est plus importante, pour nous tous, que l’accélération du TGV ou la fabrication faramineuse d’autres engins ou édifices titanesques, où la navrante impuissance des modernes sur leur propre destin croit trouver une sorte de compensation. Les dieux reviennent ; nous en acceptons l’augure s’ils viennent à se loger dans ces rivières, ces pierres, ces arbres qui nous tiennent à cœur. L’œuvre de Char nous montre qu’un homme qui rompt, se rebelle, s’obstine et va vers son risque avec bienveillance est aussi un homme de prière : « Rivière au cœur jamais détruit dans ce monde fou de prison, garde nous violent et ami des abeilles de l’horizon. »
Le propre du monde des titans et de la technique est de tout dévaster puis de nous dire, au cœur du désastre, lorsque nous ne sommes plus nulle part (mais qui est partout !) comme il est bon d’être convivial et pacifique ! Ceux qui n’y consentent, bien sûr, seront nommés « réactionnaires », ou « passéistes », encore serait-il plus juste de les dire poètes, tout simplement, amis des sentes forestières : « Jadis l’herbe était bonne aux fous et hostile aux bourreaux. Elle convolait avec le seuil de toujours. Les jeux qu’elle inventait avaient des ailes à leurs sourires (jeux absous et également fugitifs). Elle n’était dure pour aucun de ceux qui perdant leur chemin souhaitent le perdre à jamais. ». Cet « à jamais » et ce « toujours » s’opposeront à la permanente obsolescence des « nouveautés » que les Modernes adulent en les jetant les unes après les autres. Ils s’opposeront de toute la force de la prière qui épouse « le ralenti du lierre à l’assaut de l’éternité ». Ils s’opposeront, sous l’apparence du « peuplier à taille d’ogive », du peuplier des pays de France, arbre divaguant au ciel profond, à « la laideur qui décompose sa proie ».
Luc-Olivier d'Algange
23:42 | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
27/02/2023
Luc-OLivier d'Algange, notes sur le Coeur aventureux d'Ernst Jünger, version 1929
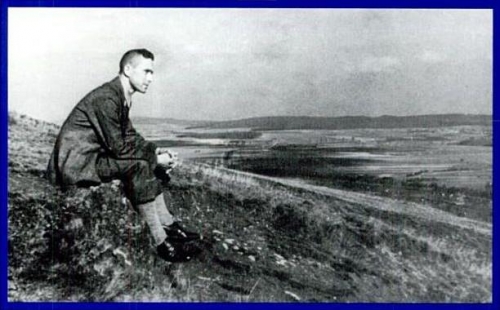
Une quête du langage originel
Notes sur Le Coeur aventureux d'Ernst Jünger, version 1929
Ernst Jünger fut d'emblée un cœur aventureux. Il est banal et parfois fallacieux de rechercher dans les premières œuvres d'un auteur le germe de ses œuvres futures. Par le regard rétrospectif, nous cultivons souvent l'illusion de découvrir des causes, des origines que la succession semble légitimer mais qui ne sont souvent que la projection sur le passé de nos préjugés présents. L'art prospectif, au sens propre aventureux, est plus difficile. Quel critique eût prévu que Les Plaisirs et les Jours, si Proust eût disparu au lendemain de leur publication, se fussent déployé en la cathédrale d'A la Recherche du Temps Perdu ? A lire Orages d'acier ou la première version, de 1929, du Cœur aventureux, il est difficile de prévoir Héliopolis ou Eumeswil. Il n'en demeure pas moins que les premiers écrits de Jünger donnent le la et commencent déjà à décrire le cercle, qui se poursuivra en spirale ascendante, des préoccupations majeures et déterminantes de l'auteur. Ce que l'on nomme le courage et dont Ernst Jünger fit preuve comme soldat, se prolonge dans son œuvre par l'exercice de l'imagination et de l'intelligence. L'auteur digne de ce nom est celui qui écoute la vox cordis, il est aussi celui qui répond à l'injonction « sursum corda »! Si la vox cordis, la voix du cœur dont nous parle Pierre Boutang dans son Art poétique, est bien la voix du silence antérieur à toute formulation, celle où s'abreuvent les poètes et les mystiques, et dont la fraîcheur et la limpidité témoignent d'une divine antériorité, ce cri « sursum corda » viendra s'ajouter à l'action pour en inscrire les puissances bienfaitrices dans le monde même de la contemplation.
L'exigence du Cœur aventureux, telle qu'elle s'annonce dès les premières pages de la version de 1929, conjugue ces deux aspects du cœur: la part secrète, silencieuse, porte vers nous le souffle, le murmure du Verbe à sa naissance tandis que l'appel au courage, la force de l'action viennent, comme un cordial, porter ce silence antérieur dans le monde par l'ambassade de l'auteur. Si le mot même d'auteur, dans l'acception jüngérienne, renvoie, ainsi que le rappelle Philippe Barthelet, à l'auctoritas, la vertu qui accroît, que l'étymologie latine associe à l'art du jardinier, l'art d'écrire est aussi, par excellence, un art diplomatique. Ce qui importe à l'auteur, qui se lance aventureusement dans ses périples intérieurs et extérieurs, qui navigue avec la même attention sur les paquebots au long cours que sur les embarcations plus fragiles et plus aléatoires de ses rêves ou songeries impromptues ou provoquées, ce n'est pas tant de témoigner de sa subjectivité ou de sa singularité que d'être l'ambassadeur des pays et des régions explorés. A cet égard, Jünger ne fut pas un voyageur romantique à la française, épris de ses états d'âme orageux qui ne retrouve partout où il va que l'ombre portée de son trouble ou de son enthousiasme. L'auteur d’Orages d'acier, de Jardins et routes s'attache d'abord à l'exactitude et à l'objectivité de son récit.
Cet auteur que des critiques hâtifs ont classé parmi les obscurantistes fut surtout un homme qui fit de l'attention la vertu majeure de l'écrivain. A maints égards, ses récits de voyage s'apparentent aux chroniques du dix-septième siècle où, dans une prose magnifique, des militaires ou des négociants écrivaient leurs rapports et leurs chroniques sans autre intention, en apparence, que de donner au lecteur les informations les plus précises. Allant de pair avec l'exploration des profondeurs de l'âme humaine et de l'Ame du monde (l'une donnant accès à l'autre) un naturaliste, disciple de Buffon, de Linné, de Fabre, accompagne l'auteur dans ses cheminements. Etre attentif, ne point se laisser abuser par la facilité des explications mécanistes, laisser les phénomènes s'éployer dans l'entendement humain, prendre figure, telles seront les règles, au sens presque monastique, de l'écrivain.
L'approche jüngérienne, et c'est son originalité, ne fait a priori aucune différence entre l'attention requise par un phénomène naturel et l'attention requise par une œuvre de l'imagination. Si Jünger ne dissocie point les méthodes, c'est aussi qu'il se refuse à séparer radicalement les ordres de la réalité. Semblable aux grands platoniciens qui distinguent le sensible et l'intelligible, mais ne les opposent point, ni ne les séparent, Ernst Jünger présume entre ces deux ordres de la réalité une « gradation infinie » dont les degrés, qu'ils soient proches de la blancheur royale de l'Intelligible, ou, au contraire, proches de l'opacité du sensible, ou bien encore dans l'espace intermédiaire et versicolore de l'Imaginal, selon le néologisme judicieux forgé par Henry Corbin, n'en exigent pas moins de l'herméneute un même courage, et, pour ainsi dire, une même courtoisie. Jünger décrit les rêves comme Linné et Fabre décrivent les plantes et les fleurs. S'il décrit les fleurs comme un poète le ferait de ses rêves, ce n'est pas seulement un procédé de style. Dans la perspective « stéréoscopique », les phénomènes intérieurs et les phénomènes extérieurs se répondent. Le cœur aventureux de l'auteur est l'espace où résonnent les réponses que la réalité invisible adresse à la réalité visible. La descente aventureuse dans les abysses scintillants de l'âme humaine est aussi, mystérieusement, remontée dans les hauteurs de l'Ame du monde. Toute promenade, tout voyage, toute rêverie est parsemées d'intersignes.
Diplomate subtil, l'auteur établit la cartographie des sites physiques et métaphysiques où le passage d'un règne à un autre est attesté par une expérience décisive. L'aventure nous donne à comprendre, en nous arrachant aux opinions et aux fausses évidences, que l'âme humaine et l'Ame du monde ne sont point séparées. L'âme humaine n'est point pour Jünger, cette "psyché" séparée du monde, emprisonnée dans sa spécificité insolite qui nous leurre et nous déroute, pas davantage que le monde n'est cette réalité radicalement étrangère et inconnaissable que nous vante une certaine philosophie néo-kantienne. Pour peu qu'elle osât l'aventure, qu'elle s'arrachât à la caverne et refusât de se laisser abuser par les marionnettistes et leurs ombres trompeuses, l'âme humaine peut exercer son courage à devenir un moyen de connaissance de l'Ame du monde. Rien ne témoigne plus exactement de cette possibilité prodigieuse que la citation de Hamann qui figure en exergue à la version de 1929 du Cœur aventureux: « La semence de tout ce que j'ai en tête, je la trouve de toutes parts. »
« La pensée, habit de l'âme »
Pour se retrouver dans ce « toutes parts » encore faut-il consentir à sortir du Moi. Ernst Jünger eut, très tôt, d'heureuses prédispositions à cet exercice auquel beaucoup, en dépit d'ascèses parfois douloureuses, échouent. « Même aux instants de pire confusion, j'ai rarement perdu ce sentiment, comme si d'un point lointain et excentrique, une instance attentive observait le mécanisme mystérieux pour le contrôler et l'enregistrer. Il me semblait souvent que dans des instants très-humains comme ceux de l'angoisse, il se déclenchait là-haut quelque chose que l'on aurait pu, en gros, comparer à un rire moqueur. Mais il est aussi d'autres signes, deuil, émotion, fierté, semblables à des signaux d'une optique intérieure: je croyais parfois les reconnaître à ce point fixe que je définirai comme une conscience seconde, impersonnelle et plus subtile. »
Ce passage mérite une attention particulière car l'auteur y décrit exactement cette complexion qui lui est propre en laquelle la « méthode stéréoscopique » trouve son origine. De cette faculté d'être à fois ici et ailleurs, pris dans la tourmente des événements et observateur immobile, et dont témoignent aussi les récits autobiographiques des Orages d'acier, de Jeux africains, Jünger va induire une méthode, et, pour ainsi dire, une dioptrique qui conférera à ses livres cette double tonalité, à la fois ardente et froide qui tant décontenance la sentimentalité bourgeoise. Cette ubiquité de l'auteur, qui se décrit à la fois en proie aux bouleversements du moment et distant, presque moqueur, rejoint « l'ironie romantique » dont parle Novalis, qui n'est point le sarcasme mais l'hommage léger et serein à la signification multiple des êtres et des choses. Loin d'être obnubilé par la violence ou l'intensité de l'épreuve, l'esprit héroïque y acquiert cette faculté de détachement, cette « optique intérieure » qui témoigne du « point fixe » de la conscience.
Une métaphysique de la double nature de l'entendement humain s'ébauche dès les premiers paragraphes du Cœur aventureux. L'ironie, l'antiphrase sont l'expression non d'un déni, d'un nihilisme, ni même à proprement parler d'un doute mais d'une dualité vivante, chatoyante qui est la source même des couleurs et des qualités. L'ironie telle qu'en usent les œuvres de Novalis et de Jünger n'est pas cette pointe de l'esprit critique à l'apogée de son outrecuidance, mais bien une ironie songeuse, accueillante aux énigmes et aux mystères du monde. C'est en s'abandonnant, en renonçant aux prétentions parfois exagérées de la ratiocination, que la double nature du monde nous apparaît et que le rôle de la pensée cesse précisément de nous faire illusion. « Ce rôle, note Jünger, dont la vision entraîne Hamann à qualifier la pensée d'habit de l'âme et Rimbaud à attribuer aux voyelles une vie cachée qui confère aux mots une signification impénétrable ».
La pensée est approche, elle donne accès. Elle n'est point cette totalité close sur elle-même dans une unité insolite qu'imaginent les subjectivistes, mais une « zone frontalière ». Lorsque Hamann écrit que l » pensée n'est que l'habit de l'âme, il retrouve la distinction soufie de l'écorce et du noyau. De même, dans le Zohar, l'ouvrage fondateur de la Kabbale, il est dit que le texte n'est que « le vêtement de la Loi ». Par-delà la pensée elle-même dans son parcours exotérique, il existerait donc une âme, un secret, une vérité ésotérique, comparable à la couleur des voyelles qui témoignent d'une vie cachée, d'une âme. Le contenu des pensées qui importe moins que leur orientation, le sens de leur navigation, leur aventure propre, leur périple: « Les pensées sont des chargements très divers qui voguent sur des eaux sombres, et dont tout le fret intellectuel a quelque chose de très fortuit, glané de-ci de-là. Il dépend des endroits où nous faisons escale et de ce qui s'y trouve justement en stock. Une fois chargé pourtant, il s'adapte aux courants et aux ralentissements de fleuve, à ses méandres, à ses tourbillons, à ses danses. C'est du courant de la vie profonde qui la porte, et non d'elle-même que la pensée tient sa subtilité, son poids et sa dangerosité. »
Qu'est-ce que ce courant ? Est-ce le devenir héraclitéen, qui fait que l'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ? Est-ce seulement la bruissante et perpétuelle présence anonyme de la vie, qui nous porte en dépit de notre volonté et de notre libre-arbitre, et à laquelle nous devrions obéir comme si elle était la maîtresse voilée de nos destinées ? Est-ce le fatum qui fait de nous des « êtres pour la mort » selon une formule de Heidegger ? L'Art de l'interprétation auquel l'œuvre de Jünger persiste à s'adonner, récuse en partie ces hypothèses trop simples. Pour Jünger, c'est bien au moment précis du « lâcher prise » que l'énigme soudain se dissout dans une plus vive clarté.
Pour assister à la transfiguration de l'énigme en arcane, il faut dans un premier mouvement s'abandonner à la complexité, s'étonner et s'émerveiller à la fois de ne pas comprendre, accepter humblement les limites imparties à notre raison. Une subtile opération devient alors possible, qui est la révélation de l'arcane. L'œuvre de Jünger se tiendra, tout au long de la traversée, à égale distance du rationalisme superstitieux des modernes et de la non moins moderne hybris des irrationalistes. L'aventure jüngérienne, pour périlleuse qu'elle soit, n'en chemine pas moins vers le Logos. Toute l'œuvre de Jünger illustrera cette possibilité d'interpréter et de connaître tous les aspects du monde par le Logos. Lorsque l'on sait que, par la sagesse grecque, la raison et le Verbe en leur unisson portent précisément le nom de Logos, l'erreur qui consisterait à réduire l'œuvre jüngérienne à quelque pur « vitalisme irrationaliste » est évitée. Pour Jünger, la conquête des profondeurs n'est pas éloignement du Logos, complaisance à l'égard de quelque confuse négation de l'intégrité humaine mais bien, selon la formule de René Char « retour amont »: « Pour finir, écrit Jünger, il ne resta de cette chute vertigineuse dans le puits de la connaissance qu'une seule voix, un sombre murmure qui semblait s'approcher du point absolu, de la zone de la parole originelle ».
La clef des formes
La navigation de l'auteur, son aventureuse traversée des circonstances terribles ou ravissantes du monde, de la confrontation aux « orages d'acier » de la première guerre mondiale à la légère présence bleutée de la cicindèle, par-delà l'apparent éclectisme de son fret, n'est perceptible que par un lecteur assez attentif et visionnaire pour voir dans les aperçus divers une seule et unique approche des contrées de la parole originelle. Si la poésie est bien, selon la célèbre formule de Hamann « la langue originelle de l'humanité », alors toute l'œuvre de Jünger peut être considérée comme approche du Mystère poétique, rendue nécessaire par le triomphe du nihilisme. Quelques exégètes d'une ingénuité désarmante ou feinte semblent croire que la poésie va de soi, qu'il lui suffit d'aller son chemin, en prose ou en vers, pour toucher les cœurs. Ernst Jünger, pour le moins, ne partage pas cette naïveté. Comme Heidegger, et nous aurons l'occasion de revenir sur l'influence que Martin Heidegger exerça sur Jünger et sur celle, moins généralement établie, mais certaine, que Jünger exerça sur Heidegger, l'auteur des Falaises de marbre ne cessa jamais d'être conscient de « l'oubli de l'être » et de notre éloignement du Logos. Le Logos demeure, il est notre demeure, mais nous nous sommes éloignés de lui au point qu'il nous est presque devenu indiscernable. Il faut pour accéder à sa splendeur pérenne littéralement se faire violence. Ce qui fut donné jadis, dans l'ensoleillement de l'être chanté par Hésiode, ce qui, aux confins de l'Age d'Or fut notre demeure et dont nous gardons, dans le secret du cœur, la nostalgie immense, s'est obscurci.
Notre entendement non seulement n'est plus transparent à la Merveille, mais s'impose désormais comme un écran. Ce monde est, par provenance et destination, un poème mais depuis que nous vivons dans l'Immonde, ce poème est devenu hors d'atteinte. La clé des formes nous échappe: le rôle de l'auteur qui s'en va aventureusement vers la parole originelle, sera d'œuvrer à la recouvrance du sens du déchiffrement. Le cœur aventureux ne s'abandonne point à la mélancolie de l'éloignement du Logos: il exige la reconquête: « Il y a trois choses qui sont la clé de toutes les formes: la vague, le nuage, la flamme. C'est pourquoi il y a toujours eu d'aimables cabalistes qui renonçaient volontiers à toute compagnie pourvu qu'ils puissent en pleine tranquillité se perdre dans la contemplation de l'eau, de l'air ou d'un bon feu de cheminée. Il y a trois états qui sont la clé de toutes les expériences: l'ivresse, le sommeil et la mort. C'est pourquoi il n'a jamais manqué de féroces buveurs de la vie, d'aristocrates du rêve serein et ténébreux, de guerriers, de lansquenets et d'aventuriers, bref de gens auxquels tout l'univers des employeurs et des employés, des boutiquiers et de l'argent étaient parfaitement indifférent. »
Les songeries cosmogoniques de Jünger le portent à méditer la vague car elle est à la fois le symbole du monde perpétuel et du retour. La vague s'élance, se retire et revient, selon un mouvement ternaire qui évoque la respiration du cosmos, chaque vague consacre à la fois une ressemblance et un retour, une figure héraclitéenne du « toujours autre » et une figure parménidienne de la permanence. Qui n'a été requis, sur une grève, par le sentiment que les vagues tentaient obstinément d'atteindre au langage par la réitération de leur immémoriale prosodie. L'écume qui scintille dans la chute évoque cette limite où la parole s'épuise face au territoire indicible: et cependant les vagues gagnent, elles transforment les roches en ce sable indispensable aux premières instruments de la mesure du Temps. La vague affirme le temps par son mouvement et elle nie le temps par sa répétition tout comme dans les disciplines monastiques la répétition du nom de Dieu maintient le récitant dans un éternel présent. Toutes les formes sont contenues dans la vague car son mouvement mystérieusement préside à l'immobilité. La contemplation du mouvement perpétuel nous donne accès à ce qui ne bouge ni de devient, de même que les oscillations du cœur et de l'âme révèlent l'immobilité souveraine du Soi.
La méditation du nuage prolonge naturellement celle de la vague car le nuage n'est autre ainsi que nous l'enseigne l'art héraldique de l'étymologie, que la nuance. Les béotiens disent volontiers du poète et du métaphysicien qu'ils sont « dans les nuages ». Il serait plus exact de dire qu'ils sont dans la nuance. Les nuages, les « merveilleux nuages » qu'aime l'étranger baudelairien sont les nuances de l'âme du monde. S'il fallait d'une seule formule définir la fonction de l'auteur, nous le dirions Maître des nuances. L'écrivain témoigne bien d'une maîtrise, mais c'est une maîtrise de la nuance et en faveur de la nuance. Les nuages offrent au regard la vision du nuancement des formes, de leurs transitions, de leurs gradations vivantes qui seront une métaphore heureuse de la toute-possibilité. Lorsque l'intelligence moyenne s'enferme et s'évertue à enfermer autrui dans des catégories qui n'ont d'autre réalité que le manque d'imagination et d'attention de celui qui les conçoit, le poète-métaphysicien persistera à dire la nuance dont dépendent également toute distinction et toute hiérarchie bien comprise. Maître des nuances, l'auteur sera « chasseur subtil », il favorisera l'interprétation infinie de l'approche au détriment de la définition et de l'explication totalitaire. Au monde statistique, le Maître des nuances oppose le monde des qualités qui correspond, selon la formulation confucéenne, aux « justes dénominations ». Bien nommer exige la reconnaissance de la nuance. Dans le ciel d'été, les nuances s'effilent et s'évanouissent peu à peu dans le bleu absolu qui les rend discernables. Les nuages apparaissent et disparaissent sur le fond absolu comme dans l'art littéraire, les nuances adviennent et s'abolissent dans le vaste espace de l'entendement.
Quant à la flamme, éclairante et destructrice, elle suscite les ombres mobiles dans le geste même qui dévore la ténèbre. Aimée comme la vague et les nuages des « aimables cabalistes », elle suffit à dire la vie qui brûle et s'élève et le secret des retrouvailles avec ce que Bachelard nommait le « temps vertical », qui rend possible, lorsque la contemplation s'en empare, une décisive victoire sur le temps de l'usure dont la linéarité nous dépossède de la gloire, de la beauté et de l'ivresse du moment présent. Ernst Jünger ne manquera jamais à cette éthique dispendieuse comme la flamme qui consent aux rêves sereins ou ténébreux, étrangère aux plans de carrière et à toute pensée calculante.
Ce serait toutefois fort mal comprendre l'œuvre de Jünger que de croire que ces puissances dionysiennes se suffisent à elles-mêmes et n'imposent à l'auteur rien d'autre qu'un refus de la lucidité, de l'éveil et de la vie. L'analyse assez commune de l'œuvre de Jünger en tant qu'œuvre « obscurantiste » trouve sa limite dans le déchiffrement auquel Jünger se livre de ces puissances. Elles ne sont pas des fins, mais des passages, des clés pour une connaissance lumineuse. S'il ne s'agit point de ramener l'inconnu au connu, ni d'abandonner le connu à l'inconnu ou de se départir, le moins du monde, de cette intelligence critique dont les modernes se targuent autant qu'ils en dédaignent l'exercice effectif. La logique jüngérienne n'obéit pas davantage à la logique de l'alternative qu'à celle du compromis. Il ne s'agit point de faire sombrer dans le sommeil, comme des vestiges en déshérence, les édifices de l'intelligence éveillée mais de faire lucidement l'épreuve de la nuit. La logique de l'alternative cède la place à la coincidentia oppositorum chère aux alchimistes. Dans cette perspective philosophale, avant d'atteindre aux couronnements de l'oeuvre-au-blanc et de l'oeuvre-au-rouge, il est nécessaire de faire l'épreuve de l'oeuvre-au-noir. Le propre du cœur aventureux est non de préjuger mais de faire l'épreuve. Ernst Jünger eut le beau courage d'aller au-devant des épreuves, car il voit en elles les clés d'une Sapience.
« Dans le commerce des hommes, et surtout à notre époque dépourvue de tenues et de normes, grande est aussi l'importance de cette clé magique, grâce à laquelle derrière ce que dit chacun, on découvre ce qui commande ses paroles ». Nous vivons ces temps étranges où l'autorité est cachée, où ce qui commande exige, pour être connu, une clé magique. Les normes ne sont point abolies, elles sont voilées. Les différences évidentes entre les hommes sont illusoires car elles ne témoignent que des seules appartenances sociales. Or, par-delà les classes, les habitudes, les mœurs, il existe d'autres distinctions, plus essentielles, quoique généralement ignorées, qui correspondent aux normes propres aux castes intérieures qui subsistent en dépit de toutes les subversions et de toutes les confusions. Quels que soient les désordres intérieurs ou extérieurs, et les abus de pouvoir, il n'en demeure pas moins que certains hommes obéissent à des « typologies » que l'on peut dire essentielles dans l'exacte mesure où elles échappent au déterminisme. Les cœurs aventureux, pour disparates que soient leurs parcours, sont prédestinés à se reconnaître car, en eux, la confrontation avec l'ivresse, le rêve et la mort révèle, par la splendeur du contraste, une éthique fondée, selon la formule de René Guénon, sur les « états multiples de l'être ».
« Les plus fines nervures »
Ernst Jünger fut cet homme lucide et ce grand vivant précisément car il sut discerner les « zones frontalières » de la lucidité et de la vie, et s'attarder en méditant sur le seuil, là où les signes apparaissent. La « vie magnifique » débute avec le regard de l'aruspice qui reconnaît dans les manifestations en apparence aléatoires ou accidentelles, les traces de l'écriture sacrée. Alors que la vue-du-monde bourgeoise ne reconnaît du réel que ce qui peut être soumis à ses desseins de planification et d'instrumentalisation, le regard de l'aruspice s'étant arraché aux normes profanes, consent au vertige et à l'éblouissement qui l'établiront dans un monde où chaque signe devient intersigne et comme l'illustration, au sens étymologique, de normes sacrées encore méconnues. La rupture héroïque avec les normes profanes prélude ainsi à une Sapience d'ordre magique et sacerdotal. Tels seront les « véritables communautés », c'est-à-dire les communautés unies sur l'essentiel, non plus régies par l'esprit grégaire, les mythes funestes du sang et du sol, ou les simulacres sociologiques, mais par l'Esprit et la Vision qui commandent les styles et les pensées.
La phrase de Pascal que cite Jünger « Tout auteur a un sens auquel tous les passages s'accordent ou il n'a point de sens du tout », montre assez que la rupture héroïque avec les normes profanes, loin d'introduire au monde « disséminé » ou « déconstruit » cher aux philosophes français des années 60, a pour fonction de rétablir l'Un dans sa souveraineté. Par la description du multiple versicolore des signes, haussés à la dignité métaphysique d'intersignes, Jünger œuvre, à sa façon à l'attestation de l'Unique : « C'est l'effort pour atteindre à travers ce qui est pensé la strate qui fait penser le cerveau, l'effort pour voir les pensées en transparence ». Loin d'être un épiphénomène de la matière, la pensée témoigne d'un au-delà de la réalité humaine qui est sa véritable provenance. Pour Jünger, les pensées ne sont pas des produits mais des moyens. Elles indiquent un passage, un lien, une transmission, non point tant horizontale, par la coutume ou la lignée, que verticale, par alliance avec l'intemporel, avec les « figures » invariables de l'être. " « A quel point les pensées ne sont que des moyens, cela ressort du fait, assurément curieux, que nous avons d'abord besoin de les détruire, de les dissoudre, de les digérer pour les rendre fécondes. Il procédait avec les systèmes comme les enfants avec les feuilles d'automne qu'ils frottent longuement avec une brosse jusqu'à ce qu'il n'en reste que les plus fines nervures ». Dans ses « ultimes nervures », le monde naturel révèle sa réalité pour ainsi dire pythagoricienne dont témoignent aussi les œuvres de Jean Sébastien Bach. Le cœur aventureux n'avance point au hasard; on le croit vagabond, mais il se révèle pèlerin vers l'ordre secret, vers l'autorité cachée que divulguent, à qui sait les déchiffrer, les « ultimes nervures du monde ».
Le métaphysicien est poète car, chasseur subtil, il reste sur le qui vive, au cœur de l'attention fervente; mais le poète est métaphysicien car, pour lui, les mots, ni même les pensées, n'ont de réalité en eux-mêmes: ils sont les clés tangibles d'un monde intangible, d'un silence antérieur dont procèdent, ici-bas, toute grandeur et toute signification. « C'est pourquoi il y a toujours eu des tentatives pour accroître l'impact des philosophèmes en les exposant par des moyens poétiques, et c'est pourquoi aussi on rencontre si souvent des natures tout à fait naïves qui, à la barbe des pédants, ont assimilé avec le plus grand profit leur Jakob Böhme, leur Angélus Silésius ou leur Swedenborg ». Sans doute la supériorité des natures naïves tient-elle en l'occurrence à leur moindre réticence à accueillir en eux la nuit du monde. Si Héliopolis est, comme l'indique son titre, de tonalité solaire, si les figures du rêve qui s'y déploient sont des figures ensoleillées, la première version du Cœur aventureux est, elle, incontestablement de tonalité nocturne. Jünger, dans ses premières approches, comme le relatent également, les Jeux africains, semble répondre à l'injonction de Joseph Conrad d'aller « jusqu'au cœur des ténèbres ».
« La vie, écrit Jünger, est une boucle qui se noue et se dénoue dans l'obscurité. Peut-être la mort sera-t-elle notre plus grande et dangereuse aventure, car ce n'est pas sans raison que l'aventurier est constamment en quête de ses lisières flamboyantes. » Telle est exactement la dimension métaphysique de l'aventure. Il ne s'agit pas seulement d'exalter les sensations, mais encore, à l'apogée de leur intensité, de déchiffrer la figure qui s'y dessine; non de s'abandonner à l'immanence mais de la vaincre »"à cet instant où se déchire le cordon ombilical qui nous reliait au monde de la matière et à ses hasards ». L'attention poétique au monde sensible loin d'incliner à une mystique matérialiste, à quelque idolâtrie de l'immanence et de la nature, porte au contraire vers l'intelligible qui préside, comme en filigrane, à ses métamorphoses. Celui qui chante la diversité révèle la sous-jacente unité. La sensation est une énigme à déchiffrer et son chiffre n'est autre que le « monde vrai », selon la formule néoplatonicienne: « Si dans les contes et la poésie, écrit Novalis, on voit la vraie histoire de la vie, alors, devant la secrète formule, toute erreur s'abolit, devient nulle. »
Le premier mouvement du cœur aventureux est de s'insatisfaire du mouvement du monde qui lui est proposé. Ce monde réduit à l'utile et aux restrictions morales afférentes, le poète-métaphysicien le rejette dès sa première intuition. Le sentiment qui incline à l'aventure s'accorde à l'intuition qui naît de l'étonnement philosophique. A l'étonnement d'être là, environné du beau cosmos miroitant des apparences, l'intuition philosophique répond par de nouvelles et incessantes questions: « Prenons garde au plus grand danger qui soit: celui de laisser la vie nous devenir quotidienne. Quelle que soit la matière à dominer et les moyens dont on dispose - cette chaleur du sang qui permet le contact immédiat ne doit pas risquer de se perdre. L'ennemi qui la possède a plus de prix à nos yeux que l'ami qui l'ignore. La foi, la piété, l'audace, la capacité à l'enthousiasme, à s'attacher avec amour quel qu'en soit l'objet, bref, tout ce que notre époque dénonce comme sottise radicale - partout où nous le rencontrons, nous respirons plus librement, fût-ce dans le cercle le plus restreint. Tout cela est lié à cette très simple expérience que j'appelle l'étonnement, cette ardeur à s'ouvrir au monde et cette immense envie de s'emparer de lui, comme un enfant qui aperçoit une boule de verre. »
Le questionnement philosophique, pour Jünger, n'exige point à proprement parler d'explication. La déception que suscite en lui son cursus universitaire d'études zoologiques eut sans doute pour cause majeure la méconnaissance de la magie qui environne les signes que la nature nous adresse à travers ses œuvres. A quoi bon s'attarder sur la diversité des formes, si celles-ci sont dépouillées de leur sens et du rayonnement secret qui témoigne de leur interdépendance: « Très tôt j'eus l'impression que de vastes domaines de vie restaient fermés à notre temps, qu'il fallait ressentir toutes choses de façon beaucoup plus ardente et que ce n'étaient que nos masques qui s'agitaient avec un tel affairement. Avant même d'aller à l'école, je nourrissais déjà le soupçon que les grandes personnes, d'une certaine façon, jouaient la comédie, que tout ce qu'on nous laissait voir était insignifiant et que l'important et le décisif se traitaient dans des appartements secrets. »
Ainsi, la complaisance dans l'ignorance, l'inclination à se satisfaire d'explications schématiques n'auraient d'autre cause que le manque d'ardeur. Ce que le cœur aventureux rend possible, n'est autre, à travers l'intuition ingénue et enfantine, que la recouvrance de la métaphysique. C'est à la pointe de l'ardeur poétique la plus libre et la plus intransigeante que naît l'intuition métaphysique restauratrice de toute véritable intellectualité qui s'interroge, elle, sur le sens et sur l'origine des phénomènes. Les masques et les apparences, les opinions et les convenances, ne sont jamais le tout. Peut-être même n'ont-ils d'autre rôle que de nous détourner de l'essentiel, de nous dérouter de notre voie, de nous décourager, au sens propre, de notre pèlerinage vers le cœur ardent de l'être ? « C'était, écrit Jünger, la question du Pourquoi ? qui, dans le cas de dispositions différentes, se serait peut-être manifestée sous la forme d'un premier doute relevant de la critique de la connaissance, mais qui, chez moi, fut ressentie comme une menace glaciale et combattue par la foi solide, en un sens, certes, caché mais assurément présent. »
Cette foi solide en un sens caché, mais assurément présent guidera toute l'œuvre de Jünger. L'intuition d'une connaissance, d'une gnosis possible de ce sens par la poésie même, sera à l'origine de sa métaphysique expérimentale. C'est par son arrachement même à l'intelligence moyenne, abstraite, discursive, que l'entendement humain retrouve, en même temps que les abysses de l'irrationnel, la possibilité d'une conquête, toujours périlleuse et menacée il est vrai, des espaces intelligibles et de la supra-rationalité. Où sont alors la folie et la sagesse ? Quel est le véritable amour de la sagesse, la prime et ultime philosophie ? La sagesse paraît folie aux yeux du monde lorsque ce monde méconnaît la multiplicité des états de l'être. « En ces temps où l'utilitarisme dirige la vie, les cœurs des fous sont donc les seuls à y échapper, de même que les fourvoiements des jeunes gens sont le seul signe qu'il subsiste encore un sentiment pour d'autres voies que la voie commune. »
Ce que les ennemis les plus acharnés de Jünger lui reprochent, ce n'est point, comme ils feignent, sa politique, ce qu'ils croient être, en ce domaine controversé, ses « idées », que la liberté d'allure, le détachement, la désinvolture qui accompagnent le mouvement de sa quête la plus ardente et la plus passionnée. Cette mise en incandescence des idées et des mots ne cessera jamais de s'opérer hors de la voie commune. Qu'est-ce qu'une éthique aristocratique ? Elle ne saurait assurément se contenter du simple état de fait des inégalités entérinées par les habitudes et les convenances. Jünger fait sienne la formule de Flaubert « est bourgeois tout ce qui pense bas ». La bassesse comme la hauteur ne sont point les attributs invariables de tel ou tel groupe humain mais des possibilités qui apparaissent comme des modes opératoires. Pour Jünger, comme pour Flaubert, Léon Bloy, Villiers de l'Isle-Adam, Gobineau, l'aristocratie, au sens étymologique de pouvoir de l'excellence, est à la fois une possibilité universelle de l'humanité essentielle et la condition nécessaire de toute métaphysique expérimentale.
Pour expérimenter métaphysiquement le monde, il faut s'être départi des préjugés, de ces facilités intellectuelles et morales qui nous abandonnent aux destinées mesquines. L'art royal de l'herméneutique générale du monde incombe aux fils de Roi. L'aristocratie spirituelle, qui n'est point liée à l'état de fait mais à la recouvrance d'un « possible » magnifique voilé par le mensonge de la vie quotidienne, court-circuite l'opposition banale entre les idéologies de l'égalité et les idéologies de l'inégalité. Le cœur est aventureux dès lors qu'il ne préjuge point de ses limites et de celles d'autrui. Sa vertu est de résister aux idéologies mesquines, soit qu'elles fondent une supériorité abusive sur des propriétés subalternes, soit qu'elles s'appliquent au nivellement par le bas. Le cœur aventureux, quand bien même il doit faire l'épreuve de sa solitude qui est le propre des contemplatifs, ne cesse pour autant d'être à la recherche d'une communauté idéale, c'est-à-dire obéissant non aux déterminismes inférieurs, mais à l'idéa, ce mot grec qui peut se traduire aussi bien par « forme » que par « vision » et dont la légitimité reconnue suffit à établir, selon le mot d'Abellio, « la transparence entre quelques uns ».
La vision stéréoscopique et « la secrète parenté de toute chose »
La grande pauvreté de la critique littéraire de ces dernières décennies, ce qui la rend si décevante, au point que l'on est en droit de soupçonner chez les critiques une sourde hostilité envers les œuvres dont ils glosent, provient sans doute de cette loi, plus ou moins tacite, qui veut à tout prix tenir pour nulle la pensée des auteurs. Que la gnose d'Ernst Jünger fût poétique, et que sa métaphysique s'aventurât dans l'expérience n'ôte rien à sa pertinence philosophique. Aussi bien notre règle est de ne point méconnaître l'intention de l'auteur. L'œuvre de Jünger est philosophique, mais elle retourne, comme le font précisément les œuvres de grands philosophes, à l'origine même de la philosophie. Ernst Jünger n'est point philosophe au sens moderne d'une philosophie ayant abandonnée l'amour de la sagesse au profit d'un positivisme dévoué aux sciences humaines, il est philosophe comme les Européens surent l'être dans l'Antiquité ou au Moyen-Age. Est-ce à dire que Jünger retourne simplement à une gnosis dépassée par la modernité ? Certes non ! Cette exigence philosophique qui l'apparente à la pensée grecque et aux théologiens médiévaux, c'est bien au déchiffrement de son temps qu'il va l'employer.
Ce que les modernes ne peuvent penser (dépourvus qu'ils sont de la nécessaire distance intérieure qui, selon les lois de la dioptrique, précise les perspectives et les contrastes) l'œuvre de Jünger aura pour fonction de le faire apparaître grâce à de nouveaux instruments intellectuels. Alors que par la psychanalyse et la sociologie, ou par le roman d'inspiration naturaliste décrivant des problèmes sentimentaux, des ascensions ou des déchéances sociales, une grande partie de la production littéraire du vingtième siècle se tient encore dans les rets du positivisme du dix-neuvième siècle, la pensée jüngérienne dont la longue mémoire assure l'avenir, invente une attention et pressent une autre logique, non plus exilée du monde dans une abstraction mortelle mais requise par l'attention extrême qui favorise les « approches ». Cette logique ne sera plus binaire, séparant le sujet et l'objet dans un face-à-face désespérant, comme dans l'existentialisme sartrien, elle ne sera pas davantage linéaire ou planifiante, comme le veut la technique moderne dans l'hybris de son arraisonnement du monde, elle sera stéréoscopique. « Je voudrais enchaîner ici sur une réflexion qui concerne l'un des plaisirs les plus rares qui soient, celui qui met en jeu des sensations que je nommerai stéréoscopiques? Le ravissement éveillé par une telle couleur repose sur une perception qui embrasse bien davantage que la pure couleur. Il s'y joignait dans ce cas particulier quelque chose que l'on pourrait appeler la valeur tactile de la couleur... »
La méthode jüngérienne s'ébauche donc à partir d'une observation et de l'observation de cette observation. L'attention devient ainsi attentive à elle-même, non moins qu'à son objet. Le phénomène n'est pas seulement objectif, il est saisi en ce qu'il délivre de possibilités de connaissance. Le sensible devient le point central d'un déploiement intelligible. Toute manifestation sensible peut fleurir et s'ouvrir en une corolle intelligible. Pour comprendre, il faut apprendre à voir. Ce qui enchante le poète devient instrument de connaissance. L'œuvre de Jünger tout entière peut être lue comme une procession liturgique vers ce moment, ou ce site, où l'intelligence poétique devient intelligence métaphysique. Pour Jünger, et nous aurons l'occasion d'y revenir en parlant des influence décisives de Novalis, de Böhme et des « philosophes de la nature », la connaissance métaphysique est décelable au cœur même de la « physis »: « Percevoir stéréoscopiquement, c'est donc découvrir dans un seul et même objet, deux qualités sensibles et cela, chose essentielle, par un organe unique. Il faut pour cela qu'un sens, outre sa propre fonction, puisse assurer aussi celle d'un autre sens ».
Par cette phénoménologie métaphysique de la perception, l'auteur va s'emparer de la perception à l'instant même de sa naissance: magique efflorescence de son essence avant que les rôles respectifs des sens ne fussent répartis. La perception immédiate rejoint la chose-en-soi dans son essence. La couleur parle, le Logos émane à travers elle et, en s'adressant à la vue, éveille, en même temps, les autres sens. Les sens, dans cette perspective, ne sont plus que des points de vue pouvant, le cas échéant, échanger leurs prérogatives: « Le langage authentique, celui des poètes, écrit Jünger, se distingue par des mots et des images ainsi dominés, des mots qui nous font étrangement dresser l'oreille et d'où semble ruisseler une merveilleuse lumière, une musique colorée. C'est ici que parvient à l'expression la secrète harmonie des choses dont Angélus Silésius chante ainsi l'origine:
Les sens sont dans l'esprit un seul sens et usage
Qui voit Dieu le respire, entend, goûte et ressent.
La stéréoscopie sensitive est elle-même l'émanation d'une stéréoscopie spirituelle qui recompose le monde comme un langage. Si la poésie est bien, selon la formule de Hamann, le langage originel de l'humanité, ne serait-ce point car le monde est poème, qu'il obéit à une grammaire, une rhétorique et une sémantique subtiles ? Si la constitution du monde est prosodique, le phénomène stéréoscopique, qui est le propre du poème écrit, devient le principe d'une métaphysique expérimentale: « La rime fait également partie des phénomènes à action stéréoscopiques. Deux mots très différents par leur signification conceptuelle Brot, le pain, et Tod, la mort, sont mis en profonde harmonie par leur sonorité - ils vibrent aux deux extrême d'un même diapason. Ici, la parenté secrète de toute chose est immédiatement accessible au cœur. »
Comprendre le cheminement du cœur aventureux, c'est ainsi prendre avec soi le paradoxe. C'est, en effet, un paradoxe étonnant que d'atteindre par l'aventure, par le refus des normes, par le goût de l'imprévu à la « profonde harmonie » et la « secrète parenté ». Loin de faire succomber la pensée, le paradoxe en accroît le pouvoir, en revêtant la nature paradoxale de la réalité elle-même. Au sens propre, le paradoxe renvoie à ce qui est marge de la doxa, de l'opinion. Or, selon la distinction platonicienne, c'est là le propre de la gnosis Toute connaissance jaillit d'une reconnaissance du paradoxe. C'est en se déprenant des normes profanes dont la fausse évidence établit le mensonge de la vie quotidienne que l'aventure peut atteindre aux normes sacrées et à la vie magnifique qu'elles déploient dans les profondeurs et dans les hauteurs. La double nature de la réalité, à la fois parménidienne et héraclitéenne, ce langage paradoxal qui unit dans une même prosodie, l'être et le devenir, l'Immuable et la rivière enchantée, est inscrite dans la parfaite concordance du langage humain et du monde, - l'un et l'autre étant également des émanations du Logos Les configurations fondamentales du monde et celle du langage se répondent, non de façon artificieuse ou fortuite mais par la même nécessité qui rend indissociable les ailes de l'oiseau et l'air où il s'éploie: « Le fait que l'oreille exige alors l'identité des voyelles et la différence des consonnes, en sorte que la rime repose dans la voyelle et bouge dans les consonnes, se tend, se différencie, c'est un parfait symbole de la façon dont nous aimons qu'un même sens nous atteigne au sein d'une grande plénitude. Car dans la voyelle parle l'authentique magie du mot qui revêt dans les consonnes une enveloppe corporelle. »
Il appartient au cœur aventureux non seulement d'entendre chanter dans les voyelles, mais encore d'en déchiffrer le sens. Le sentiment est alors non plus la manifestation de la subjectivité humaine, mais l'empreinte du sens: « Le bruit de la rue dont les sonorités se fondent toujours plus nettement dans un sombre u lugubre, la plus effrayante de toutes les voyelles, possède quelque chose d'extrêmement menaçant. Comment pourrait-il en aller autrement, puisque l'imminence comminatoire de la mort est incluse dans les signaux et les klaxons des véhicules automobiles. Sur le marché au poisson de Naples que je ne pouvais traverser sans un grand sentiment de gaieté, il me semble que la sonorité dominante était un a chaleureux dont l'effet sur la sensibilité ressemblait à celui que décrit Goethe pour l'écarlate ».
Que le monde moderne eût, dans ses œuvres les plus ordinaires une valeur chromatique ou sonore déplaisante ou angoissante, seuls peuvent ne pas s'en apercevoir ceux-là dont les sens se sont étiolés. Peut-être le propre du monde moderne est-il de nous désapprendre à respirer, voir, entendre, goûter et ressentir. L'appauvrissement du langage accompagne l'appauvrissement des perceptions. Comment saurions-nous dire les nuances et les éclats que nous ne percevons plus ? Lorsque l'aventure prend fin, l'entendement s'obscurcit. La vision stéréoscopique, loin d'être un artifice est une vision de la nature double et une du réel. De même que pour Jünger « il ne peut faire aucun doute que l'on porte en soi non seulement quelqu'un qui se réjouit, mais encore un second personnage qui se réjouit de cette joie », le monde se distingue en deux mondes dont l'un peut-être dit naturel et l'autre surnaturel. L'aventurier sera celui qui ne méconnaît point ce que cette double nature, cette nature paradoxale au sens étymologique, recèle de possibilités prodigieuses, et qui, de surcroît, et c'est là où l'aventurier devient chevalier spirituel, s'efforcera de faire partager cette connaissance. Les folliculaires qui reprochent à Ernst Jünger son dandysme oublient ou feignent d'oublier le signe de générosité qui marque toute l'entreprise et sa morale: « J'ai toujours considéré, écrit Jünger, comme une tâche importante de persuader chaque homme qu'il était lui-même un être merveilleux et le dépositaire responsable de forces merveilleuses. »
« Le soleil invisible de Swedenborg »
Etre et se concevoir soi-même comme « dépositaire responsable de forces merveilleuses », on ne saurait imaginer tournure d'esprit plus étrangère au Moderne dont l'habitude exégétique la plus commune consiste à soumettre ce qui est en haut - la hauteur étant ici le Symbole de la toute-possibilité - à ce qui est en bas, c'est-à-dire aux déterminismes qui parent à toute possibilité d'aventure par une réduction de l'humanitas à des mécanismes qui se veulent explications scientifiques alors qu'elles ne sont que l'expression d'un dédain outrecuidant à l'égard de cette autre humanité que l'on peut dire « traditionnelle », au sens guénonien, et qui se voulut précisément « dépositaire responsable de forces merveilleuses ».
La morale s'avère ici non moins stéréoscopique que ce qu'il est convenu de nommer l'esthétique, en tant que science de « la splendeur du vrai ». Pour être dépositaire responsable de formes merveilleuses, il faut en même temps adopter le point de vue de l'humilité et d'une puissante confiance en soi qui pourrait paraître d'orgueil. L'humilité de n'être que « dépositaire » est la source de l'irrésistible puissance que nous confèrent les « forces merveilleuses ». Le même regard métaphysique qui nous ôte la prétention à imposer au monde notre Moi nous comble de la puissance de la Merveille, et nous tient responsable de ce don. « Dites-nous comment vous disposez du temps qui ne vous a été donné qu'une seule fois ? » L'âme, pour être à la hauteur du don prodigieux, doit être équanime. L'égalité d'âme n'est point la torpeur. Elle ne procède pas d'un amoindrissement des intensités mais de leur exaltation. L'humilité accueille en nous les puissances et notre résolution à les servir préside à notre équanimité.
La grande et belle sérénité se tient dans l'équilibre des forces contraires, et c'est ainsi qu'elle est la seule véritable preuve d'amour que nous pouvons adresser au monde. La gnose d'Ernst Jünger est poétique car il n'est point de connaissance légitime sans amour. Toute science qui n'est point aussi une gnose amoureuse se condamne à tuer l'objet qu'elle étudie. La vie lui échappe, la vie, c'est-à-dire non tant une banale réalité biologique, que les nuances métaphysiques dont elle se diapre sous l'œil du poète-métaphysicien. « En zoologie, écrit Jünger, la tendance innée de la science à tuer la vie pour pouvoir parler du vivant ressort avec une exceptionnelle clarté. Elle ressemble en cela à la psychologie qui est aussi une sorte de profanation des momies, dans la mesure où elle tente de partir du devenir d'autrefois pour en tirer des conclusions sur le devenir futur, et verrouiller ainsi dans l'étau de la logique la merveilleuse, l'évanescente essence du monde. Mais aucun bleu de méthylène, aucun rouge d'éosine ne saurait faire ressortir le noyau le plus tendre et le plus secret de la vie et tout ce qui survient dans l'espace et le temps, dans les causes et dans les effets, dans les instincts et les actions, dans les enveloppes magiques et multicolores de la chair, dans les circuits sanguins et les systèmes nerveux centraux, dans la procréation et dans la mort, dans l'amour, la lutte et le déclin, dans les mille surprises éblouissantes et les sombres menaces l'existence, - tout cela ne reçoit de signification que grâce à l'invisible cordon ombilical qui le relie à un monde de fécondité plus profonde. Celle-ci, dont le souffle anime l'espace, est étrangère aux choses que l'on peut voir et penser. C'est pourquoi, si l'on aspire à aller plus au fond, le moment vient toujours où la soif ne peut plus être apaisée par la science, et où l'on découvre qu'avec des concepts, on en est réduit à palper le masque de la vie. »
Par-delà la science des masques et des apparences, par-delà les schémas que les intelligences paresseuses ou timorées interposent entre le regard et le monde, une autre science est possible, qui rejoint la science des médiévaux. La suprême vertu de cette Sapience est amour. « La science n'est féconde que grâce à l'amour de la science: la connaissance n'est féconde que grâce à l'exigence qui en constitue le fondement. En cela réside la haute, l'exceptionnelle valeur des natures de la trempe de Saint-Augustin et de Pascal. L'union très-rare d'une âme de feu et d'une intelligence pénétrante, l'accès à ce soleil invisible de Swedenborg qui est aussi lumineux qu'ardent. » S'il y eut de tous temps et en tous lieux une religion du Cœur, qui, par-delà les formulations diverses, les exotérismes dominateurs, les soumissions à la lettre morte, s'efforça de veiller comme sur une flamme secrète, sur la pérennité de l'esprit qui vivifie, ce fut aux poètes-métaphysiciens, quand bien même leur souci premier ne fût point doctrinal, qu'au vingtième siècle, échut la tâche de perpétuer la mémoire par des actes fondateurs. L'aventure à laquelle le poète humblement se soumet, il appartient au métaphysicien de se remémorer qu'elle témoigne du Cœur, du centre invisible, du moyeu immobile de la roue: « C'est seulement si le cœur commande à l'armée des pensées que les faits et les constatations acquièrent leur valeur; ils renvoient sans déperdition, l'écho sauvage, le souffle chaud de la vie, car toute réponse est déjà contenue dans la manière du questionner. »
Qu'est-ce qu'une question pertinente ? N'assistons-nous point, dans les temps modernes à une érosion de la curiosité humaine ? Nos semblables dédaignant le « pourquoi » aux profondes résonances métaphysiques, ne s'interrogent plus que sur le comment, et même ce « comment », ils n'en usent plus que de façon utilitaire, voire policière. Les questions essentielles de la provenance ou de la destination, de l'origine et des fins dernières semblent s'être évanouies de l'intelligence humaine. L'esprit critique tant vanté se réduit désormais à une collection d'opinions à prétention démystificatrices dont nul, hormis quelques mal-pensants, ne s'avise d'interroger la généalogie. Si l'œuvre de Jünger ne peut être dite « nietzschéenne » au sens banal du terme, - qui recouvre toutes sortes de facilités et de déraisons, - l'influence de la méthode généalogique de Nietzsche n'en paraît pas moins déterminante. De même que Nietzsche s'interroge sur la généalogie de la morale, et d'une façon plus générale sur les idées, les concepts, les convictions qui paraissent aller de soi, Jünger va saisir, par la vision stéréoscopique, le phénomène dans sa double réalité temporelle et intemporelle. La question est alors une mise-en-demeure du questionneur lui-même. Le point de haute pertinence métaphysique est atteint lorsque l'observateur en vient à répondre à la question que lui pose le phénomène. C'est alors que la réponse lui parvient « sans déperdition ». Quelle peut bien être l'interrogation de celui qui ne voit rien, ne goûte rien, n'entend rien et ne ressent rien ? L'abandon de toute perspective métaphysique, y compris chez ceux qui se targuent encore d'une fidélité religieuse, tient pour l'essentiel à cet assombrissement de l'entendement. Qu'interroger, et par quoi être interrogé si d'emblée nous préjugeons le monde sans mystère ?
Seules importent les questions qui, soumises à l'autorité légitime du Cœur, vont vers le cœur des êtres et des choses dans la reconnaissance de leur simple dignité. La mentalité moderne est hostile au secret, à l'autorité, à la splendeur. Pour pouvoir utiliser librement les êtres et les choses, il faut aussi se donner le droit de nier leur royauté intérieure. La simple dignité des êtres et des choses est bafouée dans l'exacte mesure où l'on se confère le droit d'en user et d'en abuser, et la nature même de l'abus n'est point changée par le fait d'être exercée au nom de « l'intérêt général » ou du « bonheur futur ». Toute l'œuvre de Jünger sera une rébellion active contre ce finalisme profane qui ne s'accomplit que dans la négation de toute souveraineté. « Ta répugnance envers les querelles de nos pères et de nos grands-pères, et envers toutes les manières possibles de leur trouver une solution, trahit déjà que tu n'as pas besoin de réponses mais d'un questionnement plus aigu, non de drapeaux, mais de guerriers, non d'ordre mais de révolte, non de systèmes mais d'hommes ». Jünger reproche aux drapeaux, aux systèmes et aux réponses toutes faites d'émousser le questionnement.
Le double aspect, déroutant pour les esprits schématiques, à la fois traditionnel et libertaire d'Ernst Jünger tient à la pointe aiguë d'une interrogation qui veut aller au-delà des représentations « trop humaines » propres aux mentalités individualistes et grégaires, nul n'étant plus grégaire que l'individualiste moderne. Le Cœur est au-delà du sentiment et de l'intelligence abstraite car la réponse magique dont il se fait l'écho porte avec elle le ressac d'une réalité qui excède de toutes parts notre humanité, comme elle excède la nature et la vie elle-même sous leurs aspects génériques ou biologiques. « Il existe une grande différence entre l'anarchie de l'intelligence et celle du cœur. L'intelligence devient stérile dans la mesure même où elle détruit, car elle se prive des contenus qui assureraient du poids à son activité. Environnée de valeurs en ruines, elle perd sa validité: il ne reste plus rien que le triomphe sinistre des mesures vides de sens, rien que la mortelle domination des chiffres. Pour le coeur, en revanche, la vieille maxime selon laquelle les ruines ne saurait ensevelir une âme intrépide garde toute sa valeur. En lui aussi, l'instinct de destruction est inné, mais même s'il se détache de tout ce qui l'entoure et brûle les valeurs au feu de sa propre forge, il subsiste toujours en lui cet invisible et insaisissable point de croissance d'où la reconstruction peut repartir de manière nouvelle et merveilleuse. »
« Une image voilée et dissimulée par le temps »
Le cœur, le courage, la « vox cordis » sont cette unique instance à laquelle consentent de répondre ces esprits à la fois fidèles aux principes et à la liberté que Jünger, dans Eumeswil nommera les « Anarques ». En eux s'accordent le sens de l'équité et celui de la toute-possibilité, le refus des normes profanes, des exotérismes dominateurs et l'affirmation de la gradation des mondes. « Considère ta vie comme un rêve entre mille rêves, et chaque rêve comme une aventure particulière de la réalité ». Telle sera la Sapience des « fils de Roi » dont parlait Gobineau, de ces « rares heureux » auxquels s'adressait Stendhal. Cette Sapience sera héroïque et sacerdotale: « Ainsi se constitue autour de Saint-Antoine, au milieu d'un désert chaotique, un monde puissant, cerné par le ciel et l'enfer, plus riche, plus sauvage et plus mystérieux que toute espèce de monde réel. L'âme croyante était bien consciente de cet inexprimable différence de rang ».
Ainsi, le cœur aventureux qui témoignera de cette inexprimable différence de rang, loin de rechercher la distraction, l'évasion, sera au contraire en quête de nouvelles responsabilités. Entre le ciel et l'enfer se précisent les puissances et les échos. Par la science des correspondances, un ordre s'affirme. Le cœur aventureux résonne d'un répons qui se confond avec son propre battement. Etre à l'écoute du répons, entrer dans l'aire sacrée des correspondances, c'est acquérir un plus haut rang par l'intercession d'une responsabilité nouvelle. En tous temps et en tous lieux la « religion du cœur » en laquelle se rencontrent toutes les chevaleries spirituelles fut toujours une tentative éperdue d'élargir au-delà même de l'humain, le champ des responsabilités. « L'homme qui attribue de la valeur à ses expériences quelles qu'elles soient, en tant que parties de lui-même, ne veut pas les abandonner au royaume de l'obscurité, élargit le cercle de sa responsabilité. Or, rétrécir ce cercle, c'est précisément l'ambition de l'humanitarisme moderne ».
Si la vie n'est point la valeur suprême, s'il existe entre le vivants et les morts un commerce décisif, la modernité qui parie sur l'obsolescence et l'oubli est récusée. La vie n'est point le tout, ni ce que la mentalité moderne et profane nomme la « réalité », qui ne sera jamais, pour le cœur aventureux qu'une hypothèse restrictive, une preuve flagrante de la mesquinerie morale de ceux qui s'y complaisent et l'absolutisent. Toute réalité se réduit à l'insignifiance dès lors qu'elle refuse de se mesurer au rêve et à l'ivresse. Se rendre sourd au répons du rêve et de l'ivresse, s'enfermer dans l'illusoire sécurité moderne, négatrice des hauteurs et des profondeurs du Ciel et de l'Enfer, c'est non seulement se condamner à une vie médiocre, c'est aussi tarir les sources du Logos et réduire toute culture et toute civilisation à des simulacres. Lorsque les splendeurs du rêve et de l'ivresse n'atteignent plus l'entendement humain, l'appauvrissement du langage, précédé par l'inaptitude foncière du rationaliste à déchiffrer les énigmes, n'est plus que le signe extérieur de la misère de l'imagination. La flamme du Sens danse par excellence dans l'air de l'ivresse et du rêve. La science dont elle nous détourne révèle sa plus profonde raison d'être, son foyer qui arde et prophétise. Jünger s'attarde à « cette sorte de contemplation qui superpose la région du rêve et celle de la réalité comme deux lentilles transparentes braquées sur le foyer spirituel ».
Quelques critiques ont cru voir entre le Jünger guerrier, auteur des Orages d'acier, du Lieutenant Sturm, de Boqueteau 125 et le Jünger « anarque », contemplateur solitaire des jardins et des routes une sorte de rupture existentielle. Il y aurait un premier Jünger antihumaniste inquiétant et un second Jünger, esthète et rêveur. Or, si une lecture attentive de la première version du Cœur aventureux semble établir au contraire la coexistence des « deux lentilles transparentes » braquées sur le même foyer spirituel, si d'emblée les vertus du regard stéréoscopique, de la plongée méditative dans les royaume du Songe sont évoquées et pratiquées, les œuvres ultérieures témoigneront, elles aussi, de la persistance de la mentalité héroïque, appliquée aux chasses subtiles, au combat de la conscience avec les épreuves de l'ivresse, et, par-dessus tout, de la défense résolue, et chevaleresque, des principes et des styles qui sont l'héritage commun des écrivains européens. La guerre, dont Jünger soulignera qu'elle n'eût dans sa vie et dans son œuvre qu'une part secondaire à la comparer à l'art de lire et de contempler, fut une métaphysique expérimentale, de même que la gnose poétique qu'il développa par la suite fut animée d'un incontestable esprit guerrier. S'il y eut passage et changement, sans doute est-ce moins dans les principes que dans le mode d'application. Au combat frontal, déterminé par l'histoire, succéda le combat solitaire, le cheminement du chevalier errant. Le triomphe des totalitarismes, où Jünger ne vit jamais rien d'autre que le triomphe arrogant de la médiocrité, l'éloigna du militantisme, il ne l'éloigna point de l'éthique héroïque dont le propre est une fidélité attentive à la beauté du geste qui naît de la pensée pour y retentir.
Si l'œuvre de Jünger est bien celle d'un humaniste, au sens de l'héritage spirituel de l'humanitas telle que put la concevoir un Cicéron, elle n'en constitue pas moins une critique de l'humanisme moderne qui outrecuide au détriment du cosmos et des dieux. Le Moi insolite ou collectif qui impose à l'entendement des limites mesquines, sans doute est-ce bien abusivement que les modernes l'associent à l'idée antique de l'humanitas, mesure de toute chose. Cette mesure suppose que le point dont elle définit la situation n'est point le tout et qu'autre chose,- le monde, les dieux, le Ciel et les enfers,- est mesuré par elle. L'humanisme moderne, au contraire, veut croire que la seule chose qui méritât d'être mesurée, c'est le Moi. Or ce Moi, qui n'est sans doute pas plus haïssable qu'adorable, ne vaut que par contraste. Notre fugacité nous donne à comprendre l'éternité, notre condition, le « sans-condition », nos limites nous donnent une idée de l'illimité. Ce qui passe est la clef de ce qui demeure. L'attention au devenir nous établit dans l'être, l'obscurité révèle l'essence de la lumière: « L'homme ne doit pas faire trop cas de lui-même, étant semblable, comme dit le psaume, à l'herbe qui ne tarde pas à se faner, et qu'on coupe le soir. Il ne doit pas non plus faire trop de cas de lui-même étant semblable, non moins que cette herbe, avec ses lys et ses corolles étoilées, à un principe tout autre, une image voilée et dissimulée par le temps, l'espace, et ce qu'elle a de passager. »
Luc-Olivier d'Algange
Extrait de Le Déchiffrement du monde, La gnose poétique d'Ernst Jünger, éditions de L'Harmattan, collection Théôria. 170 pages. 18 euros
![Déchiffrement du monde (Le): La gnose poétique d'Ernst Jünger (Théôria) par [Luc-Olivier D'Algange]](https://m.media-amazon.com/images/I/41SrN8bc3VL.jpg)
20:25 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
Luc-Olivier d'Algange, La gratitude:

14:29 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
01/02/2023
Un article d'Olivier François, paru dans le magazine "Eléments", n° 200, février 2023, à propos de "Terre Lucide" de Luc-Olivier d'Algange et Philippe Barthelet, éditions de L'Harmattan:
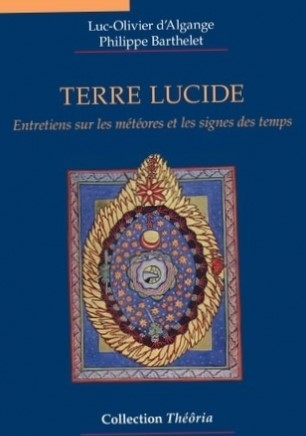
Luc-Olivier d'Algange et Philippe Barthelet
Deux hommes en quête de l'âme du monde
Par Olivier François
Les dialogues de Philippe Barthelet avec Luc-Olivier d'Algange, réunis dans Terre lucide, ne sont pas des colloques d'intellectuels, Ils nous offrent cette chose presque unique aujourd'hui, un art de vivre, et quelques indices et pistes pour retrouver des chemins trop longtemps abandonnés ou simplement oubliés.
Notre époque est assourdissante. La musique du monde et ses rythmes sont recouverts par la mitraille incessante des fausses paroles et des slogans. Les voix essentielles ne trouvent aujourd'hui qu'un très faible écho, brouillé par le bavardage des sectes intellectuelles, les novlangues idéologiques et le vacarme des industries culturelles. Et nous avons parfois le sentiment accablant que tout est tout est vain, que tout est joué, et que c'est à la fin la "panmuflerie sans limites" ( Charles Péguy) qui l'emportera dans le tintamarre et le brouhaha.
C'est dire que j'ai lu avec bonheur et soulagement Terre lucide, une conversation en onze entretiens entre Luc-Olivier d'Algange et Philippe Barthelet que publie aux éditions de L'Harmattan et dans son excellente collection Théôria notre ami Pierre-Marie Sigaud. Je me suis en effet promené dans ce livre comme dans un vaste jardin isolé en bord de mer. Une brise rafraîchissante y souffle, qui nous tient en éveil, et l'on y cueille des fleurs des fruits rares ou trop négligés. D'Algange et Barthelet sont aimables, courtois et érudits, d'une amabilité et d'une courtoisie qui m'ont semblé presque médiévales, et d'une érudition qui vient toujours à point nommé, dont ils n'usent jamais pour flatter ou épater leurs lecteurs. Les deux auteurs de ces denses et libres propos sur la littérature, la politique, la poésie, l'histoire, les rois, les peuples, les dieux, Dieu et le monde, feront fuir les "ennuyés, les grincheux, les puritains, les commères, les censeurs, les faiseurs de système et les accusateurs" et toutes les légions d'assommeurs et d'abrutisseurs. Les autres, en arpentant cette Terre lucide et en écoutant attentivement les deux amis, trouveront de quoi se ragaillardir et se remettre en selle.
Philippe Barthelet et Luc-Olivier d'Algange sont-ils des antimodernes, m'a demandé un amateur de définitions qui a lu le manuel d'Antoine Compagnon. Ils sont assurément les sujets de cette France souterraine dont parle Nicolas Berdiaev dans son autobiographie spirituelle, de ce pays secret qui compte parmi ses paladins Joseph de Maistre, Charles Baudelaire, Barbey d'Aurevilly, Villiers de l'Isle-Adam et Léon Bloy. Et ce n'est pas pour eux une posture littéraire. Barthelet et d'Algange mènent le combat pour ce royaume contre les idoles et les impostures de l'immonde moderne, contre ses cliques, ses nations et ses sociétés anonymes. On trouve dans les pages de ces entretiens sur les météores et les signes des temps des charges et des assauts. Les misères et les ridicules du temps y sont bien nommés, et les agents du néant et du désastres, et les plus tristes et les plus dangereux, y sont justement fustigés. Luc-Olivier d'Algange écrit par exemple ces phrases: " Les hommes de ce temps sont abaissés, humiliés, ratiboisés selon une méthode procustéenne si efficace qu'elle donne à leurs revendications hédonistes, profiteuses ou festives, un ridicule frôlant sans cesse le pathétique. La société est-elle en proie aux individus ? Mais quelle société ? Quels individus ? Je vois, plutôt qu'un éclatement, une concentration de laideur, un monde concentrationnaire, comme une parodie théocratique de laquelle on ne peu s'échapper que par une sorte de ruse animale" Voilà qui touche au coeur, n'est-ce pas ?
Mais les beautés de Terre lucide ne sont pas seulement des beautés d'offensive et de contestation. J'ai dit plus haut qu'on pouvait y cueillir des fruits rares ou trop négligés. Parmi ceux-là, et c'est au fond l'essentiel, la seule chose nécessaire, j'y ai découvert une invitation à renouer avec les oeuvres, les paysages et les Muses. Ces oeuvres, ces paysages et ces Muses sont aujourd'hui aussi bien ensevelis sous des tonnes de béton que sous des montagnes de gloses et de commentaires. Ils attendent leur libération. Il suffirait sans doute que nous nous prêtions à nouveau à leurs jeux et à leurs entretiens.
Luc-Olivier d'Algange et Philippe Barthelet, Terre lucide, Entretiens sur les météores et les signes des temps. L'Harmattan, 302 p., 30 euros.
18:17 | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
31/01/2023
Luc-Olivier d'Algange, " Nous qui avons franchi le Léthé", notes sur Ezra Pound:
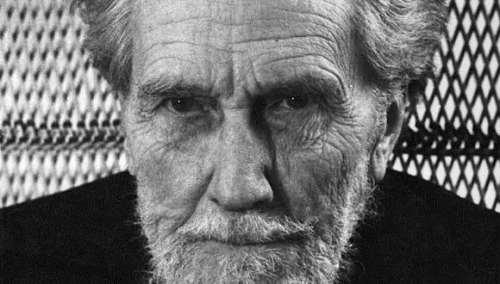
« Nous qui avons franchi le Léthé »
Notes sur Ezra Pound
Les contempteurs d'Ezra Pound, qui tentent, avec une mauvaise foi plus ou moins notoire, de réduire son oeuvre à l'idéologie, non moins que certains épigones qui la réduisent à un « travail d'intertextualité », exclusivement justiciable d'une sorte de critique littéraire para-universitaire, passent, mais c'est leur rôle, à côté de la réalité magnifique des Cantos en tant qu'aruspices. Ces mots sur la page, disposés en vol d'oiseaux, exigent un envol de la pensée, un envol, c'est à dire une conversion herméneutique qui, par-delà les écueils de l'analyse, nous portera jusqu'aux espaces ardents du déchiffrement.
Les Cantos sont, dans l'histoire de la poésie mondiale, un événement unique. Rien n'y ressemble de près ou de loin. Tout au plus pouvons-nous laisser se réverbérer en nous, à son propos, les ors fluants de la prosodie virgilienne, un art odysséen de la navigation, et le dessein récapitulatif et prophétique de La Divine Comédie. L'œuvre ne choisit pas entre l'amplitude et l'intensité, entre l'horizontalité et la verticalité. La vastitude des Cantos loge des formes brèves, des aphorismes qui s'ouvrent allusivement sur d'autres vastitudes. Pound est, avec Saint-John Perse, l'un des très-rares poètes modernes à ne point dédaigner ni le réel, ni le mythe. Les hommes dans le poème de Pound tracent les figures de leurs destinées entre les choses et les dieux. De surprenantes collisions s'opèrent, les temporalités se rencontrent et se traversent selon leurs propriétés et selon leurs signes.
Cette apparente confusion est le véritable « ordre » de la pensée. Il importe, en effet, de laisser au devenir, à l'histoire, leurs puissances et leur plasticité, et aux figures éternelles, leur éternité. Entre le mercure historial et le souffre de la flambée prophétique, le poète cristallise le sel de la sapide science. Le savoir est saveur. Le Gai Savoir d’Ezra Pound, relié aux arts poétiques romans, allège le monde. Ce monde si lourd, ce savoir si pesant, ce plomb des choses mortes et insues, la prosodie d’Ezra Pound les relance, les laisse voltiger dans les hauteurs et il nous livre, nous lecteurs, à ces prodigieux mouvements météorologiques ! Les Cantos frappent d'inconsistance une grande part de la poésie moderne, subjective, minimaliste ou sentimentale qui s'efforça d'abaisser le langage humain dans ses ressources, de rompre le pacte métaphysique unissant l'Aède à la Mesure et la pensée humaine à la diversité du monde.
Une erreur banale consiste à prendre les Cantos comme un chaos de formes, de citations, d'interférences, une machinerie sauvage d'hyperliens, pour user du jargon informatique, une rébellion polysémique contre l'ordre, la mémoire et le sens. C'est oublier qu'Ezra Pound, en bon confucéen, se voulut d'abord défenseur de la tradition, c'est à dire de la transmission du sens, de la déférence et des préséances, servant et créateur d'une Mesure sensible et métaphysique aux antipodes de l'outrecuidance de la pensée « anarchiste ».
Rien, dans cette oeuvre souverainement libre, ne se réduit à ce qui est devenu, hélas, un dérisoire mot d'ordre bourgeois: « Ni Dieu, ni Maître ». Le paradoxe n'en brille que d'un plus vif éclat. Les Cantos sont le récit de l'histoire du monde, disposés dans le ciel de la mémoire humaine, en ressouvenir du ciel de l'immémoire surhumaine, et offerts à notre déchiffrement. Nulle obscurité mais d'impérieuses lucidités. Nous ne sommes plus dans le stupide dix-neuvième siècle des téléologies évolutionnistes, ni dans l'abominable modernité fondamentaliste du vingtième siècle, mais dans une autre logique, traditionnelle et prospective, qui sera peut-être l'inventrice de l'Europe du prochain millénaire, si toutefois elle survit au ravage.
L'énigmatique « Il faut être résolument moderne » de Rimbaud trouve dans l’œuvre d’Ezra Pound à la fois son explication et son application. Etre moderne, pour Rimbaud c'est trouver la juste Mesure avant même que l'accord ne résonnât dans le monde. En ce sens, être moderne, c'est être, à l'évidence contre ce composé de toutes les paresses « progressistes » qui est le propre du « monde moderne ». Etre moderne au sens rimbaldien, c'est précisément inventer, comme le fait Ezra Pound, la prosodie de l'avenir, c'est être aruspice, c'est déchiffrer dans l'intemporel les lignes annonciatrices du plus grand avenir par fidélité à la mémoire et à la tradition. « Tout ce qui n'est pas Tradition est plagiat » écrivait Eugenio d'Ors, en échos avec Nietzsche: « L'homme de l'avenir est celui aura la mémoire la plus longue ». La remémoration des configurations décisives de notre passé n'est point nostalgique, elle est le dispositif nécessaire de toute reconquête.
Pound exige beaucoup de son lecteur, c'est sa façon de l'honorer, de le considérer comme son égal. Il est impossible de lire les Cantos sans parcourir les espaces, les savoirs, les songes qu'Ezra Pound lui-même parcourut pour les écrire. Les Cantos sont, à cet égard, une prodigieuse mise en demeure. Ils nous somment de vaincre notre paresse et notre ignorance. Ces chants sont des passerelles entre des mondes qu'il nous faut élever hors de l'oubli par l'attention et la remémoration. Le confucianisme de Pound est ainsi une méditation sur la Mesure qui unit le Ciel et la Terre, les configurations célestes, que traversent les formations ailées des vocables et les événements de l'histoire du monde.
Cette oeuvre d'un cosmopolitisme supérieur (et il faudrait un jour définir en quoi le cosmopolitisme impérial des « grands européens », pour reprendre la formule de Nietzsche, diffère fondamentalement du mondialisme uniformisateur) n'est point sans évoquer les langues de feu de ces véritables apôtres que sont les poètes qui consentent aux périls et aux gloires de l'aventure poétique. Alors que la démocratie universaliste enferme, de fait, les hommes dans des communautarismes a-historiques, le cosmopolitisme d’Ezra Pound, dans sa perspective impériale et confucéenne, œuvre à la recouvrance des possibilités abandonnées de l'aventure poétique, virgilienne et orphique, qui discerne, au-delà des langues, la vérité épiphanique de la vox cordis et de cette expérience métaphysique fondamentale qui préside à la fois au chant des poètes et à la naissance des civilisations. Des civilisations naissent et meurent, et le poète s'y intéresse en premier lieu car ces civilisations naissent et meurent dans le chant des poètes. Les poètes n'accompagnent pas la naissance des civilisations, ils la précèdent. Il faut, disait Rimbaud, « tenir le pas gagné ».
« La poésie ne rythmera plus l'action, elle sera en avant ». A dire vrai, en avant, elle le fut de tous temps. Le « toujours » du poème devance l'histoire dans laquelle elle s'inscrit et qu'elle déchiffre, comme son reflet éblouissant. Le poète cherche sa Mesure; la civilisation est une Mesure trouvée. Toutes les questions de philosophie politique ou de métaphysique trouvent leur répons dans une prosodie. Il importe seulement de ne pas confondre cette Mesure avec une demi-mesure, ou avec un compromis, autrement dit une commune-mesure. La Mesure métaphysique ne prend son sens et son efficience que par le point surplombant qui la définit.
Le songe dont naissent les civilisations, et qui chante antérieurement dans toutes les langues dans l'entendement est d'une simplicité surhumaine. Par la récapitulation enchantée de l'histoire humaine (on ne saurait méconnaître que nous sommes désormais, pour le pire et le meilleur, héritiers de l'histoire du monde) les Cantos d'Ezra Pound nous convient à rien moins qu'au dépassement de nous-mêmes et à la conquête d'une surhumanité rayonnante dans la parousie de tous les chants destinés à traverser la mort, comme des âmes infiniment fragiles et glorieuses sur la barque léthéenne. C'est au moment où tout s'efface que la poésie castalienne nous fait le signe qui nous dit que tout recommence. Le poème est écrit en diverses langues, non par goût de la confusion des genres, ou du métissage, mais pour l'excellente raison que, dans l'ordre de la poésie, tout ce qui est dit est traduit d'un silence antérieur:
« Luit
Dans l'esprit du ciel
Dieu qui l'a crée
plus que
soleil en notre oeil. »
02:27 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
29/01/2023
Luc-Olivier d'Algange, "Ode au Cinquième Empire", en hommage à Fernando Pessoa, Dominique de Roux et André Coyné:
EN HOMMAGE A DOMINIQUE DE ROUX

Ode au Cinquième Empire
« Le Mythe est le rien qui est le tout »
Fernando PESSOA
Ombres claires, jardins d'or, de quel désert bleu, tendu
Entre ces êtres et ces apparences ma mémoire en ces temps frissonnait !
C'était un battement des ailes de la victoire, un chant d'astres immobiles
Dans la profonde ténèbre de l'azur: comment ne point croire
A ces bras d'Océanides, ces pointes d'écume et de rocs
Et leurs traits de fierté sur les chemins des fantômes !
Tout reviendra, je le sais, dans ce Lointain, dans cette blancheur.
Armures du deuil, prunelles étoilées, sagesses perdues aux confins
De la mer dont les cieux tordent les couleurs comme des vaisseaux.
Nous sentions sur notre joue l'éther grandiose, son libre essor
Vers les oliviers pâles du rivage, son reflet de ciel, ses larmes étouffées
Et son sourire d'où renaissent les consolations au bord des cils
Comme une brume d'exil. J'en porte le témoignage pour ceux-là mêmes
Qui ne veulent rien entendre, pour cet ouragan immobile du matin, du plus
Haut bonheur, si tant est que l'on puisse encore dire en ce monde.
J'en porte témoignage sous le manteau de la nuit si claire à qui sait voir,
Sous le manteau de l'oubli de la Mer, sous le manteau du souffle éperdu
Où marche le souvenir de douceur et de feu des rois dont l'âme verdoie !
Est-ce fuir que de céder à ces beautés pensives ? Est-ce trahir que d'entendre
Les abeilles d'Orphée tournoyer dans l'admiration de l'ébauche du monde ?
Tel était notre bonheur que chaque seconde nous fut une cosmogonie.
Point de sommeil mais une secrète fureur de joie
Composant des siècles de pourpre avec les agrafes d'or de l'instant...
Tes lèvres douces revivaient une fable vermeille, un songe immobile
Sur l'abîme, sur la coupe visible de l'aurore
Encore endormie dans l'aile magnanime du dieu !
Que l'âpre beauté nous soulève, qu'elle nous dise
Nous serons ces cœurs brûlants jusqu'aux huées, nous serons
Les traces de son langage disparu et, s'il le faut, son haïssable mélancolie !
Forces célestes, fournaises bleues, triomphe pour la gloire
D'une innocence infaillible lorsque de toutes parts se hâtent
Les souffles étésiens, que scintillent dans les verres les vins
Parfumés de résine dans la grande trêve apollinienne de l'Empire !
Nous n'étions point étrangers à ces frontons, à cette emprise
De la Connaissance pure où s'éternisent à la fois
Les Hauteurs sans visage et les racines des oliviers !
Nous vaincrons le courroux de ces escaliers sablonneux
Et d'une pensée pure nous fleurirons d'une blancheur immobile
Comme l'instant de cette tempête adorée... Libations aux confins du monde,
Ivresses légères qui éveillent la douceur des pêches mures
Et la splendeur septentrionale des ombres du Soir,
De l'autre côté de la naissance des mondes...
De l'autre côté du temps, de l'autre côté du vent, quelque Songe
Elargit nos pupilles au ressouvenir de ces Lois excellentes...
Sites de la lumière chantante: des noms divins naissent des bronzes de la voix.
Les hymnes enseignent à la musique son propre secret
Qu'elle ne divulgue point, sinon dans la procession des regards
Qui passent, équanimes, sur les rives, entre les pins et les genévriers
Qui passent en s'attardant à peine vers l'éternité et les Mystères !
Que le dieu lumineux tende les voiles, qu'il avive le chatoiement
Des vêtements sacrés et ne nous détourne point de la face invisible de la Mer !
Nous serons fidèles entre les fidèles, dans le secret et dans l'évidence du Temps.
Fidèles en quelque lieu et en quelque temps que nous nous trouvions,
Fidèles dans la vérité de la brise qui porte le Chant et fidèles
Au sillage qui porte le Don de la mort vaincue, fidèles à Ce moment-là,
Fidèles dans le silence et dans le vacarme des dieux, fidèles
Aux pailles qu'allège la Terre et que Ciel embrase d'une image immense,
Fidèles aux ruisseaux pierreux, aux ruches cuivrées et aux expériences
Du silence et du jour éternel. Fidèles à la voix limpide qui scintille
De batailles subtiles. Voici les réverbérations messagères ! Voici le chemin précis
Dans l'immensité, voici les traces, voici les empreintes du dieu
Dont le sceau rivalise avec la douce coupole du Printemps
Pour nous faire comprendre la limite et l'illimité
Et la sagesse de l'Empire que l'on devine devant une fenêtre claire
Dans le pressentiment des cieux profonds et des mers chaudes
Que voilent à notre souvenir les siècles de vanités et de mensonges !
Quel regard de Pallas, à la pointe de l'instant où l'éternité se divise !
Que de brûlures et de fraîcheurs, dans nos veines et sur notre peau !
Les vignes et le miel, l'eau et le vent polissent notre aveugle matière.
La lumière innombrable couronne le murmure des sources, les buissons
Embaument le Grand-Oeuvre du Cosmos. Le passé, le présent et l'avenir
Se détaillent sur les feuilles et dans le vol des aigles.
Comment croire encore en la Séparation
Devant cette volupté puissante dont l'image nouvelle
Vient d'éclore dans l'air où tremble encore un parfum d'eau de pluie !
Voici la voix humaine et voici le silence, voici la bonté de la terre
Et voici les vases d'argile, comme une volonté surhumaine précédant,
Les plaines qui vont chuchotantes vers le soir. Voici l'Orbe du Temps !
Et qu'est-ce que le Temps, qu'il nous accable ou resplendisse,
Peu importe ce n'est pas lui qui passe, mais nous seuls, déjà flammes
Dans le bannissement de l'imminence, dans le secret de l'étoile au front
Dans les Formes de l'univers, les Symboles augustes que les quadriges de nos sens
Ouvrent à la connaissance des antiques tablettes d'Erato perdues
Sous le rugissement des flots ! Perdues et retrouvées comme un amour humain
Dans ses recueillements de rires, de beautés, d'acanthes prophétiques...
Qu'est-ce que le Temps, qu'il nous accable ou resplendisse
Que nous ne puissions étreindre contre notre cœur
Comme le parfum du Soir, comme une prière délaissée,
Comme une épaule nue dans une roseraie, un front empourpré ?
Qu'est-ce que le Temps s'il ne se courbe sous notre regard
Comme un horizon prosterné ? Il existe des secrets. Le Temps,
Ce promontoire, cette lance dans l'air vibrant ou comment le dire,
Peut-être ce sable chaud où nous nous endormons côte à côte,
Le Temps n'est rien, qu'il nous accable ou resplendisse, le Temps
N'est qu'un silence universel ! Notre grandeur sera d'avoir courbé aux Lois
De la douceur d'être tout ce néant tumultueux ! Notre grandeur, notre sagesse !
Grandes voiles tendues jusqu'au gémissement céleste ! Métaphores vivantes
Des peuples et des heures, nous reviendrons aussi vers la grandeur
Avec nos carènes solides, nous reviendrons jusqu'aux temples en ruines
Porter la crinière de l'air marin et des ressouvenances de labeur et d'adoration !
Nous reviendrons lavés et forts, chaque aspect de notre entendement
D'une clarté presque aveuglante annonçant que la victoire humaine est illusoire.
Nous reviendrons avec nos dieux enroulés autour des mâts, nos dieux peuplant
La grande voile, nos dieux forts comme des cordages.
Quel beau règne pour cette Terre que le règne de notre retour !
Tout recommence car le Temps n'est rien et que la brûlure de la fidélité
Plus profonde que le cri orne de son signe sacré, de son passage ailé
Le ciel fécond d'enseignements à qui sait lire... Tout recommence, Chœur
Infini, premier voile de l'Apparue disant "je te trouve enfin".
Et nous avions tant attendu Ce moment-là, avec une telle ferveur
Et une telle patience qu'une brume de chaleur montait vers nous,
Que les eaux tremblaient à nouveau,
Après tant de batailles, de fatigues, cette salutation enfin
Changeait un cœur, et l'étincelante obscurité se renversait
Comme une corbeille de fleurs sur l'orgueil aérien de la conquête.
Tout recommence, Chœur infini, car le Temps, qu'il accable ou resplendisse
Ne passe point. La Terre élève ses senteurs pour notre triomphe venu de la mer.
L'Ode enclot un prodige d'ordre étincelant. Point d'outrage à cet horizon
Que la proue de mon Chant et point d'oraison d'une plus haute innocence .
Une soif ardente fond dans le sommeil comme un oiseau de proie !
Dans quelle apparence cette lumière descendante me charme !
Ne rien dire à la voile de ce péril et vivre ! Tout entière à cet autel
Où meurt et renaît l'accord innombrable du Temps, ta bouche parfumée
Enonce le prodige. La voie, les degrés, le marbre, ô fille des astres,
Seront ces stations d'immortalité, où le dieu allège de toute sa force
Nos pas l'un après l'autre sculptés, nos pas l'un après l'autre perdus
Dans le marbre que travaille l'abîme ! Légère cette force vers le haut !
Légère et toute figurée d'être et de puissance. L'Empire compose d'immortalités
Ces générations innombrables de pas sur les marches du Temple.
Quelle abondance d'oubli comme une pulpe enracine notre savoir
Dans la profonde saveur d'une pureté qui allonge les ombres
Et que nous suivons pas à pas ! S'approche ainsi le Toit de l'intercesseur.
Le Soleil, l'Air, Dieu s'accordent à l'ombre que j'endure
A l'ouvrage des vigne et des puits, aux mille figures
De notre consolation nouvelle, à la volupté inconnue.
Ce ressouvenir fut l'onde parnassienne suspendue sur l'augure
Dont la beauté semblable à sa Ressemblance oubliée
Disparaît dans la couronne du Soleil, de l'Air et de Dieu.
Haute la nef, soulevée, dans la clameur, dans le péril !
Haute dans le prodige des vagues anciennes et mélodieuses,
Et plus haute encore dans la mémoire virgilienne de l'Esprit !
Rien n'égale cette beauté qui ressuscite, qui s'élève
Dans la louange d'un écho éternel et dans la justice du destin !
Rien n'égale la joute suprême d'une grandeur où tremblent nos mains,
Dans la ferveur de la victoire qui dilate la poitrine et hante
La vertu des songes et des dieux, le sel des cités disparues
Dans la solennité d'un Soir où nous retrouvons nos visages
Sous les casques brillants de la bienveillance du Soleil, de l'Air et de Dieu !
Lucide est l'âme accourue vers la lumière de l'être, oeuvre immense.
Lucide est la louange de la voile latine, la louange ingénue
Dont nous retrouverons l'augure dans la bruissement de la cigale
Dans ce travail secret du Jour, dans la fraternité des nuages
Et des racines, dans la concordance haute du Soleil, de l'Air et de Dieu.
Sous ce ciel de signes ardents, les collines, sœurs de l'aube et de l'oubli
Déroulent leurs rumeurs et leurs parfums. La douceur obscurcie
Penche le front sous les feuillages comme un repos divin.
La royauté se retrouve dans ce « Toujours ! » que disent les jeunes arbres.
Le jardin se referme dans sa lumière inexorable. Beauté semblable
Et qui protège ! Beauté que portent pour la fête d'Artémis
Les jeunes filles qui disent l'or flottant, vive beauté !
Sous le ciel des signes ardents et des vents fougueux,
Nous serons délivrés et comme une onde notre orgueil
Se perdra dans la royale voile radieuse qu'elle élève
Comme signe plus haut dans le ciel ardent,
Comme le signe du Soleil, de l'Air et de Dieu.
Qu'elles soient, les très-belles, les gardiennes du labyrinthe de nos pensées
Et de la profondeur des grèves, et du Soleil du Soleil, Logos intérieur
Embrasant l'Air de l'Air jusqu'aux profondes mémoires de l'éther,
Jusqu'à ce silence de Dieu qui chante dans le Cœur de Dieu...
Qu'elles soient, ces jeunes filles d'Artémis, les flammes
Du redoublement des Formes, dans l'intarissable secret
Dont la beauté subjugue le spectacle immense de l'aube
Où nous retrouvions enfin les ombres claires et le jardin d'or.
Que d'ombres pour les hommes dans ce devenir de soleil
Que d'attentes, pour les cieux où chante la divine confusion des astres !
La Forme demeurait comme une promesse dans l'aube immense
Et toute chose naissait de cette flamme comme un théâtre murmurant !
Beauté et sagesse, légèreté et désinvolture précédaient notre entendement
De leur sillage clair sur les eaux. Les songes étaient des acclamations.
Le ciel se tendait dans la solennité du bleu. A la proue, l'ombre se divisait
Comme une voix orphique. Car le Chant est ici et ailleurs. Il s'élève
Dans le mystère et plonge dans l'éblouissement de la profondeur.
Nous frappons notre parole sur des murailles de silence et l'écho
Invente des contrées étincelantes dans nos âmes !
S'élèvent dans l'air les songes maritimes ! Le cœur bat dans l'or du sang
Et nos prunelles brûlent d'adoration et de conquête. La mélodie veinée
De bleu de l'univers enchante l'arbre d'or de nos poumons. Le vent
Violente les voiles immenses et fragiles. La vigueur nous entraîne et la joie !
A l'aube de l'Idée sont les naissances du destin ! Que j'entende les voix
De la toile et du bois, que je goûte les saveurs de sel de l'air qui brûle,
Et voici que la mémoire du monde s'éveille de sa léthargie !
La mémoire du monde entre en miroir avec l'Empire désiré !
Car je garde la mémoire d'Ulysse dans l'estuaire du Tage,
Arborescence d'âmes vives sauvées des eaux et revenues
Alors que le Temps, par d'innombrables détours nous ment,
La Vérité scintille sur la proue et dans nos prunelles: l'être
Débute dans ce recueillement de la mémoire: Ulysse reviendra
Comme un ressouvenir dans la voix de notre allégresse,
Comme un chant de triomphe et de péril s'adressant
Au ciel avec ses clameurs et son grand silence d'été
Qui précède l'entrée du navire dans sa destinée surhumaine !
Apparition dans l'estuaire, mystérieuse beauté ! Le silence
Joue de cette image du Soleil que nous gardons dans la mémoire
Telle une prévision inclinée dans la brume sourde où tremblent
Les générations tressées des roses divines sur la voile du Soleil !
Ainsi, l'immense nouveauté du destin lance l'onde sur l'envers
Du monde où revivent les mythologies du monde comme une voile gonflée,
Entraînant les nerfs de chanvre, de bois et de métal du navire qui est un songe,
Avec la douceur infaillible du messager - sa volonté
Scrutant l'espace avec la sûre ténacité des Anciens,
Et son âme d'ouragan et d'incendie, son âme subtile comme la syllabe
Douce enclose dans la strophe méditée et dans son espérance
Persistante ! Tout cela fut inscrit comme un feuillage sur le bouclier.
De quelles sources lointaines s'abreuve notre Mer ? De quels confins ?
De quelles hauteurs ? De quelle glace translucide ? La limite
Est dans la réponse refusée à l'énigme et dans l'assentiment au silence.
Nous apercevrons, au-delà de la réponse refusée, quelque flamme
Céleste éclairant les contrées de notre orgueil et les plaines
Où Zeus, père du Jour, ordonne une bataille silencieuse
Entre notre hardiesse et la juste méditation de l'univers !
J'honore cette aube, ces colonnes, ce faîte où repose le chant
Dont le sens se perd dans l'éternité et dont s'abreuve notre nostalgie.
Rien n'est perdu. Tout se tient dans l'apaisement immense.
Comme la goutte de rosée à la pointe du brin d'herbe,
Les mondes invisibles rassemblent leur limpidité à la pointe
De notre entendement. Le dieu se diffuse dans le soir versicolore.
Tout se tient: la sagesse et le nom, la lumière et la chevelure
De l'Aimée comme le sourire et le geste qui l'invente
Sur le visage. Tout se tient. Le soleil se tient dans la prunelle.
La Grandeur est dans le regard. L'Empire est dans l'instant.
Et le ciel à notre front s'accorde. Les écumantes constellations
Frémissent dans le battement de nos cils, et toutes les saisons
Vivent et meurent sous nos paupières. La douce chaleur de l'automne
S'évanouit entre nos lèvres fécondes comme des vergers. L'hiver
S'immobilise comme un chœur de pierre dans notre cœur
Et le printemps fait éclater cette rosace minérale avant l'été
Qui fait glisser comme dans un songe léger le navire d'Ulysse...
Tout se tient dans cet estuaire du Tage: le souvenir de la déréliction
Et, dans la tremblante douceur, celui de la lumière étonnée.
Apaisement du souffle dans l'Immense, j'acquiers le puissant espace
Alors même que la déclive destinée humaine ne pourvoit point à ma patrie.
Elle fut cette frondaison de fleurs sur l'horizon inconnu...Apaisement
Du front, apaisement du Temps. L'Olympe résonne de cet appel,
Homme qu'un entendement adamantin fourvoie dans la bataille lumineuse !
L'Apaisement triomphe ! Dans ces hautes trames de l'espace-temps,
L'Apaisement triomphe et nous en sommes les témoins.
Tisseuse de profondes Imminences est la parole de l'Apaisement.
Car les éléments rugissent dans L'Apaisement dont je parle et qui n'est point l'abandon des forces
Mais leur apogée dans la gloire d'une discordance vaincue.
Sur les tablettes de la nuit une voix écrit des signes vaporeux.
Invisible est le signe mais présent dans l'agitation de l'esprit.
Tel est l'Apaisement qui s'en élève, tel est le vaste accord
De l'Apaisement... La brindille qui ploie sous le souffle en témoigne.
Le bruit sourd de l'eau sur la pierre. Lentement nos paumes se tournent vers le ciel
Est-ce pour le sommeil ou pour une prière ? Notre âme
Est la conque bruissante de l'abîme. Notre âme est la louange.
Tel est l'Apaisement, une mélodieuse gratitude. L'âme connaît l'été.
Elle triomphe dans l'oscillation des feuilles, dans l'allégresse
De l'été dont nous atteignîmes la cime par la sérénité !
Sourdre ainsi du cœur de silence d'une saison ! L'Apaisement
Est cette verte limite ! L'Apaisement dis-je, point l'inertie. L'Apaisement
Est cette alacrité des forces dominantes et charnelles qui fleurissent
En Idées, comme surent les célébrer Virgile et Porphyre !
L'Apaisement gît dans le secret de la roche dorée platonicienne.
L'Apaisement est le Don des dieux. L'Apaisement est une claire fanfare
Qui se répercute dans le Silence comme le soleil vermeil
Derrière les paupières. Nous feignons de dormir, mais voici
Que sur la table de l'esprit brûlent les aromates et montent
Vers les ondes impétueuses du ciel qui reviennent et m'envahissent !
L'Apaisement est de s'épandre dans quelque lumière
Tombée de Haut. L'Apaisement est d'entendre la bouillonnante
Harmonie résonner dans les formes parfaites du rêve
Qui pose sa tête sur notre épaule lorsque nous feignons de dormir,
Lorsque derrière nos paupières nous devinons l'efflorescence vermeille du monde.
Dans toutes nos oeuvres, l'Apaisement nous attendait.
Dans la violence, dans la tristesse, dans l'étonnement, l'Apaisement
Veillait. Attendant son heure. Levant l'ancre
Avant même que nous ne fussions éveillés. L'Apaisement amplifiait
La nuit et le jour, de sorte que nous ne pouvions en percevoir les limites.
L'Apaisement gardait l'orgueil de sa frontière infaillible. De cercles
En cercles, et de plus loin, l'Apaisement veillait sur nous
Pour nous conduire vers l'émerveillement et les richesses inconnues
Du matin d'or. Mes amis, gardez mémoire du bas-relief égyptien
Qui montre la déesse Hathor accueillant le Roi Séthi premier
Car dans le geste de sa main s'éveille l'Apaisement.
Comment dire la paix de l'âme. Est-elle cette lumière d'Or
Où nous voulons nous ensevelir au terme de l'exigence
D'une pure pensée, ou vive, dans l'occulte allégresse d'un vin
L'ardente soif que seule comble une soif nouvelle ? Comment dire
Cette moisson des puissances devant le portique des tourbillons ?
La terre pareillement fut-elle cette nombreuse beauté vers l'Occident désert
Comme le cours du temps dont un mensonge nous sauva ?
La paix de l'âme est-elle dans la vérité ? Mais quelle ?
Elle divise la fontaine de notre orgueil. Elle songe, vagabonde,
Elle brille dans la tourmente auguste, recueillie, perdue,
Retrouvée dans la perdition de toute évidence du cœur,
Mais visible, ô Merveille, dans l'intelligence nuancée ! Quelle Vérité ?
Celle qui ne cesse point d'être dans l'attente d'elle-même,
Celle qui prodigue les promesses, les méandres, trame frémissante
De l'aube, et chacune de nos pensées vient à son appel
S'instruire à sa mémoire mystérieuse, s'égarer délicieusement
Et se retrouver... Quelle vérité ? Mais la Seule qui dise
La patience et l'autorité, la seule qui chante la divine temporalité
De la rencontre des regards ! La Seule dont la voix est couleur de houle.
Il y eut de ces prodiges, des roues étincelantes dans le ciel !
Luc-Olivier d'Algange
Extrait du Chant de l'Ame du monde, éditions Arma Artis.
18:44 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook


