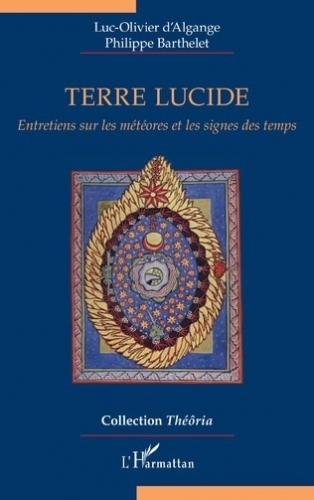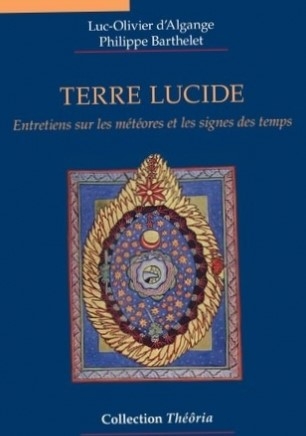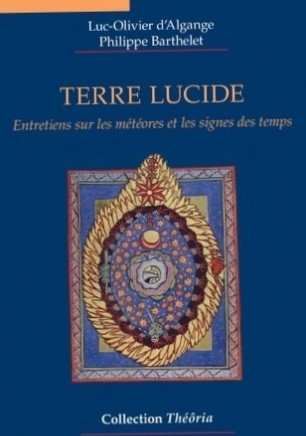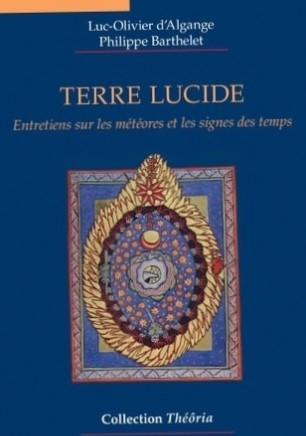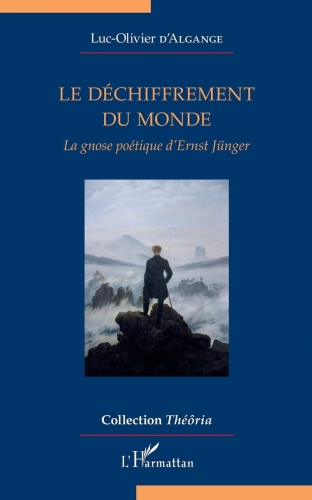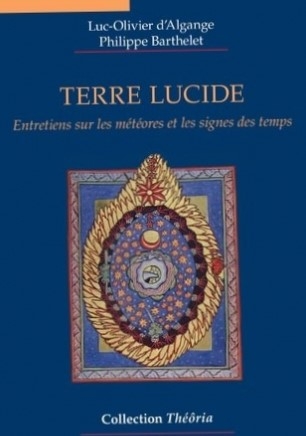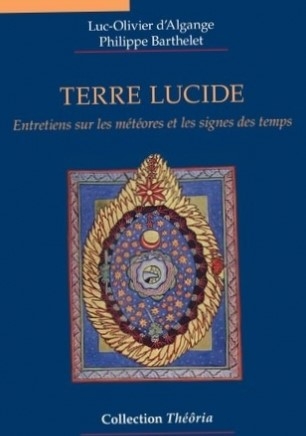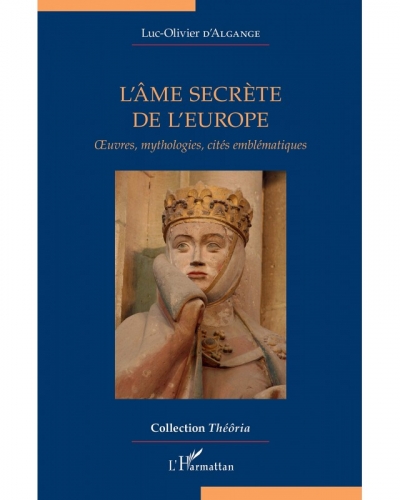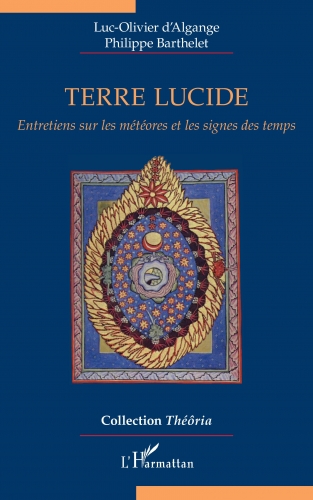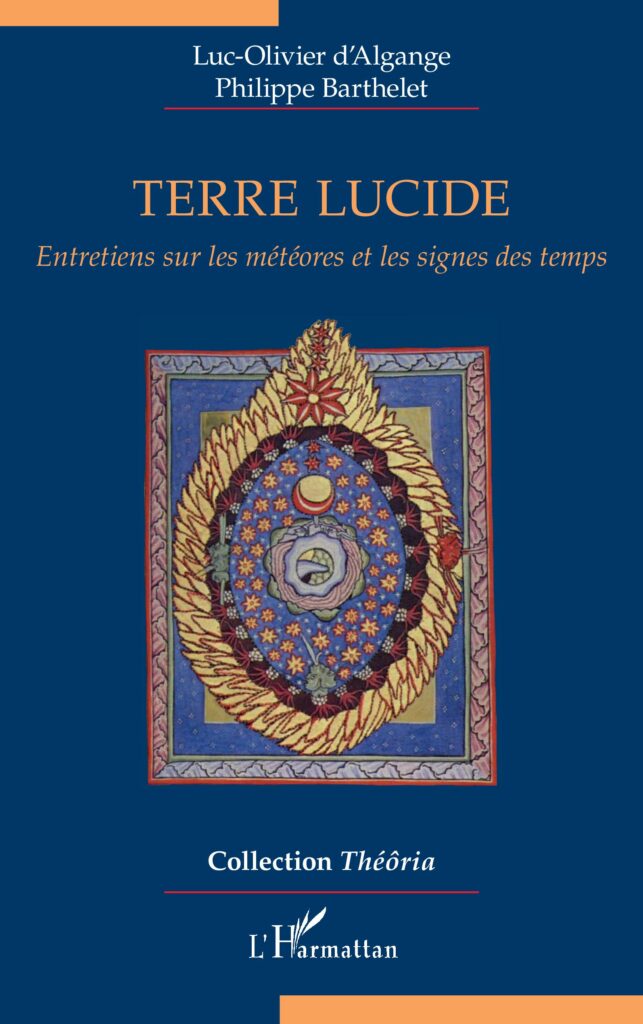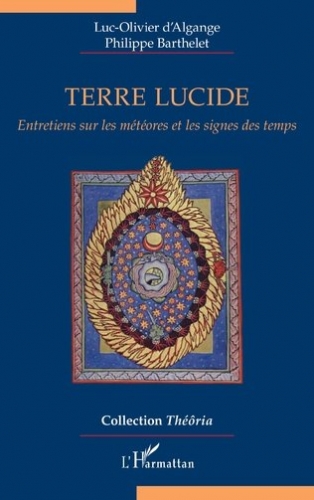Luc-Olivier d’Algange
Dominique de Roux, entre la nostalgie orphique et le pressentiment sébastianiste
« L’existence, c’est quand l’être envoie en exil une expérience particulière de lui-même, qui devient alors souvenir, mémoire, volonté ou désir de retour, sinon revenir. Exister, c’est donc être en exil par rapport à l’être, s’en souvenir et tout sacrifier au retour, ressusciter les choses mortes. Reconquête de tout un art, d’un esprit de renaissance. »
Dominique de Roux
La portée poétique et métaphysique d’une œuvre tend à demeurer méconnue de ceux qui n’en retiennent que la figure humaine qu’elle dessine et le génie du style, en oubliant ce dont il est question, l’action que le Songe précipite comme une matière ardente dans ces conditions nécessaires que sont un destin d’homme et un art d’écrire. Il existerait ainsi, dans une zone antérieure à l’œuvre, comme le sceau d’une empreinte invisible. Qu’en est-il du sceau de l’œuvre de Dominique de Roux ? Quelle est sa mise-en-demeure ? De quelle nature, ouranienne, héliaque, impériale, est l’invisible dans ce que nous voyons d’elle, de ces images qu’elle fait apparaître ? Qu’en est-il des mythes et des Symboles ? Quelle attente ardente brûle dans ces phrases ? Et pour qui ? Une œuvre, et surtout une œuvre laissée en suspens, n’est-elle pas une courbe qui débute avant la page écrite et s’achève après elle ? Faute de se poser ces questions, la littérature des littérateurs, ou des idéologues, ce qui revient au même, nous rattrape, et nous en sommes réduits à juger et à jauger l’œuvre selon des normes sommaires, stéréotypées, grégaires.
L’œuvre de Dominique de Roux témoigne d’une stratégie de rupture, mais rupture pour retrouver la plénitude de l’être, à laquelle, selon la théologie apophatique, « tout ce qui s’ajoute retranche ». Il faut donc rompre là, s’arracher avec une ruse animale non moins qu’avec l’art de la guerre (et l’on sait l’intérêt tout particulier que Dominique de Roux porta à Sun Tsu et à Clausewitz) pour échapper à ce qui caractérise abusivement, à ce qui détermine, et semble ajouter à ce que nous sommes, alors que la plénitude est déjà là, dans « l’être-là », dans l’existant pur, lorsque celui-ci, par une succession d’épreuves initiatiques, de ressouvenirs orphiques, de victoires sur les hypnoses léthéennes, devient le témoin de l’être et l’hôte du Sacré.
La radicalité de Dominique de Roux, ses provocations de Moderne anti-moderne, ne s’expliquent pas autrement : il faut aller au cœur de l’être, résolument, encourir le blâme pour s’établir souverainement dans ce qui nous appartient de toute éternité, s’y établir pour en devenir l’hôte et ne point laisser prise à ce qui, par l’usage quotidien, nous dépossède de sa claire vérité. N’hésitons point alors à encourir le reproche que certains firent à Dominique de Roux : de parler de lui-même en parlant des autres, - reproche mal fondé au demeurant car à parler de ce qu’une œuvre met en mouvement, de ce qu’elle suscite, à s’éloigner du texte et de la biographie, de la linguistique et de la psychologie, ou encore de l’idéologie, qui furent longtemps les seules grilles d’interprétation des critiques ( mais que voir et que vivre derrière des grilles ?), à s’évader de la fausse objectivité où s’exacerbe jusqu’à l’hybris la vanité du savoir, c’est bien une humilité que nous retrouvons, celle de laisser l’œuvre agir sur nous, d’en recevoir, pour nous-mêmes, ce qu’elle veut nous donner, de la lire comme si elle n’avait été écrite que pour nous, de suivre les pistes qu’elle nous indique au lieu, du haut de notre science, de la vouloir démonter, déconstruire, expliquer, comme si nous savions mieux que l’auteur ce dont il s’agit !
Longtemps Dominique de Roux fut notre aîné ; et voici, depuis quelques années, qu'il est notre cadet, qu'il nous devance déjà et encore de sa juvénilité, nous rappelle aux audaces essentielles, nous invite à découvrir et à défendre d'autres oeuvres que la nôtre et nous délivre, par cela même, de la mécanique odieuse de la subjectivité, de cet enfermement dans le « moi », autrement dit, de la « psychologie des larves » dont parlait Novalis, pour solliciter en nous ce songe de grandeur, cette nostalgie impériale qui veut le monde plus grand que ce que nous en pouvons penser. Nous gardons le souvenir des découvertes, des « missions de reconnaissance », où il nous précéda, de l’aventure prodigieuse des Cahiers de l’Herne, de son ultime revue Exil, où nous retrouvions tout ce qui, ces dernières années, nous avait requis, d'une requête tout autant métaphysique que littéraire, Pessoa, Julius Evola, Valery Larbaud, Knut Hamsun, Céline, Raymond Abellio, Gombrowicz, et parmi les contemporains, Jean Parvulesco, André Coyné, Matthieu Messagier, Patrice Covo… Les poètes et leurs intercesseurs, les aventuriers du Logos, les « calenders », selon le mot de Gobineau, les Exilés, car depuis que le monde se montre tel que nous le connaissons, les Fils de Roi sont toujours en exil. Qu’en est-il de l'exil, non point dans l'ailleurs mais dans l'ici-même ? Qu'en est-il de l'exil ontologique, et non point circonstanciel ou historique ?
L'exil, dans un monde déserté de l'être, dans un monde de vide et de vent, où toute présence réelle est démise par sa représentation dans une sorte de platonisme inversé, est notre plus profond enracinement. Et ce plus profond enracinement est ce qui nous projette, nous emporte au voisinage des prophéties. « Etre aristocrate, que voulez-vous, c’est ne jamais avoir coupé les ponts avec ailleurs, avec autre chose ». Cette fidélité aristocratique, qui scelle le secret de l’exil ontologique, autrement dit, de l’exil de l’être en lui-même, dans le cœur et dans l’âme de quelques uns, est au plus loin de la seule révérence au passé, aux coutumes d’une identité vouée aux processions funéraires : « Je ne me dédouble pas je cherche à multiplier l’existence, toujours dans le flot des fluctuations, vérités et mensonges qui existent, qui n’existent pas, au bord du langage. »
L’héritage, alors, n’est plus un poids, un carcan de convenances mais un recours, une puissance à celui qui sait de par ses choix « être toujours et partout en territoire ennemi ». Etre en exil, c’est-à-dire au plus proche de l’être, au bord du langage, c’est être offert, comme en sacrifice, à la possibilité d’inventer une écriture dont le tracé, de crêtes en crêtes, d’énigmes en clartés, ravive le pouvoir de « protéger le ciel le plus haut, autrement dit, sa tradition ». Rien de moins conservateur, toutefois, que cette sauvegarde de sa tradition ; nul repli, fût-il stratégique, sur des positions obsolètes. Aux guerres frontales, qui, de notre côté, ne peuvent qu’être perdues, Dominique de Roux préfère les guérillas nuancées de logique taoïste, d’un « ethos » à la Sun Tsu qui feront de cet « anti-moderne » une figure décisive de l’ultra modernité, -autrement dit de la modernité au sens rimbaldien : celle de « l’étincelle d’or », de la fulgurance imprévisible. D’où l’importance de se garder d’être « inébranlable dans ses concepts, catégorique dans ses déclarations, clair dans ses idéologies, féru dans ses goûts, responsable dans ses dires et dans ses actes, précis et cristallisé dans ses manières d’être.»
Seuls pourront, en territoire ennemi, prolonger ce qui doit l’être, « le plus haut ciel », ceux qui refusent d’endosser un rôle, de se revêtir de la livrée ou de l’uniforme, de simplifier ou de schématiser leurs pensées ou leurs croyances à toutes fins utiles. Ce qui importe n’est point la doxa mais la gnosis, non point la représentation mais la présence réelle, non point l’eau croupie de la citerne mais l’eau vive, non point les mots mais la parole : « Le présent, donc, le passé ainsi que l’avenir d’une littérature qui est celle dont nous assumons les destinées sont chacun pris à part et tous ensemble, le temps d’un seul et même combat. Le combat de la parole contre les mots, du pouvoir d’intégration contre les puissances de la désintégration, et c’est là le mystère ultime de la parole d’Orphée déchiré par les chiens d’Hécate que sont les mots laissés à eux-mêmes ».
Loin d’être soumission aux prestiges fallacieux de la lettre, à la fascination des « signifiants » et à leurs structures immanentes, l’écriture de Dominique de Roux, au sens où lui-même parlait de l’écriture du Général de Gaulle, ressaisit dans un même combat le passé, le présent et le futur, la nostalgie orphique et le pressentiment sébastianiste, ressaisit, ou plus exactement refonde, la fondation étant aussi fusion dans le creuset alchimique de l’existence voulue comme expression de l’être, le Sens lui-même, le fluidifiant, lui restituant ses impondérables, ses fugacités tremblantes, ses chromatismes insaisissables qui sont le propre de la parole, c’est-à-dire du Logos lorsque de celui-ci ne se sont pas encore emparés les idolâtres et les abstracteurs.
Ecrire sera ainsi pour Dominique de Roux cette action subversive, « ultra-moderne » qui consiste à retourner à l’intérieur des mots la parole contre les mots, à subvertir, donc, l’exotérique par l’ésotérique et à ne plus s’en laisser conter par ceux-là qui oublient que la parole humaine voyage entre les lèvres et les oreilles, comme sur les lignes ou entre les lignes, qu’elle voyage entre celui qui la formule et celui qui la reçoit, comme entre la vie et la mort, le visible et l’invisible : ce profond mystère qui se laisse sinon éclaircir, du moins comprendre, par la Théologie.
L’ardente polémique contre les diverses cuistreries plus ou moins universitaires qui prévalaient alors, loin de relever seulement d’une joyeuse humeur mousquetaire, se fondait, on ne le vit pas assez, sur une autre vision du langage et du monde, autrement dit de l’écriture comme « praxis » du haut et du profond, du lointain et de l’immédiat, destinée à lutter contre l’obscurcissement de l’être, contre cette banalité et cet ennui, toujours aux aguets, qui nous envahissent à la moindre inadvertance.
Dominique de Roux fut ainsi bien davantage que « le plus grand éditeur de l’après-guerre » selon la formule perfide de Jean-Edern Hallier qui dut avoir quelque difficulté à comprendre que l’on pouvait être un écrivain de grande race sans être exclusivement tourné vers soi-même. « Editeur », au demeurant, fût-ce « le plus grand » suffit mal à définir l’action de Dominique de Roux dans ce domaine pour autant que sa méthode, si méthode il y eut, fut d’abord de prolonger, de prouver par des actes, ses admirations. Editeur, Dominique de Roux le fut non par défaut mais par surcroît.
Par surcroît aussi, la politique, sujet litigieux. Disons simplement, avant d’en revenir à l’écriture, qu’il n’y a plus à discutailler de son prétendu « fascisme » dès lors que l’on sait que tout ce qui s’est opposé, s’oppose ou s’opposera au monde comme il va globalement a été, est, ou sera traité de « fasciste » par les adeptes de la loi du plus fort et qu’il n’y a pas de rébellion, de « contre-monde », fussent-ils purement contemplatifs, qu’il n’y a pas de métaphysique ou d’esthétique rétives au règne de l’argent et de la technique qui ne seront traités de « fascistes » par les défenseurs, pathétiquement dépourvus d’imagination, de l’ordre établi, comme naguère on réputait hérésiarques Maître Eckhart ou Giordano Bruno. Comme si le fascisme réel, le nazisme opérationnel ne furent pas aussi et d’abord de lourdes collusions entre l’esprit grégaire et les puissances de l’argent et de la technique !
Des temps où il fut notre aîné, Dominique de Roux nous incita à donner forme à notre dessein. Devenu notre cadet, lorsque nous eûmes dépassé la frontière des quarante-deux ans, son œuvre nous fut cette mise-en-demeure à ne point céder, à garder au cœur la juvénile curiosité, à déchiffrer, dans son écriture aux crêtes téméraires, le sens d’une jeunesse qui, suspendue trop tôt dans l’absence, ne peut finir. Il y a une écriture de Dominique de Roux, un style, un usage de la langue française en révolte contre cette facilité à glisser, avec élégance, mais sans conséquence, sur la surface du monde. On s’exténue à condamner ou à défendre sa plume de « polémiste d’extrême-droite », alors que ce qui advient dans ces bouillonnements, ces ébréchures, ces anfractuosités n’est autre que la pure poésie.
Sauver la poésie de ce qu’en font les poètes de laboratoire ou les poètes minimalistes ou illettrés, redonner la poésie à la prose et la prose à la poésie ( et je ne vois nul texte dit de « poésie » plus digne du beau nom de poème que La Maison jaune, texte inclassable, lapidaire et mystérieux) ; retrouver de la poésie un à un les pouvoirs, tel fut, semble-t-il le dessein de Dominique de Roux, - d’où l’absurdité de vouloir juger de ses œuvres selon les normes du genre romanesque ou de la prose française néoclassique.
La poésie est aussi présente à chaque page des romans et des essais que du journal et de la correspondance ( dont l’excellente biographie de Jean-Luc Barré nous livre maints extraits inédits) qu’elle est absente de la plupart des recueils de poèmes des « poètes » patentés par les satrapes du texte à lignes irrégulières qui officièrent alors dans la régulation des petits bouts de proses vantardes qui n’emportent rien sinon la pose de celui qui consent à ne rien dire, à ne rien évoquer, à s’en tenir rigoureusement en deçà du péril lyrique et liturgique du langage en cultivant de molles ambiguïtés par l’utilisation de métaphores discrètes, bien policées, insoupçonnables de moindres « accointances » avec le Sacré, avec le mythe ou avec le tragique, - autrement dit, avec la vérité orphique que l’enfer du décor où nous vivons nous dissimule alors qu’elle est, cette vérité, la seule à pouvoir dire en même temps notre destin et notre anti-destin, notre monde ( c’est-à-dire notre exil) et ce contre-monde qu’il nous faut ourdir en faveur de l’être et contre le néant.
C’est donc bien vers l’écriture de Dominique de Roux qu’il nous faudra nous tourner comme lui-même se tourna par un livre ardent vers l’écriture du Général de Gaulle : écriture des épicentres, non point cette écriture diurne, cette écriture de l’après-midi, coulée d’évidences en évidences au rythme du canotage mais bien une écriture nocturne, s’enroulant autour d’une métaphore solaire, mais d’un soleil en voie de création. D’abord l’Image, et ensuite les mots : « Ne servir que sa vision ». La rencontre éblouie avec d’autres œuvres, venues là comme des « confirmations », selon le mot de Philippe Barthelet, lui permettra précisément d’échapper au déjà formulé, au banal, au stéréotype et d’aller chercher l’impondérable entre l’œuvre et celui qui la reçoit : ce passage où le Verbe devient silence. L’espace de la passation des pouvoirs, la zone philosophale et « diplomatique » n’est pas le moi fictif, la subjectivité dont le triomphe nous réduit à l’état de mécanique, mais l’expérience métaphysique du Verbe. Ainsi la confrontation explicite avec d’autres œuvres, avec l’encre de sang d’autres « horribles travailleurs » devient fondatrice d’une vérité et d’une liberté essentielle.
Rien n’importe que « la saison mystérieuse de l’âme». Toutes nos luttes, nos impatiences, et notre solitude conquise et notre exil, nos œuvres, qui ne sont ni des victoires ni des défaites, tout cela, non seulement au bout du compte, mais dès le départ ne vaut que pour ces retrouvailles légères : « Je viendrai en janvier. Je viendrai longtemps. Vous me parlerez encore des jardins et des hommes… dans cette petite salle blanche du monastère qui sent la pomme et le grain, sur cette colline de silence et de beauté, parmi les pluies qui tressent tout autour une saison mystérieuse. Je vous écouterai. Vous calmerez ma foi clignotante comme une étoile. J’enserrerai votre trésor comme un écureuil entre mes mains. »
Dominique de Roux ne fut ni « fasciste » ni « réactionnaire » comme le disent les imbéciles mais antimoderne (ce qui est tout autre chose et peut-être le contraire) ; et antimoderne, il faut bien reconnaître qu’il y a de bonnes rasions de l’être pour peu que l’on soit sensible à l’âme des êtres et des choses, à leurs « saisons mystérieuses ». Substituant le confort à la beauté, la prédation à l’héroïsme, le pouvoir de l’argent (qui rend également esclaves les dominants et les dominés) aux jeux divers de la puissance et de la gloire, le monde moderne est cette lèpre, cet enlaidissement général de tout par tous les moyens, y compris ceux de la morale déchue en « moraline », pour reprendre le mot de Nietzsche.
Antimoderne en morale, c’est-à-dire ultra-moderne pour ce qui est de l’inventivité littéraire, penseur paradoxal, c’est-à-dire littéralement en marge de la doxa, de la croyance commune de son temps, aimant le heurt des contradictions, Dominique de Roux fut, à sa façon, le parfait représentant de sa lignée alors que d’autres, qui ne sont point idiots, le voient en rebelle à toute convenance héritée. Or, s’il fut l’un et l’autre, fidèle et rebelle, ce ne fut pas même alternativement mais en même temps, c’est-à-dire dans l’éternité qui, pour éternelle qu’elle soit, ne nous est donnée que par brusques échappées, semblables à ces rafales qui, dans leurs embruns, nous étourdissent.
Dominique de Roux fut cet aristocrate antimoderne, ce fidèle, ce chevalier, dans le geste même qui affirme la liberté absolue : « Un nouvel équilibre est à conquérir dans la fièvre » ou encore : « Il faut rester des hommes libres… Jamais je ne me laisserai prendre dans ma vie à quelque parti que ce soit, droite gauche centre vert bleu hormis celui de l’amitié, de la violence de l’amitié, ses traits bien fermes, ses grandes passes d’ombre, ses vivacités nerveuses, ses inconnues, ses droits. »
A l’exigence morale qui consiste à ne pas être là où les autres vous attendent correspondra une écriture aux incidentes imprévisibles où les mots inattendus, dans leurs explosions fixes, captent les éclats du pur instant : « Par rapport à l’écriture, ni loi, ni science, pas même une destinée ». L’héritage comme force motrice, élan donné, s’oppose à la destinée, forme consentie de la soumission. Du peu de liberté qui nous reste, l’anti-moderne ultra-moderne veut étendre le champ d’action et les prestiges secrets pour aller vers la réalité, tracé de lumière entre deux ténèbres : « Retrouver la réalité, aller vers le réel, l’élémentaire, vers la mort prévue de l’homme et vers l’homme secret qui vit encore, vers sa réapparition dans la forme nouvelle, dans l’éternelle jeunesse de l’antiforme éternelle ».
S’il faut « jeter par-dessus bord les totems et les tabous de la tribu », c’est-à-dire devenir, selon la formule d’Al-Hallâj « un Unique pour un Unique », s’il faut, en même temps, accompagner « la longue marche de l’Occident à son propre être, au-delà du déclin », ce ne saurait être sans le dévoilement de l’écriture par elle-même, où plus exactement, sans le voilement de l’écriture par l’Ecriture qui accomplit à travers elle cette « intelligence prophétique de l’Histoire » cette « expérience du salut, secrète, existentielle » que Dominique de Roux évoquait à propos du Général de Gaulle.
Ecrire, alors, ce n’est plus s’évertuer, dans le néant du sens, à composer un « texte », lui-même destiné aux thanatopracteurs virtuels, universitaires ou journalistes, mais laisser œuvrer en soi la « vague d’assaut », l’action théurgique, d’un « certain retour à la vie ». Ces vagues, toutefois, ne sont pas un vain tumulte mais orbes venues d’une immobilité centrale, d’un cœur de calme infini, là où règnent « les Forts, les Sereins, les Légers » de L’Etoile de l’Alliance, évoquée par Stefan George. « Maintenant, les cercles sont plus lents et plus hauts, c’est le temps de l’exil, de l’écriture ». Le sens de la tradition, de la fidélité à l’appartenance se révèlent dans la distance et dans la solitude. L’écrivain doit être séparé du monde « pour qu’il lui faille l’imaginer à nouveau et l’aimer autrement, l’unifier et en éclairer toutes les causes, le pénétrer, le vaincre intérieurement, le régénérer. »
Pour témoigner du monde, il faut le porter en soi, et pour le porter en soi, il faut s’en détacher. La politique et l’écriture dévoilante sont à équidistance de ce détachement qui permet de « transcender abruptement l’actualité immédiate, de nouer avec le passé le fil rompu, d’appliquer un De Monarchia. » Point de retour à Ithaque sans l’arrachement, le déracinement, sans l’exil dans le vent et la mer qui nous revêt de « la livrée majeure de l’Esprit ».
« L’exil n’est pas une autre demeure. Il est séparation d’avec notre demeure. L’exil s’accompagne de la volonté de retour. C’est le visage dans les mains de l’homme séparé de lui-même (…) Et si la grande poésie arrache au monde, le développement de l’exil ne concerne pas seulement l’expérience de celui qui le vit, il abandonne les organisations têtes baissées vers la flamme et commence une vie nouvelle, cherchant la passe. »
Cette « passe », impériale et portugaise, passe vers l’écriture à travers la politique et non subordination de l’une à l’autre, comme il en advient aux écrivains dits « engagés ». Loin d’être ce retour contrit à l’Histoire et au collectif des clercs hantés par la conscience malheureuse ou mauvaise, l’engagement de Dominique de Roux se trouve être exactement contemporain de son plus radical désengagement, de sa perception d’un au-delà de l’Histoire, véritable et seul objet de l’enquête : « Le Portugal, parce qu’il croit aux réalités finales a compris, quand le reste de l’Afrique est livré au désordre, que dans le continent noir il ne fallait pas seulement avancer en espace mais aussi en esprit (…). Quand l’histoire européenne est pleine de peuples morts ou moralement détruits par le temps, le Portugal, refusant d’échapper au temps humain, qui est aussi une manière d’échapper aux exigences de la réalité, fait coexister dans son espace planétaire, une réalité humaine universellement pensée et prétendant agir sur l’Histoire ».
Ne pas échapper au temps mais le transmuter de l’intérieur, tel sera le propre du Cinquième Empire que Dominique de Roux entrevoit. C’est aussi toute la différence entre la Révolution et la contre-révolution qui veulent échapper au temps en le niant, en refusant le palimpseste du réel et ce « contraire de la révolution » qu’évoquait Joseph de Maistre qui vainc le temps en opérant à sa transmutation alchimique, providentielle. L’écriture de Dominique de Roux accompagne et souvent précède ces étapes successives, ou ces stations de la conscience où la conscience individuelle devient le miroir ardent de la conscience du monde. A la globalisation uniformisatrice, Dominique de Roux n’oppose pas ces vieilleries du modernisme que sont le nationalisme, le racisme, le pétainisme mais une autre universalité qui est celle du palimpseste, de la mémoire libérée de ses propres représentations, de la mémoire rendue à sa matière fusible, chatoyante et dispersée.
Le révolutionnaire comme le contre-révolutionnaire sont des nihilistes : ils nient la mémoire réelle, ils veulent, dans l’hybris de leur volonté, conformer le monde à leurs plans : hybris de ménagère et non de conquérant. Il faut défendre sa vision du monde ; mais telle est la limite du colonialisme, il convient que les mondes conquis, et même le monde natal, nous demeurent quelque peu étrangers. Cette étrangeté discrète et persistante est la condition universelle de l’homme que les planificateurs modernes ont en horreur et dont ils veulent à tout prix départir les êtres et les choses au nom d’un « universalisme » qui n’est rien d’autre que la plus odieuse des hégémonies, la soumission des temporalités subtiles de l’âme au temps utilitaire, au faux destin de l’Histoire idolâtrée, à l’optimisme stupide, au nihilisme béat.
Le « code secret du fado », la saudade qui « projette les êtres et les choses hors du temps », sera pour Dominique de Roux le signe du retour, l’aperception directe, en mode visionnaire, d’un horizon paraclétique où s’opèrent les noces de l’eau mercurielle et du feu apollinien, de la nostalgie et du pressentiment : « Le Cinquième Empire ? L’Empire de la Fin d’après la fin, quand toutes les choses humaines auront été consommées (consumées) et ce qui apparaîtra de l’homme alors, ce sera ce que l’homme aura passé l’histoire entière à gommer, et qui lui reviendra : sa ressemblance. »
Que l’homme soit enfin, et au-delà de toute fin, à sa propre ressemblance comme à la ressemblance de son empire infime et infini sur les êtres et les choses, que notre solitude soit enfin signe et condition de cette amitié divine qu’évoquent Maître Eckhart et Rûmî, qu’une ombre jetée, qui est pure transparence, « antiforme éternelle », entre le monde et nous advienne pour nous réconcilier, l’écriture de Dominique de Roux nous en persuade d’autant mieux qu’elle devance, par un Songe (creuset de la réalité) toute démonstration et toutes arguties : ainsi à la pointe du Songe comme à la pointe du Calame, l’écriture de l’Empire « universel, missionné pour l’éternité » sera désormais « comme fondu dans l’immensité océanique de son rêve, non point âge de conquérants ou de bâtisseurs, mais de découvreurs, de messagers, de navigateurs sans fin tenant leur raison d’être et leur force de cette absence de fin. »
Le Cinquième Empire appartient au passé autant qu’à l’avenir et quand bien même son attente semble déçue, il appartient encore au présent, à cette « lumière qui persiste identique à elle-même derrière le film » pour reprendre la formule de Nisargadata Maharaj. L’une des énigmes du Cinquième Empire se trouve paradoxalement chez Gombrowicz dont le parti pris anti-idéologique, le mépris de toute forme collective, l’aristocratisme libertaire sont précisément les plus profondes raisons d’être. C’ est que l’Empire, pour Dominique de Roux, loin d’être un super-état (c’est-à-dire, pour paraphraser Nietzsche, le plus grand des plus froids des monstres froids) serait au contraire, s’il advenait, un espace géopolitique et spirituel d’une « rejuvénation » du monde, d’un retour à cette enfance, à cette adolescence, d’avant les systèmes, à cet Eros premier, cette humeur turquoise, qui précède les adultérations, le sérieux utilitaire, l’esprit « homaisien », le puritanisme, auquel les intellectuels échappent si rarement quand bien même ils se veulent parangons de la « transgression » et de la « dérision » .
Que ce monde soit triste, torve, rancuneux et qu’il nous apparaisse tel sans que nous en eussions connu un autre suffit à convaincre qu’il n’est qu’un leurre, un mauvais rêve, un brouillard qui laisse deviner, derrière lui, une vérité éclatante mais encore plus ou moins informulée. Dominique de Roux fut exactement le contraire d’un nihiliste ; loin de nous ressasser que tout a déjà été dit, il nous donne à penser que presque tout reste à dire et même à créer : ainsi le Cinquième Empire dont la venue a pour condition le retour du Roi, un soir de brume sur le Tage ou le Nouveau Règne paraclétique de Stefan George ou encore l’Imam caché du prophétisme ismaélien.
L’attente paraclétique n’est pas le contraire de l’action, quand bien même elle subordonne l’action à la contemplation, l’action n’ayant pour raison d’être que de favoriser les conditions de la contemplation. Cette attente est une « écriture du monde », et cette écriture est un renouvellement, une « rejuvénation poétique », celle là même que Dominique de Roux chercha chez les poètes de la Beat Génération ou chez les Electriques. De même que pour Sohravardî la prophétie n’était point scellée, que d’autres prophètes pouvaient survenir, croyance qui lui coûta la vie, Dominique de Roux crut en une poésie future, une poésie autre, non encore advenue, celle des « langues de feu » de la Pentecôte, du Paraclet annonçant l’Imperium Amoris, ou celle encore de la « foudre d’Apollon » qui frappa Hölderlin. D’où l’incertitude où nous sommes de savoir si sa vue-du-monde est païenne ou prophétique, inspirée par quelque gnose orphique ou empédocléenne ou inscrite dans l’œcuménisme des racines, des branches, des fleurs et des parfums de la tradition abrahamique.
Si le Paraclet est avenir, s’il est l’eschaton de notre destin, la foudre d’Apollon, elle, est déjà tombée, mais elle est aussi mystérieusement en chemin vers nous, comme voilée, encore insue. De son ultime chantre, ou victime, Hölderlin, qui incarne pour Dominique de Roux « la poésie absolue », il nous reste encore à déchiffrer les traces, ces « jours de fêtes » dans l’éclaircie de l’être, ces silhouettes à la fois augurales et nostalgiques sur les bords précis de la Garonne, dans la lumière d’or de Bordeaux, cet exil en forme de talvera de la patrie perdue et infiniment retrouvée.
« Tout recommence » écrit Dominique de Roux et ce recommencement contient en lui l’admirable paradoxe de la coexistence du révolu et du prophétique, dépassant ainsi dans une torrentueuse assomption, l’opposition, somme toute subalterne, de l’anti-modernité et de l’ultra-modernité que nous évoquions plus haut. Le propre du Songe impérial est non seulement d’arracher le politique au despotisme de la société individualiste ou communautariste, de retrouver la dimension historiale et légendaire du destin commun des peuples, des races, des nations, mais aussi, et par cela même, de sauver, en même temps, la fidélité hölderlinienne aux dieux antérieurs et le frémissement annonciateur du Nouveau Règne. La société, dès lors qu’elle est livrée à la goujaterie, à la crétinisation de masse ne saurait en aucune façon trouver en elle-même les ressources du recommencement. Condamnée à l’infantilisme cacochyme, elle laisse jouer, en une apparence de liberté, une alternative emprisonnée dans la conjoncture profane, apoétique, soumise aux aléas des coutumes dévastées. Ces « communautés » que l’on veut opposer à l’individualisme, prises dans le plan général (et donc dépourvue de volume) sont à l’intérieur de la société, comme une âme qui serait emprisonnée dans un corps, comme dans un cachot dont, sauf un gardien muet, tout le monde a oublié l’existence. L’Empire que rêve Dominique de Roux suppose un radical renversement herméneutique : comprendre soudain que ce n’est point l’âme qui gît dans le corps mais le corps qui est dans l’âme, qui est environné d’âme, qui voyage dans l’âme.
A ce point de recouvrance, l’intériorité et l’extériorité ne se distinguent plus et le temps n’est plus de distinguer l’individu du collectif, le subjectif de l’objectif, une autre logique apparaît où nous nous apercevons soudain que la clef de notre destin est un « mantra » en accord avec la poésie du monde. Le Cinquième Empire, comme le nouveau règne de Stefan George, comme l’état confucéen rêvé par Ezra Pound, comme la « république » impériale de Valery Larbaud apparurent à Dominique de Roux comme autant de chances offertes à un contre-impérialisme – étant entendu que seule une idée d’Empire, idée au sens platonicien de « forme formatrice » suscitée par l’anamnésis (le ressouvenir d’Hésiode à Hölderlin, en vagues d’or…) disposera de la puissance en songe et en acte de frapper d’inconsistance l’impérialisme brutal, fiduciaire et puritain.
Luc-Olivier d'Algange