13/01/2026
Sohravardî et la sagesse de l'ancienne Perse:

Sohravardî et la sagesse de l'ancienne Perse
Nos contemporains, à ce qu'il paraît, aiment à philosopher. Certains ouvrages de vulgarisation, estampillés « philosophiques », se vendent comme des romans de gare (l'appellation « romans de gare » au demeurant, ne m'a jamais semblé injurieuse, et les gares, de merveilleux endroits pour acheter des livres). Tout se joue dans la nature du voyage. Il se trouve seulement que la moraline de nos philosophes bien pensant, loin d'entraîner les « trains de luxe à travers l'Europe illuminée » dont parle Valery Larbaud, ou le fameux transsibérien de Cendrars, vers quelque décisive révélation poétique ou métaphysique, nous amènent tout au plus à nous préparer à répondre à ces "Q.C.M" que certains pédagogues progressistes entendent substituer aux délicates dissertations que l'on exigeait encore des apprentis-philosophes aux temps lointains d'Etienne Gilson ou de Pierre Boutang.
Ces préliminaires désabusés ne masqueront pas davantage notre enthousiasme à aiguiller, pour poursuivre la métaphore ferroviaire, nos lecteurs vers la réédition d'une œuvre majeure de Sohravardî, Le Livre de la Sagesse orientale. Ce « héros philosophique exemplaire » (pour reprendre la formule de Henry Corbin qui fut son divulgateur, aussi bien pour l'Occident que pour l'Orient) surnommé le Shaykh al-Ishrâq, autrement le Shaykh de l'aube levante, ne tenta rien moins, en effet, que la résurrection, par l'entremise de la philosophie platonicienne, de la « Lumière de Gloire » zoroastrienne, le Xvarnah (en persan Khorrah). « Il y avait, chez les anciens Perses, écrit le Shaykh al-Ishraq, une communauté dont les membres étaient guidés par le Vrai et qui par lui observaient l'équité. C'est leur haute philosophie de la Lumière dont témoigne d'autre part l'expérience personnelle de Platon avec celle d'autres sages antérieurs, que nous avons ressuscitée dans notre Livre de la Sagesse orientale. Et je n'ai pas de prédécesseur pour quelque chose comme cela. »
Cette tâche pour laquelle il n'eut point de prédécesseur le conduisit à mourir en martyr à sa cause, à Alep, à l'âge de trente-six ans, en l'an 1191 de notre ère. Mise en regard avec la brièveté tragique de sa vie, l'immensité de l'œuvre, qui opère à la synthèse de toutes les savoirs de son temps et les projette dans l'avenir par le recours aux philosophies oubliées, laisse pour le moins dubitatif quant aux supposés « progrès » de l'intelligence spéculative que certains nous vantent comme l'apanage de la modernité .
Si, par l'ampleur et la profondeur des vues, l'œuvre de Sohravardî demeure inégalée, il est possible cependant de lui trouver, sinon un prédécesseur, du moins une figure analogue. Le byzantin Gémiste Phléton, qui oeuvra en son temps, et sous l'évocation conjointe de Platon et de Zoroastre, au réveil des dieux antérieurs retrouva, à son insu, le sillage prophétique du poète-métaphysicien d'Azerbaïdjan.
Les crépuscules, nous dit Heidegger, détiennent le secret de l'aube. L'herméneutique créatrice de Sohravardî, par son engagement héroïque et visionnaire, est ainsi à la fois castalienne, portée par la source vive de l'anamnésis, du ressouvenir, et annonciatrice d'aubes pressenties. Son œuvre demeure la clavis herméneutica indispensable à ceux pour qui « l’homme de l'avenir est celui qui aura la mémoire la plus longue ». (Nietzsche). Les « Dieux-Anges » de la théologie platonicienne de Proclus, répondent du passé et du futur à ceux qui les invoquent dans la présence, dans l'être-là de leurs plus ardentes fidélités. Toute chevalerie spirituelle procède de cette invocation qui frappe d'inconsistance le temps linéaire.
Cette méditation héliotropique héritée des Sages de l'ancienne Perse, cette recouvrance des processions idéales de Proclus, favoriseront, aux marges du soufisme, l'équivalent ismaélien des théologies dionysiennes de Maître Eckhart et de Jean Tauler, qui fut en Iran durement persécutée, non sans préfigurer ce que seront, à quelques siècles de là, en Italie, les philosophies renaissantes de Pic de la Mirandole, de Marsile Ficin ou du Cardinal Egide de Viterbe. Lorsque les modes de la « déconstruction » seront passées, l'œuvre de Sohravardî apparaîtra comme une mise-en-demeure impérieuse à dépasser, en renaissances métaphysiques, le nihilisme qui dissocie le l'imagination et le Logos (en réduisant la première à une pure fantaisie subjective et le second à la banale et fastidieuse ratiocination).
Homme de guerre et d'extase, spéculatif autant que visionnaire, tour à tour dandy fastueux, comme Oscar Wilde et mendiant lumineux, comme Germain Nouveau, franchisseur des "portes de corne et d'ivoire" comme Gérard de Nerval et logicien implacable comme Aristote, Soharvardî fut, par excellence, le philosophe matutinal, celui qui annonce « les aurores qui n'ont pas encore lui ». L'Orient, dont parle le traité soharvardien, est bien l'aube levante d'une nouvelle conscience phénoménologique. « Cet Orient mystique suprasensible, écrit Henry Corbin, lieu de l'Origine et du Retour, objet de la quête éternelle, est au pôle céleste; il est le Pôle, un extrême-nord, si extrême qu'il est le seuil de la dimension au-delà. L'Orient que cherche le mystique, Orient non situable sur nos cartes est dans la direction du Nord, De ce nord cosmique choisi comme point d'orientation, seule une marche ascensionnelle peut rapprocher. »
Luc-Olivier d'Algange
19:24 | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
09/01/2026
Jünger, Heidegger, par-delà la ligne:

Ernst Jünger par-delà la ligne
Rien ne sera admis, reconnu, dépassé, redimé des temps d'abominable servitude que nous vivons tant que nous n'aurons point médité sur la ligne qui sépare le monde ancien du monde nouveau. Sur la ligne, c'est-à-dire, selon la réponse de Heidegger à Jünger, non seulement par-delà la ligne, au-dessus de la ligne, mais aussi, plus immédiatement à propos de la ligne. Faire de la ligne même le site de notre pensée et de son déploiement, c'est déjà s'assurer de ne point céder à quelque illusoire franchissement. Il s'en faut de beaucoup que l'au-delà soit déjà ici même. L'ici-même où nous nous retrouvons, en ce partage des millénaires, a ceci de particulier qu'il n'est plus même un espace, une temporalité mais une pure démarcation. Là où nous sommes, l'être s'est évanouit et jamais peut-être dans toute l'histoire humaine nous ne fûmes aussi dépossédés des prérogatives normales de l'être et ne fûmes aussi radicalement requis par la toute-possibilité.
Cette situation est à la fois extrêmement périlleuse et chanceuse. Le pari qui nous incombe n'est plus seulement de l'ordre de la Foi, - selon l'interprétation habituellement quelque peu limitative que l'on donne du pari pascalien, mais d'ordre onto-théologique. Certes, il existe un monde ancien et un monde nouveau. " Le domaine du nihilisme accompli, écrit Heidegger, trace la frontière entre deux âges du monde". Le monde ancien fut un monde où la puissance n'étant point encore entièrement dévouée à la destruction et au contrôle, s'épanouissait en oeuvres de beauté et de vérité. Le monde nouveau est un monde où la "splendeur du vrai", étant jugée inane, la morale, strictement utilitaire, soumise à une rationalisation outrancière, c'est-à-dire devenue folle, s'accomplit en oeuvres de destruction.
La radicalité même de la différence entre ces deux âges du monde nous interdit généralement d'en percevoir la nature. Le plus grand nombre de nos contemporains, lorsqu'ils ne cultivent plus le mythe d'une modernité libératrice, en viennent à croire que le cours du temps n'a point affecté considérablement les donnée fondamentales de l'existence humaine. Ils se trouvent si bien imprégnés par la vulgarité et les préjugés de leur temps qu'il n'en perçoivent plus le caractère odieux ou dérisoire ou s'imaginent que ce caractère fut également répandu dans le cours des siècles. La simple raison s'avère ici insuffisante. Une autre expérience est requise qui appartient en propre au domaine de la beauté et de la poésie. L'accusation d'esthétisme régulièrement proférée à l'encontre de l'oeuvre de Jünger provient de son approche plus subtile des phénomènes propres au nihilisme. Certes, un esthétisme qui n'aurait aucun souci du vrai et bien serait lui-même une forme de nihilisme accompli. Mais ce qui est à l'oeuvre dans le cheminement de Jünger est d'une autre nature. Loin de substituer la considération du Beau à toute autre, il l'ajoute, comme un instrument de détection plus subtil aux considérations issues de l'approche rationnelle. La vertu de l'approche esthétique jüngérienne se révèle ainsi dans la confrontation avec le nihilisme. Pour distinguer les caractères propres aux deux âges du monde dont il est question, encore faut-il rendre son entendement sensible aussi bien à la beauté familière et qu'à l'étrangeté.
Sur la ligne, les soufis diraient "sur le fil du rasoir", le moindre risque est bien d'être coupé en deux, ou d'être comme Janus, une créature à deux face, contemplant à la fois le monde révolu et le monde futur. Que l'on veuille alors aveugler l'une ou l'autre face, en tenir pour la nostalgie pure du passé ou pour la croyance éperdue en l'avenir meilleur, cela ne change rien à l'emprise sur nous du nihilisme. Penser le nihilisme trans lineam exige ce préalable: penser le nihilisme de linea. Le réactionnaire et le progressiste succombent à la même erreur: ils sont également tranchés en deux. La fuite en avant comme la fuite en arrière interdit de penser la ligne elle même. Toute l'attention du penseur-poète, c'est-à-dire du Coeur aventureux consistera à se tenir sur le méridien zéro afin d'interroger l'essence même du nihilisme, au lieu de se précipiter dans quelque échappatoire. En l'occurrence, Jünger, comme Heidegger, nous dit que toute échappatoire, aussi pompeuse qu'elle soit ( et comment ne pas voir que notre siècle est saturé jusqu'à l'écoeurement par la pomposité progressiste et réactionnaire ?) n'est jamais qu'une impardonnable futilité. Sur la ligne, nous dit Jünger "c'est le tout qui est en jeu". Sur la ligne, nous le sommes au moment où le nihilisme passif et le nihilisme actif ont laissé place au nihilisme accompli. Le site du nihilisme accompli est celui à partir duquel nous pouvons interroger l'essence du nihilisme. Après la destruction des formes, les temps ne sont plus à séparer le bon grain de l'ivraie. Le nihilisme, écrit Nietzsche est l'hôte le plus étrange, et Heidegger précise, "le plus étrange parce que ce qu'il veut, en tant que volonté inconditionnée de vouloir, c'est l'étrangeté, l'apatridité comme telle. C'est pourquoi il est vain de vouloir le mettre à la porte, puisqu'il est déjà partout depuis longtemps, invisible et hantant la maison." L'illusion du réactionnaire est de croire pouvoir "assainir", alors que l'illusion du progressiste est de croire pouvoir fonder cette étrangeté en une nouvelle et heureuse familiarité planétaire. Or, précise Heidegger: " L'essence du nihilisme n'est ni ce qu'on pourrait assainir, ni ce qu'on pourrait ne pas assainir. Elle est l'in-sane, mais en tant que telle elle est une indication vers l'in-demne. La pensée doit-elle se rapprocher du domaine de l'essence du nihilisme, alors elle se risque nécessairement en précurseur, et donc elle change."
La destruction des communautés, des corporations, des castes et des classes, qui est le signe du nihilisme moderne, serait donc à la fois l'instauration généralisée de l'insane et une indication vers l'indemne. Si le poète et le penseur doivent parier sur l'esprit qui vivifie contre la lettre morte, il n'est pas exclu que par l'accomplissement du nihilisme, c'est-à-dire la destruction de la lettre morte, une chance ne nous soit pas offerte de ressaisir dans son resplendissement essentiel l'esprit qui vivifie. Le précurseur sera ainsi celui qui ose et qui change et dont la pensée, à ceux qui se tiennent encore dans le nihilisme passif ou le nihilisme actif, paraîtra réactionnaire ou subversive alors qu'elle est déjà au-delà, ou plus exactement au-dessus.
Comment ne point aveugler l'un des visages de Janus, comment tenir en soi, en une même exigence et une même attention, la crainte, l'espérance, la déréliction et la sérénité ? Il n'est point vain de recourir à la raison, sous condition que l'on en vienne à s'interroger ensuite sur la raison même de la raison. Que nous dit cette raison agissante et audacieuse ? Elle nous révèle pour commencer qu'il ne suffit point de reconnaître dans tel ou tel aspect du monde moderne l'essence du nihilisme. La définition et la description du nihilisme, pour satisfaisantes qu'elle paraissent au premier regard, nous entraînent pourtant dans le cercle vicieux du nihilisme lui-même, avec son cortège de remèdes pires que les maux et de solutions fallacieuses. Vouloir localiser le nihilisme serait ainsi lui succomber à notre insu. Cependant l'intelligence humaine répugne à renoncer à définir, à discriminer: elle garde en elle cette arme mais dépourvue de Maître d'arme et d'une légitimité conséquente, elle en use à mauvais escient. Telle est exactement la raison moderne, détachée de sa pertinence onto-théologique. Etre sur la ligne, penser l'essence du nihilisme accompli, c'est ainsi reconnaître le moment de la défaillance de la raison. Cette reconnaissance, pour autant qu'elle pense l'essence du nihilisme accompli ne sera pas davantage une concession l'irrationalité. " Le renoncement à toute définition qui s'exprime ici, écrit Heidegger, semble faire bon marché de la rigueur de la pensée. Mais il pourrait se faire aussi que seule cette renonciation mette la pensée sur le chemin d'une certaine astreinte, qui lui permette d'éprouver de quelle nature est la rigueur requise d'elle par la chose même".
Le Coeur aventureux jüngérien est appelé à se faire précurseur et à suivre "le chemin d'une certaine astreinte". La raison n'est point congédiée mais interrogée; elle n'est point récusée, en faveur de son en deçà mais requise à une astreinte nouvelle qui rend caduque les définitions, les descriptions, les discriminations dont elle se contentait jusqu'alors. " Que l'hégémonie de la raison s'établisse comme la rationalisation de tous les ordres, comme la normalisation, comme le nivellement, et cela dans le sillage du nihilisme européen, c'est là quelque chose qui donne autant à penser que la tentative de fuite vers l'irrationnel qui lui correspond." A celui qui se tient sur la ligne, en précurseur et soumis à une astreinte nouvelle, il est donné de voir le rationnel et l'irrationnel comme deux formes concomitantes de superstition. Qu'est-ce qu'une superstition ? Rien d'autre qu'un signe qui survit à la disparition du sens. La superstition rationaliste emprisonne la raison dans l'ignorance de sa provenance et de sa destination, et dans sa propre folie planificatrice, de même que la superstition religieuse emprisonne la Théologie dans l'ignorance de la vertu d'intercession de ses propres symboles. L'insane au comble de sa puissance généralise cette idolâtrie de la lettre morte, de la fonction détachée de l'essence qui la manifeste. Aux temps du nihilisme accompli le dire ayant perdu toute vertu d'intercession se réduit à son seul pouvoir de fascination, comme en témoignent les mots d'ordre des idéologies et les slogans de la publicité. Dans sa nouvelle astreinte, le précurseur ne doit pas être davantage enclin à céder à la superstition de l'irrationnel qu'à la superstition de la raison. En effet, souligne Heidegger, " le plus inquiétant c'est encore le processus selon lequel le rationalisme et l'irrationalisme s'empêtrent identiquement dans une convertibilité réciproque, dont non seulement ils ne trouvent pas l'issue, mais dont ils ne veulent plus l'issue. C'est pourquoi l'on dénie à la pensée toute possibilité de parvenir à une vocation qui se tiennent en dehors du ou bien ou bien du rationnel et de l'irrationnel."
La nouvelle astreinte du précurseur consistera précisément à rassembler en soi les signes et les intersignes infimes qui échappent à la fois au rationalisme planificateur et à l'irrationalisme. La difficulté féconde surgit au moment où l'exigence la plus haute de la pensée, sa requête la plus radicale devient un refus de l'alternative en même temps qu'un refus du compromis. Ne point choisir entre le rationnel et l'irrationnel, et encore moins mélanger ce qu'il y aurait "de mieux" dans l'un et dans l'autre, telle est l'astreinte nouvelle de celui qui consent héroïquement à se tenir sur le méridien zéro du nihilisme accompli. Conscient de l'installation planétaire de l'insane, son attention vers l'indemne doit le porter non vers une logique thérapeutique, qui traiterait les symptômes ou les causes, mais au coeur même de cette attention et de cette attente pour lesquels nous n'avons pas trouvé jusqu'à présent d'autre mots que ceux de méditation et de prière, quand bien même il faudrait désormais charger ces mots d'une signification nouvelle et inattendue.
L'entretien sur la ligne Ernst Jünger et de Martin Heidegger ouvre ainsi à la raison qui s'interroge sur ses propres ressources des perspectives qui n'ont rien de passéistes et dont on est même en droit de penser désormais qu'elles seules n'apparaissent point comme touchées dans leur être même par le passéisme, étant entendu que le passéisme progressiste est peut-être, par son refus de retour critique sur lui-même, et par la méconnaissance de sa propre généalogie, plus réactionnaire encore dans son essence que le passéisme nostalgique ou néo-romantique. L'attention du précurseur, sa théorie, au sens retrouvé de contemplation, sera d'abord un art de ne pas refuser de voir. Quant à l'astreinte nouvelle, elle éveillera la possibilité d'une autre hiérarchie des importances où le vol de l'infime cicindèle n'aura pas moins de sens que les désastres colossaux du monde moderne. " De même, écrit Jünger, les dangers et la sécurité changent de sens". Comment ne pas voir que les modernes doivent précisément à leur goût de la sécurité les pires dangers auxquels ils se trouvent exposés ? Et qu'à l'inverse l'audace, voire la témérité de quelques uns furent toujours les prémisses d'un établissement dans ces grandes et sereines sécurités que sont les civilisations dignes de ce nom ?
L'homme moderne, ne croyant qu'à son individualité et à son corps, désirant d'abord la sécurité de son corps, ne désirant, en vérité, rien d'autre, est l'inventeur du monde où la vie humaine est si dévaluée qu'il n'y a presque plus aucune différence entre les vivants et les morts. C'est bien pourquoi le massacre de millions d'êtres humains dans son siècle "rationnel, démocratique et progressiste" le choque moins que la violence d'un combat antique ou d'une échauffourée médiévale, pour autant que sa sécurité, son individualité ou, dans une plus faible mesure, celles des siens, ont été épargnées. Le nihilisme de sa propre sécurité s'établit dans le refus de voir le nihilisme du péril auquel il n'a cessé de consentir que d'autre que lui fussent livrés, et se livrant ainsi lui-même à leur vindicte. Les Empereurs chinois savaient ce que nous avons oublié, eux qui considéraient leurs armes défensives comme les pires dangers pour eux-mêmes. Les Coeurs aventureux, ou selon la terminologie heiddegerienne, les précurseurs, trouveront la plus grande sécurité dans leur consentement même à se reconnaître dans le site du plus grand danger. De même qu'au coeur de l'insane est l'incitation vers l'indemne, au coeur du danger se trouve le site de la plus grande sécurité possible. Comment sortir indemne de l'insane péril ( qui prétend par surcroît avoir inventé la sécurité comme Monsieur Jourdain la prose !) où nous a précipité le nihilisme ? Quelle est la ligne de risque ?
Certes, le méridien zéro n'est nullement ce "compteur remis à zéro" dont rêve la sentimentalité révolutionnaire. Ce méridien, s'il faut préciser, n'est point une métaphore de la table rase, ou le site d'un oubli rédimant. Le méridien zéro est exactement le lieu où rien ne peut être oublié, où toute sollicitation extérieure répond d'une réminiscence, comme le son répond à la corde que l'on touche, où l'empreinte ne prétend point à sa précellence sur le sceau. Ce qui advient, pas davantage que ce qui fut, ne peut prétendre à un autre titre que celui d'empreinte, le sceau étant l'hors-d'atteinte lui-même: l'indemne qui gît au secret du coeur du plus grand danger. La ligne de risque de la vie et de l'oeuvre jüngériennes répond de cette certitude acquise sur la ligne.
Toute interrogation fondamentale concernant la liberté est liée à la Forme. Si le supra-formel, en langage métaphysique, bien l'absolu de la liberté, le propre de ceux que l'hindouisme nomme les libérés vivants, l'informe, quant à lui, est le comble de la soumission. La question de la Forme se tient sur cette ligne critique, sur ce méridien zéro qui ouvre à la fois sur le comble de l'esclavage et sur la souveraineté la plus libre qui se puisse imaginer. Dès Le Travailleur, et ensuite à travers toute son oeuvre, Jünger poursuivit, comme nous l'avons vu, une méditation sur la Forme. Or, cette méditation, platonicienne à maints égards, est aussi inaugurale si l'on ose la situer non plus dans l'histoire de la philosophie, comme un moment révolu de celle-ci mais sur la ligne, comme une promesse de franchissement de la ligne. Ce qu'il importe désormais de savoir, c'est en quoi la Forme contient en elle à la fois la possibilité du déclin dans le nihilisme ( dont l'étape d'accomplissement serait la confusion de toutes les formes: l'uniformité) et la possibilité d'une recréation de la Forme, voire d'un dépassement de la Forme dans une souveraineté jusqu'ici encore non pressentie. Par les figures successivement interrogées du Travailleur, du Rebelle et de l'Anarque, Jünger s'achemine vers cette souveraineté. Pour qu'il y eût une Forme, au sens grec d'Idéa, et non seulement au sens moderne de "représentation", il importe que la réalité du sceau ne soit pas oubliée.
Une lecture extrêmement sommaire des oeuvres de Jünger et de Heidegger donnerait à penser que lorsque Heidegger tenterait un dépassement, voire un renversement ou une "déconstruction" du platonisme, Jünger, lui s'en tiendrait à une philosophie strictement néo-platonicienne. Le dépassement heideggérien de la métaphysique, qui tant séduisit ses disciples français "déconstructivistes" ( et surtout acharnés, sous l'influence de Marx, à détacher toute philosophie de ses origines théologiques) laissa, et laisse encore, d'immenses carrières à l'erreur. Les modernes qui instrumentalisent l'oeuvre de Heidegger en vue d'un renversement du platonisme et de la métaphysique méconnaissent que, pour Heidegger, dépassement de la métaphysique signifie non point destruction de la métaphysique mais bien couronnement de la métaphysique. Il s'agit moins, en l'occurrence, de se libérer de la métaphysique que de libérer la métaphysique. Il n'est point question de la déconstruire, pour en faire table rase, que d'en établir la souveraineté en la dépassant par le haut, c'est à dire par la question de l'être. Pour un grand nombre d'exégètes français la différence essentielle entre une anti-métaphysique et une métaphysique couronnée demeure obscure. Heidegger ne reproche point à la métaphysique de s'interroger sur l'essence, il lui impose au contraire, comme une astreinte nouvelle, de s'interroger plus essentiellement encore sur l'essence de son propre déploiement dans le Logos. A la métaphysique déclinante des théologies exotériques, des sciences humaines, de la didactique, de la Technique et du matérialisme, Heidegger oppose une interrogation essentielle sur le déclin lui-même.
En établissant clairement son dépassement de la métaphysique comme un couronnement de la métaphysique, Heidegger suggère qu'il y a bien deux façon de dépasser, l'une par le bas ( qui serait le matérialisme) l'autre par le haut, et qui est de l'ordre du couronnement. Loin de vouloir "en finir", au sens vulgaire, avec la métaphysique, Heidegger entend en rétablir sa royauté. Par l'interrogation incessante sur les fins et sur la finalité de la métaphysique, Heidegger oeuvre à la recouvrance de la métaphysique et non à sa solidification. Qu'est-ce qu'une métaphysique couronnée ? De quelle nature est ce dépassement par le haut ? Que le déclin de la métaphysique eût conduit celle-ci de la didactique à la superstition de la technique, du nihilisme passif jusqu'au nihilisme accompli, en témoignent les théories modernes du langage et l'humanisme qui ne voit en l'homme qu'un animal "amélioré" par le langage. Ce que Heidegger reproche à ces théories du langage et de l'homme est d'ignorer la question de l'essence de l'homme et de l'essence du langage, et d'être en somme, des métaphysiques oublieuses de leurs propres ressources.
Le dialogue entre Jünger et Heidegger, que le bon lecteur ne doit pas circonscrire à l'échange hommagial et épistolaire sur le passage de la ligne mais étendre aussi aux autres oeuvres, prend tout son sens à partir des méditation jüngériennes sur le langage et l'herméneutique. En effet, loin de rompre avec la source théologique, Heidegger en fut le revivificateur éminent par l'art herméneutique qu'il ne cessa d'exercer au contact des oeuvres anciennes, les présocratiques, Aristote, ou modernes, Hölderlin, Trakl, ou Stephan George. De même Jünger, en amont des gloses, des analyses et des explications poursuivit le dessein de retrouver, dans les signes et les intersignes, la trace des dieux enfuis. Entre les noms des dieux et leurs puissances, entre l'empreinte et le sceau, entre le langage et la langue, entre ce que doit être dit et ce qui est dit, l'Auteur s'établit avec une inquiétude créatrice. Ce serait se méprendre grandement sur la méditation sur la Forme qui est à l'oeuvre dans les essais de Jünger que de n'y voir qu'une reproduction d'un néoplatonisme acquis et défini une fois pour toute, et réduit, pour ainsi dire à des schémas purement scolaires ou didactiques. Se tenir sur la ligne, c'est déjà refuser d'être dans la pure représentation. Entre la présence et son miroitement se joue toute véritable et féconde inquiétude spéculative.
Luc-Olivier d'Algange
Extrait de Le déchiffrement du monde, la gnose poétique d'Ernst Jünger, éditions de L'Harmattan, collection Théôria.
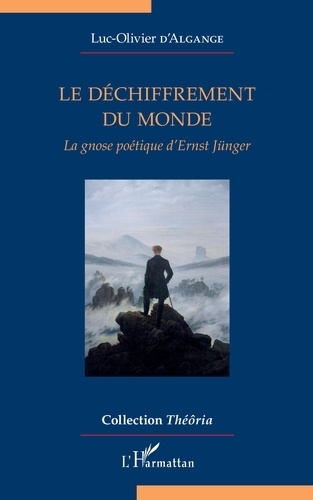
23:31 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
02/01/2026
Luc-Olivier d'Algange, Mythe et Logos:

19:16 | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
27/12/2025
Hommage à Pascal Vinardel:

A quoi bon l'an neuf s'il ne prélude à de nouvelles découvertes ? Il est bien de dire tout le mal que l'on peut penser de l'art gonflable, des ostentations subventionnées du mauvais goût, des transgressions faciles et du conformisme de la laideur, mais il est mieux, infiniment, de rendre hommage aux véritables artistes , surtout lorsque nous avons le bonheur d'être leurs contemporains, et qu'ils savent, comme Pascal Vinardel, saisir le génie de la lumière naissante, ou du soir qui vient, dans une oeuvre dont la fidélité aux Maîtres n'ôte rien à son irréductible singularité, ni à son mystère destiné à se prolonger dans la mémoire.
L'oeuvre de Pascal Vinardel est dans cet hors du temps où nous retrouvons le monde tel qu'il demeure, - et dont nous aurons alors le bonheur de faire notre demeure. Le Mystère, au sens orphique, sera de nous retrouver en des lieux qui n'existent pas mais dans lesquels nous existerons, pour déployer, envers et contre tout, la dignité des êtres et des choses. Nul mieux que Pascal Vinardel ne sut peindre les orées de la lumière qui advient ou s'éloigne. C'est à l'aurore et crépuscule que, dans son oeuvre, s'ouvrent les ailes de l'Ange.
°°°
Une lettre de Pascal Vinardel:
25 Juillet 2025
Cher Luc-Olivier d'Algange,
J'ai bien reçu votre beau livre que je me suis empressé d'ouvrir.
Dès les premières pages, au travers des voilages somptueux de votre langue, j'ai entrevu le fantôme d'un immense bonheur à retrouver.
Il me semble aussi que vous parlez d'un temps millénaire, que vous revenez vers nous pour mesurer le désastre et nous parler de royaumes inouïs.
Reviendront-ils ?
Admiration et amitié,
Pascal Vinardel.
°°°
Notice biographique :
Pascal Vinardel est né le 29 avril 1951, à Casablanca, dans le Maroc du protectorat français dont il gardera la nostalgie.
Issu d’une famille d’intellectuels et de musiciens, il s’oriente très tôt vers la peinture.
Rentré en France en 1965, il poursuit ses études au lycée Janson de Sailly à Paris, puis après l’obtention d’un baccalauréat littéraire en 1969, il est admis à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris dont il obtient le diplôme en 1972.
Après avoir été primé à plusieurs occasions, il est reçu en 1974 au concours de la Casa Velázquez. De retour à Paris après un séjour de deux ans à Madrid, il rencontre ses premiers marchands, et d’importants collectionneurs commencent à remarquer ses travaux.
Pascal Vinardel affermit dès cette époque une réputation de peintre secret, à l’écart des modes de son temps.
En 1977, il participe à l’exposition « Ateliers Contemporains » au Centre Georges Pompidou, Paris.
En 1980, il participe à l’exposition « Figuration d’aujourd’hui » à l’Hôtel de Ville, Paris.
Parallèlement , ses œuvres seront montrées lors d’expositions personnelles à la galerie Albert Loeb en 1980 puis en 1984 à Paris.
De 1980 à 1988, François Mitterand, alors Président de la République, deviendra un de ses collectionneurs
et fera acquérir par l’Elysée quelques unes de ses œuvres pour les chefs d’états étrangers.
En 1988, exposition personnelle à la F.I.A.C au Grand Palais à Paris
par la galerie François Ditesheim, puis en 1989 et en 2003 dans cette même galerie, à Neuchâtel en Suisse
En 1990, il épouse la peintre /graphiste Rima Shaw . Ils ont une fille née à Paris en 1995
De 1994 à 2000, il dirige un atelier de peinture à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris
En 2002, première rétrospective à L’espace Culturel des Dominicaines, à Pont-l’Evêque en Normandie
En 2003, exposition personnelle à la galerie Visconti et simultanément à la galerie Francis Barlier. Paris
En 2004, exposition personnelle à ART PARIS au Carrousel du Louvre par la galerie Visconti.
En 2009, exposition personnelle à la galerie Vincent Pietryka qui montrera en 2011 ses dessins et ses lavis au Grand Palais
lors du salon « du dessin et de l’estampe »
En 2012, parution de la monographie « Pascal Vinardel, une oeuvre » aux éditions Mezzo,
textes de Jean-Philippe Domecq, Jérôme Godeau, James Lord, Frédéric Musso, Pascal Riou, Jaime Semprun et Anne de Staël.
En 2013, il est nommé Chevalier des Arts et des Lettres.
Ses lavis seront exposés cette année-là au musée Angladon en Avignon, à l’occasion de l’événement
« A livre ouvert » en collaboration avec la Revue Conférence.
De 2013 à 2017, ses œuvres seront régulièrement exposées à la galerie Francis Barlier, Paris
En 2017, une de ses œuvres majeures intitulée « les portes du fleuve » (200x 320 cm) évoquant la ville de Bordeaux,
a été montrée lors de l’exposition collective de prestige « Présence de la peinture en France( 1974-2016) »
à la Mairie du Vème, place du Panthéon, Paris.
En 2019, ses œuvres récentes ont été présentées à la galerie Nicolas Deman, Paris
22:57 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
23/12/2025
Ode au Cinquième Empire, lu par Carolyne Cannella:
17:25 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
17/12/2025
Raymond Abellio, le roman du huitième jour:

Luc-Olivier d'Algange
Raymond Abellio, le roman du huitième jour
« Je n'étais qu'une ombre parmi les ombres, mais je sentais bouger en moi ce monde ultime où la pensée devient acte et purifie le monde, sans geste ni parole, toute seule, par la seule vertu de sa rigueur, de sa claire magie. »
Raymond Abellio
Le roman « idéologique » de Raymond Abellio outrepasse l'idéologie au sens restreint d'une partialité humaine, liée à des appartenances ou des circonstances historiques. C'est un roman engagé dans le désengagement, décrivant les conditions de l'advenue de l'Inconditionné. En allant aux confins de la psychologie, il importe à l'auteur de passer de l'autre côté, là où toute psychologie devient métaphysique, toute politique, gnose. Le roman d'Abellio s'achemine vers la « conversion du regard », ou, mieux encore, il est le cheminement de la conversion du regard à travers les apparences d'un monde transfiguré, impassible et lumineux, où les ténèbres mêmes sont devenues les ressources profondes du jour. Qu'importe un récit qui n'a pas pour ambition ultime de dire le huitième jour ? Qu'importe un personnage dont l'auteur n'ôte point le masque humain ? Qu'importe une histoire qui n'est point le signe visible d'une hiéro-histoire ? Qu'importe le visible s'il n'est point l'empreinte de l'invisible ? Qu'importe l'instant qui ne tient pas au cœur de l'éternité ?
La vaste orchestration abellienne, dont l'ambition romanesque n'est pas sans analogie avec celle de Balzac, semble n'avoir d'autre dessein que ce basculement à la fois final et inaugural dans l'éternel. Mais pour abolir le Temps, pourquoi écrire romans et mémoires qui semblent être, au contraire, des modes d'accomplissement de la temporalité ? Pour quelles raisons Abellio, qui visait à une sorte de monadologie leibnizienne appliquée à l'épistémologie contemporaine, ne s'est-il point limité à l'exposé didactique de la structure absolue ? « Ma plus haute ambition, écrit Raymond Abellio, c'est en effet d'écrire le roman de cette structure absolue, à travers les bouleversements qu'entraîna pour moi cette découverte, et d'écrire à ce sujet non pas un essai philosophique romancé, ou un roman bâtard, mais un vrai roman, celui de ma propre vie, replacée dans cette genèse, et, à cet égard, toute vie sachant reconnaître les signes est selon moi un sujet d'une valeur romanesque sans égale, le seul sujet. »
La structure absolue de Raymond Abellio se distingue d'abord du structuralisme universitaire en ce qu'elle est une structure mobile. La structure absolue n'est pas un schéma mais un tournoiement de relations qui s'impliquent les unes dans les autres, jusqu'à ce vertige que Raymond Abellio nomme « le vertige de l'abîme du Jour ». Or, qu'est-ce qu'un roman lorsqu'il se délivre du positivisme sommaire de la psychologie et de la sociologie, sinon la victoire de « l'abîme du jour » sur « l'abîme de la nuit » ? Les forces obscures, destructrices, qui hantent les personnages d'Abellio (et ne sont pas sans analogie, à cet égard, avec ceux de Dostoïevski) sont la « matière première » au sens alchimique, du Grand-Œuvre qui portera le roman idéologique jusqu'à l'incandescence du roman prophétique. Le paroxysme de l'événement est effacement de l'événement.
Drameille, dans La Fosse de Babel, précise que l'on ne peut décrire un effacement. En revanche, il est possible, à l'écrivain de l'extrême, de décrire un paroxysme, « cette floraison d'un Dieu si plein de lui-même que martyrs et criminels s'y confondent. » Avant la grande libération solaire, il faut passer par l'ascèse nocturne de l'action :« Les hommes ne retrouveront le sens du sacré qu'après avoir traversé tout le champ du tragique. » La passion encoreinvisible du « dernier Occident » s'accomplira dans « la montée nocturne du roman où s'efface sans cesse et se renouvelle le pouvoir des mots. »
L'œuvre de Raymond Abellio rejoint ainsi l'ambition continue de la philosophie grecque, des présocratiques jusqu'aux néoplatoniciens, qui est de changer l'Eris malfaisante en Eris bienfaisante: « Les hommes les plus torturés par l'impossible peuvent passer pour des êtres en repos, mais leur passivité met en action, dans l'invisible, les forces les plus puissantes ». Le parcours de Raymond Abellio, de la politique à la gnose, relate ce passage de l'Eris néfaste à l'Eris faste. L'ascèse personnelle de Raymond Abellio consistera pour une grande part à juguler en lui la violence tragique et dostoïevskienne de l'ultime Occident et à dépasser, par le haut, le nihilisme des idéologies antagonistes: « Il fallait alors regrouper secrètement, au-delà de toutes les idéologies, la minorité européenne déjà consciente de sa future prêtrise. ». Le premier chapitre de son roman significativement intitulé Heureux les Pacifiques débute précisément par un meurtre inaccompli. L'ennemi véritable n'est pas celui que paraissent désigner, au demeurant de façon toujours obscure ou aléatoire, les circonstances historiques. L'Ennemi véritable est le Moi. Pour atteindre le Soi, il faut tuer le Moi. Les romans d'Abellio décrivent l'élévation transfigurante, avec ses dangers, ses écueils et ses échecs, de la « petite guerre sainte » à la « grande guerre sainte » qu'évoquait René Daumal.
L'œuvre de Raymond Abellio est de celles pour qui le monde existe. Là où le romancier du singulier ratiocine en exacerbant son recours à l'analyse psychologique ou en se perdant en volutes formalistes, le romancier de l'extrême vit son œuvre comme « la triple passion de l'éthique, de l'esthétique et de la métaphysique. »Le singulier enferme l'individu en lui-même. L'extrême le conduit à ses propres limites qui non seulement le révèlent à lui-même mais changent le miroir du Moi en une vitre murmurante, voire en un vitrail dont les couleurs sont clairement délimitées mais dont les accords sont infiniment variés par le mouvement de la lumière. Les rosaces des cathédrales sont les figures versicolores de la Structure Absolue. A la fois dans le temps et en dehors du temps, révélant l'éternité par la mobilité de ses dialectiques entrecroisées, la structure absolue circonscrit l'abîme du jour de la conscience dans sa rotation solaire, dans son ensoleillement génésique. Tout pour le romancier, comme pour le gnostique (et la phénoménologie husserlienne dont se revendiquera Abellio se définit elle-même comme une « communauté gnostique ») se joue dans la conscience, qui est « le plus haut produit de l'être ».
Le roman digne de ce nom, qui entretient encore quelque rapport avec une spiritualité romane, sera donc le roman d'une ou de plusieurs « consciences en action ». A la ressemblance des romans de Stevenson, de Conrad ou de John Buchan, les romans d'Abellio inventent des personnages qui se mesurent aux évidences et aux ténèbres du monde. Ces personnages « lucifériens » ne croient point abuser de leurs forces en allant « au cœur des ténèbres », voire au cœur du « typhon ». Leur quête de l'immobilité centrale passe par l'expérimentation des tumultes et des tourbillons les plus périlleux. N'est-il point dit dans les récits du Graal que le château périlleux « tourne sur lui-même »? Pour n'être point rejeté dans les ténèbres extérieures, il importe de saisir au vif de l'instant l'opportunité excellente. C'est bien cette prémisse qui donne à la gnose abellienne le pouvoir de subjuguer le récit et de susciter un romancier qui, en toute conscience, domine son genre, sans nuire à l'impondérable vivacité: « Chaque fois j'ai vécu d'abord, réfléchi ensuite. J'ai même parfois revécu assez vite pour être obligé de détruire ce que j'avais écrit. Mais qui me comprendra ? Un seul roman dans toute ma vie, ce devrait être assez, quand la vie est finie en tant que récit et qu'en tant que réalité, elle commence. »
Alors que Les Chemins de la liberté de Sartre s'alourdissent de l'insistance avec laquelle son auteur défend sa thèse, la trilogie abellienne (ou la tétralogie, selon que l'on y intègre ou non son premier roman Heureux les Pacifiques) fait jouer la structure absolue dans tous les sens et se refuse aux vues édifiantes, laissant au lecteur la possibilité d'une lecture périlleuse, où la conscience ne peut compter que sur ses propres pouvoirs pour discerner le Bien et le Mal, autrement dit, la Grâce et la pesanteur. Si Abellio est bien le contraire d'un donneur de leçons, il est fort loin de se complaire dans un immoralisme qui ne serait que la floraison parasitaire de la morale qu'il condamne. Il peut ainsi fonder une éthique, directement reliée à l'esthétique et à la métaphysique. La morale abellienne est cette fine pointe où la pensée de Nietzsche rejoint la théologie de Maître Eckhart.
Dans leurs fidélités et dans leurs transgressions, c'est bien à la recherche d'une morale que s'en vont les personnages de Raymond Abellio et à travers eux, Raymond Abellio lui-même. Mais cette morale n'est pas une morale utilitaire, une morale de la récompense ou du marchandage, mais une morale héroïque et sacerdotale. Pour Raymond Abellio, le péché, c'est l'erreur. A ce titre, le péché ne doit point conduire à la culpabilité mais à un repentir, au sens artistique. Le penseur est un archer: il doit apprendre à ajuster son tir. Pécher, c'est rater le cible. La méditation du repentir favorise une plus grande exactitude. Le moralisateur se trouve en état de péché continuel, lui qui à force de s'occuper des archets d'autrui, ne cesse de manquer, dans sa propre relation au monde, la cible du Bien, du Beau et du Vrai. A cet égard, l'œuvre de Raymond Abellio relève bien d'une ascèse pascalienne.
Les romans de Raymond Abellio sont pascaliens par leur dramaturgie qui décrit la rencontre, à travers les personnages, de l'esprit de finesse, qui saisit les nuances du moment, et de l'esprit de géométrie, qui entrevoit les vastes configurations où s'inscrivent les destinées humaines, collectives ou individuelles. L'œuvre n'est pas moins novatrice lorsqu'elle délivre le sens du destin, le fatum des tragédies et des romans de Balzac, du déterminisme purement naturaliste. Dans La Fosse de Babel ou Visages immobiles, le destin individuel n'a pas une moindre signification que le destin collectif. L'individuel et le collectif s'entretissent si bien qu'il n'est aucune complexité, ni aucune puissance, qui ne dussent être saisies et dominées par l'entendement. Loin de soumettre l'individu, de lui ôter son libre-arbitre, l'interdépendance universelle, qui est l'a-priori théorique de la structure absolue, restitue la personne à sa souveraineté bafouée par l'individualisme de masse .
Si les mouvements majestueux des astres influent sur nos destinées, Abellio ne manquera pas de rappeler qu'un homme qui étend ses bras change l'ordre des constellations, fût-ce de manière infime. Mais qui est juge de l'importance de l'infime ou du grandiose ? Lorsque l'esprit de finesse coïncide avec l'esprit de géométrie, l'infime et le grandiose s'impliquent l'un dans l'autre dans un ordre de grandeur où la qualité entre en concordance avec la quantité sans plus être écrasée par elle, comme par sa base, la pointe d'une pyramide inversée. Tout auteur, qui n'entend pas être réduit au rôle de pourvoyeur de distractions ou d'homélies à conforter la bonne conscience du médiocre, ne peut témoigner en faveur de son art sans avoir entrepris, au préalable, une critique radicale des morales, des valeurs et des savoirs qui prétendent au gouvernement absolu des hommes par l'exclusion de toute métaphysique et de toute transcendance. Conjoignant la finesse du romancier et la géométrie du métaphysicien, s'inscrivant ainsi dans la voie royale de la haute-littérature - de la Délie de Scève jusqu'aux Nouvelles Révélations de l'Etre d'Antonin Artaud - l'œuvre de Raymond Abellio veut définir l'espace nécessaire à de nouvelles advenues de l'Intellect.
Ces advenues seront transdisciplinaires, européennes, tiers-incluantes et gnostiques : « Si aujourd'hui, en Europe, la politique n'est plus qu'affairisme ou futilité, une supra-politique est train de naître, qui n'est encore que pressentiment et reste au stade de la non-politique. Le grand drame intérieur de Kierkegaard, Dostoïevski, Nietzsche, Kafka et Husserl, qui s'est dilué chez les épigones en scolastiques de minuties incapables de rapprocher les signes, devient le drame même de l'histoire. Sur la sous-humanité, par une juste compensation, une surhumanité tente de naître. Dans un monde où toute relation véritable est rompue, elle seule vit, dans sa solitude, la triple et unique passion de l'éthique de l'esthétique et du religieux, d'où sortira un comble de relation: une religion nouvelle. » Mais cette religion nouvelle sera essentiellement christique, comme une possibilité, en attente ardente, autant qu'en péril, de la sophia perennis.
Luc-Olivier d'Algange
Deux lettres de Raymond Abellio
Vence, le 5 février 1986
Cher Luc-Olivier d'Algange,
La revue Pictura et votre lettre m'ont été retransmises à Vence, où je passe durant l'hiver, la majeure partie de mon temps. Merci pour l'une et l'autre et tous mes compliments pour votre article sur les néoplatoniciens: vous y abordez de grands et multiples sujets, dans une parfaite clarté, ce qui n'est pas si simple, et j'y ai retrouvé avec bonheur nombre de thèmes qui me passionnent et dont je serais heureux de parler avec vous. Car nous pouvons, si vous le désirez, nous rencontrer, soit ici, soit à Paris, soit à Toulouse où je serai, en principe, au début du mois de mai.
N'ayant reçu Pictura qu'hier soir, je n'ai pu lire que votre article dont je ne vois pas encore comment il s'intègre au reste de la revue, mais peut-être cet éclectisme est-il voulu. Dites-moi ce qu'est Pictura.
Vous donner un texte m'est plus difficile que vous rencontrer; je travaille en ce moment à un essai qui me prend tout mon temps et me fatigue beaucoup. A mon âge, il est à peu près impossible de mener deux choses de front. Mais j'ai avec moi un petit groupe d'amis bien plus compétent en matière de Kabbale et de Yi-king, par exemple. Je pourrais les mettre en rapport avec vous.
Soyez assuré en tous cas du vif plaisir que j'ai à vous lire, et, en attendant de faire votre connaissance, croyez-moi, je vous prie, bien sympathiquement vôtre.
Raymond Abellio.
*
Vence, le 27 février 1986
Cher Luc-Olivier d'Algange
Un grand merci pour votre envoi (lettre et article destiné à Question de). Question de est une revue que je connais bien et qui, en gros, m'a toujours soutenu. Robert Amadou, qui y écrit, est mon ami. Je n'en dirai pas autant de l'Université en général, à l'exception de non-conformistes comme François George, qui dirige la revue Liberté de l'Esprit, fort éclectique, il est vrai, - mais il faut être agrégé de philosophie pour être admis dans le milieu professoral, et le groupe d'influence qui s'est créé autour de Foucault, Barthes, Derrida, Lyotard, est encore tout puissant, et l'accès à la collection La Bibliothèque des Idées, chez Gallimard, est devenu impossible, je pense, à qui n'est pas "du métier". La parution de la "Structure Absolue" n'y fut possible que grâce aux efforts d'un ami politique, Robert Carlier, qui sut convaincre Michel Deguy. Il y fallut quand même des mois de palabres.
Je serai à Toulouse le 29 avril pour une conférence à l'Hôtel d'Assezat, sous l'égide de l'Académie des Jeux Floraux et resterai dans ma bonne ville natale (qui m'a remarquablement ignorée jusqu'ici) jusqu'au 3 mai. Nous pouvons nous rencontrer avant, à Paris ou à Vence, si vous le désirez, mais ce séjour à Toulouse nous donnera toute liberté.
A bientôt donc, et toujours bien sympathiquement vôtre
Raymond Abellio.
21:44 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
16/12/2025
Jean-Pierre Melville dans le Cercle Rouge:
Jean-Pierre Melville dans le Cercle Rouge
Un témoignage de Jean Parvulesco sur Jean-Pierre Melville
Alors que pour n’importe quel avortement mondain la grande presse prend feu et flambe comme de la paille sèche, les meneurs cachés de la désinformation générale ont décidé que la mort de Jean-Pierre Melville devait être passée sous un éclairage ultra-diminué : à quelques rares, trop rares exceptions près, cette consigne, il faut le reconnaître a été plutôt bien suivie. La tristesse glaciale et ambiguë, par ailleurs si parfaitement urbaine, prévue, ainsi, pour signaler la disparition de Jean-Pierre Melville n’a donc pas manqué de sombrer, sur commande, dans une rhétorique de circonstance, factice, conventionnelle et vide, dont l’inauthenticité patente frisait l’obscénité peut-être plus encore que la provocation. Tout cela s’est vu, épargnons-nous, par décence envers nous-mêmes, les citations appropriées.
L’homme seul, et si serein dans son désespoir absolu, qui, en moins de cinq ans, a su donner au cinéma français, Le Samouraï, L’Armée des Ombres, Le Cercle Rouge, c’est-à-dire ses seules armes actuelles de violence et d’action totale, l’homme qui avait su comprendre, et avec quelle discrétion hautaine, que la dernière chance d’un cinéma allant contre la mise en abjection générale était la tragédie et que la tragédie, aujourd’hui, au-delà de la politique, ne saurait plus être que morale, l’homme du dernier et suprême combat de la fatalité héroïque, qui est combat contre soi-même, ne méritait-il pas qu’on lui laissât l’honneur de s’en aller sans que l’on fasse donner, pour lui, la faquinade parisienne et ses minables chacaleries du prêt à porter sentimental, lui infligeant ainsi, sournoisement, et comme pour une dernière fois, ce qu’il avait le plus exécré, le plus haï dans sa vie ?
Jean-Pierre Melville n’était pas, Jean-Pierre Melville n’a jamais été des leurs. Ces jeunes larves fatiguées de ne pas être qui dictent, aujourd’hui, dans le cinéma français, leur loi de subversion et de déchéance avantageuse, Jean-Pierre Melville les vomissait de tout son être, et jusqu’au vomito nero, spécialité comme on le sait, des Papes qui s’en vont en état de désespoir, et marquent leur agonie d’un signe d’épouvante et de malédiction. Il faut dire, aussi, que les autres le lui rendaient bien. Ce n’est peut-être pas qu’ils avaient déjà tellement envie qu’il s’en aille tout de suite, mais ils n’avaient pas non plus tellement l’envie qu’il s’attardât encore. Depuis quelque temps Jean-Pierre Melville commençait vraiment à être de trop.
Mais d’où leur vint-elle donc cette haine inavouable autant qu’inextinguible, la méfiance active qu’ils n’ont pas fini d’entretenir à l’égard de l’auteur de L’Armée des Ombres, cette ségrégation à plaie ouverte qui lui a été si efficacement prodiguée le long de ces dernières années ? C’est que Jean-Pierre Melville était lucidement, et comme fatalement, un homme de droite, ainsi que le soulignait Jean Curtelin, - et si tant est que cette séparation douteuse entre la gauche et la droite puisse encore avoir, aujourd’hui, un sens autre que celui que s’acharnent à lui imposer le fanatisme halluciné, l’obscurantisme retardataire de ceux pour qui la gauche reste l’alibi d’une irrémédiable impuissance d’être en termes de destin.
D’autre part, plus qu’un homme seul, Jean-Pierre Melville était un homme séparé, un activiste forcené du vide qui sépare du monde et des autres, un fanatique glacé et serein du vide qui traduit tout en terme d’infranchissable. Le secret de sa vie tenait, tout entier, dans ce que Nietzsche appelait le pathos de la distance.
La séparation, pourtant, ni l’éloignement du monde, n’étaient, chez Jean-Pierre Melville, une forme de désertion, bien au contraire. Le monde, pour lui, il ne s’agissait pas de le fuir, mais de le changer. Car tel est l’enseignement intérieur de l’engagement pris par Jean-Pierre Melville envers sa propre vie, sa relation souterraine avec ce que Rimbaud avait appelé « la vraie vie » : ne pas changer soi-même devant le monde, mais changer le monde afin qu’il se rende conforme et s’identifie au rêve occulte, à l’image lumineuse et héroïque que l’on porte au fond de soi. Comment transfigurer, comment changer le monde si, comme le dit, toujours, Rimbaud « le vrai monde es ailleurs ». Aux voies dites traditionnelles, Jean-Pierre Melville avait su préférer l’action directe, la vie de l’action directe, l’action occulte d’un petit nombre de prédestinés à l’accomplissement des grandes entreprises subversives du siècle, et qui, piégés à l’intérieur du Cercle Rouge, changent, pour s’en sortir, les états du monde, le cours de l’histoire et de la vie. Et c’est ainsi que Jean-Pierre Melville avait trouvé dans l’action politique, dans ses options subversives d’extrême-droite : une confrérie, une caste de combattants de l’ombre qui s’imposent à eux-mêmes une rigueur, un dépouillement terrible, indifférents aux résultats immédiatement visibles de leur action, attentifs seulement aux exigences de leur sacrifice et à la gloire cachée de leur longue rêverie activiste sur le mystère du pouvoir absolu.
En ce qui me concerne, c’est en termes de caste spirituelle, ainsi que l’eussent fait, à coup sûr, les Treize de Balzac constitués en société secrète de puissance, que je me risque à parler de Jean-Pierre Melville comme d’autres n’ont pas su, n’ont pas voulu ou, tout simplement, n’ont pas eu le courage de le faire, la terreur conjuguée du gauchisme qui se montre trop et du grand argent qui ne se cache plus assez les tenant tous à la gorge impitoyablement. Mais moi je n’ai plus rien à perdre. Alors, pourquoi ne parlerais-je.
Un cinéma chiffré en profondeur
Ce même combat de l’ombre, Jean-Pierre Melville le retrouve, avec son cinéma le plus grand, dans l’exploration des réprouvés suicidaires de la société et de leur milieu secret, exploration qu’il poursuit, lui-même à la fois lucide et fasciné, jusque dans les derniers retranchements, de leur décision de rupture, de leur séparation originaire.
Seulement il se fait que du Deuxième Souffle jusqu’au Cercle Rouge, ces réprouvés de la société ne sont qu’autant de projections chiffrées de ses propres phantasmes intérieurs, phantasmes qui n’ont rien à voir, en réalité, avec le monde irrespirable, intenablement atroce et vide, où évoluent les vrais truands. Bien mieux sans doute que certains autres, réputés, pourtant, et cultivés avec soin pour leurs relations supposées dans le grand mitan, le mitan dans le vent, Jean-Pierre Melville savait parfaitement à quoi il lui fallait d’en tenir quant à la soi-disant morale du milieu, qui n’en a rigoureusement aucune, et dont les seules vertus actives sont celles d’une immonde inclination aux boucheries inutiles et lâches, marque d’infamie des tarés qui en veulent congénitalement à l’ordre établi et qui se défoncent, chaque fois qu’ils peuvent se le permettre sans trop de risques, par l’étalage d’une violence que d’aucuns s’obstinent à vouloir à la noirceur exaltante, héroïque, alors qu’en réalité celle-ci n’a aucune signification autre que celle de sa bestialité intime, aucun souffle de désespoir profond ni de grandeur, fût-elle négative. Au bout du compte, et au-delà de tout romantisme imbécile, de toute fascination équivoque envers les bas-fonds, la seule attitude majeure envers le milieu reste celle d’une Roger Degueldre, qui, sous prétexte de je ne sais plus quelle « conférence au sommet » entre le grand milieu d’Afrique du Nord et l’OAS, avait réussi à rassembler les caïds de la pègre dans une ferme isolée des environs d’Alger pour un nettoyage par le vide dont on ressent encore les conséquences : trois générations de malfrats passés au fusil-mitrailleur, cela laisse quand même un trou.
Quelle est alors l’impulsion occulte, quelle est la déchirure fondamentale du cinéma de Jean-Pierre Melville, si admirablement cachés, au demeurant, l’une et l’autre, derrière les mythologies de dissimulation qui lui auront permis de dresser dialectiquement face au monde transparent et creux de la réalité extérieure, la réalité à la fois fulgurante et interdite de son propre monde intérieur ?
Comme Joseph Buchan, comme Fritz Lang, Jean-Pierre Melville appartient à la grande race des obsédés du pouvoir absolu. Le secret de sa vie, qui est aussi le secret de son cinéma, concerne une longue et déchirante rêverie sur le mystère en soi et sur l’appropriation subversive du pouvoir total, pouvoir total conçu à la fois comme un vertige, comme une super-centrale activiste et comme un concept absolu. Appropriation subversive d’un pouvoir politique total dont les chemins passent par l’expérience ultime de l’empire de soi-même, auquel, pour y parvenir, il faut franchir, comme dans Le Samouraï, les épreuves terribles d’une action de plus en plus voisine de l’impossible, de plus en plus ouverte sur le vide de soi-même et, finalement, sur la mort.
Mais le pouvoir total ne saurait être qu’un pouvoir caché, et, de par cela même, un pouvoir essentiellement symbolique : le cinéma de Jean-Pierre Melville est un cinéma chiffré en profondeur, tout comme l’aura été sa propre vie. Car chose certaine et claire, l’expérience des confrontations permanentes, de la permanente remise en question, - remise en question des pouvoirs de la liberté cachée et de la liberté ultime de tout pouvoir secret, expérience dans laquelle on reconnaît le problème des rapports de force auxquels se résument tous les films noirs de Jean-Pierre Melville, est aussi, de l’expérience intérieure de tout pouvoir politique en prise directe sur la marche de l’histoire. Derrière le cinéma exaltant le mystère de solitude et de vide ardent du crime, Jean-Pierre Melville s’est employé à cacher en semi-transparence le véritable discours, l’unique tourment profond de sa vie. Discours et tourment qui n’ont jamais été que d’ordre politique : dans cette perspective de clair-obscur et de vertige au ralenti, le Samouraï devient soudain autre chose, Le Cercle Rouge aussi. Tout change, tout se laisse et se donne à comprendre autrement. Mais surtout, pas par n’importe qui. Il faut y avoir accès, il faut en être, il faut en avoir été. Ce qu’il n’avait pas pu mener à bien ouvertement jusqu’au bout, Jean-Pierre Melville l’a fait, occultement, dans son cinéma. Il en va, ainsi, de toute poursuite de la grandeur tragique en France, où le terrain est depuis longtemps pourri. Si quelque chose doit se faire jusqu’au bout, il faut d’avance se résigner à passer toujours par l’épreuve de l’acceptation des ténèbres et de la dissimulation.
Quoi de plus français, en ce sens, qu’une figure apparemment logique et très claire, où le soleil limpide de la raison luit en liberté et s’exalte de tous ses feux, mais dont l’éblouissement même en double la clarté par une nuit impitoyable et profonde comme la mort ? Dans l’œuvre de Jean-Pierre Melville, la raison apparaît et semble s’imposer avec les mécanismes intérieurs du pouvoir de la pègre, où tout est logé dans les rapports objectifs des forces en présence, alors que la nuit et ses abîmes agissent, par en-dessous, à travers la confrontation nocturne des organisations secrètes de puissance et du pouvoir absolu qui se les approprie et les détruit, l’une après l’autre, en les assumant.
Ce que des témoins non prévenus se trouveront forcés de prendre pour des règlements de compte entre truands de haut vol, représenteraient ainsi, dans le cinéma de Jean-Pierre Melville, la tragédie intérieure du pouvoir politique total, le tourbillon qui porte, toujours plus avant vers son propre centre, vers le lieu de résolution finale de leurs destinées communes, les divers secrets d’action révolutionnaire que l’on sait et que l’on ne sait pas.
Dans cette perspective, et en forçant quelque peu la note, disons que le cinéma d’action de Jean-Pierre Melville pourrait fort bien n’être, après tout, et comme au bout du compte, qu’une longue réflexion sur le CSAR, sur le « Comité Secret d’Action Révolutionnaire » d’Eugène Deloncle, ou sur toute entreprise de grande subversion du même genre. Et cette supposition, on l’aura déjà compris, n’est pas tellement gratuite. Au contraire même, peut-être.
Enfin, toutes ces choses dites, il ne reste plus que le problème de la solitude irrémédiable du héros tragique, ce que Jean-Pierre Melville appelait « la solitude du tigre ».
La solitude du Tigre
Plus que jamais, devant le monde des autres, reconnu intolérable, l’unique recours est celui de faire face, de se refuser violement à toute forme de démission, à tout compromis et à tout oubli. La morale intime de Jean-Pierre Melville est la morale secrète du samouraï, du guerrier mystique pour qui, indifférent quant à l’issue finale de son épreuve, seul compte le combat de la lumière invisible de ses armes. Cette morale ne s’enseigne pas, son secret ni son souffle de vie ne sont transmissibles : on n’y accède que par la prédestination, ou par l’œuvre intime, en soi, du « seigneur inconnu du sceptre et de l’épée ».
Cette morale c’est déjà le Bushîdo de la grande solitude occidentale de la fin, la solitude du tigre lâché dans la jungle de béton, dans le monde trois fois maudit du renversement final de toutes les valeurs.
Que l’on aille donc revoir les films de Jean-Pierre Melville, et l’on comprendra peut-être quelle espérance il nous reste de retrouver, en nous, un jour.
Jean Parvulesco
Ce texte a été publié précédemment dans le Cahier Jean Parvulesco publié aux Nouvelles Littératures Européennes, sous la direction d’André Murcie et Luc-Olivier d’Algange.
23:51 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
Un phénoménologue à l'état sauvage, Malcolm de Chazal:

Malcolm de Chazal, un phénoménologue à l'état sauvage
« Tous les gestes de la nature se résument en un mouvement de danse »
Malcolm de Chazal
Il existe différentes sortes de livres. Ceux que l'on étudie dans la boiserie des bibliothèques, ceux que l'on emporte avec soi dans le verdoiement des forêts, ceux, enfin, qui nous emportent où bon leur semble au point de nous faire oublier où nous sommes et qui nous sommes.
L'œuvre de Malcolm de Chazal appartient d'emblée à toutes ces catégories. Aussi prompte à alimenter les cogitations structurales d'un Raymond Abellio qu'à porter à l'incandescence des songeries chamaniques, aussi audacieuse dans ses spéculations métaphysiques qu'enracinée dans le sensible, dont elle réveille en nous les pouvoirs d'étonnement et de merveilleux, cette œuvre, phénoménologique, cosmogonique, poétique et mystique échappe à toutes les règles et tous les genres. Sans doute n'y eut-il point, depuis Novalis, une tentative aussi magistrale de réinventer la « grande herméneutique », celle de la nature et des choses, avec l'intuition de l'aruspice conjuguée à la virtuosité du poète.
Comment être au monde ? La Vie filtrée de Malcolm de Chazal répond à cette question non par des hypothèses, des raisonnements mais par des « répons » qui changent la nature même de l'entendement humain. Nous autres, Modernes, passons notre temps à croire que nous raisonnons alors que nous ne faisons que ratiociner (et médiocrement) dans le vide. Nous voyons le monde comme un spectacle dont nous nous croyons retranchés. Nous oublions que notre esprit, notre âme et notre corps ne sont rien d'autre que des organes de perception et que toute pensée qui nous vient ne vient pas de nous mais du monde. Mais nous vient-il encore des pensées ? Et qu'est-ce qu'une pensée ? En quoi pèse-t-elle sur notre âme ou l'allège-t-elle ? Malcolm de Chazal, qui ne croit ni à l'intelligence humaine ni à la raison s'efforce de capter l'influx de l'intelligence du monde, telle qu'elle se manifeste dans les nervures les plus subtiles de la vie intérieure et de la vie extérieure (qui n'en font qu'une). L'intelligence, pour Malcolm de Chazal n'est pas une faculté, mais une possibilité, « l'homme, en essence, n'étant pas intelligent, ni ne se faisant intelligent, mais étant fait intelligent par l'Influx, par la pénétration de l'Invisible... ». On se souviendra de la phrase de Schelling: « Le "Je pense donc je suis", est depuis Descartes, l'erreur fondamentale de toute connaissance. Le penser n'est pas mon penser, et l'être n'est pas mon être car tout n'appartient qu'à Dieu ou à l'univers. »
De même que Claudel parlait à propos de Rimbaud d'un mysticisme à l'état sauvage, on pourrait dire de Malcolm de Chazal qu'il fut un phénoménologue à l'état sauvage. Là où les phénoménologues universitaires se heurtent à d'infinies difficultés, l'auteur de La Vie filtrée devance ce piège que la raison lui tend en s'identifiant immédiatement au phénomène lui-même, en faisant de la métaphore poétique une façon d'être, et non plus seulement une façon d'écrire. Ce retournement de la vision, qu'Abellio, en gnostique, nommera la « conversion du regard », fut, pour Malcolm de Chazal une expérience fondatrice, au même titre que la réminiscence proustienne ou l'irradiante « étoile au front » de Raymond Roussel. Toute grande œuvre littéraire, poétique ou philosophique procède d'une expérience extatique de cette sorte, qu'on la dise mystique ou « expérience-limite », qu'elle se traduise par une mathématisation du Réel ou par une fusion immanente dans les fougères dans un archéon anté-humain comme chez Powys, qu'elle soit une intuition fulgurante de la nature inconnue de l'espace-temps, comme dans Ada ou l'Ardeur, le merveilleux roman de Nabokov, il s'agit toujours d'un instant fondateur, où le regard change et se trouve changé par ce qu'il voit. « Je suis, écrit Malcolm de Chazal, un être revenu aux origines. A mon sens, il est stupide de croire que l'on peut connaître l'homme si l'on ne connaît pas la fleur. Que l'on peut connaître Dieu si l'on ne connaît pas le sens occulte de la pierre. La connaissance est indivisible et cette connaissance a été perdue. »
La recouvrance de cette connaissance perdue n'est pas seulement un vœu pieux, comme elle le fut parfois dans le Romantisme et le Surréalisme, elle devient, par le « sens magique » de Malcolm de Chazal, une véritable métaphysique expérimentale. Touchant à ce qu'il y a en nous de plus archaïque, mais avec l'intelligence la mieux exercée, Malcolm de Chazal retourne vers le monde ce sens des nuances, des radicelles, propre à l'introspection. Ainsi la métaphore n'est plus le signe, la réverbération d'une réalité intérieure, inconsciente, mais un mouvement que l'on pourrait dire d'extrospection.
Cette herméneutique radicale et immense qui ressaisit le monde comme une conscience ensoleillante est à la fois œuvre de poète et de philosophe, œuvre de visionnaire et de naturaliste. Les philosophes sont nombreux à avoir cherché cette « clef magique » qui permettrait de penser et d'éprouver en même temps l'un et le multiple et d'en finir avec le dualisme, auquel le monisme métaphysique lui-même n'échappe pas, puisqu'il s'oppose encore au multiple et veut s'en distinguer. L'une des clefs de cette herméneutique totale se trouve sans doute dans la théorie des « passe-teintes ». Ainsi la multiplicité des mondes, des teintes, au sens alchimique, des états de conscience et de l'être est à la fois une réalité et une vue de l'esprit qu'unissent les « passe-teintes » comme autant de moments d'une gradation dynamique, en perpétuelle révolution, et dont les bouleversements imperceptibles dans l'apparente immobilité accordent ce qu'il y a de plus grand dans le cosmos à ce qu'il y a en nous de plus secret et de plus précieux. Loin d'être séparés, le microcosme et le macrocosme, le sensible et l'intelligible ne cessent, dans les pages admirables de Sens plastique et de La Vie filtrée, de s'illuminer et de s'obscurcir réciproquement, non sans déployer, entre cette clarté et cette nuit, les abîmes et les apogées des couleurs. « Quelque immense l'artiste, écrit Malcolm de Chazal, et à quelque grandeur que puisse atteindre l'Art dans les temps futurs, jamais ne seront inventées ces teintes qui font pont entre les berges des couleurs, quand les couleurs se frôlent en torrents dans l'air et laissent entre elles des fossés d'infinie profondeur. C'est le secret des couleurs d'enjambement dans la Nature de ne laisser aucun détroit de vide entre champs colorés, quelle que soit la furie avec laquelle une couleur glisse auprès d'une autre teinte à l'état stagnant ou ralenti, et quelque terrifiante la course de deux couleurs à la fois qui passent l'une contre l'autre sans se toucher. Cet art de mettre des ponts entre les couleurs est l'art naturel des passe-teintes qui fait que la fleur est mariée au fruit et à la feuille, et que la tige ne déborde pas sur le tronc, et que le tronc ne sème pas son feuillage en flaques colorées dans le vent, mais le marie au paysage d'alentour. » Il nous resterait donc encore, tâche exaltante, à faire de cette théorie, de cette vision, la charte d'une herméneutique, non plus dévouée seulement au déchiffrement des écrits mais à celui du monde lui-même (les écrits, au demeurant faisant aussi partie du monde, au même titre que les fleurs de givre sur les vitres hivernales ou le tracé des oiseaux dans le ciel).
Les ressassements les plus cacochymes étant, de nos jours, invariablement qualifiés de « nouveautés » on hésite à souligner la nouveauté de l'œuvre de Malcolm de Chazal. L'œuvre, par ailleurs, s'inscrit bien dans une tradition. Nous évoquions Novalis, mais l'on songe aussi au Maurice Scève du fabuleux et méconnu poème Microcosme, voire, et la comparaison ne nous paraît point injurieuse, à Gongora (auquel il conviendrait aussi de rendre justice). Ce qu'il y de nouveau, d'une nouveauté éternelle, dans l'œuvre de Malcolm de Chazal, au point de renouveler l'acte même de lire, ce n'est pas seulement qu'il nous apprend, en lisant son livre, à lire à notre façon le ciel et la terre, les couleurs, les astres, les fleurs et les songes, c'est d'avoir fait de cet art de lire une expérience non point singulière ou subjective mais objective et extrême. Il s'agit bien d'un au-delà de l'art, qui emporte avec lui et en lui tous les prestiges et toutes les libertés de l'art, mais pour s'en affranchir. La pensée devient ainsi, désentravée de l'utilitarisme et de son contraire, « l'art pour l'art », cette puissance recueillie et songeuse, dionysienne et précise qui « court et rattrape les couleurs qui bougent, les lient à travers l'espace, marie les houppes jaune d'or du mimosa au vert en flèche de ses feuilles, fiance pour toujours le feu à sa fumée, rattache les veines pourpres de la rose écarlate au fuseau vert de sa tige, allie les vertes vrilles de la vigne au corset gris de l'écorce, met un pont entre le bleu de l'azur et les blanches ailes des nuées... »
Pour Malcolm de Chazal, nous ne sommes point séparés du monde qui nous entoure, ou plus exactement nous entourons le monde qui entoure. Métaphysique fondée sur une physique expérimentale des sensations, restituant à l'intuition, à ce qu'il nomme « le sens angélique immédiat », sa place royale, la pensée de Malcolm de Chazal nous délivre radicalement du positivisme du dix-neuvième siècle et de la superstition de la logique linéaire des effets et des causes. Nous comprenons à lire La Vie filtrée qu'il serait aussi absurde de croire que notre pensée est un « produit » de notre cerveau que de croire que l'air est seulement un produit de nos poumons ou la lumière un épiphénomène de nos yeux. Puisant à source même de l'enfance (« Quand l'enfant goûte un fruit, il se sent goûté par le fruit qu'il goûte. Quand l'enfant touche l'eau, il se sent touché par l'eau en retour. Quand l'enfant regarde une fleur, il voit la fleur le regarder »), Malcolm de Chazal, puise à la source antérieure à tous les nihilismes, et rend possible, comme à jamais, la faculté de penser et d'être pensé au même instant. « Toutes les théories initiatiques de la connaissance, écrit Raymond Abellio dans sa préface à L'Homme et la connaissance de Malcolm de Chazal, procèdent, on le sait, d'un retour sur soi de la conscience qui, dans le rapport entre le sujet et l'objet transfigure l'objet en une sorte de panpsychisme parfaitement communiel. Ici nous assistons au retour sur soi de la sensation, ce qui est une autre façon de vivre le même chose tout en signifiant à la connaissance qu'elle est recréation, c'est-à-dire pure poésie. »
Cette « pure poésie » semble désormais, contre le nihilisme, la seule et ultime chance offerte, sous condition, bien sûr de n'être pas seulement, un « dépotoir sentimental » qui vise « à ne faire goûter que l'esthétique au dépens des vérités, à ne nous nourrir que du seul beau plaisir sans étancher notre soif de connaissance ». L'auteur est lui-même la création de son œuvre, de même que son œuvre est la création du monde. Ce « continuum » fait du cerveau « tout en même temps salle de laboratoire, outils, réactifs, expérimentateur, sujets, agent analytique et conclusif de données ». L'œuvre ne saurait être que plus vaste que la pensée qui la produit, la surprenant sans cesse, la défiant, la poussant dans ses ultimes retranchements, l'inquiétant et la ravissant tout à tour, exigeant d'elle de revenir sans cesse sur l'oraison et le labeur alchimique qui la rend possible. Ainsi La Vie filtrée se donne à lire, comme une « recondensation » de la pensée antérieure de l'auteur: « Pour obtenir les pages qu'on va lire, j'ai du revivre mon œuvre en esprit à la vitesse de l'éclair ». Ces métaphores de foudre et de tonnerre abondent dans l'œuvre de Malcolm de Chazal: elles sont la forme même de la manifestation de la pensée dans « ces hautes régions » où « l'homme se sent pensé ». L'inspiration, l'illumination, l'intuition extatique, qui ne relèvent, dans bien des cas, que de la pure rhétorique, retrouvent alors une irrécusable réalité. Le poète écrit « à la vitesse de l'éclair, l'esprit vide, et cependant, il enfante le tonnerre et l'éclair ».
A nous que les Parques destinèrent à vivre dans un monde hors du monde, encombrés de ridicules abstraction publicitaires ou idéologiques, dans un « temps » dépourvu de toute profondeur sacrée, nous à qui l'on enseigne chaque jour, par mille tours, à ne point faire usage de nos sens et de notre intellect, à méconnaître ces instruments prodigieux de connaissance et d'extase que sont nos sens et notre pensée, il se pourrait bien que l'œuvre de ce vertigineux aruspice que fut Malcolm de Chazal, maître de la « perspective tournante » et de la connaissance amoureuse, devienne un viatique majeur.
Luc-Olivier d’Algange
15:50 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
15/12/2025
Jean Parvulesco, une voie orphique et royale:

Une voie orphique et royale
"Un de ces jours, écrit Jean Parvulesco au début de son roman, le onzième, intitulé Dans la forêt de Fontainebleau, il faudra quand même que je me décide à me pencher très sérieusement sur la zone singulièrement troublante et troublée des problèmes concernant les relations actives régnant entre l'état de veille et le rêve".
Qu'en est-il, en vérité, du rêve et de la vie, et du dédoublement du rêve dans la vie et de la vie dans le rêve ? Quels sont les orées, les seuils, les passages ? Quelles diplomaties mystérieuses, quelles traversées, quels voyages, et en proie à quels périls, quels enchantements, agissent sur nous, et autour de nous, comme par réverbération, dès lors que nous quittons l'illusion de la réalité profane, de la banalité, et que nous tentons l'aventure des états multiples de la conscience et de l'être ?
On se souvient de Shakespeare, de la vie qui est un songe pour Calderon de la Barca, de l'apologue de Tchouang-Tseu sur le papillon qui rêve qu'il est Tchouang-Tseu, de Proust encore qui songea à donner pour titre à La Recherche du temps perdu, "La vie rêvée"; mais si l'on peut chercher d'innombrables clefs au roman de Jean Parvulesco, et à celui-ci en particulier, la seule véritable opérative, au sens alchimique, est sans doute la clef nervalienne, celle "qui ouvre les portes de corne et d'ivoire qui nous séparent du monde invisible".
Sinon quelques tentatives surréalistes, la suite à donner à l'oeuvre de Gérard de Nerval fut des plus discrètes dans une littérature française par trop vouée aux minauderies théoriques. Jean Parvulesco est l'un des rares à s'être emparé, au coeur même du vertige, de la folie nervalienne: folie lumineuse et ténébreuse que traversent les filles du feu. Le monde où nous introduit son roman est un monde où les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent être, de même que le roman lui-même, par une prodigieuse mise-en-abîme héraldique, est d'emblée un autre roman, le "roman perdu en rêve" et retrouvé dans le plus grand rêve de l'écriture que nous croyons être la réalité jusqu'à ce que celle-ci, à son tour, se dédouble... Dans cette logique étourdissante, où le lecteur se trouve entraîné, c'est un mouvement hélicoïdal qui domine, - la Structure Absolue dont parait Abellio, "double dialectique croisée", devenant "spirale prophétique".
Pour Jean Parvulesco, chacun d'entre nous est la proie d'un songe, mais le chasseur subtil sait lâcher la proie pour l'ombre car l'ombre est alors la vraie proie qui nous indique, aux heures claires, le "sentier perdu", le "mystère arthurien", par le soleil même auquel nous avons tourné le dos, - allant vers cet Extrême-Occident où les froidures sont brûlures, où la nuit polaire délivre le coeur ardent, Thulée hyperboréenne où s'est réfugiée notre "identité dogmatique", notre âme, - loin de tout et de tous, loin de ce monde d'ignominie et de désastre, en attendant la Parousie. Car, et c'est le sujet du roman, une recouvrance royale demeure possible dont le secret, ayant quitté notre "cauchemar climatisé", selon la formule de Henry Miller, s'est réfugiée dans le Songe. C'est donc une âme perdue, une Eurydice, qu'il s'agit de retrouver, par un "rituel de récupération" agissant selon "une volonté conforme au plus occulte dessein de la Divine Providence", qui s'y dénude en se revoilant. Ame perdue, celle de nos origines royales, par quoi le monde serait à la fois délivré et transfiguré comme par un souffle, une effusion paraclétique.
Ainsi, la vérité royale incarnée demeure en attente, non seulement comme une vérité oubliée, détruite, mais aussi, et surtout, comme une vérité qui ne fut jamais connue, et qui, désormais, c'est-à-dire immédiatement, exige de l'être. Et tel est précisément le sens de la "spirale prophétique" à l'oeuvre dans ce roman, repassant par les mêmes points, mais plus haut. La nostalgie royale n'est plus alors consentement à la défaite, mais pressentiment de "l'imprépensable". Le rêve alors n'est pas la vie, mais une vie plus haute, antérieure et jamais advenue. Tout le roman se déploie dans ce paradoxe, dans les concordes éblouissantes de l'effroi et du ravissement, dans cette nuit dont parle Gérard de Nerval "qui est noire et blanche".
°°°°°
Une lettre de Jean Parvulesco
Paris, le 9 juin 1996
Cher Luc-Olivier d'Algange,
comment vous remercier pour l'envoi que vous m'avez assez mystérieusement fait de votre méditation poétique intitulée Car les temps sont venus de rendre grâce ?
Mais cette illumination voilée, dont vous avez tenu à me faire le don prémonitoire, n'est-elle pas, aussi, un signe confidentiel en sa transparence même, une annonce chuchotée sur la ligne de passage vers le cœur ardent de l'été, du plus grand été gnostique vers se dirigent - sont occultement attirés - les nôtres, tous les nôtres ? A votre insu peut-être, avez-vous donc été pressenti pour cela, invité à donner cours ? A faire passer la consigne ?
De toutes les façons, à présent on le sait que les temps sont venus, et que nous sommes appelés à procéder en conséquence, chacun sur le lieu de sa prédestination propre et suivant le pari halluciné de sa dernière chance, du suprême péril.
Cependant, qu'importe le propre mouvement de remontée existentielle vers l'être, si l'être lui-même n'est pas en venue vers nous ? L'épreuve ultime ne sera jamais la nôtre, mais toujours celle de l'être en marche vers lui-même.
Or, n'est-ce pas, de quoi peut-on rendre grâce, et à qui, si ce n'est à l'être lui-même, et pour le seul secret de sa remontée vers lui-même en nous, de l'abyssale décision en lui de nous revenir, de s'établir révolutionnairement en un recommencement autre ?
Tel aura été, à ce qu'il semble, le pressentiment, l'inspiration élective pour lesquels vous avez été amené à témoigner. Voyez ce qui se loge en votre blessure.
Nous sommes en première ligne, c'est dans les ténèbres mêmes de la défaillance qui nous est imposée en ces temps que se dissimulent la stratégie subversive et les très hautes armes de la victoire finale. Nous l'emporterons sur tout: c'est bien ce qui s'était irrémédiablement refermé qui s'entr'ouvrira, et qui déjà nous entraîne vers le nouvel ouvert en son incandescence si terrible.
Je reste votre
Jean Parvulesco
Que Infra Nos Nihil Ad Nos
17:19 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
13/12/2025
Luc-Olivier d'Algange, vient de paraître:
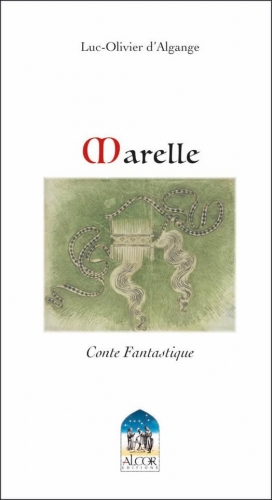
MARELLE, conte fantastique.
Luc-Olivier d’ALGANGE
Sans doute le moment est-il venu de dire enfin ces vastes songes qui vinrent à m’envahir dans les premières journées de ce limpide et tournoyant printemps 1985… Songes immenses où sans cesse je me dédoublais en moi-même, me retrouvant et me perdant, de même que chaque seconde se divisait et se mirait infiniment dans son propre miroir, de telle sorte que l’aire du temps s’élargissait et prenait une allure fatidique et divine. Et je m’éveillais sous un ciel crépusculaire, un ciel majestueux et lent comme une cosmogonie sans mémoire. J’avais beau me révolter et user de stratégies diverses pour échapper à cette fatalité, je ne m’éveillais qu’au cœur de la dramaturgie du crépuscule, à l’apogée du spectacle pour ainsi dire, – où venant de franchir le rideau de l’heure bleue on se retrouve environné du prodige des couleurs réinventées, d’un luxe extrême, presque offensant si l’on songe aux circonstances humaines qui accompagnent cette hautaine fête flamboyante à laquelle, il faut bien le reconnaître, ne participent que les poètes, les amoureux et certains désespérés dans l’essor de leur philosophie la plus ardente, la plus alchimique (...).
58 pages
Format 12X22
Impression quadrichromie
Pages intérieures 80 g Munken
Couverture Rives tradition blanc naturel 250 g
ISBN : 978-2-909554-51-8
Édition 2025
Prix 25 euros
Editions ALCOR
1, rue de Ramatuelle
13007 Marseille
06 03 24 78 39
Mail : contact@alcor-editions.fr
19:33 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
02/12/2025
Hommage à Didier Carette:

20:44 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
16/11/2025
Luc-Olivier d'Algange et la transparence de la mémoire, par Gabriel Arnou-Laujeac:
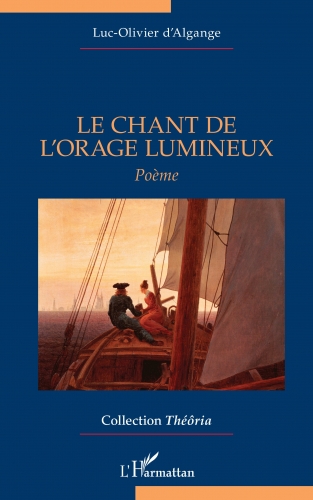
19:54 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
13/11/2025
Luc-Olivier d'Algange, notes sur La Musique intérieure, Maurras, Victor Nguyen:
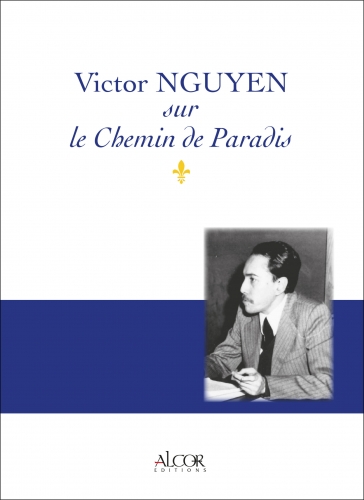
La Musique intérieure
« C’est alors qu’apparut la consolation divine des vers »
Charle Maurras
In memoriam Victor Nguyen
Pourquoi relire La Musique intérieure de Charles Maurras ? Sans doute, déjà, pour contredire tous les sophismes et fausses raisons qui voudraient nous en dissuader, - et qui suffisent à prouver que ces pages, rédigées il y a un siècle, demeurent d'une actualité permanente, - comme le sont les bons souvenirs et les serments de l'enfance. Ce « Grand Temps » de l'enfance, même s'il se situe en amont, - dans une relation encore intime avec les dons et les vertus impérissables, « image mobile de l'éternité » selon la formule de Platon, - ne sera pas étranger à l'Histoire qui viendra. Il y a en toute vie humaine pleinement vécue, une succession d'âges semblables à ceux qui ordonnent notre civilisation. A l'enfance chevaleresque, libre et médiévale, succédera la Renaissance, autrement dit l'adolescence aventureuse et philologique ; puis l'âge adulte, classique, qui prendra la juste mesure de l'inné et de l'acquis, - et enfin l'âge moderne, cette décrépitude où tout semble vouloir se défaire dans une lamentable cacocratie, telle que nous la voyons aujourd'hui, ostensible, arrogante et ridicule. Quelle admirable et nécessaire leçon alors que ce recours aux premiers dons ! Mieux encore est d'apprendre, par le poète intercesseur, que recevoir ne suffit point, et qu'il faut encore consentir et célébrer. La littérature, avant qu'elle ne devînt, par décret de la mode, un dévergondage victimaire, fut souvent une célébration des temps héroïques ou heureux. La Musique intérieure nous en fait souvenir : « Quand on demande ce que c’est que le bonheur — action ? passion ? ou l’un et l’autre ? —, il faut bien répondre que l’homme est un complexe animal. Tour à tour, il accueille avec de semblables transports le sentiment aigu de la nature des choses, la vue sereine des essences, pourvu qu’elles soient belles et dignes de désir, enfin l’essai hardi d’une puissance qui soumette l’idée du monde et de la vie à son idée propre, qui la lie à son cœur et à sa pensée pour la transfigurer tôt ou tard dans sa flamme… De tous ces biens, quand il y pense, l’homme voudrait ne faire qu’un. Les amoureux s’y essayent de temps à autre. Le poète y songe toujours. »
Etre moderne, c'est naître d'avance déshérité, non seulement par l'inconséquence de la génération précédente, et la main crochue de l'Etat subordonné à l'Economie, mais aussi, et surtout, dans nos souvenirs. Aux comptines se sont substitués les « tubes » radiophoniques, aux saveurs et paysages, les écrans ; rien de tout cela n'est assez fécond pour faire pousser un bel arbre et faire bruire les feuillages de la mémoire. Nous sommes livrés aux surfaces, à la platitude et ce que nous croyons être nous-mêmes, individus déracinés, n'est qu'un écho de la confusion des temps. Ce qui nous manque, et nous précipite dans l'affairisme le plus vain, est l'espace intérieur où toute chose chante et toute présence enchante. Nous, Modernes voulus modernes, croyons vivre hic et nunc, dans le mépris du « vieux monde » alors que nous vivons précisément dans un monde où il n'y a plus d'Ici ni de Maintenant. La présence réelle fait défaut. D'où l'importance du rappel : « Poésie est Théologie, affirme Boccace dans son commentaire de la Divine Comédie. Ontologie serait peut-être le vrai nom, car la Poésie porte surtout vers les racines de la connaissance de l’Être. Le savent bien tous ceux qui, sans boire la coupe, en ont reconnu le parfum ! »
Tout recommencera donc par les évidences les plus plus vastes et les plus fines. Un devoir nous incombe, qui est une joie : nous offrir à la recouvrance de ce que nous savions déjà mais dont l'accès nous était interdit par quelque noire magie, - ce que Villiers de L'Isle-Adam, nommait « l'hypnotisme du Progrès ». Mais en ces pages, soudain, une porte s'ouvre sur un jardin. Tout platonicien, de science ou d'intuition, sait qu'un jardin, une forêt, une mer, sont la réverbération, ou le reflet, du Jardin, de la Forêt ou de la Mer immémoriaux. L'enfance dispose de cette chance magnifique de faire une cosmogonie, voire une théodicée, de tout ce qui l'émerveille : « Aussi loin que j’y peux descendre, seul désormais, sans le secours des mémoires qui sont éteintes, je vois de longs jours filés d’or que l’hiver même éclaire d’un soleil luysant, cler et beau que nul printemps ne me ramène. Des saveurs, des parfums, des contacts de toutes les choses se dégage l’esprit de la surabondance accordé au jeune désir. L’événement et le souhait, la réalité et le rêve se tiennent et se suivent par des liens délicats qui ne rompent jamais ; tout a son sens, son lustre. Ah ! comme dit le Grec optimiste, il était bon et doux de voir la lumière ! »
Il n'est sans doute rien de plus universel que l'enracinement, rien qui ne révèle mieux, selon la formule de Maurras, « l 'humanité essentielle » dont la civilisation française lui semble une preuve particulièrement heureuse. Pour le comprendre, il ne faut se vouloir juge, évaluateur ou comptable des vices et des vertus. Il ne faut pas mesurer les civilisations entre elles, comme si nous étions au-dessus d'elles dans quelque module spatial ; il faut entendre, de la nôtre, de là où nous sommes réellement, dans cet espace géo-poétique, et surtout dans cette langue, la musique intérieure, le secret du poème, divine consolation : « Sur ces confins légers des nuits et des matins où tout semble renaître, était-il déplacé de désirer plutôt des vers qui fussent, eux aussi, en voie de naître et de grandir, des vers à prendre et à reprendre, à user, à rouler, semblables aux galets qu’arrondissent les mers chantantes ?.
Charles Maurras, certes, a beaucoup parlé de la raison, mais ce ne fut guère la raison ratiocinante, la raison redondante, qui tombe comme une chape de plomb sur le secret conseil des Muses. La raison, fut, dans ce qu'il nous légua de plus libre, de moins subordonné à l'actualité confuse de son temps, d'abord une raison d'être, - expression française au suprême et presque intraduisible. Quant-à-la « raison » prônée par les Révolutionnaires, qui en voulurent faire une « déesse » alors qu'ils n'en firent qu'une idole, la raison des « rationalistes », nous avons vu qu'elle tranchait au lieu d'unir – et jusqu'à la tête de Lavoisier qui tomba au prétexte, la citation vaut son pesant de fanatisme, que « La République n'a pas besoin de savants » . L'actuelle collusion des néo-robespierristes avec le fanatisme exotique le plus obtus du monde le confirme, nihil novi sub sole.
Ne plus entendre la musique intérieure, soit qu'elle fût recouverte par le vacarme de l'époque, soit qu'elle fût niée, par fallacieuse repentance, dans le secret des cœurs, ne sera pas sans conséquences. Cette mélodie intime qui suit son cours, comme le Lignon de l'Astrée, entre ce que nous pensons et les phrases servantes qui viendront, comme elles peuvent, prouver notre fidélité, tient en elle la plus grande part de notre avenir, ou, du moins de l'espérance de notre avenir, - de sa possibilité. Nous reviendrons ainsi à La Musique intérieure par la conscience d'un enjeu qui dépasse largement la politique de celui qui devait proclamer «la politique d'abord » - les conséquences du désastre, les causes politiques, en effet, dépassant désormais l'aire où elles se manifestaient alors.
Perdre la musique intérieure, ce n'est plus seulement perdre la possibilité de la politique, rendre son retour impossible dans un monde impolitique gouverné par l'économie et la technique , c'est effacer sa raison d'être et même la raison d'être en soi qui nous fait être là et non ailleurs, bien vivants, avec selon la formule de Giono, « le chant du monde « . L'immensité du désastre requiert la riposte la plus intime, tel un iota de lumière incréée, étincelle dans la pupille, susceptible de toute recréer en regardant de nouveau le monde avec attention. C'est de ne plus rien voir ni entendre du monde, de rester là, derrière nos écrans, que nous sommes tués et que l'Ennemi remporte sa sinistre victoire.
Pour retrouver la musique intérieure, la rejoindre, y trouver l'accalmie de l'âme, qui est la promesse la force, sans doute faut-il faire silence, se taire, retrouver l'attente. Ne point se hâter ne signifie pas reporter ad infinitum, procrastiner, mais se rassembler, en soi-même d'abord, pour un nouvel assaut. Les forces déliées par le calme sont les moins incertaines, elles ont saveur et sapience d'enfance, pureté du feu, mots qui, par leurs étymologies, révèlent leurs actes, l'arbre et ses fruits ; et c'est bien la racine que la musique intérieure célèbre, « source sacrée » : « La joie est l’état qui déborde. Elle extravase, elle transmigre. Large ou bornée, brève ou durable, elle ne tient jamais dans son enceinte pure ; elle rayonne à proportion des puissances de son foyer. L’être y jaillit de soi, pour être mieux lui-même : ce n’est pas autrement que, retenu et précipité, emporté et fixé, il accède à sa plénitude. Allumée au bûcher natal, nourrie du feu qui l’engendra, Psyché prétend sans honte à la couche des dieux parce qu’elle peut dire à ses père et mère s’ils s’en étonnent : — Fîtes-vous autre chose que de m’élancer d’où vous retombiez ? »
Par le Mystère d'Ulysse, ensuite, nous saurons que rien n'est dit, que le règne des Prétendants n'a qu'un temps, et que nous reviendrons, de si loin, avec l'expérience, la traversée du danger, entre les dieux favorables et hostiles, par devers les fascinations funestes et les déroutes ; nous reviendrons, purement et simplement, dans notre pays d'enfance, peut-être méconnaissables (sauf d'Argos) dans un pays lui-même méconnaissable, mais dans une résolution renforcée par les épreuves et les errances. C'est dans l'enfance, dans la musique intérieure de l'enfance que nous aurons trouvé le courage de contrebattre le monde qui n'existe – dans toutes ses propositions, diatribes,- que pour répandre la peur. Nous retournerons d'où nous venons, naturellement et surnaturellement, nous reviendrons vers la source sacrée de notre mémoire, vers cette « simple dignité des êtres et des choses » tant cruellement oubliée ; nous y reviendrons après le terrible et ravissant périple, le cœur de bronze et les sens affinés. Le monde est une épreuve, et nos défaites, à nos victoire confondues, formeront quelque invisible couronne, ombre changeante sur nos fronts au bord d'une rivière française, dans le silence de toutes les musiques tues ou espérées : « Ferai-je le dénombrement de ces héros, que je voudrais suivre aux Enfers ? Rapporterais-je leurs discours, leurs chants et leurs plaintes ? Pas mal de strophes en existent, trop peu au point pour être écrites. Si vive que soit la passion de toucher au but dès que le désir se ranime, nulle hâte ne m’éperonne, il semble que nos morts sacrés, les seuls à qui je sois redevable de la pieuse offrande intermittente, surtout nos orateurs, nos philosophes, nos poètes, veuillent me tenir compte du long et fidèle essor de ma volonté : ils me laissent conduire le poème à loisir. Il pourrira sur pied ou bien, « comme mûrit le fruit » parviendra au terme tout seul. Mieux vaudrait le quitter inachevé, comme ce triste monde, que de le finir autrement qu’il ne se voit et qu’il ne se veut ».
Luc-Olivier d'Algange
°°°
Victor Nguyen, à l'honneur, et pour l'honneur de l'esprit, dans ce livre, Victor Nguyen sur le chemin de Paradis, qui vient de paraître aux éditions Alcor, au ressouvenir, du côté d'Antinéa, et de la France latine.
Présentation de l'éditeur:
"ALCOR ou la passion d’un éditeur Marseillais.
Petite étoile nichée dans la constellation de la Grande Ourse, nous l’avons adoptée pour donner son nom à notre maison d’édition.
Son nom, d’origine arabe signifie le Cavalier.
Elle servait jadis de test d’acuité visuelle pour les archers de Genghis Khan et de Charles Quint.
Alcor est aussi la clé du mystère du trésor des rois de France de Maurice Leblanc dans le roman « La comtesse de Cagliostro »
Le contenu de notre catalogue s’inscrit d’une manière large dans une perspective que nous appellerons traditionnelle : Esotérisme Chrétien, Alchimie, Tradition, Métiers, Histoire et Poésie…
Nous proposons soit des rééditions de précieux ouvrages anciens mais également des publications d’auteurs contemporains, avec comme souci permanent la recherche de la qualité des textes et de l’édition."
Quatrième de couverture:
Plus de quarante ans après la publication de l’ouvrage Aux origines de l’Action française, intelligence et politique à l’aube du XXe siècle, salué comme un chef d’œuvre par une critique quasi unanime, il peut paraître singulier de revenir sur ce qui l’a précédé, et tenter de suivre le regard porté par Victor sur la société française de son temps dans son ensemble. Le livre est unique et posthume alors que l’auteur avait publié des dizaines d’articles sur Maistre, Mistral, Vico, Dimier cofondateur de l’Action Française, Barrès, Péladan ou Guénon notamment. Toutes aussi singulières sont les circonstances de sa parution, il s’agit d’une thèse de Doctorat d’Etat refusée parce que hors délai. Pierre Chaunu a donné dans sa préface le récit qui a coûté la vie à l’auteur, son témoignage vient en tête du présent travail. Dès 1970 Victor avait créé dans le cadre de l’Université de Nanterre la revue Anthinéa en compagnie d’Elisabeth de Pusy La Fayette, Pierre Guiral, son directeur de thèse et Pierre Chaunu qui y avaient collaboré.
Il était également le fondateur des colloques Maurras dans le cadre du Centre Maurras qu’il anima de 1968 à 1976 avec Georges Souville. Politica Hermética avec Jean-Pierre Brach et Jean-Pierre Laurant enfin clôt le voyage en 1987, une naissance posthume également.
19:03 | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
02/11/2025
Luc-Olivier d'Algange, hommage à Jean Biès:
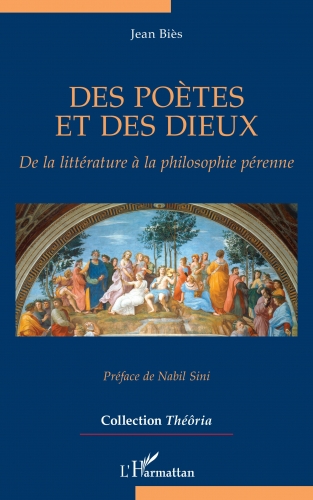
Hommage à Jean Biès
L'oeuvre de Jean Biès qui se place sous le signe du « retour l'Essentiel » - à la fois mot d’ordre, une devise héraldique et mise-en-demeure - suppose que nous nous sommes éloignés de l’essentiel, que ces dernières décennies, voire ces derniers siècles, furent propices à un éloignement de l’essentiel. Mais « éloignés » n’est pas assez dire, il faut préciser : à perte de vue ! Ce n’est plus seulement une distance spatiale ou temporelle qui nous sépare de l’essentiel. Les distances de cette sorte, l’obstination et la patience suffisent à les franchir. Il s’agit d’une distance elle-même essentielle qui nous sépare non seulement du plus lointain mais aussi du plus proche et du plus intime.
Retourner à l’essentiel, ce serait ainsi à la fois accueillir le plus lointain et dévoiler le plus proche, consentir à l’appel du Grand-Large qui rassemble en lui, comme une promesse, le Dire posthume, les gestes épiques et métaphysiques d’Orient et d’Occident, et le Dire anthume, - qui annonce ce qui doit être à la pointe exquise de l’Instant. L’essentiel serait alors le retour lui-même : retour sur soi, qui emporte avec lui le retour du monde en nous-mêmes. La modernité qui nous sépare de l’essentiel est catastrophe pure, répétition cauchemardesque, sur-place frénétique d’un « temps » qui a perdu, en même temps, l’archéon et l’eschaton, l’origine et la promesse.
Nous cheminons vers le retour, autrement dit vers l’Eveil : « Ulysse sommeille en chacun de nous ». Mais il ne saurait être de cheminement sans la conscience de l’écart, de la faillite, du désastre. Celui qui prend la mesure de ce qui sépare sa vie de la vie magnifique, celui qui constate la faillite de ce monde et qui ne se refuse point à voir les désastres pour ce qu’ils sont, est déjà en chemin. Tel est le sens de l'oeuvre de Jean Biès : un état des lieux qui définit, par contraste, un autre monde, extraordinaire présent, dont nous ne sommes séparés que par un battement d’aile de libellule.
Entre les possibilités prodigieuses de notre intellect, de notre âme et de nos sens et ce à quoi, dans nos activités quotidiennes, nous les réduisons, par torpeur, paresse ou soumission, sont tous les voyages. « La pire menace, écrit Jean Biès, n’est pas dans la vitrification atomique mais dans la désertification intérieure de l’humain, le lent oubli de toute transcendance, l’insensibilité au supra-sensible, l’absence de tout vibrato métaphysique. » Ce monde réduit à son mécanisme, cet individu réduit à son corps périssable dont l’âme et l’esprit ne seraient que les « épiphénomènes », le Moderne s’y tient en fanatique alors même que les sciences, en leurs ultimes avancées, les récusent. Toutes les collectivités sont religieuses, mais encore faut-il distinguer le religere de l’au-delà de celui, en forme d’amalgame, de l’en-deçà.
Certains livres, rares, gagnent en pertinence, en justesse, en profondeur à l’épreuve du temps. Les années qui se sont écoulées depuis leur parution loin d’en atténuer l’éclat le révèle. Résister au temps, ou, mieux encore, s’en affermir, sans doute est-ce là le propre des œuvres qui, ne s’étant point emprisonnées dans un « hic et nunc » illusoire, eurent l’audace de s’enquérir du passé le plus lointain et la générosité de songer à l’avenir. Ce que l’on nomme la grandeur et la beauté des œuvres tient en cette double exigence à la fois altière et tendrement humaine, que les auteurs servent selon leurs talents : la grandeur d’être l’hôte du plus lointain et la beauté trempée au feu lucide d’une intelligence qui se refuse à pécher contre l’espérance. L’oeuvre de Jean Biès nous invite à la recouvrance de ces vertus.
Ne cédons point à la vaine gageure de vouloir « résumer ». Disons seulement que, loin de toute vanité novatrice, l'oeuvre s’inscrit dans une tradition, celle des traités de résistance à laquelle appartiennent, à des titres divers, Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, de René Guénon, Le Traité du Rebelle d’Ernst Jünger ou Chevaucher le Tigre de Julius Evola. Il s’agit, pour l’auteur, non point d’illustrer sa subjectivité, de se livrer à quelque « auto-fiction », ni d’engager de vaines polémiques, mais de donner à ses lecteurs quelques unes de ces armes de l’intelligence et de l’art sans lesquelles toute révolte contre le monde moderne s’asservit à ce qu’elle croit récuser. Il ne suffit point, en effet, de se désillusionner du monde moderne, d’en percevoir la laideur et la lourdeur, d’en décrire les ridicules et les abominations, il faut encore trouver en soi, c’est à dire en dehors du « moi », les puissances heureuses qui feront de cette rébellion une voie spirituelle, un chemin orienté par la clarté matutinale, aurora consurgens de la réminiscence.
Toutefois, le « retour à l’essentiel » n’est pas un retour au passé, mais à la présence du passé, ce qui est tout autre chose. La Tradition, au sens guénonien, dont se réclame Jean Biès, n’est en rien muséologique. Le tradere de la Tradition est la source vive, paraclétique, le mouvement même qui nous porte à la fine pointe de l’élan au-delà du temps qui le rythme : cette temporalité pure, aurorale, délivrée de sa propre représentation dont la musique hindoue traditionnelle, par exemple, nous donne à entendre la vibrante immanence comme une résonance d’une transcendance pure. Le propre du Moderne, au contraire, est d’être emprisonné dans son temps et de s’en faire, par dépit, l’apologiste éperdu. Quoiqu’il en veuille, le véritable Maître à penser du Moderne ne sont plus Descartes ou Hegel, mais Monsieur de La Palice. Pour lui, en effet, la modernité est bonne car elle est moderne et inversement. Pour preuve, tout ce qu’il juge bon dans le passé est sans ambages qualifié de « moderne » et tout ce qu’il trouve de fâcheux dans le monde moderne est, sans davantage de scrupules, qualifié « d’archaïque ».
La voie que propose Jean Biès, fidèle à la perspective métaphysique, est plus difficile. Aux commodités des systèmes, elle oppose la subtilité des « approches ». Rien n’est moins systématique que la pensée traditionnelle. C’est ne rien comprendre à la « Doctrine » que de la confondre avec un système. Erreur comparable à celle qui confond le Symbole et l’allégorie ou celle qui confond l’Idée et le concept. Le concept se tient tout entier dans sa formulation discursive. L’Idée est la chose vue qui exige l’intuition intellectuelle, la profonde et limpide méditation de l’Un. Or, le Moderne, en refusant l’intuition intellectuelle, la possibilité directe de la perception des états multiples de l’être se prive non seulement de la connaissance, il se prive de la réalité elle-même dans sa beauté frémissante et diverse. Son refus de la transcendance lui ôte, par surcroît, le sentiment de l’immanence pure. D’où le despotisme de la laideur, de la répétition cauchemardesque, le clonage physique et mental, l’abolition du réel dans le virtuel cybernétique. L’étiolement du vrai implique le saccage du Beau et le désastre du Bien. L’art dit « moderne » qui, selon l’excellente formule de Baudrillard, revendique la laideur, l’insignifiance et le mauvais-goût alors qu’il est déjà insignifiant, laid et vulgaire dans une sorte de redondance ubuesque ; l’idéologie inepte de l’égalité entre tout et n’importe quoi ; l’offense permanente faite, sous couvert de « dérision » à toute solennité et à toute profondeur, exigent une riposte, ou, comme l’écrivait, Henry Montaigu une contre-attaque.
L'oeuvre de Jean Biès doit ainsi se lire comme une contre-attaque, mais sereine, la colère s’y trouvant comme transfigurée par la vérité qui la justifie, transmutée et convertie par les teintures abrasives et scintillantes de l’âme qui retrouve, dans l’élan de sa propre sauvegarde, les ressources du ressouvenir, c’est-à-dire d’une véritable présence, reçue autant que donnée, transparue, autant que conquise par une décision résolue, - présence qui tient en elle, repliées, des ailes de lumière et de nuit.
S’il y a dans l'oeuvre de JeanBiès quelque chose d’un traité de savoir vivre en temps de détresse à la manière de Sénèque ou de Marc Aurèle, on y trouve aussi des pages qui se donne à lire comme de nécessaires prolégomènes aux exercices spirituels sans lesquels tout ce que notre entendement nous propose est destiné à s’évanouir aux premières brises. Or, ce ne sont point des zéphyrs mais d’assourdissants ouragans de crétinisation auxquels nous sommes exposés chaque jour, lavages de cerveau en bonne et due forme, étayés par les technologies de pointe. Le retour à l’essentiel passe ainsi à travers les frondaisons d’un simple retour au monde, au cosmos, comme disaient les Grecs, à « la simple dignité des êtres et des choses » comme disait le poète roman, car ce monde, s’il ne suffit point à lui-même s’offre à nous comme l’enluminure de l’écriture de Dieu.
Cette enluminure ne dit point l’essentiel mais l’environne et l’essentiel n’est point si despotique qu’il veuille la disparition de l’enluminure où il apparaît. D’où ces textes sur l’Alchimie intérieure, sur la religion de la beauté, la philocalie, les couleurs et les chants, les parfums et l’élégance des signes dont la beauté, pour les plotiniens que nous sommes, est une approche du Vrai : « Garder le seul sens littéral des enseignements, écrit Jean Biès, c’est finir par perdre même le sens littéral alors que leur lecture symbolique, relevant de l’ésotérisme, déploie une pluralité infinie de sens, enrichit de nombreux apports. La parabole du vin nouveau et des outres neuves montre que l’ésotérisme, - le vin, symbole de la connaissance éternelle renouvelée ici dans son énonciation,- reste toujours le même, cependant que les outres désignent les modalités d’accès à l’ésotérisme, les structure rituelles, les cadres théologiques. »
La perspective ouverte à une « gnose » ou un ésotérisme chrétien ne manquera pas de choquer les gnosimaques, qu’ils soient intégristes ou progressistes (et enclins, de ce fait, à discerner dans la gnose ou l’ésotérisme un périlleux élitisme « fascisant »). Or, la gnose, loin de toute outrecuidance, n’est autre que la contemplation de l’Intellect et l’abandon de l’âme à la souveraineté divine. A égale distance de l’arrogance de l’entendement humain et de l’arrogance des « vertus » qui escomptent, par quelque étrange marchandage, une récompense aux « bonnes œuvres » ; à égale distance de l’approbation « réaliste » de l’état de fait et de la négation du monde, la gnose chrétienne qui « célèbre l’harmonie et le rythme qui émanent du monde comme d’une lyre, l’immobile fuite des vagues, les vastes fleuves, le chant du vent » ( Grégoire de Naziance) apparaît à celui qui l’approche sans prévention comme le combat sans cesse repris contre ce nihilisme qui solidifie la doctrine ou hâte sa dissolution.
Entre le narcissisme religieux où l’homme s’adore lui-même à travers sa religion qu’il juge, bien sûr, la meilleure de toutes, et le syncrétisme du tout et du n’importe quoi, la gnose chrétienne serait ainsi la tierce voie, la voie droite de la reconnaissance d’un Logos universel (mais nullement universaliste) à travers la multiplicité des « demeures ». « Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père » (Jean, XIV,2) A juste escient, Jean Biès cite l’Apologie de Justin : « Tous ceux qui ont vécu selon le Logos sont chrétiens, même s’ils ont passé pour athées, comme, chez les Grecs, Socrate, Héraclite et leurs semblables » ; ou encore Nicolas de Cuse : « A travers la diversité des Noms divins, c’est Toi qu’ils nomment, car tel Tu es, tel Tu demeure, inconnu et ineffable. »
Le passage entre ce « Dieu » qui n’est qu’un « Il », c’est à dire un « étant suprême » que rien, sinon son unité, ne distingue d’une idole, et ce Dieu, que nomme Nicolas de Cusa, qui est un « Tu », c’est là, exactement ce qui distingue la fausse gnose, l’arrogance du Moi, de la véritable gnose qui est effacement du Moi dans le resplendissement du Soi.
Jean Biès nous invite également à méditer, dans toutes ses conséquences, cette phrase de saint Thomas d’Aquin. « La puissance d’une Personne divine est infinie et ne peut se trouver limitée à quelque chose de créé. C’est pourquoi l’on ne doit pas dire qu’une personne divine ait assumé une nature humaine de sorte qu’elle n’ait pu en assumer une autre. » Loin d’être hérésiarque, la gnose chrétienne s’ordonne ainsi à cette phrase d’Origène : « Tout ce qui se voit est en relation avec quelque chose de caché, c’est-à-dire que chaque réalité visible est un symbole et renvoie à une réalité invisible à laquelle il se réfère. » L’apparence est apparition et cette apparition est l’acte d’être de Dieu qui est, selon la formule d’Angélus Silésius, comme « un Eclair dans un éclair ». Relevons encore cette citation de Saint-Ephrem de Syrie : « Une image du Père, tu l’as dans le soleil, du Fils dans son éclat, du Saint-Esprit, dans sa chaleur ; et pourtant, tout cela est un ».
Luc-Olivier d'Algange
Jean Biès, Des poètes et des dieux, De la littérature à la philosophie pérenne, éditions de L'Harmattan, 2025.
20:06 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
15/10/2025
Prix des Quarante-Cinq 2025.
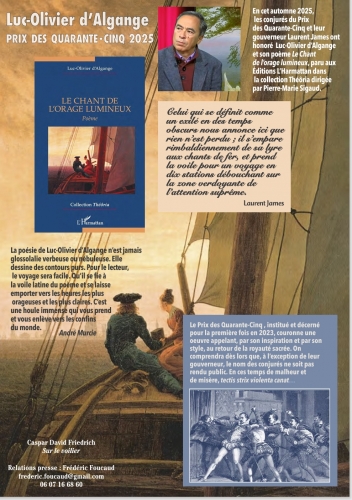
13:44 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
19/08/2025
Luc-Olivier d'Algange, Vues sur Mishima:

A propos de Mishima et ses masques de Stéphane Giocanti.
La plupart des biographies sont inutiles. A celui qui est entré dans une œuvre, qui a reconnu les songes, les idées, les passions d'un auteur, que lui importent les détails, souvent triviaux et communs, de sa vie. Presque toutes les biographies gagneraient à se résumer en deux mots : « Il écrivit ». Des exceptions cependant demeurent - et les règles générales ne valent que pour les saluer - tel ce beau livre de Stéphane Giocanti, Mishima et ses masques, paru récemment aux éditions de L'Harmattan. Erza Pound disait que l'on ne peut lire un écrivain – et a fortiori, en parler – sans partager avec lui quelque trait commun, une expérience partagée, voire une part de la vie intérieure.
Stéphane Giocanti, s'il ne faille jamais à l'exactitude et à l'objectivité nécessaires, poursuit, dans cette biographie, le dessein de ses livres précédents consacrés à Maurras, Pierre Boutang ou T.S Eliot. De quoi est-il question dans une œuvre ? Quelles sont sa provenance et sa destination ? Quelles en sont les étapes décisives ? Autant d'interrogations auxquelles la critique littéraire, telle que la pratiquent généralement les Modernes, ne suffit à répondre.
Il ne suffit point, en effet, d'analyser et d'expliquer, il faut encore interpréter et comprendre, c'est à dire s'impliquer. L'auteur de Kamikaze d'été - ce court mais fulgurant roman, que Stéphane Giocanti, publia naguère aux éditions Pierre-Guillaume de Roux – pouvait, et devait, mieux que d'autres, répondre à cette exigence, et l'exiger de son lecteur même. « Tout esprit profond a besoin d'un masque » écrivait Nietzsche, - qui fut sans doute, parmi les auteurs d'Occident, avec Racine, Thomas Mann et Radiguet, celui exerça la plus grande influence sur Mishima, sans oublier, bien sûr, Oscar Wilde, que cite, à bon escient l'auteur de Mishima et ses masques : « la forme objective est en réalité la plus subjective. L'homme est moins lui-même lorsqu'il parle pour son propre compte. Donnez-lui un masque et il vous dira la vérité ».
L'oeuvre de Mishima accomplira, extrêmement, cette fusion de l'objectivité et de la subjectivité, de la vie extérieure et de la vie intérieure, du paysage et de l'âme qui, dans la tétralogie de La Mer de la fertilité, transmigre par l'exercice de la contemplation. C'est par le paysage qu'elle voit que l'âme peut devenir volatile et se réincarner. Kenneth White, voyageur à travers les paysages en quête d'un territoire où, je le cite, « le temps se convertit en espace, où les choses apparaissent dans toute leur nudité et où le vent souffle anonyme » citera Mishima : « Le "Je" qui va m'occuper ne sera pas le "Je" qui se rapporte strictement à l'histoire de ma personne mais autre chose... Réfléchissant à la nature de ce "Je", je fus amené à conclure que le "Je" en question correspondait très précisément à l'espace que j'occupais physiquement »
Le masque n'est pas seulement posé sur le visage pour le révéler, c'est-à-dire pour le revoiler de sa vérité inconnue, mais sur le monde lui-même dont l'écrivain veut atteindre la vérité intime, « le feu central de l'être » selon la formule de Dominique de Roux. Parlant du style d'un de ses Maîtres, Kyoka Izumi, Mishima évoque « son vocabulaire aussi riche que la mer » et « ses phrases imperméables comme la roche » « A la réalité ( un pont, une forêt, des champs) Mishima, écrit Stéphane Giocanti, surimpose des fragments d'univers seconds qui demeurent malgré tout en continuité avec elle ». Ces univers contigus seront au principe de la transmigration du personnage central de La Mer de la Fertilité, et le principe de son art romanesque, qui s'avère être ainsi une expérience métaphysique, proche de certains courants du bouddhisme ésotérique.
Si évidente que soit l'influence sur Mishima de la littérature occidentale, et si occidentalisé voulut-t-il parfois paraître dans quelques de ses masques, le livre de Stéphane Giocanti plonge dans les racines les plus profondes de la culture japonaise, aventure inédite, en France, et passionnante. Au caractère « disruptif » de l'Occident, à son sens de la représentation, Mishima oppose la continuité des règnes telle que la perçoit la tradition japonaise et, plus encore les traditions bouddhistes de l'Inde et de la Thaïlande dont il eut, comme en témoigne le troisième volume de sa tétralogie, une connaissance profonde. Sa fascination pour l'Occident – autrement dit, la modernité globale, dont il saisit, mieux que personne, les tenants et les aboutissants, suscite précisément chez lui une volonté de lui résister, en toute connaissance de cause.
S'il lui faut vivre dans le monde instauré par l'ère Meiji, antihéroïque, pudibonde et commerciale, c'est en gardant au cœur l'idéal de « sauver ici-bas et au-delà l'intégralité de la Beauté ». « Mishima, écrit Stéphane Giocanti, fut bouleversé par l'accélération des changement au Japon : affadissement et vulgarité des mœurs, obsession de l'argent, de la consommation et de la réussite économique , sentiment d'abêtissement général. » Qu'en sera-t-il de ceux qui auront disparu dans la mémoire de ceux qui demeurent ? Qu'en sera-t-il d'un monde où le chemin profond semble perdu, où toute trajectoire est définie d'avance ? Qu'en est-il de la fatalité ? Qui viendra après nous comme nous sommes venus après ceux qui portaient un monde oublié, mais qui nous tient à cœur, comme une pointe exquise, une souffrance, promesse de suavité ? Qu'en est-il de la postérité ? Le livre de Stéphane Giocanti, qui est un livre engagé, suscite ces questions.
Lorsque nos Maîtres auront disparus , ceux qui ne furent guère leurs familiers et ne leur portèrent qu'une attention médiocre, se vanteront de les avoir connus sans prendre le risque d'être contredits. La postérité est une feinte et une fuite, - et même la vie : nous ne vivons nos plus beaux moments que rétrospectivement et continuons, dans le présent, à passer à côté des êtres et des choses. L'oeuvre de Mishima est une révolte radicale contre cette fatalité. S'il oppose une fatalité à une autre, ce sera celle de se saisir de sa propre mort dans le feu d'un grand soleil rouge, afin de ne pas être dépossédé, de rassembler, dans sa pointe extrême, toute la vie et toute la mort.
« Mishima, écrit Stéphane Giocanti, pense par métaphores dans la mesure où celles-ci traduisent son intuition sans passer par les progressions ordinaires de la logique rationnelle ». La métaphore est alors épiphanie, manifestation, « mer allée avec le soleil », selon la formule de Rimbaud. Une juste métaphore est un acte magique qui ouvre le monde et abolit la distinction entre le monde intérieur et le monde extérieur, et nous donne ainsi la chance de résister à l'avilissement de la pensée par représentation. Par l'amitié stellaire dont il témoigne, le livre de Stéphane Giocanti nous donne la possibilité de comprendre , par delà le nihilisme, la plus plus secrète et et la plus ardente corrélation du Tragique et de la Joie.
L'erreur serait de penser que ce livre clôt le sujet, et qu'il suffirait de de ranger , avec l'oeuvre de Mishima dans le rayonnage des classiques dont nous n'attendons plus rien plus rien, sinon la satisfaction de l'avoir reconnue à sa juste valeur. Le livre de Stéphane Giocanti appelle au contraire à une suite à donner, - dans la littérature comme dans la vie. Une suite qui commencerait par exemple par la traduction des œuvres inédites évoquées et commentées, et celles encore de ceux qui furent, dans la littérature japonaise, de la période médiévale jusqu'à nos jours, ses « maîtres et complices ». Il y faudrait des traducteurs-poètes, tel Armel Guerne, qui écrivit à propos de Melville, ces phrases qui conviendraient aussi, au suprême, à Mishima : « Quand le poète est dévoré par la poésie, quand le créateur devient lui-même la monture de ce qu'il a créé, quand il meurt sous sa créature ( dont il connaît seul et ne connaît pas la véritable mesure), quand au cœur même de la création, il tombe en combat singulier pour et par l'oeuvre qu'il va laisser, c'est alors aux portes de l'éternité qu'il touche. Et l'oeuvre est faite pour durer. »
Luc-Olivier d'Algange
23:50 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
26/07/2025
Où il est question des "Droits de l'âme", éditions de L'harmattan:
à partir de la mn 12:
20:56 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
06/07/2025
Stéphane Barsacq, à propos du Chant de l'orage lumineux, éditions de L'Harmattan, collection Théôria, 2025
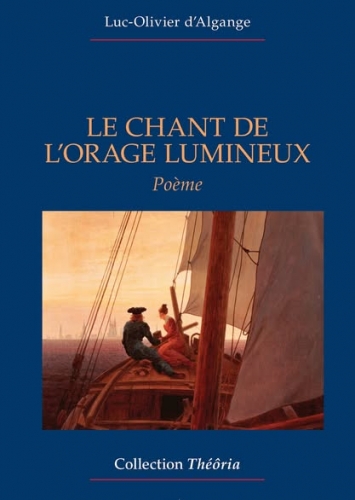
"Je tiens à écrire tout le bien que je pense du livre de Luc-Olivier d'Algange. Poète de la pensée, doté d'une pensée de la poésie, cet auteur a le privilège de pouvoir compter sur l'avenir, qui le placera, non au premier rang de notre temps, mais à l'avant-garde de celui de demain, où on le lira dans le dialogue qu'il ouvre, une main tendue à Hölderlin, l'autre au jeune homme ou à la jeune femme encore à naître qui le découvrira. Il est question du haut chant de l'âme, lorsque celle-ci se saisit d'elle-même, et renvoie non son image, mais le monde, quand il mérite ce nom, et l'irisation de ses teintes. Nul désespoir, nulle violence, une puissance qui se domine, une joie qui se conquiert, l'assurance d'un combat en vue de l'accord suprême, et par-dessus tout la musique qui rythme l'action, il y va d'une grande oeuvre."
Stéphane Barsacq
Le Chant de l'Orage lumineux, éditions de l'Harmattan. 126 pages, 14 euros.
19:57 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
07/06/2025
Le chant de l'orage lumineux, éditions de L'Harmattan, 2025, extrait:
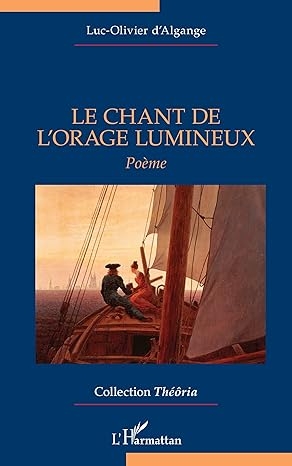
Cesserai-je un jour de désirer
cette transparence de la mémoire, cette nuit en laquelle
telle une douce joie,
s'assombrit la beauté jusqu'à l'extase ? Et telle une fragile
silhouette qui s'éloigne dans les entrelacs de l'air,
flamme légère, à peine rêvée,
solitaire et pure et fière
sans nul abri en ce monde
exposée au bonheur d'être, elle revenait vers moi
Divine Anamnésis. Il n'est point de mérite ni de gloire
à demeurer fidèle. Le jour qui se brise dans la nuit
d'un autre été magnifique annonce
la venue. Nous savons que nos errances nous conduisent.
Vive nostalgie,
Jardins inventés dans cette pâleur d'écume
lorsque la pluie tombe du chant du ciel, de sa hauteur
qui si passionnément refuse la mort
Ainsi venaient à nous
au-dessus de nos têtes,
les palmes brillantes de la tristesse de l'été…
Ainsi les jardins, l'ombre, les racines, les fleurs
qui semblaient appartenir à d'autres siècles,
d'autres mondes
comme les hiéroglyphes de civilisations futures,
évoquant d'autres pierres, d'autres lumières…
Et tout cela cependant si proche
dans les bannières de la pluie et du vent…
Encore et toujours.
Comment être vivant
dans cette solitude de toute chose,
cette solitude à peine troublée
par le pressentiment d'une soumission à l'ordre
injuste des étoiles ? Et nous devinions soudain
que nos jours sont perdus dans ces demeures
perdus,
sous les voiles tendues
entre l'air et l'éther…
Nous devinions
et de cette divination âpre comme le suc
des fruits immatures, une grande
passion nous venait,
une grande divagation
inaccessible nous venait,
épée unie à l'éternité de son rêve miroitant,
soudaine volonté d'être,
ardente et légère volonté
tombée de l'ombre haute comme une immobilité
depuis longtemps
attendue, désirée
et nous demeurions nous aussi immobiles,
impassibles,
face à cet automne maritime qui rendit nos demeures
à la fois si capiteuses et si désolantes…
Quelle douce nuit s'inclinait
sur la terre brillante ! Quelle douce Apparence
devant laquelle notre orgueil enfin
pouvait capituler car enfin le ciel immense
traversait notre pauvreté, notre attente
et déchirait ces nuages et ces ombres. Enfin.
Je recueillais en moi cette miséricordieuse lumière,
cette transparence
de la mémoire
que je désirais.
Encore et toujours survenue,
mémoire de nos rêves et de nos rives,
cieux vivants dans l'altération des couleurs
jusqu'à ce jour de ton visage d'une parfaite pureté.
Jamais mon âme ne fut lasse,
jamais
dans ces branches embrasées du vent côtoyant l'éther,
jamais mon âme ne fut lasse de cette douceur.
La mémoire déployait ses paroles,
ses pluies,
de telle sorte qu'un recueillement de l'âme
encore toujours survenue
donnait à l'immense abandon
cette fraîcheur du sommeil dont les frondaisons
logent des oiseaux
au cœur battant…
Encore et toujours, grande beauté mienne
à jamais dans toute mémoire profuse ou déserte
quand l'antique malheur et les larmes
cèdent devant le découragement
du bonheur embelli par sa défaite :
c'est la grâce du retour
dont toute nostalgie nous hante et nous délivre
de toute hantise…
Brillante
et sûre,
aimée de toute chose qui ne consent point,
brillante
à la pointe de cette virtuosité native de l'être
qui ne consent point
mais désire…
Brillante et pure
dans les méandres majestueux d'autres siècles et d'autres mondes…
Il s'en fallut de peu qu'ensembles le lointain
et le proche
ne s'abolissent
dans cette couronne de mélancolie
que ce très-haut ciel d'automne fit tomber sur nos fronts…
Sur nos fronts
et sur les horizons mêmes de notre parole
comme un silence, couronne d'un grand silence
d'une royauté muette. Il s'en fallut
d'une coque d'amande, d'un murmure, - ô joie
secrète - ou mémorable tonalité d'oubli,
chose infime,
seconde d'or
honneur de l'imperceptible
beauté soudaine
qui nous sauve !
Cesserai-je un jour de désirer cette splendeur ?
Ce soir
la mer et le ciel
et cette joie mémorable
dont la nuit de l'âme nous illumine !
Quel oubli divin
à la pointe de cette allégresse impérieuse
plus haute que le don plus haute que l'espoir
de toute ramure dans le vent,
plus haute
et plus légère,
hôte des nues,
prophétesse !
La nostalgie fut cette lucide destruction du possible, niant l'hélas,
la vertu cachée de l'obscurcissement,
son ombre renégate,
afin qu'élue,
colombe vive dans le matin elle surgisse et nous sauve !
Cesserai-je un jour d'attendre cet instant ?
Les voiles s'éloignaient,
les tempes étaient bruissantes, j'entendais
d'autres êtres et d'autres mondes, l'esprit ailleurs…
J'entendais ces couleurs
qui sont notre patrie,
profondes couleurs du Sud
qui disparaissent au crépuscule
dans la pureté de leurs méandres,
l'esprit ailleurs… Et ces ombres teintes d'oubli,-
selon la mystérieuse alchimie, se balançaient dans le vent
jusqu'au front de la mer
Iles dans le ciel !
Promontoires ! Ma mémoire embellie !
Les clartés recueillies dans les feuilles
d'autres siècles et d'autres mondes…
Comment douter de ce plus grand abandon du lointain
de ces jardins qui renoncent ? Ce soir, en vérité,
la mer et le ciel…
Ce Soir en vérité
comme les voix adoucies
alors que l'ardente soif en nous demeure
et la nostalgie comme une promesse intense
au cœur de tout sommeil
et de toute mémoire épargnée, avec ce désir
d'être sauvé ! Me voici
devant toi, mes souvenirs
sont des terrasses ouvertes sur le lointain.
Eclate la fanfare du ciel nu ! le lilas universel du Soir
dont je reconnais enfin la sensation et la beauté,
mais presque avec désinvolture,
- ainsi qu'il convient à l'apogée du bonheur -,
car le pouvoir du Chant est cette folie de l'air
qui tournoie
au plus proche
tournoie et m'entraîne devant toi,
où je désire demeurer.
Et quelles nuits pour la gloire nous traversâmes ! Ce verbe
qui fleurissait dans le combat
des siècles et des mondes
ce verbe à la source
de mon propre commencement comme une hésitation vertigineuse
n'allait-il point me faire défaut, soudain,
telle une réponse oubliée ? O nudité de l'âme,
ma gloire et ma détresse.
Ces nuits furent vastes et d'or
dans l'esprit comme un manteau flottant
derrière les coursiers furibonds, sauvages
allant au-devant du battement du silence
et du souvenir d'une toute puissance aimée,
d'une toute-puissance
aimée
et légitime
dans cette nuit profonde et légère que nous traversions
légère et nue
toute-puissance,
sous les frontons de la nuit notre refuge !
Ailleurs
les frivoles pensées ! Ailleurs
dans d'autres rêves et d'autres mondes !
Je t'aimais uniquement.
Et la nuit était ce visage paisible,
cette harmonie, ce parfum
que nous apportions au sacre de la pensée légère.
Belles furent ces pensées, nos sœurs
comme de légères oliveraies bruissantes dans la nuit.
Il fut un jour où je feignis
ne point comprendre la terrestre raison.
J'aimais l'arche des couleurs,
l'alchimie des songes
Mon âme fut l'instant,
vif épicentre d'un cyclone régnant sur les cendres
d'autres mondes. L'esprit ailleurs
je prenais pour guide des visages
d'une insoutenable beauté.
Les apparences trompeuses ne m'effrayaient point. Ma colère
était angélique…
Paraître fut le roi de sa propre légende
dans la fureur construite des ubiquités.
Ma science figurait une fresque oublieuse sur les rives
d'un fleuve d'oubli…
Tels furent les artifices pour traverser
cette nuit hautaine et tardive,
et sainte
pour des raisons que je ne pouvais comprendre
et qui pourtant m'envahissaient, m'enivraient
comme un orage lumineux, une Annonciation !
J'évoquais, pour comprendre, les secrets
et les rites de mon enfance. J'évoquais
les Anges et les Dieux. La beauté religieuse de l'Instant
éclipsait les paradis perdus.
J'attendais en vérité,
dans la fragilité d'autres êtres et d'autres mondes
j'attendais une Muse qui daignât m'apprendre
l'extrême ultra-marine de l'hiéroglyphe croisé !
Muse attentive
dont la science est l'oracle des règnes de l'espérance,
Muse connue d'autres êtres et d'autres mondes,
qui naviguent
l'esprit ailleurs
épris de la science de l'Oracle ! Tout
ce que nous attendons en vérité
est ici
dans cette chambre aux volets clos où l'Ange de la présence
déploie
la grâce d'un Orient éclaboussé de couleurs et de rires…
Tout ce que nous aimons est au plus proche
(avec son plus vaste Ailleurs ) dans cette chambre
opaline et profonde
où le sommeil est le prodige des libellules
où la lumière
est semblable aux colonnes de la fin du monde…
Et l'énigme de cette image architecturale résonnait en moi…
Telle ce jour où je feignis ne point comprendre
la terrestre raison ! Ce jour
en d'autres lieux et d'autres temps, - et comment dire
l'ici-même ? -
dans cette chambre immobile corbeille des clartés
qui, au-dehors resplendissent
telles une énigme dont on se souvient
une vibrante image qui surgit,
s'inscrit
mais que la terrestre raison feint de ne point comprendre.
Un grand bonheur grandissait en moi,
un bonheur ancien et nouveau,
à la ressemblance de cette énigme qui nous saisit.
Cesserai-je, un jour
d'en désirer le juste triomphe ? Et cette jeunesse
perdue et retrouvée
dans la demeure suspendue des corps ardents, glorieux
dont le même néant est soleil d'adversité ?
Cesserai-je un jour
d'en dire le lointain fugitif,
l'insaisissable éloge de sa beauté grandissante, sa violente et cruelle
et mélancolique tendresse dont d'autres mondes et d'autres êtres
dans le ciel très-haut
gardent la mémoire et l'énigme ?
Cesserai-je ( un jour ) d'en désirer
l'étendue verte sous les plumes de la nuit et du jour ?
D'en convoiter l'essence ?
Et mon âme,
de quelles régions issues
de quels repos, âges, absences
reviendrait-elle nous dire
qu'il ne reste à la pauvreté et à l'exil
que le reproche étourdissant des nues…
Cesserai-je un jour
de m'éveiller
dans l'éveil
avec ce cœur battant ?
Le grand honneur sera de n'y point consentir.
Le Chant de l'orage lumineux, éditions l'Harmattan, collection Théôria, 2025, 126 pages. 14 euros.
17:05 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
15/05/2025
Hommage à Roger Nimier, extrait de Les Droits de l'Ame, éditions de L'Harmattan:

Hommage à Roger Nimier
Roger Nimier fut sans doute le dernier des écrivains, et des honnêtes gens, à être d'une civilisation sans être encore le parfait paria de la société; mais devinant cette fin, qui n'est pas une finalité mais une terminaison.
Après les futilités, les pomposités, les crises anaphylactiques collectives, les idéologies, viendraient les temps de la disparition pure et simple, et en même temps, des individus et des personnes. L'aisance, la désinvolture de Roger Nimier furent la marque d'un désabusement qui n'ôtait rien encore à l'enchantement des apparences. Celles-ci scintillent un peu partout dans ses livres, en sentiments exigeants, en admirations, en aperçus distants, en curiosités inattendues.
Ses livres, certes, nous désabusent, ou nous déniaisent, comme de jolies personnes, du Progrès, des grandes abstractions, des généralités épaisses, mais ce n'est point par une sorte de vocation éducative mais pour mieux attirer notre attention sur les détails exquis de la vie qui persiste, ingénue, en dépit de nos incuries. Roger Nimier en trouvera la trace aussi bien chez Madame de Récamier que chez Malraux. Le spectre de ses affections est large. Il peut, et avec de profondes raisons, trouver son bien, son beau et son vrai, aussi bien chez Paul Morand que chez Bernanos. Léautaud ne lui interdit pas d'aimer Péguy. C'est assez dire que l'esprit de système est sans prise sur lui, et que son âme est vaste.
On pourrait en hasarder une explication psychologique, ou morale. De cette œuvre brève, au galop, le ressentiment qui tant gouverne les intellectuels modernes est étrangement absent. Nimier n'a pas le temps de s'attarder dans les relents. Il va à sa guise, voici la sagesse qu'il nous laisse. Ses quelques mots pointus, que l'on répète à l'envie, et que ses fastidieux épigones s'efforcent de reproduire, sont d'un piquant plus affectueux que détestateur. Pour être méchant, il faut être bien assis quelque part, avec sa garde rapprochée. Or le goût de Roger Nimier est à la promenade, à l'incertitude, à l'attention. Fût-ce par les méthodes de l'ironie, il ne donne pas la leçon, mais invite à parcourir, à se souvenir, à songer, - exercices dont on oublie souvent qu'ils exigent une intelligence toujours en éveil. Son goût n'est pas une sévérité vétilleuse dissimulée sous des opinions moralisatrices, mais une liberté exercée, une souveraineté naturelle. Il ne tient pas davantage à penser comme les autres qu'il ne veut que les autres pensent comme lui, puisque, romancier, il sait déjà que les autres sont déjà un peu en lui et lui dans les autres. Les monologues intérieurs larbaudiens du Hussard bleu en témoignent. Nimier se défie des représentations et de l'extériorité. Sa distance est une forme d'intimité, au rebours des familiarités oppressantes.
L'amour exige de ces distances, qui ne sont pas seulement de la pudeur ou de la politesse mais correspondent à une vérité plus profonde et plus simple: il faut aux sentiments de l'espace et du temps. Peut-être écrivons nous, tous, tant bien que mal, car nous trouvons que ce monde profané manque d'espace et de temps, et qu'il faut trouver quelque ruse de Sioux pour en rejoindre, ici et là, les ressources profondes: le récit nous autorise de ses amitiés. Nul mieux que Roger Nimier ne sut que l'amitié est un art, et qu'il faut du vocabulaire pour donner aux qualités des êtres une juste et magnanime préférence sur leurs défauts. Ceux que nous admirons deviendront admirables et la vie ressemblera, aux romans que nous écrivons, et nos gestes, aux pensées dites « en avant ». Le généreux ne jalouse pas.
Il n'est rien de plus triste, de plus ennuyeux, de plus mesquin que le « monde culturel », avec sa moraline, son art moderne, ses sciences humaines et ses spectacles. Si Nimier nous parle de Madame Récamier, au moment où l'on disputait de Mao ou de Freud, n'est-ce pas pour nous indiquer qu'il est possible de prendre la tangente et d'éviter de s'embourber dans ces littératures de compensation au pouvoir absent, fantasmagories de puissance, où des clercs étriqués jouent à dominer les peuples et les consciences ? Le sérieux est la pire façon d'être superficiel; la meilleure étant d'être profond, à fleur de peau, - « peau d'âme ». Parmi toutes les mauvaises raisons que l'on nous invente de supporter le commerce des fâcheux, il n'en est pas une qui tienne devant l'évidence tragique du temps détruit. La tristesse est un péché.
Les épigones de Nimier garderont donc le désabusement et s'efforceront de faire figure, pâle et spectrale figure, dans une société qui n'existe plus que pour faire disparaître la civilisation. La civilisation, elle, est une eau fraîche merveilleuse tout au fond d'un puits; ou comme des souvenirs de dieux dans des cités ruinées. L'allure dégagée de Roger Nimier est plus qu'une « esthétique », une question de vie ou de mort: vite ne pas se laisser reprendre par les faux-semblants, garder aux oreilles le bruit de l'air, être la flèche du mot juste, qui vole longtemps, sinon toujours, avant son but.
Les ruines, par bonheur, n'empêchent pas les herbes folles. Ce sont elles qui nous protègent. Dans son portrait de Paul Morand qui vaut bien un traité « existentialiste » comme il s'en écrivait à son époque (la nôtre s'étant rendue incapable même de ces efforts édifiants), Roger Nimier, après avoir écarté la mythologie malveillante de Paul Morand « en arriviste », souligne: « Paul Morand aura été mieux que cela: protégé. Et conduit tout droit vers les grands titres de la vie, Surintendant des bords de mer, Confident des jeunes femmes de ce monde, Porteur d'espadrilles, Compagnons des vraies libérations que sont Marcel Proust et Ch. Lafite. »
Etre protégé, chacun le voudrait, mais encore faut-il bien choisir ses Protecteurs. Autrefois, les tribus chamaniques se plaçaient sous la protection des faunes et des flores resplendissantes et énigmatiques. Elles avaient le bonheur insigne d'être protégées par l'esprit des Ours, des Lions, des Loups ou des Oiseaux. Pures merveilles mais devant lesquelles ne cèdent pas les protections des Saints ou des Héros. Nos temps moins spacieux nous interdisent à prétendre si haut. Humblement nous devons nous tourner vers nos semblables, ou vers la nature, ce qui n'est point si mal lorsque notre guide, Roger Nimier, nous rapproche soudain de Maurice Scève dont les poèmes sont les blasons de la langue française: « Où prendre Scève, en quel ciel il se loge ? Le Microcosme le place en compagnie de Théétète, démontant les ressorts de l'univers, faisant visiter les merveilles de la nature (...). Les Blasons le montrent couché sur le corps féminin, dont il recueille la larme, le soupir et l'haleine. La Saulsaye nous entraîne au creux de la création dans ces paradis secrets qui sont tombés, comme miettes, du Jardin royal dont Adam fut chassé. »
Hussard, certes, si l'on veut, - mais pour quelles défenses, quelles attaques ? La littérature « engagée » de son temps, à laquelle Nimier résista, nous pouvons la comprendre, à présent, pour ce qu'elle est: un désengagement de l'essentiel pour le subalterne, un triste "politique d'abord" (de Maurras à Sartre) qui abandonne ce qui jadis nous engageait (et de façon engageante) aux vertus mystérieuses et généreuses qui sont d'abord celles des poètes, encore nombreux du temps de Maurice Scève: « Ils étaient pourtant innombrables, l'amitié unissait leurs cœurs, ils inspiraient les fêtes et décrivaient les guerres, ils faisaient régner la bonté sur la terre. » De même que les Bardes et les Brahmanes étaient, en des temps moins chafouins, tenus pour supérieurs, en leur puissance protectrice, aux législateurs et aux marchands, tenons à leur exemple, et avec Roger Nimier, Scève au plus haut, parmi les siens.
Roger Nimier n'étant pas « sérieux », la mémoire profonde lui revient, et il peut être d'une tradition sans avoir à le clamer, ou en faire la réclame, et il peut y recevoir, comme des amis perdus de vue mais nullement oubliés, ces auteurs lointains que l'éloignement irise d'une brume légère et dont la présence se trouve être moins despotique, contemporains diffus dont les amabilités intellectuelles nous environnent.
Qu'en est-il de ce qui s'enfuit et de ce qui demeure ? Chaque page de Roger Nimier semble en « répons » à cette question qui, on peut le craindre, ne sera jamais bien posée par l'âge mûr, par la moyenne, - dans laquelle les hommes entrent de plus en plus vite et sortent de plus en plus tard, - mais par la juvénilité platonicienne qui emprunta pendant quelques années la forme du jeune homme éternel que fut et demeure Roger Nimier, aimé des dieux, animé de cette jeunesse « sans enfance antérieure et sans vieillesse possible » qu'évoquait André Fraigneau à propos de l'Empereur Julien.
Qu'en est-il de l'humanité lorsque ces fous qui ont tout perdu sauf la raison régentent le monde ? Qu'en est-il des civilités exquises, et dont le ressouvenir lorsqu’elles ont disparu est exquis, précisément comme une douleur ? Qu'en est-il des hommes et des femmes, parqués en des camps rivaux, sans pardon ? Sous quelle protection inventerons-nous le « nouveau corps amoureux » dont parlait Rimbaud ? Nimier écrit vite, pose toutes les questions en même temps, coupe court aux démonstrations, car il sait que tout se tient. Nous perdons ou nous gagnons tout. Nous jouons notre peau et notre âme en même temps. Ce que les Grecs nommaient l'humanitas, et dont Roger Nimier se souvient en parlant de l'élève d'Aristote ou de Plutarque, est, par nature, une chose tant livrée à l'incertitude qu'elle peut tout aussi bien disparaître: « Et si l'on en finissait avec l'humanité ? Et si les os détruits, l'âme envolée, il ne restait que des mots ? Nous aurions le joli recueil de Chamfort, élégante nécropole où des amours de porphyre s'attristent de cette universelle négligence: la mort ».
Par les mots, vestiges ultimes ou premières promesses, Roger Nimier est requis tout aussi bien par les descriptifs que par les voyants, même si « les descriptifs se recrutent généralement chez les aveugles ». Les descriptifs laisseront des nécropoles, les voyants inventeront, comme l'écrivait Rimbaud « dans une âme et un corps ». Cocteau lui apparaît comme un intercesseur entre les talents du descriptif et des dons du voyant, dont il salue le génie: «Il ne fait aucun usage inconsidéré du cœur et pourtant ses vers ont un caractère assez particulier: ils semblent s'adresser à des humains. Ils ne font pas appel à des passions épaisses, qui s'essoufflent vite, mais aux patientes raisons subtiles. Le battement du sang, et c'est déjà la mort, une guerre, et c'est la terre qui mange ses habitants ».Loin de nous seriner avec le style, qui, s'il ne va pas de soi, n'est plus qu'un morose « travail du texte », Roger Nimier va vers l'expérience, ou, mieux encore, vers l'intime, le secret des êtres et des choses: « Jean Cocteau est entré dans un jardin. Il y a trouvé des symboles. Il les a apprivoisé. »
Loin du cynisme vulgaire, du ricanement, du nihilisme orné de certains de ses épigones qui donnent en exemple leur vide, qui ne sera jamais celui des montagnes de Wu Wei, Roger Nimier se soucie de la vérité et du cœur, et de ne pas passer à côté de ce qui importe. Quel alexipharmaque à notre temps puritain, machine à détruire les nuances et qui ne connaît que des passions courtes ! Nimier ne passe pas à côté de Joseph Joubert et sait reconnaître en Stephen Hecquet l'humanité essentielle (« quel maître et quel esclave luttant pour la même cause: échapper au néant et courir vers le soleil ») d'un homme qui a « Caton pour Maître et Pétrone pour ami. » Sa nostalgie n'est pas amère; elle se laisse réciter, lorsqu'il parle de Versailles, en vers de La Fontaine: « Jasmin dont un air doux s'exhale/ Fleurs que les vents n'ont su ternir/ Aminte en blancheur vous égale/ Et vous m'en faites souvenir ».
On oublie parfois que Roger Nimier est sensible à la sagesse que la vie et les œuvres dispensent « comme un peu d'eau pris à la source ». La quête d'une sagesse discrète, immanente à celui qui la dit, sera son génie tutélaire, son daemon, gardien des subtiles raisons par l'intercession de Scève: « En attendant qu'à dormir me convie/ Le son de l'eau murmurant comme pluie ».
Luc-Olivier d'Algange
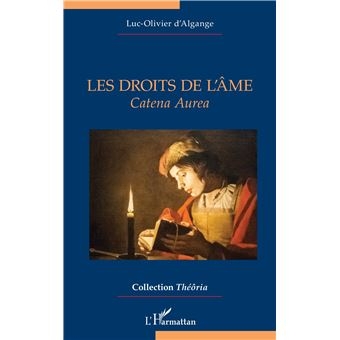
00:30 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
26/04/2025
Au ressouvenir d'Empédocle, poème:

Au ressouvenir d'Empédocle
Ce labyrinthe est léger
et ses teintes profondes et douces
comme de pures pensées.
Le regard sait
la hauteur qui s'incline
où l'ombre aborde avec la mémoire des sables.
Nous savons cette antistrophe de limpidité
dont le heurt resplendit sur nos lèvres.
Terrestre voyageur, tu viens avec la pluie.
Ta force fut cette âme nommée,
cette heure très-ancienne sur le rivage.
Ou bien lorsque les déesses
parent de leurs tristes reflets les âmes mélodieuses,
tu te souviens des contrées blanches et fécondes…
Cette beauté te fut une halte
où flamboyait l'ivresse du jour qui s'achève,
cette beauté longeant la rive
des pins et des genévriers,
songeant comme une ondulation du vent
à la ténèbre apparue,
dans le bronze frappé,
au saphir moissonné par l'azur
lorsque les flammes de Perséphone
sont les fleurs d'une autre patrie…
Nous éveillerons ce silence
comme une torche,
nous raviverons la bataille.
Nous préciserons les périls
dans la nudité constellée des Cyclades,
sous l'attentive nuée,
dans l'accord des voiles qui se tendent,
nous nous éveillerons…
Hymnes et lyres de clartés !
Quelle victoire sera dite ?
Ce printemps, le vol dévoile le dédale de l'air.
Ce printemps, la victoire est le ciel.
L'essor fut un long ondoiement du Chœur.
Les astres sifflaient près de nos tempes
dans l'invisible et le désir donnait
à notre hardiesse le don de l'accalmie.
Que de tempêtes courbées, dociles,
assagies dans nos têtes !
S'il faut un Nom pour cette victoire,
nous la dirons élue pour l'Empire du monde !
Celui qui fut nommé s'éveilla
dans notre âme dormante,
son ombre sous le ciel d'Agrigente
de lumière nous inonda.
La sagesse à grande gorgée nous enivrait.
Et de toutes nos fautes nous renaquîmes,
de toutes nos fautes et de toutes nos espérances,
du vertige immense de nos cruautés
et de nos douceurs portant l'effigie tardive,
du vertige vermeil,
dont l'infini recueille le faste et le néfaste,
nous renaquîmes,
inexprimés et véridiques,
semblables aux hommes aventureux
sculptés par la fièvre et des grandeurs lointaines !
De quel souvenir de races odysséennes,
notre nostalgie s'emporta,
et de quel emportement
nous renaquîmes à la fierté d'être ?
Souvenir d'audaces aux ailes de métal azuré,
souvenir de promptitudes aimées…
Quel nom donnerai-je à vos crinières abstraites ?
Quelles ombres pusillanimes éloignerai-je du seuil sacré ?
De quelles épouvantes et de quelles hontes bues
trouverai-je la force experte qui,
dans le déclin même du soleil,
suivant du regard son parcours
descendant sur les contrées abandonnées,
élève encore comme un pressentiment d'ivresse
dans la vendange refusée,
les belles nervures des feuilles,
les entrelacs des abeilles d'or ?
Ai-je nommé l'essor ?
La parole me fut elle arrachée à la lisière de la pensée ?
Qu'entendre dans nos entendements vides,
sinon l'infini et la totalité du monde ?
Se perdre et renaître, la terre danse !
Telle moins lourde qu'un phalène,
son or et sa rougeur de sables…
Telle, moins lourde que nos âmes, le cœur des roches !
Ce printemps en vérité fut lave et guirlandes de volcan,
aigle dédoublé au fronton d'un temple bleu !
Mais quelle tristesse nous menace ?
Je dis: le nom du dieu engendre son silence
et tout est sauvé.
Nous suffoquons
de la beauté reconnue sous les constellations rougeoyantes !
Que notre oubli même nous sauve,
fol espoir, et rien n'est perdu !
Qu'entendre dans nos entendements vides,
sinon la lente mélopée du roi
subjugué par son désir d'être ?
Rien n'est perdu, ce n'était qu'un ensorcellement noir,
un fétu d'obscurité que roulent les vagues de l'aurore !
Nous trouble
ce brin de la désinvolture amie
dans le soir où l'ivresse vert-bleu des regards
s'accorde avec la ténébreuse pupille du dieu
dont le nom attire les soleils, les raisins,
et les cieux entre nos paumes.
Telle est la limite, telle est notre conquête…
Le Temps n'est plus qu'une vague amie
dont le murmure accompagne
la Sapience consolatrice des fleurs.
Telle est la limite: notre prière est plus haute.
Nous scrutons sur la mer
les mille figures ingénues
que le sommeil de la nature
laisse à sa surnaturelle lumière.
Car de cet entendement aux lames profondes
nous fûmes les Servants.
En témoignent nos houleuses Destinées !
L'enfance fut l'eau, le pain, la terre et la lumière
et l'infini situé dans les groseilles fraîches de rosée.
Par quel obscurcissement du langage
notre âme s'est-elle éloignée de ce Jour ?
Les métaphores existent:
elles ne sont point de notre pensée.
Elles vivent au-dehors, entre les mondes,
et le sensible s'en émerveille.
L'intelligible beauté est aujourd'hui
la recouvrance du langage,
et ce monde me parle comme à l'esprit
des secrètes valeurs de la prière !
Un sentiment d'être défaille dans une connaissance plus haute,
comme entre le zénith et le nadir
le sillage silencieux de l'instant,
sa poussière de pluie lumineuse…
Cette autre région nous saisissait
et dans son vide parfait se déploie
l'enchantement du monde !
Gloire non soumise, son nom s'irise dans le silence…
Ai-je nommé, ai-je oublié ?
L'évidence souveraine s'empare de l'horizon
que le bonheur
voile de ses champs de pluie.
Pâques amoureuses,
l'âme surgit comme un corps dans le petit matin.
Il va sous les nuées éloquentes,
s'en revient vers sa patrie,
toute capitulation s'est effacée de son empreinte !
L'invisible sceau interroge la proximité extrême,
à portée d'un visage en miroir d'eau,
à portée d'un nom dont la distance aimée est l'hôte,
et l'intuition s'avive dans la saveur de l'air.
Dans l'assomption marine ,
cette farouche et calme
dont le début du monde éclabousse notre bonheur d'être.
Rien n'est perdu.
Il suffit de s'attarder comme un dieu
dans l'heure du matin…
Luc-Olivier d'Algange
23:03 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook


