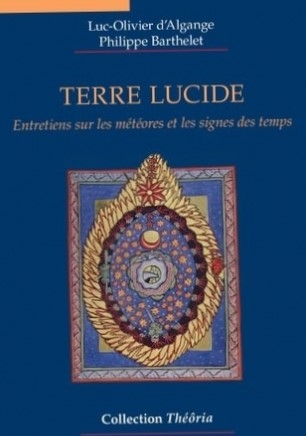Rechercher : Jean Parvulesco
Notes sur le voyage intérieur:

Luc-Olivier d'Algange
Notes sur le Voyage intérieur
« L’esprit, nous dit Nûruddîn Abdurrahmân Isfarâyinî, a deux faces, l’une tournée vers l’incréé, l’autre vers le créé. ».
Avant même d’atteindre à la perspective métaphysique dont elle procède, avant même que nous en comprenions le sens profond, gnostique, cette phrase s’adresse déjà à notre entendement, à notre raison. Sans même comprendre la sainteté de l’Esprit, et ses œuvres lumineuses et providentielles, hors même de toute théologie et de toute gnose, l’esprit humain reconnaît en effet, pour peu qu’il s’attarde en lui-même, cette double nature, ce double visage, cette figure de Janus tournée en même temps vers l’advenu et le non-advenu, le possible et le réel, ce que nous pressentons, devinons et imaginons et ce qui s’offre à nous dans l’infinie diversité du monde créé.
Aussi éloignés croyons-nous être de toute métaphysique, aussi attachés au monde sensible que nous nous voulions, nous n’échappons pas à l’exercice quotidien de cette « double nature » de l’Esprit. Chacune de nos actions est précédée de son projet, de même que chaque rêve et chaque désir naissent d’une observation du monde qui nous entoure. Le temps, qui, en un voyage impondérable, nous précipite vers l’incréé et laisse le créé devant nous, non point aboli mais hors d’atteinte, définit à lui seul ce double visage de notre esprit. Aussi attachés soyons-nous au monde qui nous entoure, si réglées que soient nos existences et quel que soit notre consentement à la servitude du temps planifié, nous voyageons dans le temps, et le moindre éclair de lucidité nous révèle la fragilité de notre embarcation, l’incertitude de notre traversée.
Entre ce qui n’est plus et ce qui n’est pas encore, la seule réalité est l’Esprit. Il est cet au-delà du temps, cette crête, qui nous laisse voir à la fois les houles parcourues et les houles pressenties. Toute existence est vagabondage ou pérégrination. Et toute pérégrination est déchiffrement. Dans l’histoire de la philosophie occidentale, l’herméneutique homérique, qui nous entraîne aux métaphores maritimes, précède l’herméneutique biblique. Presque entièrement détruite dans l’incendie de la bibliothèque d’Alexandrie, il ne nous reste de l’herméneutique homérique, que des titres et des fragments (tel cet Antre des Nymphes de Porphyre qui suggère une lecture de l’Odyssée comme traversée du mundus imaginalis) et nous portons encore le deuil de cette destruction. Ce qui subsiste, toutefois, nous laisse entrevoir, sinon comprendre, que le périple d’Ulysse, ce voyage dont l’horizon est le Retour, se laisse lire comme une métaphore de l’art herméneutique. Déchiffrer un texte, c’est-à-dire consentir à la transparence de son chiffre, de son secret, ce n’est point lui ajouter mais révéler sa jeunesse éclatante, venir à lui, dans un commentaire qui s’efface, semblable, pour reprendre le mot de Maurice Blanchot, à « de la neige tombant sur la neige » et se confondant avec elle, ou encore au scintillement de l’écume retombant dans le bleu profond de la mer dont elle provient. « Le sens de cette rejuvénation, écrit Henry Corbin est non pas de tourner le dos à l’origine mais de nous ramener à l’origine, à l’apokatastasis, à la réinstauration de toute chose en leur fraîcheur, en leur beauté originelle. »
La lettre, le phénomène, sont ainsi « sauvés » de l’insignifiance par l’interprétation qui est tout autre chose qu’une explication. Notre cheminement à partir des textes sacrés (et les œuvres des poètes en font partie) ne nous éloigne de la lettre que pour la garder, pour veiller sur elle, pour en rétablir le rayonnement et la souveraineté. L’opposition entre le « littéralisme » et l’herméneutique ne serait ainsi qu’une illusion. Loin de trahir la lettre, l’herméneutique la rétablit dans sa légitimité : littéralement, elle la sauve de la futilité d’une explication figée ou réductrice, telle que la défendent, de façon souvent vindicative, les fondamentalistes.
Les herméneutes qui, tel Ulysse, s’éloignent pour revenir, les « déchiffreurs » pour qui l’Origine est le Retour, seraient ainsi les véritables fidèles de la lettre, mais d’une lettre non plus administrée ou instrumentalisée à des fins trop humaines mais d’une lettre restituée à l’Esprit, d’une lettre véritablement sacrée, non-humaine, et, par cela même, fondatrice de l’humanitas ; d’une lettre délivrée, dénouée, éclose et légère, d’une lettre qui serait une « invitation au voyage », sauvée de la morale subalterne et des illusions de l’identité et rendue, saine et sauve, à l’Autorité qui lui revient et qui est inconnaissable. « Plus nous progressons, écrit Henry Corbin, plus nous nous rapprochons de ce dont nous étions partis. Je crois que la meilleure comparaison que nous puissions proposer c’est ce qu’en musique on a appelé le miracle de l’octave. A partir du sens fondamental, quel que soit le sens dans lequel nous progressions, c’est toujours vers ce même son fondamental, à l’octave, que nous progressons. »
Le voyage herméneutique nous conduit, par étapes successives mais sur une même octave, de l’apparence à l’apparaître, de l’illusion des ombres mouvantes sur les murs de la caverne à la lumière et à la présence réelle. Les étapes sont autant d’épreuves ou d’énigmes dont il importe de déchiffrer le sens, autrement dit l’orientation. Entre l’infini du ciel et celui de la mer, la couleur de la mer se livre à l’herméneutique de la couleur du ciel, la réfléchissant mais en accentuant ses nuances et sa profondeur : le gris léger du ciel, le gris de cendre, par exemple, se fait gris de plomb à la surface des eaux, de même que la mer violette, « lie de vin », annonce l’orage avant qu’il n’apparaisse dans le ciel.
Cette vertu anticipatrice, sinon prophétique, de l’herméneutique, certes, ne révèle que ce qui existe déjà, mais dans l’indiscernable. L’herméneutique serait ainsi ce qu’est la splendeur à la lumière luminante ; mais la surface réfléchie est elle-même profonde, d’où les dangers du voyage, d’où l’importance de l’orientation. De même que le sens d’un mot tient à la fois de la lumière immédiate de l’intelligence qui le frappe et de sa profondeur étymologique, de son palimpseste généalogique, de même l’herméneute qui s’aventure de mots en mots doit se tenir entre l’archéon et l’eschaton, entre le créé et l’incréé, comme le navigateur crucifié entre le ciel et la terre, entre ce côté-ci de l’horizon, et cet autre, qui toujours s’éloigne et le requiert.
Toute traversée comme le suggère Virginia Wolf est « traversée des apparences » » : l’apparaître sans cesse traverse l’apparu, qui est une nouvelle énigme. Que la traversée soit périlleuse, nul n’en doute, mais elle est aussi mystérieusement protégée. Il n’est rien de moins naturel à l’être humain en tant qu’animal social (cellule du « gros animal » dont parlent Platon et Simone Weil) que de s’arracher à la « pensée calculante », qui n’est autre que la transposition rationnelle de l’instinct, pour oser l’aventure de la « pensée méditante ». Le « gros animal » veille à ce que l’humanitas ne soit pas tentée par son propre dépassement. L’individualisme de masse, ce grégarisme des sociétés modernes, définit notre destinée comme exclusivement soumises à une collectivité, quand bien même celle-ci ne serait constituée que d’égoïsmes interchangeables. La solitude est crainte. Qu’il navigue, ou médite, voyageur de l’extériorité ou de l’intériorité, aventurier ou stylite, ou encore adepte face à l’athanor dont les couleurs, en octave, s’ordonnent à ses propres paysages intérieurs, le voyageur est seul, mais d’une solitude nomade immensément peuplée de toutes les rencontres possibles.
De même que l’herméneute quitte le sens littéral pour retrouver l’orient de la lettre, le voyageur quitte l’esseulement grégaire pour s’offrir à la solitude hospitalière ; son adieu contient, en son orient, en son « sens secret », un signe de bienvenue. Le voyage intérieur est si peu dissociable du voyage extérieur qu’il se trouve bien rare que l’un ne fût pas la condition de l’autre. La chevalerie soufie, andalouse ou persane, celle des Fidèles d’Amour, occitanienne ou provençale, les Romantiques allemands, puis Gérard de Nerval, se laissent définir par un ethos voyageur que révèle, chez eux, la précellence de l’orientation intérieure sur les contextes religieux, historiques ou culturels dont il importe de ne pas méconnaître l’importance mais qui ne sont que des écrins. Qu’ils fussent Juifs, Chrétiens ou Musulmans, d’Orient ou d’Occident, fidèles aux dieux antérieurs, zoroastriens ou soucieux, comme les ismaéliens duodécimains et septimaniens, d’une recouvrance, d’une « rejuvénation » du monde par « l’étincelle d’or de la lumière nature », les Nobles voyageurs trouvent sur leur chemin des intersignes et des Symboles qui ne doivent plus rien au déterminisme historique ni au jeu des influences.

La parenté des récits visionnaires de Nerval avec ceux de Rûzbehân de Shîraz témoigne de l’existence entre le sensible et l’intelligible, du « supra-sensible concret » que l’on ne saurait confondre avec la subjectivité ou une quelconque fantaisie individuelle ou collective. Les paysages du monde imaginal, les événements qui y surviennent, les rencontres qui s’y opèrent n’appartiennent pas davantage que la mer et le ciel, à un monde « culturel » dont on pourrait définir les aires d’influence ou expliquer les figures en tant qu’épiphénomènes d’une psychologie individuelle ou collective. L’Archange empourpré dont une aile est blanche et l’autre noire, - cette « intelligence rougeoyante » que Sohravardî voit surgir à l’aube ou au crépuscule, qui allège soudain le monde par l’étendue de ses ailes au moment ou la nuit et le jour, le crée et l’incréé, se livrent à leur joute nuptiale, - cet Ange n’est pas davantage une « invention » de l’esprit qu’une allégorie : il est exactement un Symbole, c’est-à-dire une double réalité, visible-invisible, sur laquelle se fonde la possibilité même de déchiffrer et de comprendre. « Il m’arriva, écrit Rûzbehân de Shîraz, quelque chose de semblable aux lueurs du ressouvenir et aux brusques aperçus qui s’ouvrent à la méditation. ».
Le monde imaginal, échappe aux catégories de l’objectivité, en tant que représentation comme à celle de la subjectivité en tant que « projection ». Le ressouvenir et les « brusques aperçus » donnent sur le même monde qui récuse les frontières de l’intérieur et de l’extérieur, du littéral et de l’ésotérique. Ce monde offert à l’expérience visionnaire non moins qu’à la spéculation n’est autre que le monde vrai, le monde dévoilé par les affinités de l’aléthéia et de l’anamnésis. Victor Hugo eut l’intuition de cette imagination créatrice : « L’inspiration sait son métier (…). Tel esprit visionnaire est en même temps précis, comme Dante qui écrit une grammaire et une rhétorique. Tel esprit exact est en même temps visionnaire, comme Newton qui commente l’Apocalypse. » Tout se joue sur le clavier des correspondances. A cet égard, le voyage intérieur n’est pas déplacement mais transmutation. « Le voyage intérieur, écrit Rûmî, n’est pas l’ascension de l’homme jusqu’à la lune, mais l’ascension de la canne à sucre jusqu’au sucre ».
Si le monde est bien créé par le Verbe, si la « sapience » est bien cet Ange qui s’éploie entre la lumière et les ténèbres, l’Appel et la mise en demeure sont adressés non à n’importe qui mais à chacun. La témérité sohravardienne, qui annonce la témérité rimbaldienne, le conduisit précisément à proclamer qu’en la permanence du créé et de l’incréé, dans le flamboiement de la sainteté reconquise de l’Esprit, la prophétie législatrice n’était point close, ni scellée, que d’autres prophètes pouvaient advenir. « Tout se passe alors, écrit Henry Corbin, comme si une voix se faisait entendre à la façon dont se ferait entendre au grand orgue le thème d’une fugue, et qu’une autre voix lui donnât la réponse par inversion du thème. A celui qui peut percevoir les résonances, la première voix fera entendre un contrepoint qu’appelle la seconde et d’épisode en épisode, l’exposé de la fugue sera complet. Mais cet achèvement, c’est précisément cela le mystère de la Pentecôte, et seul le Paraclet a mission de le dévoiler ». Le but du voyage est le voyageur, mais non pas le voyageur tel qu’il fut et chercha à se fuir mais le voyageur dévoué, selon la formule de Plotin « à ce qui est en lui plus que lui-même ». Le voyage répond à ces questions plotiniennes : « Qui étions-nous ? Que sommes-nous devenus ? Où étions-nous ? Où avons-nous été jetés ? Où allons-nous ? D’où nous vient la libération ? » Pour Plotin, ainsi que l’écrit Jean-Pierre Hadot, « l’âme est d’origine céleste et elle est descendue ici-bas pour un voyage stellaire au cours duquel elle a revêtu des enveloppes de plus en plus grossières, dont la dernière est le corps terrestre », si bien que dans notre voyage la fin devient le commencement et le retour est l’origine même.
Entre le ciel et la mer, entre le sensible et l’intelligible, entre le créé et l’incréé, entre l’intérieur et l’extérieur, entre ce qui fut et ce qui doit être, ce ne sont plus des discords, des « problématiques » qui surgissent mais de beaux mystères qui se déploient, se hiérarchisent et se nuancent. Nous devons à Gabriel Marcel cette parfaite distinction du mystérieux et du problématique : « Le problème est quelque chose que l’on rencontre, qui barre la route. Il est tout entier devant moi. Au contraire, le mystère est quelque chose où je me trouve engagé, dont l’essence est, par conséquent, de n’être pas tout entier devant moi. C’est comme si dans ce registre, la distinction de l’en-moi et du devant moi perdait sa signification ».
De la nécessité du dépassement du problème par le mystère et du mode opératoire de ce dépassement, nul sans doute ne fut mieux informé que Novalis : « Si vous pouvez faire d’une idée une âme qui se suffise à elle-même, se sépare de vous, et vous soit maintenant étrangère, c’est-à-dire se présente extérieurement, faites l’opération inverse avec les choses extérieures et transformez les en idées. » Si le problème, n’est jamais, selon la formule de Gustav Thibon qu’un mystère « dégradé », le passage de la sédentarité profane au nomadisme sacré nous ouvre à la vérité du « Logos intérieur » qui nous traverse et nous invite aux traversées. Ce passage toutefois peut-être aussi discret qu’éclatant. « Ce sont, écrit Jünger, les grandes transitions que l’on remarque le moins. ».
Le passage de la chevalerie héroïque, inscrite dans l’Histoire, à la chevalerie spirituelle qui ne connaît plus que des événements sacrés, des événements de l’âme, ce passage de la prophétie législatrice à l’amitié divine, peut aussi bien s’opérer comme une rupture radicale, ainsi que ce fut le cas dans la « Grande Résurrection d’Alamût » des Ismaéliens qui proclamèrent l’abolition de la Loi exotérique, que par des transitions presque imperceptibles. Si Ibn’Arabî, au contraire de Sohravardî, considère la prophétie législatrice comme scellée, et qu’il veut demeurer, au contraire des Ismaéliens, fidèle à la lettre d
05/01/2022 | Lien permanent
Luc-Olivier d'Algange, Maurice Magre, fidèle de Mélusine:

Luc-Olivier d'Algange
Maurice Magre, fidèle de Mélusine
« Je percevais dans l’air des forces en suspens »
Maurice MAGRE
De Maurice Magre, on serait tenté de dire, les oxymores seuls pouvant définir les êtres entiers, qu’il fut un hédoniste spiritualiste (ou un spiritualiste hédoniste), espèce qui fut moins rare jadis que naguère et qui devient, par les temps qui courent, rarissime. De nos jours, les spiritualistes sont, en général, d’austères pions et les hédonistes, des gorilles. Il demeure cependant dans nos civilisations, et ailleurs, de merveilleux dispositifs, tels que la philosophie plotinienne ou le premier Romantisme allemand, celui de Schlegel ou de Novalis, conjuguant le frémissement sensible et l’ardeur de la connaissance, le bouleversement à fleur de peau et l’audace à franchir « les portes de corne et d’ivoire qui nous séparent du monde invisible » (Nerval)
Avant de désirer la vie éternelle, à laquelle Maurice Magre croyait en toute liberté, c’est-à-dire en dehors de tous les dogmes, encore faut-il, selon la formule de Pindare, traduite par Valéry, « épuiser le champ du possible ». Cette vie si passagère, si troublée, si incertaine que nous traversons est un appel à la plénitude, une convocation, ainsi que l’écrivait Montaigne, à « jouir loyalement de son être ». Or, nos temps sont à la restriction ; ils ne supportent plus ces alliances subtiles, ces noces philosophales entre le souffre et le mercure, la volupté et la sagesse, entre ce qui flambe dans les hauteurs et disparaît et ce qui roule et se divise dans le miroitement de l’immanence.
Le puritanisme s’est substitué aux ascèses et la pornographie aux jeux de l’Eros : triomphe de la marchandise sur la gratuité heureuse qui n’est autre que la part divine dans un monde humain, trop humain. Maurice Magre célèbre ainsi d’un même mouvement l’ascèse et le plaisir, la quête d’une transcendance, d’un Idéal, et le consentement à la beauté féminine, la recherche de la grandeur et l’amour des humbles. Son sens du grand art, subtil et savant, ne lui interdit pas de faire sienne la juste revendication des pauvres. Ses premières œuvres, comme la Prière au Soleil appartiennent à la tradition du socialisme français, d’inspiration libertaire, unanimiste et païenne :
« Un esprit Fraternel frémissait dans chaque herbe ;
Les Vieux arbres avaient des voix d’êtres aimés ;
Et nous sentions le soir assis parmi les gerbes
La poussière des morts mêlée au sol sacré. »
Proche, à cet égard, de Péguy, Maurice Magre sut dire, au-delà de l’éminente dignité des pauvre, « l’éminente pauvreté des dignes », dont il fut l’un des premiers : « J’ai voulu écrire la chanson des hommes d’aujourd’hui, de ceux que font souffrir l’affaissement des énergies, la pauvreté du cœur, toutes les misères morales et matérielles. » Loin de l’orienter vers un rigorisme aux inclinations totalitaires, cette révolte anti-bourgeoise le conduisit jusqu’aux frontières mêmes de l’invisible, qui n’est point l’abstraction, mais la puissance d’une âme libre, l’au-delà de l’orée qui enchante toutes les apparences du monde :
« Le monde est un secret que soudain je comprends :
Notre corps est léger et notre esprit fidèle »
Ce prosateur qui connaît l’art des longues périodes et de la « rhétorique profonde » fut particulièrement sensible à l’éclat de la soudaineté, qu’elle soit dans l’emportement de la compassion, dans la conversion ou la rencontre des regards. Les « choses vues » lui sont des Symboles, les Cités qu’il habite ou parcourt lui deviennent peu à peu emblématiques, tels le Londres de Thomas de Quincey, dont il partagea le goût de l’Opium, ou l’Ispahan des poètes persans dont les « jardins d’émeraude », suspendus entre le sensible et l’intelligible, sont familiers à ses voyages intérieurs. Ses spéculations et ses rêveries se lovent également dans les lieux de gloire ou de misère. Ses amantes sont haussées au rang de déesses ; ses rares amis lui apparaissent comme des héros ou des saints. De ses ennemis, il ne garde que le souvenir de l’inaccomplissement. Maurice Magre est de ces auteurs sur lesquels la médiocrité n’a aucune prise, quand bien même il s’en accuse, et par cela même. Loin de se croire parfait, ce qui est précisément le propre de la médiocrité forte de son nombre, Maurice Magre mesure, avec autant de précision que possible, l’écart entre son vœu et sa réalisation ; et cet écart n’est autre que l’espace même de son œuvre. Ses regrets ne sont pas moralisateurs : ils sont le secret de la musique des mots, non point contrition mais persistance amoureuse, consentement au « beau secret ».
Ses Confessions sur les femmes, l’amour, l’opium, l’idéal, disent cette soudaineté du secret, cette pointe exquise où le plaisir et la sapience se ressemblent, cette légèreté du corps (car, pour Maurice Magre, c’est bien le corps qui est dans l’âme et non l’âme qui est dans le corps), cette fidélité de l’esprit à l’émotion de ses premières épreuves et de ses premiers émerveillements. Rien ne lui est plus étranger que le reniement ou cette versatilité du consommateur, qui se croit libre pour brûler le lendemain ce que la veille il adora. Ses Confessions s’achèvent sur des « Remerciements à la destinée », d’une hauteur goethéenne, et qui ne sont point sans évoquer, aussi, l’émouvant « Bonsoir aux choses d’ici-bas » qui furent les derniers mots de Valery Larbaud : « Je remercie la loi qui préside à la destinée. Elle a placé mon enfance dans une maison de banlieue toulousaine, dans un jardin où il y avait un pin, un buis et une île de noisetiers… »
Par le don de la gratitude, devenu si rare, toute beauté devient frissonnante. Ni l’habileté technique « qui se manifeste par la glorification du laid », ni les cités industrielles « qui remplacent les antiques cités de pierre qui abritaient jadis des bonheurs paisibles et lents, où les hommes avaient la possibilité de pratiquer la rêverie et l’étude » ne donnent, ou plutôt, ne restituent, à la beauté du monde ce que nous lui devons. Le monde moderne apparaît à Maurice Magre comme « ces pyramides dressées par les esprits du mal ». Or, rien ne nous interdit, sinon quelque mauvais sort jeté à grands renforts de puissance et d’argent, de saisir la seconde heureuse, de retrouver le resplendissement de ce qui est :
« Un frisson de beauté circule une seconde.
Je sens qu’un beau secret dans l’atmosphère passe.
Un bal mystérieux s’éveille dans les choses. »
L’œuvre de Maurice Magre se propose ainsi comme un viatique contre la tristesse et le nihilisme qui nous privent à la fois de la vérité sensible et de la beauté intelligible. Cet hérésiarque de belle envergure, qui trouve son bien chez les gnostiques albigeois, non moins que dans le néoplatonisme des ultimes résistances païennes (qui lui inspira l’admirable roman intitulé Priscilla d’Alexandrie) n’a d’autre ambition que de nous nous enseigner une liberté dont l’apogée serait la fidélité même. Fidélité aux premières rencontres, aux premiers amours, aux premières lectures et aux premières ivresses ; fidélité aux moments d’intensité et de grâce. Priscilla d’Alexandrie, publiée en 1925, qui se situe dans l’Egypte tourmentée entre le christianisme et la paganisme, du quatrième siècle, nous invite, et c’est un genre d’invitation qui ne se refuse pas, à fréquenter les philosophes d’Alexandrie, tel Olympios, ermite néoplatonicien, ou Aurélius qui accomplira un pèlerinage « à l’ombre de l’arbre bodhi ». Priscilla qui sera la réincarnation d’Hypathie, après avoir participé à sa lapidation, médite, en compagnie de ses amis philosophes sur l’accord possible entre la volupté et la sagesse, entre l’assentiment au monde sensible et l’aspiration au monde invisible. Le sceau et l’empreinte, ce qui symbolise et ce qui est symbolisé ne sont-ils pas une seule et même réalité ? « Toute la nature avec ses soleils et ses nuits douces ne serait alors qu’un vaste piège pour empêcher l’homme, par le réseau des désirs, de parvenir à la plus haute spiritualité. Ce n’est pas possible. Il doit y avoir une conciliation entre la splendeur de la matière et le règne de l’esprit. Il doit existe une sagesse qui aime, une vérité qui a du sang ».
On songe à cet autre livre, de Mario Meunier, qui fut un éminent traducteur de Platon et de Sophocle, Pour s’asseoir au Foyer de la Maison des Dieux : « Etre volupteux : c’est entendre en son sang bouillonner tous les vins ; c’est aimer le besoin de multiplier ses amours, ses sympathies et ses admirations ; c’est participer à l’infini de l’Etre, collaborer à son éternité et aimer la vie jusqu’au désir de souffrir pour mieux vivre, et de mourir pour changer et revivre. » Pas davantage que le sensible ne s’oppose à l’intelligible, le multiple ne s’oppose à l’Un, ni le provincial à l’universel : « Ne te scandalise donc pas de la multiplicité des dieux. Si les morcellements de la divinité ne nous apprennent rien sur la vérité de son être insondable, ils affirment néanmoins, en tous temps et partout, sa souveraine présence (…) Une des plus nobles activités de l’esprit est de surprendre, en chacun des dieux des nations, la parcelle d’infini qu’il contient. En cette interminable théorie de déités, ma pensée reconnaît et adore les rayons divers d’un soleil identique. »
Libertaire, par goût de la légèreté, hostile aux pomposités et au puritanisme bourgeois, dont il se moque sans amertume mais avec une sereine ironie, Maurice Magre demeure avant tout fidèle à l’esprit des lieux. L’esprit des lieux, comme toutes les choses difficiles à définir et qui échappent aux ensembles abstraits (dont certains voudraient nous voir dépendre exclusivement) exerce sur nous une influence profonde. Simone Weil évoquait la persistance d’une science romane, d’une gnose occitanienne, Raymond Abellio, Joë Bousquet vinrent à la rencontre du reste du monde à partir de Toulouse, cette Thulée cathare. Il en fut de même pour Maurice Magre. Ne méprisons point le sens de l’universel, mais sachons qu’il n’est jamais que la fine pointe d’une réalité provinciale, d’un cheminement à partir d’un lieu, d’une méditation sur une configuration historique et sensible, d’une tradition dont on ne saurait s’exclure à moins de saccager en nous le Logos lui-même.
Nous existons à parti d’un lieu, et qu’importent nos pérégrinations ou nos errances, une fidélité demeure inscrite dans notre langage même, dans le ressouvenir de nos rencontres, dans la lumière. L’esprit des lieux est un composé de culture et de nature ; le cosmos et l’histoire y ourdissent ces admirables conjurations où nous trouvons nos raisons d’être. L’auteur du Sang de Toulouse et du Trésor de Albigeois donne le sens de son cheminement par l’incipit, cher au cœur des toulousains évoquant le second âge d’or de la cité palladienne : « Par les quatre merveilles de Toulouse, par la beauté de ses clochers et la jeunesse de ses jardins ; par Clémence Isaure, la virginale et la protectrice, par Pierre Goudoulin aux beaux chants, par l’hôtel d’Assezat aux belles sculptures… ».
Ainsi débute la quête du Graal pyrénéen, par cette voix qui s’adresse une nuit de septembre à son héros Michel de Bramevaque : « Lève-toi ! Marche dans le pays toulousain, Retrouve le Graal qui est caché et les hommes seront sauvés ! » La quête du héros sera de retrouver les descendants des quatre chevaliers « portant sous leur manteau l’héritage de Joseph d’Arimathie, l’émeraude en forme de lys ». Ne divulguons pas davantage de ce roman, sinon qu’il y figure une « Nuit des loups » qui est l’un des hauts moments de la littérature fantastique. Evoquons encore, parmi les innombrables romans de Maurice Magre, Jean de Fodoas, qui fut réédité sous le titre La Rose et l’Epée où, ainsi que l’écrit Robert Aribaut, dans son ouvrage sur Maurice Magre, « la fleur royale n’est plus offerte au héros par quatre cavaliers noirs mais par Inès de Saldanna, sœur du vice-roi de Goa ! ». C’est bien la profonde méditation sur le « sang de Toulouse », qui circule d’un mouvement invisible dans l’architecture de la Cité ; c’est bien l’accord du promeneur avec les rues de sa ville, où les temps se superposent et transparaissent les uns dans les autres, qui donne sa vertu poétique à sa conquête du monde, à son amour baudelairien des cartes et des estampes, à sa nature prodigue et accueillante aux merveilles de l’étrange et du lointain.
Dans cette œuvre immense, d’une imagination vive, colorée et voyageuse, où l’art d’écrire n’est ni trop ostensible ni trop caché, où la beauté consent à se manifester, mais comme sous une injonction supérieure dont l’auteur ne serait que l’intercesseur, les romans d’aventures, tels Les Aventuriers de l’Amérique du Sud ou Les Frères de l’or vierge, les récits de voyage aux Indes, alternent avec les romans poétiques ou initiatiques tels Mélusine, où, sous l’égide des Lusignan, et de la reine Chypre, qui hantent aussi un célèbre poème de Gérard de Nerval, Maurice Magre annonce, en le précédant de quelques années, l’Arcane 17 d’André Breton : « Avec quel incommensurable amour étaient attentifs les êtres vivants de la terre et de l’air. Il flottait une pureté que je n’avais jamais ressentie. Elle était dans le dessin des nervures des feuilles, la cristallisation des gouttes de rosée, la fluidité de l’air pénétré par la prescience du soleil levant… ». C’est vers cette « fille de l’air et des songe » que va l’ultime passion de Maurice Magre. « Mélusine, notera Michel Carrouges, est en relation intime avec les forces de la nature et par conséquent avec l’inconscient ; mais elle a des ailes et par là elle est aussi en communication avec les mondes supérieurs, ceux d’où elle s’envole selon la légende ». Symbole de ce spiritualisme hédoniste, que nous évoquions plus haut, de ce supra-sensible concret qui appartient au monde imaginal, la Mélusine de Maurice Magre est la divulgatrice de l’enchantement des apparences, l’amie de ces « créatures messagères » que sont les grillons et les rossignols, elle qui fait de notre âme, non plus cet espace insolite, restreint, carcéral mais une nuit de Pentecôte peuplée de lucioles, de signes d’or, messagers d’une «connaissance cosmologique », à l’instar de ces « paroles profondes » qui étendent le royaume du secret et transfigurent le monde. A l’orée de sa mort, dans ses derniers écrits, Maurice Magre ne demandera plus au monde que d’être lui-même, mais en beauté : « Des milliers de petites gouttes de rosée, invisibles jusqu’alors, devenaient brillantes, s’allumaient comme les lampes d’une féerie minuscule, mais répandue à l’infini. Sortant du bain mystérieux de la nuit, le jardin émergeait, rajeuni et purifié. La lumière cependant continuait à naître d’elle-même. »
19/03/2023 | Lien permanent
René Guénon, l'ensoleillement intérieur:
Luc-Olivier d’Algange
L'ensoleillement intérieur
Notes sur René Guénon
Alors que nombre d'essais publiés dans les premières décennies du siècle paraissent désormais obsolètes ou excessivement entravés par les circonstances qui les virent naître, la pertinence de l'œuvre de René Guénon s'accroît presque de jour en jour. La possible réduction de l'être humain en objet de série, suite logique du « clonage mental » favorisé par la « communication de masse » corrobore, au-delà de toutes les craintes, la justesse de l'analyse du Règne de la Quantité et des Signes des Temps. La soumission de plus en plus affirmée des religions à ce que Jean Tourniac nommait « l'exotérisme dominateur », à l'idolâtrie de la lettre morte, confirme ce processus de matérialisation et la haute pertinence de la distinction nécessaire que René Guénon établit entre les domaines initiatiques et religieux.
Dans l'ordre du politique, enfin, seuls les esprits les plus aveuglés peuvent encore méconnaître que la disparition de tout pôle d'Autorité spirituelle est la cause directe de l'abus de pouvoir, de l'hybris vertigineux du pouvoir de l'homme sur l'homme se traduisant, entre autres, par des massacres d'une ampleur et d'une horreur sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. Le despotisme moderne cautionne sans sourciller des horreurs qui eussent fait reculer d'épouvante l'empereur romain le plus fou, non sans conférer à son règne les allures dérisoires de l'opérette. La coexistence des camps de concentration, de la famine organisée et des « parcs d'attractions » témoigne de la nature fondamentalement bestiale et infantile de la « modernité ». Ce monde moderne accorde si bien en une même volonté le sentimentalisme et l'inhumanité que l'homme moderne qui fut épargné, ou qui s'imagine avoir été épargné (rendu à l'incapacité de mesurer sa propre déchéance) ne cesse de se redire à lui-même qu'il vit bien « dans le meilleur des mondes possibles ».
Sans voir que le mouvement même qui l'exile de toute fidélité et de toute centralité intérieure l'arrache, en même temps, de la terre, que le sensible lui est ôté en même temps que l'intelligible et l'appartenance au particulier en même temps que la possibilité de l'Universel, il s'acharne à l'apologie de son temps par une accumulation de mensonges, d'aveuglements et de faux-semblants qui obscurcissent son entendement jusqu'à la stupeur. Esclave entre les esclaves, unité interchangeable sans être, ni devenir, exilé de l'Exil lui-même, oublieux de l'Oubli, rejeté dans ces zones extérieures de l'être où toute parole est frappée d'inanité, le moderne croit encore être un « individu » libéré des exigences de la Tradition et des traditions, voire un « humaniste », alors que son consentement aux déterminismes inventés par le matérialisme mécaniste du dix-huitième siècle l'a soumis à n'être qu'une catégorie zoologique, une espèce parmi les espèces et non plus un Unique à l'image de Dieu.
Ce que le moderne nomme liberté est d'abord la liberté de ne pas penser, d'abandonner toute vie intérieure à l'utilitarisme dérisoire de la marchandise. Ses villes désorientées, titanesques et tentaculaires le convainquent sans peine qu'il n'est rien alors que l'idéologie dominante lui ressasse qu'il est tout, ruinant ainsi symétriquement tout esprit de fraternité et de compassion. Entre le tout et le rien, l'infantilisme, qui récuse tout héritage, toute déférence à l'égard des morts, - et la bestialité qui veut, selon la formule de Maurice Blanchot « réduire à la toute-puissance de la mort ce qui ne se mesure point en terme de pouvoir », le moderne veut s'éprouver supérieur aux hommes de la Tradition, à ceux qu'il nomme « archaïques », aux fidèles, aux porteurs d'une morale héroïque et sacerdotale. Mais cette supériorité étant, à ses propre yeux, des plus douteuses, il ne peut s'en convaincre sans exterminer ceux qui lui demeurent étrangers, peuples fidèles, tels que les Indiens d'Amérique, porteurs d'une culture chevaleresque et métaphysique, les Juifs d'Europe, les Orthodoxes de Russie, les Tibétains, parmi d'autres, sans oublier les victimes de la Terreur républicaine, et les hommes différenciés, poètes ou philosophes, en butte à la vindicte acharnée des planificateurs.
Pour ceux-là qui ne se sont point interdit de discerner ce que le monde moderne exige de nous, à savoir la réduction de notre entendement à un seul état d'être résolument périphérique, l'œuvre de René Guénon est à la fois un vade-mecum et une arme, et c'est à ce titre qu'elle fait désormais l'objet d'attaques de plus en plus nombreuses et diverses. Outre les irresponsables folliculaires qui s'évertuent à taxer « d'extrême-droite » toute œuvre hostile au totalitarisme moderne, par un simple renversement de la vérité, coutumier des pratiques journalistiques, il se trouve encore, dans certains milieux « chrétiens », des esprits vétilleux qui, pour surseoir à la confrontation avec la doctrine transmise par René Guénon, s'en prennent à la personne de l'auteur, ce qui équivaut à contester la justesse d'une formule mathématique en s'en prenant au mathématicien lui-même.
René Guénon, que je sache, n'a jamais interdit, ni même déconseillé à quiconque d'être chrétien, pas plus qu'il n'a proscrit la possibilité de ne l'être pas, tout en demeurant fidèle à la Tradition. Tout au plus s'agit-il de savoir si dans tel ou tel contexte religieux celui qui prie et adore adresse sa prière et son adoration à Dieu ou bien à la représentation que ses coreligionnaires se font de Dieu. Est-ce la religion qui doit être vénérée, dans sa réalité historique et humaine, ou bien la réalité supra-historique dont elle témoigne ? Est-ce la communauté humaine qui détermine le sens des sacrements et des liturgies ou bien le sens des sacrements et des liturgies qui doit influer sur les hommes ? Dans n'importe quelle église du monde, en sa plus humble prière, l'homme est seul avec Dieu. Cette solitude essentielle oriente sa ferveur vers l'universel, quand bien même elle est rendue possible par la fidélité à telle ou telle forme particulière. Le principe de gradation s'avère ici d'une importance décisive, ainsi que celui de l'initiation.
« Lorsqu'on lui montre la lune, l'imbécile regarde le doigt » dit un proverbe chinois. L'exotérisme dominateur, non seulement fourvoie le regard, mais il interdit la juste orientation du regard. Il existe en toute religion une part immanente, sociale, historique, humaine qui se manifeste par le lien nécessaire des hommes entre eux; l'erreur moderne est de vénérer cette part, de l'absolutiser dans l'identification absurde du message et du médium. Le critique moderne croit que le sens d'une œuvre n'est qu'un « épiphénomène du texte »; le fondamentaliste, non moins moderne, veut croire que la formulation de la vérité vaut davantage que le vérité elle-même. Du Symbole qu'il représente et qu'il vénère, il détruit la puissance opératoire en refusant de joindre la part visible, historiquement inscrite, particulière, conditionnée, formelle, à la part invisible, universelle, centrale, inconditionnée et supra-formelle.
L'oeuvre de René Guénon nous enseigne à nous défier de l'idolâtrie du Symbole. Elle vient nous rappeler à propos que le Symbole n'est qu'un instrument et qu'il peut aussi bien nous aveugler que nous éclairer selon que nous en usons à bon escient, selon une métaphysique dont l'exactitude et la transmission régulière font l'objet dans Aperçus sur l'initiation, de minutieux exposés, ou bien à mauvais escient,- c'est-à-dire en état de pure fascination.
Tout langage dispose du double pouvoir de fascination et de communion. La fascination relève du pouvoir, et comme telle, elle s'exerce éperdument, et sur tous les fronts, dans le monde moderne. L'infantilisme et la bestialité du monde moderne possèdent en la fascination leur alliée la plus sûre. La propagande, la publicité, tout ce qui fait écran entre l'homme et les réalités sensibles et intelligibles travaille sans discontinuer pour le règne sans partage de la Quantité.
L'immense conjuration contre toute forme de vie intérieure dont parlait Bernanos trouve en la fascination sa suppléante la plus diligente car elle réduit l'immense liberté humaine à la double servitude de l'hébétude et de l'activisme. La communion au contraire n'est possible que par l'Autorité, elle est la garante et la légitimité de l'Autorité; l'Autorité véritable est la clef de voûte de la communion. L'oratoire solitude de l'homme avec Dieu implique la communion avec ses semblables, morts ou vivants dans une synchronicité et, pourrait-on dire, une ubiquité dont témoignent les facultés surnaturelles de la sainteté et de la compassion, alors que la collectivité humaine, réduite à son immanence, exile l'individu dans une solitude narcissique dont il ne peut sortir, illusion funeste, que par sa fusion, son agrégation sub-humaine à un groupe, avec des semblables également décentrés, désorientés, également défaillants et cherchant dans le groupe humain une densité d'être qui leur fait défaut.
Cette accumulation de défaillances démultipliées donne la mesure des désastres et des déchéances modernes. Or, les désastres et les déchéances sont exponentiels; les normes profanes sont profanatrices, et loin d'indiquer seulement un état de soumission elles entraînent une accélération du déclin, de même que la chute d'un corps s'accélère par accumulation de la vitesse acquise en fin de course.
L'idéologie du progrès, magistralement réfutée par René Guénon, n'a d'autre raison d'être que de conférer un semblant de raison à ce mouvement descendant dont ce serait une erreur grossière de croire qu'il épargne les formes. De même que l'oubli ou le refus du monde métaphysique finissent par nous priver de la compréhension et de l'appréhension du monde physique et nous précipiter dans ce "monde virtuel" qui est un simulacre, à la fois du monde physique et du monde métaphysique, de même, les formes religieuses, après leur solidification exotérique et fondamentaliste sont menacées de se dissoudre.
Beaucoup feignent encore de voir dans la distinction guénonienne de l'ésotérisme et du religieux une opposition, voire un conflit dont l'un devrait sortir victorieux et l'autre vaincu. Or, un ésotérisme qui considérerait les religions constituées comme des adversaires ne saurait être qu'une écorce morte, une outrecuidance humaine parmi d'autres. Inversement, une religion considérant son propre ésotérisme comme néfaste ou périlleux en viendrait à nier le Principe de vérité lui-même, et son universalité métaphysique dont ses formes sont l'empreinte, si bien qu'elle condamnerait ainsi ses formes à une érosion fatale, voire à une disparition pure et simple.
L'universalité métaphysique, loin d'être l'ennemie des formes en constitue le centre et la légitimité. « Toutes les voies, écrit René Guénon, partant de points différents vont en se rapprochant de plus en plus mais demeurant toujours distinctes jusqu'à ce qu'elles aboutissent à ce centre unique, mais vues du centre même, elles ne sont plus en réalité qu'autant de rayons qui en émanent et par lesquels il est en relation avec les points multiples de la circonférence. » Le religieux n'a pas davantage à se considérer comme hostile ou contraire à la métaphysique que les rayons ou la circonférence n'en auraient à se considérer comme étrangers au centre dont ils émanent. Tout se joue dans la perspective; l'idolâtrie débute aussitôt que tel ou tel point particulier prétend à l'exclusivité.
Le centre auquel aboutit le voyageur spirituel est le même que celui dont émanent les formes diverses. Telle est la Jérusalem Céleste que le Chevalier de Dürer, qui doit demeurer hors d'atteinte de la Mort et du Diable, discerne dans les hauteurs et vers laquelle il oriente sa monture. Le Chevalier est guidé par un acte de foi, mais cette foi n'a d'autre couronnement que la connaissance. « Les deux sens, inverses l'un de l'autre suivant lesquels les mêmes voies peuvent être envisagées correspondent exactement, écrit René Guénon, à ce que sont les points de vues respectifs de celui qui est en chemin vers le centre et celui qui y est parvenu, et dont les états précisément sont souvent décrits, dans le symbolisme traditionnel, comme ceux du voyageur et du sédentaire. Ce dernier est encore comparable à celui qui, se tenant au sommet d'une montagne, en voit également, et sans avoir à se déplacer, les différents versants, tandis que celui qui gravit cette même montagne n'en voit que la partie la plus proche de lui, et il est bien évident que la vue qu'en a le premier peut seule être dite synthétique. »
L'erreur funeste serait alors d'induire de l'unité transcendante des religions un syncrétisme qui, à la vertu éminente d'universalité, substituerait la confusion des formes. Ainsi, les mystiques obscurantistes du New-Age, avec leur cortège de sectes plus ou moins odieuses ou loufoques, appliquent à des domaines qu'elles ne peuvent ni ne veulent comprendre la logique aberrante d'une philologie qui, se fondant sur la possibilité de la traduction, principe de toute tradition, en conclurait, par une sophistique sommaire, à la nécessité d'imposer à tous un espéranto où s'éteignent précisément les vertus d'universalité contenue dans chaque langue.
Ecrivain français, je crois en la possibilité de traduire un poète allemand, anglais ou chinois (le poème, en chaque langue étant lui-même traduit d'un silence antérieur) précisément car je crois en le génie propre de chaque langue. Alors que la voie vers l'universalité traditionnelle va de la périphérie vers le cœur, le mondialisme moderne et profane se contente de parcourir la circonférence en l'ignorance des rayons et du centre où ils convergent. D'où l'importance de préserver l'intégrité des langues et des formes. Une langue française amoindrie, rendue dissonante par l'usage malencontreux de formes idiomatiques étrangères, appauvrie dans sa syntaxe et dans son vocabulaire, s'éloigne de l'universalité, tout comme une forme traditionnelle, dédaigneuse de la précision opératoire de sa liturgie, de ses rites et de ses symboles est condamnée à s'étioler. «