23/05/2024
Luc-Olivier d'Algange, Hommage à Malcolm de Chazal:


La théocosmogonie de Malcolm de Chazal
Ainsi, certains livres ne sont pas seulement des œuvres, et moins encore des travaux littéraires, mais des événements de l’Ame. La date où ils apparaissent, la révélation dont ils émanent, appartient, plus encore qu’à l’histoire où ils s’inscrivent, à une hiéro-histoire, qui, dans un renversement de clartés, devient visible dans la nuit même qui nous gouverne.
Ce livre de Malcolm de Chazal, Aggenèse, - paru aux éditions Arma Artis, - est une entrée dans la nuit, dans ce « noir invisible » où gisent les couleurs secrètes du monde. « Et je continuais, écrit Malcolm de Chazal, presque moribond de désincarnation la Route du Noir dans le paysage ensoleillé des Salines parmi les cocotiers, les acacias, dans l’herbe tremblante de lumière… ». L’entrée dans la nuit n’est pas un consentement aux ténèbres, ni la seule considération de l’ombre, mais éveil de la pensée antérieure, de la mémoire profonde. La théocosmogonie, qu’illustre l’œuvre de Malcolm de Chazal, est amoureuse tout autant que métaphysique ; sa dualitude est embrassement et embrasement. Dieu, dans cette cosmogonie, est « NOON et ALLA » dans leurs « étreintes ». L’espace et le temps sont inspir et expir. La corolle du jour éclose dans la nuit est « bouquet de flamboiements ».
Après la pensée mythique de Pétrusmok et le flot de correspondances et d’analogie de Sens Plastique et de La Vie Filtrée, Malcolm de Chazal entre ici dans la vastitude et la profondeur de la nuit divine. Voir et penser le monde à partir de la nuit divine, en amont de toutes les représentations que nous nous faisons collectivement et individuellement de nous-mêmes, par-delà les idéologies, les religions exotériques, les sciences, c’est laisser venir à nous, à travers nous, une puissance, un Verbe antérieur : « Ce Verbe est infini tant que le poète s’effacera suffisamment pour être uniquement l’objet qu’il traduit et dépouillera son moi au point de devenir la chose qu’il dit ».
Cette impersonnalité active est libération au sens le plus haut ; non pas cette illusion de l’individu irrélié, mais liberté conquise sur le grief, l’utilitarisme, le ressentiment qui président à l’utilisation technique du monde,- cette vengeance de ceux qui ne savent pas le contempler. Le « Vaste » de la théocosmogonie de Malcolm de Chazal, ces latitudes et ces longitudes reconquises, cette attention au plus lointain à l’intérieur du plus immédiat, cette plongée dans la nuit invisible à partir de laquelle le monde immanent scintille et s’irise, - telle est l’aventure, non pas décrite mais récitée, chantée, en poèmes, aperçus et litanies dans cette Aggenèse qui échappe à tous les genres littéraire car elle les précède, non comme un objet mais comme un visage qui nous regarde : « Ce qui fait la couleur / C’est la pensée / Pensée de franciscea / Pensée de l’œillet / Pensée de la rose et du lys / Sur le visage, c’est l’expression. »
Dans le monde de Malcolm de Chazal, les pierres parlent des civilisations englouties pour en dire les mystères et les fraîcheurs, et les fleurs nous regardent. Le temps n’est plus à faire des expériences avec les êtres et les choses mais d’entrer en relation avec eux, comme la couleur entre en relation avec la nuit, comme la musique entre en relation avec le silence. Rien n’est plus versicolore que ce grand traité d’entrée dans l’invisible et dans la nuit, là où attendent les ensoleillements de l’être : « La lumière vint / Du ventre du Noir ». Lumière génésique, confondue à la pensée qui la cherche, aurora consurgens de la conscience.
La pensée nocturne et la clarté révélée sont d’une même source. Un même éros cosmogonique présage à leurs accomplissements : « A deux corps pour une même extase / A deux cœurs pour un même amour / A deux extases pour un même Dieu. » La dualitude révèle par intégration de l’Un et dans l’Un le mystère d’une trinité non plus abstraite ou simplement dogmatique mais incarnée dans « l’Homme-Lumière ». La terre est céleste et le ciel est un jardin qui tourne et se renverse : « Tu es la source / De tout ce qui est / De tout ce qui se vit / Se goûte / Se pense / Ou se caresse. »
L’œuvre de Malcolm de Chazal nous offre à ce rappel, à ce ressouvenir. La vie ne vaut d’être vécue que si elle est un cheminement vers le Miracle, - qui veille telle une lumière incréée au fond de la pupille : « Et ma fleur est pleine / De pupilles/ C’est tout l’invisible en elle / Le Noir la pénètre / La lumière inversée. »
Cette allée ouverte par les mots, par l’écriture immanente-transcendante de Malcolm de Chazal, est, au sens premier, une théorie du Graal : cette coupe qui, renversée, est le ciel même qui nous protège de sa nuit et favorise l’éclosion, la renaissance immortalisante de la fleur symbole du regard, de la pensée éclose, et, si l’on ose dire, symbole d’elle-même dans son advenue voyante : « Et voici ce moment du temps / Incarcéré dans une couleur / Voici l’espace de voir / Intégré à une forme / Deux images : visible et invisible / Et c’est la fleur. »
L’exercice spirituel, pour Malcolm de Chazal, n’est pas austère, quand bien même il provient d’une exigence radicale, car ce qu’il déploie, par la double lumière de l’Un, n’est autre que l’arc-en-ciel : « Signe de matière / Aux côtés nuital et de Jour / NOON et ALLA : La double lumière en Un / Que lie le jaune incandescent. »
Nous ne pensons pas encore ; nous ne parlons pas encore. Une puissance est retenue, détenue dans l’archéon, au plus lointain, dans la nuit antérieure. Pour advenir à la pensée, la pensée doit nous advenir dans l’oubli de ce que nous croyons être, de nos évaluations, de nos estimations, de nos calculs, de nos planifications, de nos « savoirs » qui se sont détournés de la sapience. Or pour atteindre ce point où la pensée et la parole naissent l’une de l’autre, en présence réelle, il faut entrer dans le Verbe qui est à la fois proche et lointain, hors d’atteinte et substantiel : « Verbe tu es lié à la substance : Comme l’ombre à la lumière… / Voici le grand secret : l’indivisibilité du moi et des choses / Une même pâte / Une même vie. »
Le secret de l’archéon le plus lointain, perdu, comme la « Parole Perdue » des Alchimistes dans l’Atalante Fugitive de la nuit des temps, est aussi au plus près dans la substance même, et dans « l’herbe tremblante de lumière ». Le Là-bas est l’Ici-même, le visible et l’invisible tournoient et fleurissent dans le Verbe nocturne : « Car le monde Là-Bas / Est Renversement pensée-image / De ce monde ci / Comme Renversement / De lumière / Retournement du Visible et de l’Invisible. »
Nous comprenons alors, lisant Malcolm de Chazal, que c’est l’invisible qui, advenant à l’envers du visible en révèle l’avers en resplendissements sensibles. L’Homme-Lumière qu’évoque Malcolm de Chazal, a pour vocation de révéler, par son cheminement entre l’archéon et l’eschaton le ressac de la mémoire vive. Ce Là-bas qui, torrentueusement, revient dans l’Ici-même, dans la prophétie de l’Ici-même : « Là-bas l’homme sera Toute Mémoire / Et imaginer sera faire sa vie. » Le ressouvenir est imagination créatrice : « La Mémoire sera le rappel de l’Eden… / L’Image Originelle reviendra / Peu à peu en nous / Et embellira le monde projeté. »
L’Aggenèse de Malcolm de Chazal est ainsi, à la suite de la Divine Comédie de Dante, une méditation sur la Paradis. Comment sortir de l’enfer du ressentiment et du purgatoire de la représentation ? A quel appel répondrons nous ? C’est aux signes infimes comme les herbes tremblantes de nous le dire, afin de réinventer, au-delà de l’agonie du Dédire quotidien, le Dit qui parle vif au secret du cœur : « O Toi qui agonise, le Paradis t’attend ».
Luc-Olivier d'Algange
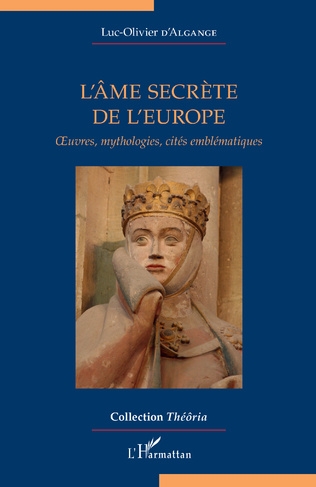
23:43 | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
14/05/2024
Luc-Olivier d'Algange, Hommage à Maurice Scève, poème:

Heures de syrtes et de feu, heures aimées…
En hommage à Maurice Scève
Heures de syrtes et de feu, heures aimées…
Des univers y battent leurs feuilles sous la pluie si claire,
Laudes écrites contre la brume et dans le marbre de l’air.
Quelle enfance en poussière dans le sommeil léger ? Les regards
Mystérieusement se rencontrèrent dans l’intimité du monde,
Et cet être du vent sur le dos des tempêtes nous emporte
Vers l’exquise incertitude qui nous laisse dans l’abandon
Comme une barque tardive, vaguement oscillante
Sous la blancheur du ciel, nous laisse être
Avec le seul souvenir des temps où nous n’étions rien,
Sinon cette ombre du chant qui nous précède, cette ombre
D’un temps où fleurissent les patries des terres dorées
Dites, de degré en degré, jusqu’aux fortins paradisiaque !
La nostalgie change les proportions du monde.
Depuis des temps immémoriaux, la nuit est mauve.
Les nuages se sont habitués aux cadrans des Jardins.
Notre tourment s’achève avec les grands vaisseaux du siècle
Qui pavoisent… La sagesse n’est point jalouse, mais éblouie.
Elle est l’hôte de l’heure déployée, de l’heure ardente,
De l’heure frémissante sous le joug des anciennes nuées…
Nous serons en elle, à jamais, et pour elle, et contre le monde !
Six feuilles entrelacées en épine dans l’incohérence des mots
Suffisent à notre bonheur, à notre gloire ! Six feuilles nervurées
D’un sang qui déchiffre les clartés de l’ombre
Lorsque nous marchons sur le profil de l’aube …
Ce furent ces aventures dites, où le double du firmament
S’abolit dans la nuit de l’azur, dans la ténèbre qui sauve la raison,
La seule qui nous dise la courbe claire de la musique, des navires…
Ainsi j’éveille doucement ce sommeil, je l’éveille de lui-même
Comme une lueur, comme un combat de pierres noires sur les rives nues.
Cela demeure, et ne nous quitte jamais. Cela demeure
Dans le passage du soleil comme l’apocalypse joyeuse
Des chants d’oiseaux au matin, dans l’entrelacs des six feuilles
Brodées d’absolutions et de chimères, mais seules vraies
Dans le bien qui nous est offert, dans la beauté de l’œuvre
Qui tient en elle la beauté du monde, tenue comme six feuilles
Du sommeil polaire entre les doigts, six feuilles insondables
Qui tressaillent des battements de la terre, où nous étions
De passage.
L’âme endure ces roseraies de tonnerre ! L’âme ne se lasse
D’être au seuil de l’effroi et de l’extase. Il n’y a que la bassesse qui se lasse,
L’infidèle à toute beauté, l’incessante traitresse aux oracles obscurs :
Les seuls qui vaillent. L’âme endure le sel de Typhon et la transparence
Qui brûle. Elle endure les abysses du bonheur, et les lentes processions
Vers la Somme incompréhensible des hauteurs. Elle endure,
Infaillible, et se forge, se gemme, sous le feu sifflant de la Sapience.
L’âme endure les désastres, mais devant l’âme, les désastres se courbent
Comme l’orgueil du vent sur la mer. De tant de siècles stellaires
Nous gardons mémoire, de tant de siècles de ravages : ils se courberont
Sur notre sein comme un jour se love dans le regard, comme une treille
Promise à d’autres ivresses inconnues s’établit dans le règne
D’un palais rouge crétois, comme encore ce qui passe dans ce qui demeure,
A l’infime : là où ce jour qui est nuit traverse le temps comme une vague ;
Nous y serons, à jamais, dans cette présence là, sable fin et grandes aurores…
L’âme endure et l’espace des formes, et le soleil tournant
Qui démantèle le monde et le déploie comme une corolle
Eclose sous la caresse. Tant de violences l’âme endure,
Et tant de douceurs : comment y survivre, sinon dans l’Eclat ?
Luisent six feuilles entrelacées dans la pénombre qu’elles animent
Pointent six feuilles : le monde s’y tient.
Six feuilles sybillines. De quel idiome, leurs nervures ? Il y eut
Ce mot comme une croix dans le ciel, cette marche vers la puissance
Que nomment les Parques, ce monologue sans fin dans la nuit
Qu’interroge le regard. Il y eut ces mots que ne disent ni la ruse
Ni le chancellement de l’existence dans la seconde aimée, rougeoyante
Comme d’elle-même devenue ce chiffre ordonné à la victoire !
Et cette bienheureuse doctrine des fougères, cette beauté infligée
Au théâtre sombre des heures, ce moment noir aux atours scintillants
De l’espace et du temps que nos prunelles, lumières gisantes ajournent
Pour de chant qu’il nous reste à dire… Six feuilles disparues, mais unies ;
Six feuilles dessinées sur l’arrière-pays où conduisent les routes colorées…
Six feuilles de vallées et d’étoiles. La terre vibrante comme un rubis
S’effondrait dans le vent du coucher comme un incendie, une ombre
Neuve à l’abordage du Soir où le sommeil dessine ses nervures, où l’attente
Dresse ses chapiteaux d’orage, où viennent se heurter les jardins et les guerres.
Cette folie était royale. Elle inondait nos larmes de lumière jaune. Elle élevait
Jusqu’au centre du monde ces routes, ces armées, ces noces prodigieuses.
Six feuilles d’or, six feuilles gravées par le feu dans l’air immobile,
Six feuilles, et voici que le jeu céleste obéit à nos cils, rumeurs donnée
Aux gorges vertes des aruspices. Les derniers empires vivent de cette clarté,
De cette sagesse claire. Les derniers empires appareillent au levant
Que détruisent les souvenir d’avoir aimé. Les derniers empires, les premiers,
Tombés sous la coupe transversale des règnes, en proie à leurs incertitudes,
Telles des strophes, des prairies renoncées au dieu inconnu…
Ces empires, sous l’aile double qui porte le mystère des vignes
Et des peuples affligés au nom des choses dernières ; ces empires
Qu’aucune trace sur les vagues à travers le temps, qu’aucune grandeur
Dans la genèse muette ne saurait dire, comme dans la gorge
Emprisonnée de ténèbres, le pôle de la voix s’exténue… Ces empires
Qui tiennent dans l’irisation de la goutte de rosée,
Mais que le monde, machine perpétuelle, ne contient ;
Ces empires de métamorphose et d’automne sans lune ; ces empires
Tropicaux et hyperboréens ; ces empires de baies rougissantes
Sur les mains ; ces empires qui passent doucement comme des songes,
Qui attendent avec des signes incertains ce point du jour suspendu
Au-dessus des forêts ; ces empires où l’obscur repos se mêle aux crinières
Foisonnantes des dionysies ; ces empires construits et détruits ; ces empires
Harassés, où des lumières siciliennes consentent à leurs dernières chances,
Il n’est pas un seul de leurs signes, un seul de leurs cris
Qui ne tiennent sur le Finistère de l’une des six feuilles que je dis.
L’intensité allège l’esprit. Point de fardeau qu’elle n’élève
Jusqu’à la plus haute branche du frêne du monde, où six feuilles frémissent.
Le vol prophétique clôt le crépuscule, et les ailes frôlent les feuilles ;
Les dieux irréversibles sont loin. Flèches ou flammes ? Qui devine ?
Encore d’autres violences, d’autres terreurs. Ne cesse le monde
Dans cette eau trouée par la bataille du jour : une colonne de gloire
Vers la profondeur ! Les dieux sont loin, mais je les nomme.
Quelque liturgie sabéenne cours dans la rumeur de mon sang.
Astarté fige le noir de ses roses d’ombre dans le détail de son tombeau.
Vive et tardive ! Des formes dansent sur les flots : elles se nomment Idées.
Le deuil ne trahit point la légende. L’intensité ne se dédit point :
Elle succombe à son propre bonheur et nous n’avons nul mal à en dire !
La première feuille fait signe dans l’orage. Proche, si proche, de son propre feu.
Le dieu de ses nervures hante la tristesse et le silence du serment :
Chaque fidélité dite témoigne de l’infidélité du monde.
La seconde feuille n’est point l’inconsolable : le Chœur est avec elle,
Et les voyages sur la mer calmée. Cette lueur de l’envers qui rédime
La douceur de l’avers, et la protège comme le bouclier de Vulcain,
Garde son blé en herbe. Mais la troisième feuille est comblée.
Sur elle la pluie ruisselle. La quatrième n’est point apostrophée par l’abîme.
La cinquième se tient entre une fille nue et l’étourdissante mémoire du monde.
La sixième, enfin, serait un mirage si le mirage n’était le monde.
Six feuilles mes Amis, pour ce long voyage… Six feuilles incorruptibles,
Six feuilles entrelacées sur les genoux, nouées
Dans la nuit turbulente, six feuilles vides comme le chagrin,
Et coupantes, six feuilles comme six flammes. L’une tient en elle
La mer qui va, l’autre le ciel qui tourne, l’autre encore la pensée qui domine,
L’autre une voix d’enfant, et l’autre encore ne tient que la brûlure de l’Ether…
De longtemps j’imaginais que la vie magnifique était écrite sur la sixième.
Funeste erreur : tout reste à dire. Soldat mérovingien, je tombe
Aux genoux d’Isis, s’il me plaît de nommer, comme en songe,
Cette présence immense. A la plus légère, mon destin ! Qu’il vague !
Elle se reconnaîtra, la rebelle au règne de Caliban, la jamais lasse
Pour bien et le vrai ; et que la beauté couronne
Comme un hiver d’Orient, le pâle azur !
Pour elle, ces feuilles de mon poème, ces ailes sixtes sises
Entre la perfection de l’aube et le sommeil de la terre.
Luc-Olivier d'Algange
Bibliographie
-
Manifeste baroque, Toulouse, Cééditions, 1981
-
Orphiques, éditions Style, 1988
-
Le Secret d'or, éditions des Nouvelles Littératures Européennes, 1989
-
La Victoire de Castalie, Aguessac, Editions Clapàs, 2000
-
Traité de l'ardente proximité, Aguessac, Éditions Clapàs, 2005
-
L'Étincelle d'or : notes sur la science d'Hermès, Paris, Les Deux Océans, 2006
-
L'Ombre de Venise, essai, Billère, Alexipharmaque, 2006
-
Le Songe de Pallas , suivi de De la souveraineté et de Digression néoplatonicienne, essai, Billère, Alexipharmaque, 2007
-
Fin mars. Les hirondelles, éditions Arma Artis, 2009
-
Terre lucide. Entretiens sur les météores (avec Philippe Barthelet), La Bégude de Mazenc, Éditions Arma Artis, 2010 ; rééd. revue et corrigé Editions L'Harmattan, coll. Théôria, 302 p., 2022
-
Le Chant de l'Ame du monde, poèmes, éditions Arma Artis, 2010
-
Lectures pour Frédéric II, Alexipharmaque, 2011
-
Lux Umbra Dei, éditions Arma Artis, 2012
-
Propos réfractaires, éditions Arma Artis, 2013
-
Au seul d'une déesse phénicienne, éditions Alexipharmaque, 2014
-
Apocalypse de la beauté, éditions Arma Artis, 2014
-
Métaphysique du dandysme, éditions Arma Artis, 2015
-
Intempestiva Sapientia, suivi de L'Ange-Paon, éditions Arma Artis, 2016
-
Notes sur L'éclaircie de l'être, éditions Arma Artis, 2016
-
Le Déchiffrement du monde : la gnose poétique d'Ernst Jünger, Paris, L'Harmattan, coll. Théôria, 2017 )
-
Sous la dir. de Pierre-Yves Rougeyron, Pourquoi combattre ?, Éditions Perspectives Libres, Paris, Janvier 2019, .
-
L'Âme secrète de L'Europe : Œuvres, mythologies, cités emblématiques, Paris, L'Harmattan, coll. Théôria, 2022.
-
Terre Lucide entretiens sur les météores et les signes des temps (avec Philippe Barthelet) Paris, L'Harmattan, coll.Théôria, 2023.
Propos réfractaires, édition revue et augmentée, Paris, L'Harmattan 2023
17:13 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
04/05/2024
Luc-Olivier d'Algange, Pour célébrer le bicentenaire de la mort de Joseph Joubert:

Le courage d'être heureux
Nos temps sont à l’outrance. Les moralisateurs univoques sévissent. En guise de contrepoison, les éditions des Instants nous offrent, sous le titre Le courage d’être heureux, les Carnets 1774-1824 de Joseph Joubert, avec une très belle préface de Christiane Rancé, – laquelle est la descendante de l’Abbé dont Chateaubriand, qui fut l’ami et le divulgateur de Joseph Joubert, fit un livre.
« La littérature respire mal » disait Julien Gracq de celle de son temps. Dans le nôtre, elle s’essouffle parfois d’indignations, feintes plus ou moins, et de complaisances en de réelles tristesses. Le courage d’être heureux n’est plus guère la chose du monde la mieux partagée.
Ce courage, Joseph Joubert nous l’enseigne, non par des propos édifiants ou des recettes, à la façon navrante du « développement personnel », mais par des exemples, des signes d’intelligence, saisis au vif de l’instant. « Il faut, écrit Joseph Joubert, plusieurs voix ensembles dans une voix pour qu’elle soit belle. Et plusieurs significations dans un mot pour qu’il soit beau ». D’une seule phrase, il nous donne ainsi un art de vivre et un art poétique. Rien, en effet, n’est si monocorde que la tristesse ; et se connaître, se reconnaître, c’est entendre le chœur des voix qui se sont tues mêlé de voix vivantes. Nous connaissons mieux un homme par les inflexions de sa voix que par son visage et mieux encore une œuvre par ses secrets, par ce qu’elle se dispense de nous dire, que par les convictions qu’elle affirme.
La lucidité, pour Joseph Joubert, est une forme supérieure de la bienveillance ; si matinale, si heureuse nous apparaît-t-elle en ces temps fuligineux traversés de cris de vindicte : « Porter en soi et avec soi cette indulgence qui fait fleurir les pensées d’autrui ». Quelles étendues anonymes nous séparent désormais du monde de Joseph Joubert, et par quelles passerelles le rejoindre ? La réponse est toute donnée dans ses pensées cueillies au fil des jours : par la langue française dans son usage le plus précis, le plus nuancé, le plus naturellement élégant.
Dans ces carnets Joseph Joubert nous donne à visiter ses jardins, qui sont de ceux « où le Maître peut se montrer ou se cacher à sa guise ». Son ambition est humble et immense : nous parler comme à des amis, passer les étapes intermédiaires d’un propos pour en éviter le tour didactique qui ferait insulte à notre intelligence, et enfin, laisser vivre dans sa faveur le repos de notre âme, le calme qui est la clef des mystères et des merveilles : « Les âmes en repos sont toutes en harmonie entre elles ».
Ce n’est point sans doute de cette façon, en nos temps spectaculaires, que l’on comprend la gloire (« Néant de la Gloire, dit Joubert, Dieu même est inconnu ») mais plutôt que le resplendissement péremptoire, et parfois accablant, sinon aveuglant, le lecteur trouvera dans ces pensées une autre lumière, une lumière filtrée par les feuillages des peupliers de France, une lumière qui joue au bord des rivières, une lumière spirituelle que l’on ne voit pas, mais qui révèle tout ce qu’elle touche.
Aux antipodes des manuels de « pensées positives», comme aux antipodes du nihilisme qui joue sa partition pour les déçus et les craintifs, et plus loin encore de tous les donneurs de leçon, Joseph Joubert ravive le goût, lequel, par excellence, alerte l’intelligence. Sans goût, l’intelligence – qui veut tant avoir raison qu’elle la perd – est insipide ou monstrueuse, de même que « l’esprit », s’il est malveillant, est le ridicule de celui qui croit en user au dépend des autres.
Philosophe, et même métaphysicien, Joseph Joubert l’est au suprême – mais non de cette façon discursive héritée des épigones de la philosophie allemande qui veulent faire des pensées « novatrices » avec de vieux sentiments. Joseph Joubert ne se veut point novateur, ou révolutionnaire, mais juste, si possible, de façon immémoriale. Son ambition est plus grande que de soulever le monde par l’abstraction, et son souci est plus humble : il ne veut point séparer le sensible de l’intelligible.
Souvent comparé aux Moralistes du dix-septième siècle, il se distingue d’eux par la métaphysique. S’il désabuse, comme eux, les hommes de leurs fausses vertus, c’est pour mieux nous inviter à quelque méditation. Frontalier entre deux mondes, comme son ami Chateaubriand, sa nostalgie est discrète et ses pressentiments sans drame. Sur l’orée, il exerce sa vertu majeure, dont il n’attend pas d’être sauvé ni perdu : l’attention.
« Ne confondez pas ce qui est spirituel et ce qui est abstrait » Et ceci encore : « Je n’aime la philosophie (et surtout la métaphysique) ni quadrupède, ni bipède, je la veux ailée et chantante ». L’étymologie est bonne conseillère. Chez Joseph Joubert, tout est pur, c’est à dire feu. Que nous faut-il ? « Du sang dans les veines, mieux du feu, et du feu divin. »
Le courage d’être heureux de Joseph Joubert (Edition des Instants)
°°°
Hommage à Joseph Joubert
D’emblée, à lire les Cahiers de Joseph Joubert, nous sommes saisis par un sentiment de légèreté, d’enfance, un « je ne sais quoi », un « presque rien » (selon la formule de Fénelon) qui évoque le matin profond des dialogues platoniciens, - ce moment qui précède leur exécution maïeutique ou didactique. La pensée de Joseph Joubert fréquente l’amont. Elle scintille au vif de l’instant qui la voit naître et l’auteur ne s’y attarde pas. A trop s’attarder sur elles-mêmes, les pensées les plus justes, les plus heureuses, deviennent fallacieuses et mauvaises.
S’il est des penseurs de l’après-midi ou du soir, ou de la nuit, Joseph Joubert est le penseur du matin, du jour qui point, de la fine pointe. D’où la vertu éveillante et roborative de ces fragments, - cette façon d’aviver l’intelligence, de la cueillir, de la précipiter, comme on le dirait dans le vocabulaire de la chimie, non sans lui donner parfois, et comme par inadvertance, une portée prophétique ou générale : « Les idées exagérées de compassion, d’humanité conduisent à la cruauté. Chercher comment. » Esprit chrétien, classique et platonicien, Joseph Joubert répugne à l’exagération, mais son goût de la mesure loin d’être seulement un accord de la morale et de la raison se fonde sur une intuition métaphysique. Pour Joseph Joubert, il n’est d’équilibre, d’harmonie et d’ordre que légers. L’ordre n’échappe à sa caricature que par des affinités particulières avec l’âme, la germination, la composition musicale : « L’ordre aperçu dans le mouvement : la danse, la démarche, les évolutions militaires ». L’exagération de la compassion, comme toute exagération, substitue à l’âme la volonté qui est négation de l’âme. La volonté outrecuide et grince ; sa dissonance est d’outrepasser les prérogatives humaines en passant à côté des bonnes actions qui naissent directement de la bonté et du cœur.
On se souvient de la phrase de La Rochefoucauld : « Cet homme n’a pas assez d’étoffe pour être bon ». C’est que la bonté est un art, une force, un don, une résolution peut-être, mais nullement une volonté. Elle nous est donnée par la Providence et nous devons la servir. Répondant aux circonstances qui la sollicitent en nous, elle ne peut exagérer ; elle est juste ou elle n’est pas. La vérité et le bonheur ne se détiennent pas, ils n’obéissent pas à notre volonté : « Nous sommes nés pour les chercher toujours, mais pour ne les trouver qu’en Dieu ». La belle et heureuse fidélité n’est pas crispée sur son dû. Elle est consentement à ce qui, en nous, est plus profond ou plus haut que nous-mêmes et non pas volonté de faire de nous-mêmes autre chose que ce que nous sommes dans nos plaisirs et vraisemblances. De la vraisemblance à la vérité, le chemin, qui n’est point une marche forcée, ne saurait être que providentiel.
Ainsi, « le siècle a cru faire des progrès en allant dans des précipices ». La suspension de jugement est bien souvent plus spirituelle que la certitude dont la volonté s’empare pour la faire servir à ses exagérations et ses aveuglements. L’humanité véritable s’exerce non dans le système, dans l’abstraction, dans la volonté, mais dans le regard échangé, dans l’attention et le recueillement : « Porter en soi et avec soi cette attention et cette indulgence qui fait fleurir les pensées d’autrui. »
Joseph Joubert distingue l’incrédulité de l’impiété, l’une n’étant qu’une « manière d’être de l’esprit », presque égale à la crédulité, alors que l’autre est « un véritable vice du cœur » : « Il entre dans ce sentiment de l’horreur pour ce qui est divin, du dédain pour les hommes et du mépris pour l’aimable simplicité. ». L’incrédulité est une vue partielle, alors que l’impiété est une volonté. « La piété nous rattache à ce qu’il y a de plus puissant et de plus faible ». Printanière, la pensée de Joseph Joubert l’est aussi par cette déférence à l’égard de la fragilité, par ce sens tragique du caractère irremplaçable de tout ce qui est, par la soumission à l’impératif divin qui fonde en son unificence chaque chose qui existe, et dont l’existence est, par voie de conséquence, à nulle autre semblable. La beauté du principe resplendit en chacun : « L’Un est tout ce qui n’est pas lui ».
La pensée de Joseph Joubert opère ainsi par élans, par des brusqueries bienvenues qui devancent le préjugé et nous donnent une chance, deux siècles plus tard, de nous poser les bonnes questions. « Scintillation, lumière par élancement » écrit Joseph Joubert, nous donnant la clef de sa méthode : « La musique a sept lettres, l’écriture a vingt-cinq notes. » Cette attention musicale sera singulièrement favorable à l’intelligence prospective. « Connaître la musique », l’expression vaut aussi pour les désastres de l’Histoire, les ruses des idéologues, les moroses confusions de l’Opinion dont les ritournelles ne sont pas si nombreuses. L’ « Empire du Bien », comme disait Philippe Muray, nous y sommes, et l’enfer moderne pave la planète de ses indiscutables bonnes intentions au nom d’une humanité qui n’est plus la douceur mais une abstraction vengeresse, une farouche volonté de contrôle et d’uniformisation, moins imputable à tel ou tel système qu’à l’esprit du temps lui-même qui est au ressentiment, à la conjuration puritaine contre toute forme de sérénité ardente et de profonde intelligence du cœur : « L’envie est un vice qui ne connaît que des peines ».
La cruauté moderne est de nous arracher exactement le « bonheur » qu’elle nous promet : « Chercher comment. » L’injonction joubertienne a ceci d’imparable et de nécessaire que faute de comprendre le processus qui nous asservit nous ne pouvons-nous en libérer. L’œuvre de Joubert est une invitation à perfectionner l’art de poser des questions imprévues au programme des idéologies, par exemple : « La démocratie et l’esclavage inséparables ». D’aucuns se contenteront de reléguer l’aperçu au rang des paradoxes ou des mauvaises pensées. Mais aussitôt consentons-nous à y chercher une question, c’est une grande partie de notre passé qui s’en trouvé éclairé, autrement dit ces « totalitarismes » toujours fondés sur la décapitation des autorités légitimes, voués à la surveillance généralisée, la haine du secret, la « fusion » sociale obligatoire, qui éteignent peu à peu tous les feux de l’âme et de l’esprit.
Dans le règne des esclaves sans maîtres, qui s’accommode fort bien, au demeurant, de vertigineuses disparités de fortune, l’esclavage est universel. C’est un « meilleur des mondes » où, tout simplement, la liberté n’a plus cours et où toute pensée n’est jamais, comme le remarquait Ernst Jünger, que réponse à un questionnaire préétabli. Or lire Joseph Joubert, c’est s’initier, pas à pas, à trouver ses propres questions, à varier leurs angles, leurs aspects, à exercer librement son attention et la rendre digne de la solennité légère du langage et du monde, digne d’être à la ressemblance des hirondelles de mars qui passent dans un cri.
Nulle trace, chez Joseph Joubert, de cette hubris (de laquelle, à des degrés divers tous les modernes sont atteints, y compris les modernes « antimodernes ») mais approche déférente de ce qui est et de ce qui passe, l’éphémère et l’éternel n’apparaissant pas comme des catégories radicalement séparées. Joubert écrit exactement ce qui lui passe par la tête. Il écrit non pas ce qu’il pense devoir écrire, ou ce qu’il faudrait écrire, moins encore ce qu’il conviendrait d’écrire mais ce qui lui apparaît, ce qui surgit, ce qui vole : « Evocations d’idées. Evoquer ses idées. Attendre que les idées apparaissent. »
Joseph Joubert nous révèle que le centre de gravitation de sa pensée n’est pas le moi, ni le nous, mais, comme en dehors de l’individuel ou du collectif, un consentement à la vérité de l’être : « Car l’erreur est ce qui n’est pas ». La vérité, si elle vaut comme réalité métaphysique et universelle, ne saurait être circonscrite par l’entendement humain. Joseph Joubert distingue « les pensées qui naissent de l’entendement » et « les pensées qui y viennent et s’y forment seulement ». Distinction capitale qui ouvre la perspective à l’intuition d’un suprasensible concret, à des idées dont l’entendement humain serait l’instrument de perception. « Ainsi l’esprit est presque à l’âme ce que la matière est à l’esprit ». Entre le sensible et l’intelligible, en bon platonicien, Joseph Joubert perçoit les états intermédiaires, comme entre la lumière et les couleurs : « Imagination, cet œil. Objets qui se peignent dans sa prunelle ». »
Ce sentiment de liberté qui nous gagne à la lecture de Joseph Joubert tient non seulement aux latitudes heureuses laissées à l’intuition mais encore à ce dégagement du moi, de la subjectivité, de la psychologie qui ne conçoivent les formes, les idées, les imaginations qu’issues du moi, le sien propre ou le moi d’autrui, sans jamais entrevoir, ne fût-ce qu’à titre d’hypothèse, qu’elles soient telles des lumières extérieures en provenance du monde, y compris du monde de l’âme ou du monde de l’esprit : « Et comme la poésie est quelquefois plus philosophique même que la philosophie, la métaphysique est, par sa nature, plus poétique même que la poésie ».
Mieux qu’un traité systématique, didactique, fermé sur lui-même, singeant la perfection ou la totalité ( et l’on sait à quelles abominations conduisent ces singeries lorsqu’elles ajoutent une « praxis » à leur « théorie »), l’œuvre en sporades, en fulgurances, en étincellements de Joseph Joubert nous reporte au centre qui, « partout et nulle part » selon le mot de Pascal, se trouve toujours et en toute plénitude dans l’instant pour peu qu’à l’auteur fût dévoué le génie de s’en saisir : « Poésie. Ce qui la fait. Claires pensées, paroles d’air, et lumineuses. »
Ce centre est non dans la subjectivité, où la critique subalterne, appareillée de « sciences humaines », cherche des preuves explicatives mais dans la hauteur et la profondeur dont l’entendement humain reçoit les figures et les symboles, autrement dit « la lumière par élancements ». Cette luminologie poétique ouvre à une métaphysique du resplendissement et du miroitement : « Dieu, seul miroir où l’on puisse se connaître. Dans tous les autres on ne fait que se voir ». De reflets en reflets, nous comprenons qu’il faut « penser au-delà de ce que nous disons » et « voir au-delà de ce que nous pensons ». La poésie est mouvement vers la lumière, vers l’Intelligence, au sens platonicien : « Dans le ciel personne ne sera poète car nous ne pourrons rien imaginer au-delà de ce que nous voyons. Nous ne serons qu’intelligents. »
Platonicien, Joseph Joubert l’est par expérience de la pensée comme le furent, avant lui, Marsile Ficin ou Pic de la Mirandole. Ce ne sont pas les catégories qui requièrent son intelligence mais les passages, les gradations, les notes et les couleurs, les nuances et les nuées, le chatoiement, le frémissement des feuillages, l’âme qui « se parle en paraboles » dans la rapidité des choses entrevues : « Pour entendre Platon, et le supporter, il faudrait que les mots avec lesquels on les traduit eussent pour nous le sens équivoque qu’avaient les siens propres pour les lecteurs et les auditeurs de son temps ». Les mots pour Joseph Joubert n’ont pas d’identité fixe, ils oscillent dans la balance des analogies, selon les poids et les mesures de la phrase, selon un ordre qui dépasse l’entendement de celui qui le perçoit : « Il faut que les mots naissent des pensées et que les phrases naissent des mots. » C’est aimée des Muses, musicienne, que la pensée se laisse ressaisir par la métaphysique et non par le jargon qui fixe arbitrairement le sens, perversion commune aux idéologues et aux spécialistes. La clarté et la légèreté ne sont pas hostiles à la profondeur et au mystère, bien au contraire, ils en exaltent les vertus, les sauvent de l’informe et du difforme et redonnent à nos trouvailles l’enfantine vérité des commencements : « Il faut adorer et prier selon les coutumes de son enfance. Dieu le veut, et aussi la nécessité. »
Joseph Joubert n’a nul besoin d’être antimoderne pour ne pas être moderne, et, plus encore, pour être déjà au-delà de la modernité, pour faire du monde moderne une chose obsolète, déjà dissipée et dont on peine à se souvenir. Sa pensée ne lutte plus avec ce qui nous entrave encore, elle s’en dégage, et comme dit Rimbaud, « vole selon », non sans donner, en une phrase, le portrait parfait et suffisant du siècle révolu où nous sommes nés, qu’il ne pouvait que deviner : « Un cerveau sombre, un esprit lourd, une imagination glacée et une raison échauffée… »
Le commentaire universitaire, qui ressasse Platon depuis quelques décennies, en croyant par surcroît le réfuter ou le « renverser », témoigne à sa façon de cette « imagination glacée » qui fige en simplifiant et ne renverse qu’une préalable caricature. Or, écrit Joseph Joubert, « Le même trait qui est agréable lorsqu’il est fugitif devient hideux s’il reste fixe ». Peut-être conviendrait-t-il alors de se souvenir que les dialogues platoniciens, ces « jardins tournoyants », donnent une pensée en conversation et en promenade, et non un système dualiste qui opposerait le sensible et l’intelligible. L’objection ordinaire faite à Platon et aux néoplatoniciens tombe ainsi d’elle-même. Le système que l’on croit réfuter n’est que l’invention du contempteur ou du réfutateur : « Il est des objections qui annoncent moins le défaut d’une exposition que les défauts de celui qui écoute. Elles ne viennent pas de l’obscurité de la matière mais de l’obscurité de l’esprit qui la considère, ou de sa lenteur, de sa précipitation ou de son inattention. »
Pour Joseph Joubert, le sensible et l’intelligible ne s’opposent pas mais se distinguent comme la lumière se distingue des couleurs : « La lumière entre dans les couleurs, qui néanmoins ne deviennent visibles que lorsqu’elles sont fixées, agglomérées par une matière propre à fournir cet effet ». D’où la préférence joubertienne pour l’élancement de la lumière, qui précède la fixation de la couleur, pour l’âme, qui est pur mouvement, pour l’intelligence d’où naissent les mots et la musique des phrases. Ce serait pure outrecuidance que de vouloir fixer l’éternité dont le temps est précisément, selon la formule de Platon « l’image mobile ».
La Tradition n’est pas immobilité mais traduction, interprétation infinie, scintillante rivière, elle ne peut être servie par des « cerveaux sombres » et des « esprits lourds ». Elle vient à nous par enchantement, par ce qui nous chante, par le suspens, dans l’apesanteur, qui est pure attente, claire attention : « Suspendue. Cette idée entre essentiellement dans toute idée d’enchantement. L’éclat y entre aussi. Et la légèreté, et le peu de durée. Ravissement est la suspension de l’âme ». La durée et la volonté sont des impiétés ; elles se substituent à l’éternité qui nous apparaît par éclats et à l’âme qui se meut par elle-même. L’âme est involontaire. Il en va de même dans l’art : « Il ne faut qu’un sujet à un ouvrage ordinaire. Mais pour un bel ouvrage, il faut un germe qui se développe de lui-même dans l’esprit comme une plante. »
Si donc pour atteindre aux idées, la pensée doit se retirer dans l’intelligible, ce retrait n’est nécessaire que pour y emporter avec soi, en les transfigurant, les images sensibles, d’autant que « toute grande attention est toujours double et quand on regarde devant soi, on regarde au dedans de soi ». Remonter de la couleur vers la lumière, ce ne sera pas nier les couleurs et moins encore les dévaloriser de façon puritaine mais œuvrer ( « comme les secousses d’une lumière qui cherche à se dégager ») à la recouvrance du principe : « Expliquer les reflets, et à quel point les rayons du soleil les augmentent ». Point de séparation entre le sensible et l’intelligible, mais des gradations : « Il faut une échelle à l’esprit. Une échelle et des échelons. »
La vérité n’est jamais acquise, ni détenue, mais approchée. Ce qui interdira donc de la planifier ou de l’administrer de façon indue. L’approche laisse un vague, mais ce vague n’est pas un vice mais une probité : « Il y a des figurations vagues qui doivent demeurer telles. La précision y nuirait à la vérité, et, pour ainsi dire, à la justice ». Le jargon, qui échauffe la raison (au point de la rendre meurtrière) est une outrance de la précision, de même que les écrits excessivement subdivisés sont des logiques outrées. La pensée juste est plus exigeante : elle désire rendre justice à ce qui lui parvient : « L’essentiel n’est pas qu’il y ait beaucoup de vérités dans un ouvrage mais qu’aucune vérité n’y soit blessée. » Nous n’avons de part à ces vérités que par reflet, de façon seconde, par notre disposition à les recevoir : « Nos meilleurs jugements sont ceux qui se forment en nous malgré nous et sans que par nos soins, nous y ayons part pour ainsi dire. »
D’où la nécessité du silence et du retrait qui honorent la parole et la communion : « C’est ici le désert. Dans ce silence tout me parle : et dans votre bruit tout se tait » Excellent alexipharmaque contre les poisons léthéens de notre temps, art de recouvrance du beau silence profané par nos temps vacarmeux, et qui font du vacarme une arme de destruction massive contre toute forme de méditation, l’œuvre de Joseph Joubert éveille en nous apprenant, par touches successives, à empreindre nos gestes et nos pensées de la beauté donnée. Il s’en faut d’infiniment peu que le monde ne soit paradisiaque, mais ce peu obnubile, tonitrue, s’impose. Sans cesse, pour ne pas en être possédé, il faut apprendre et réapprendre à se délier, reprendre souffle. Il n’est pas une occurrence du monde qui ne soit atteinte, marquée par le déni, par l’usure ou par cette formidable volonté de contrôle, guidée par la peur, qui semble être le mouvement majeur de notre temps, sa « vocation » dirions nous, si l’on ne craignait de profaner le mot. D’où encore la justesse de l’œuvre de Joseph Joubert dans sa forme même, insaisissable, diverse et mouvementée, sa parfaite actualité faisant de la pensée des actes, des sollicitations agissantes à l’intelligence du lecteur, aux antipodes de toute propagande. Point de train en marche qu’il faudrait prendre, point de locomotives, point de rails, mais bien plutôt une façon de descendre du train, d’aller dans le paysage, dans « le silence des champs », de retrouver le monde de la pensée accordé au monde (c’est-à-dire en constellation et non plus en ligne droite), un monde délivré de cette compulsion à démontrer à tout prix, de cette hybris discuteuse, de cet assommoir argumentatif qui nous interdit de le voir comme il est !
Si donc de tous nos grands classiques, Joseph Joubert est l’un des moins fréquentés, sans doute est-ce qu’il ne trouve aucune prise à notre manie du résumé et à l’utilisation que nous en voudrions faire : il nous laisse émerveillés et désemparés aux rayonnements du jour et aux hirondelles de mars. Lorsqu’un penchant funeste nous porte à considérer toute pensée serve de l’idéologie, de la stratégie, voire de la cupidité ou du pouvoir, Joseph Joubert la reporte, si l’on peut dire, sur sa naturelle portée musicale d’où elle nous dit ce qui lui chante, infiniment humble et souveraine, puissante et fragile.
Si presque toutes les apparences du monde sont désormais profanées par le ricanement, la dérision, la « joie d’abaisser » comme disait Nietzsche, qu’en est-il de nos pensées, - et de celles, surtout, qui « se forment dans notre entendement », qui nous viennent d’ailleurs ou d’autre part ? Savons nous encore les accueillir ? « L’œil de l’imagination » n’est-il pas aveuglé ? « Esprit humain. J’en cherche la nature ; d’autres en apprendront l’usage ». Aveu capital, immense dessein ! Ce n’est pas à l’usage de l’esprit humain que s’attache l’attention de Joseph Joubert mais bien à sa nature, à ce qu’il est, à la source même de nos paroles et de nos pensées, avant leur profanation utilitaire, avant leur réduction au plus petit dénominateur commun.
L’œuvre est celle du retour de l’âme (« L’Ame. Elle peut soulever le corps ») qui ré-enchante la pensée dans sa nature tout en nous désabusant de ses usages. Cependant la lucidité de Joseph Joubert n’est nullement désespérée car la nature de la pensée, à sa source, demeure impolluée de ses usages. Toujours vient le moment : « Dieu reprend alors le gouvernement de ce monde perdu ». Dieu, principe lumineux, antérieur, en amont, au matin, son heure est de toutes les heures, étymologiquement, de toutes les prières. Son éloignement est à la mesure de nos mauvais usages. Mais le Ciel est invariable : « Ciel, - le raisonnement en est banni, mais non l’éloquence ou la poésie. Au contraire, c’est là leur véritable séjour. Toutes les pensées y ont une éclatante beauté, parce qu’elles ont toutes pour objet les essences mêmes qui sont représentées dans tous les esprits avec une exactitude et une clarté parfaite. »
°°°
L'Allée Joseph Joubert
Quiconque prendra l'Allée Joseph Joubert ira vers une merveille discernable, « un jardin tournoyant ».
Cet homme qui fut peu inscrit dans la société de son temps, cet homme absent des représentations, fut prodigieusement présent au monde, témoin au suprême de sa civilisation, qui déjà se défaisait mais se continuait en lui, de façon impondérable, méconnue et magistrale.
Discret, modeste, mais se donnant, ou, plus exactement se laissant donner le génie de parler exactement de tout, - se laissant, s'accordant cette liberté, cet abandon, où Dieu brille à la pointe des pensées. Nul ne fut moins kitch ou pompier que Joseph Joubert, pas même son ami, et premier admirateur, Chateaubriand. Ce que les dandies cherchent, ce qu'ils poursuivirent au risque de le voir échapper, cette désinvolture heureuse qui ne se refuse rien, pas même la fragilité, Joseph Joubert la trouve à chaque pas de ses pensées. Sa liberté ne semble pas encore soumise à une volonté. Si le grand dessein des dandies fut de faire de leur vie une œuvre d'art, Joseph Joubert, en amont, fait de sa pensée, non pas une œuvre, mais un art de penser.
Joseph Joubert est un magnifique écrivain car ne croit pas aux genres littéraires, mais, de toute sa foi ardente, à la parole et à la pensée. Quelque chose de très important, de décisif, pour son temps et le nôtre, s'accomplit là, à l'insu de presque tous, - et que rechercheront, avec des bonheurs divers et plus ou moins embarrassés, les phénoménologues, les herméneutes, les avant-gardistes: une immédiateté dans l'intention pure, dans le feu clair de la plus radicale attention.
S'expliquerait ainsi le peu d'attention que lui accordent les modernes. Joseph Joubert est léger, - mais non point comme eux, inconstant, ou inconséquent; léger comme l'air, les oiseaux, comme les pensées lorsqu'elles virevoltent dans ces « jardins tournoyants » que sont, pour lui, les Dialogues de Platon.
Cet écrivain du fragment, de l'inachèvement, est un écrivain du tout et de l'infini. Sa pensée ne désire pas se reconnaître pouvoir dans les yeux d'autrui mais puissance infinie et diverse du monde. Dans cet immémorial combat métaphysique qui oppose l'universalité et l'universalisme, l'unité et l'uniformité, autrement dit la barbarie et la civilisation, Joseph Joubert est sans conteste du côté de l'infini, c'est-à-dire de l'exactitude. Il peut ainsi aller vers l'essence, vers le réel, la civilité, en amont de la civilisation, la rondeur avant la roue.
Ce retour à l'essentiel, au centre, est bien d'un homme de cœur pour qui les êtres et les heures ne sont pas interchangeables; et précieux infiniment car en eux se loge une répercussion de l'unité divine. L'extrême liberté de Joseph Joubert qui ne s'en laisse conter par aucun sous-ensemble du Gros Animal, ne se peut comprendre sans la piété, et sans le génie dont la piété récompense ceux qui la portent dans leur corps, leur âme et leur esprit.
Avec une extrême finesse, Joseph Joubert distingue l'incroyance de l'impiété, la première n'étant que conjoncturelle, alors que la seconde est absolue. Les négligences de l'incroyant sont bénignes à les comparer à la force destructrice de l'impiété (laquelle, cela se voit, peut revêtir divers voiles ou robes de la croyance).
La piété, et par l'écriture particulièrement, telle qu'en use Joseph Joubert, est dévoilement, et ce dévoilement est infini car, ainsi que l'écrit Ruzbehan de Shîraz, soixante-dix mille voiles recouvrent le Réel et ennuagent le cœur.
A chaque pensée, à chaque notation lapidaire ou furtive, Joseph Joubert ôte un voile de nos yeux. Son œuvre pie rapproche de nos prunelles le monde dans sa beauté et dans sa vérité. Hirondelles, ses pensées tracent leurs géométries à la venvole dans un ciel clair.
Le contraire de la piété n'est pas l'athéisme, l'incroyance, l'agnosticisme et moins encore la libre-pensée (Joseph Joubert n'aura aucune leçon à recevoir des « libres penseurs », ou soi-disant tels) mais le ressentiment, le relent, la stagnation. La pensée est juste car elle est, si l'on ose la redondance, un mouvement de l'âme, qui s'inscrit dans l'ordre de l'âme, non par un mouvement qui lâche, quitte, trahit, mais un mouvement vers le haut et le cœur, - vers la source invisible qui est l'apparaître de l'apparence, son advenue, à la fois transcendante et immanente. La révolution est passée, entre deux forces équivoques, versant finalement dans le saccage, puis dans un relativisme généralisé. Joseph Joubert n'opposera pas un ressentiment à un autre, une contre-révolution à la révolution, pas même une nostalgie explicite. Il se détourne du vacarme, de la lourdeur, se souvient qu'il est un homme et cultivera l'amitié des êtres et des choses, toujours sur le « qui vive ».
Nous trouverons dans les pensées de Joseph Joubert le meilleur usage possible de l'inquiétude. Le temps est court, les jours sont comptés, le désastre immense. Joseph Joubert sait déjà que les temps ne sont plus à la construction des systèmes ou des contre-systèmes, des visions globales, mais à la reconquête du retour vers une finesse native, vers une ressemblance subtile de la pensée humaine avec les œuvres de la nature et de Dieu.
Quelle avance dans cette œuvre pleine de retenue ! Et comme nous autres modernes, traînons derrière elle avec nos concepts, nos problématiques sociales, nos « sciences humaines », nos démagogies, nos jargons, notre volonté d'imposer et de convaincre, nos banalités sinistres, nos fanatismes de commande, nos effarantes étroitesses puritaines, nos embarras, nos encombrements.
On cherche, avec une espérance de plus en plus ténue, un esprit vif, délié, honnête. Partout ce ne sont que grimaces, hystérie, pathos et vengeance, publiques ou privées, politiques ou domestiques. Reniements qui s'adulent eux-mêmes, se veulent imposer comme la norme du monde, haines du bonheur machinés par ceux que l'ennui a chassé d'un paradis terrestre trop généreusement offert.
L'impiété nie le monde en reniant Dieu. Joseph Joubert, par bonheur pour lui, n'a pas connu ce qu'hélas nous connaissons: les hommes tapis derrière leurs écrans avec leurs petites âmes ulcérées et vétilleuses et dont le projet moral est de faire honte à l'esprit d'aventure et de porter aux héros, et sans risque, le coup fatal. La médiocrité despotique est au travail. Toute l'énergie qu'elle omet de dévouer à l'amitié et à l'amour va au service de cette normalité grimaçante, parodique. La vague et protectrice anarchie qui subsistait dans des époques plus anciennes est derrière nous. Tout est contrôlé et planifié tant il semblerait que le monde n'est plus gouverné par l'arbitraire d'un tyran ou téléguidé par les milles yeux du Docteur Mabuse mais par une mégère planétaire réduisant tout à ses ambitions et ses rancunes domestiques et dont les remugles sont l'étouffoir de toute pensée, de toute justice et de toute gratitude.
Le choix est simple: vous remerciez pour ce qui est donné, et donc vous goûtez ce qui est donné, ou point du tout. La négation du donné est la négation du possible, puisque le possible est le premier donné. Le goût est le possible dans le donné. Nier le possible, c'est nier la création dans la chose créée.
Joseph Joubert nous accompagne. Nous cheminons avec lui. Il n'entend pas modifier notre trajectoire, nous diriger, mais nous donner, à chaque intersection, la chance du choix le plus heureux, c'est-à-dire le mieux approprié à notre nature. Nul n'est plus idéaliste que lui (mais dans un sens bien différent de l'acception commune et récente du mot), lui qui, en bon platonicien sait contempler les idées.
On ne saurait utiliser ce que l'on contemple. La chose contemplée est cause. Elle est servie et non servante, ni serviable. Toute contemplation recèle un péril, elle est, au sens étymologique, expérience, traversée d'un péril, alors que les idéologies sont asservissement à des représentations secondes, à des fins empiriques et normatives, - alors même que ces normes ne correspondent qu'à l'illusion la plus largement répandue.
Une exigence secrète, ésotérique, traverse toutes les pensées de Joseph Joubert, les engendre, les lance; qui pourrait ainsi se résumer: il serait possible dans nos existences et dans nos pensées, de faire mieux, plus juste, plus léger, et mieux accordé à une bonté vaste, puissante, qui divague au-dessus de nous dans les nuées, et que, faute de lever la tête, nous n'apercevons plus, - mais qui nous guide et formule des vœux de bienvenue à ce qui, en nous, connaît les vertus de dégagement, de la tangente (qu'il faut prendre).
Telles se formulent les pensées de Joseph Joubert, non dans la linéarité démonstrative, en la monstruosité d'une pensée abîmée dans la considération de ses propres représentations, mais précisément dans la tangente, la traverse, - une oblique évoquant les rayons du matin et du soir, des sagesses naissantes ou déclinantes. Ce qui ne se pense plus, ce qui ne se pense pas encore.
Luc-Olivier d'Algange
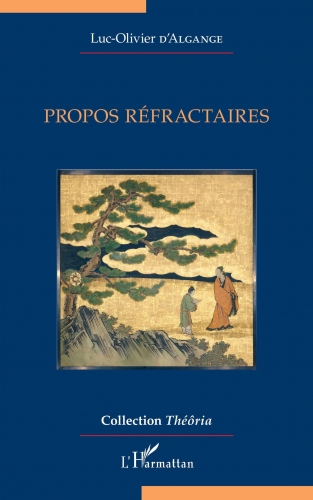
08:12 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook


