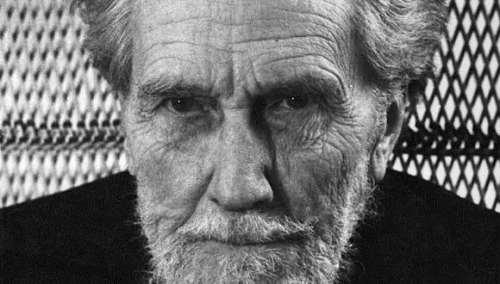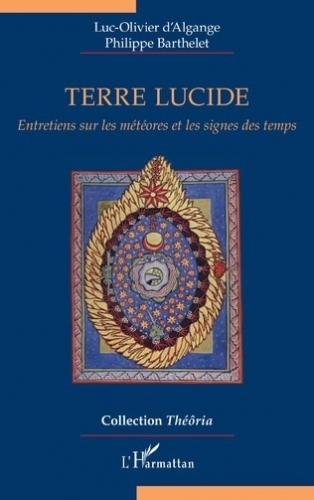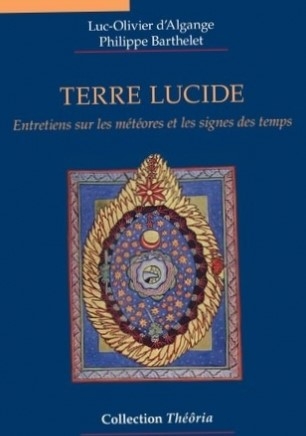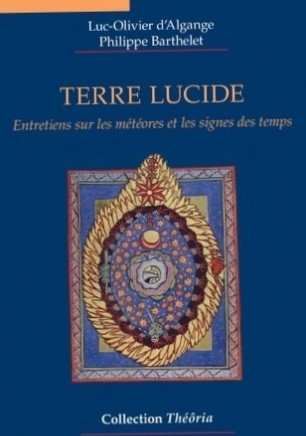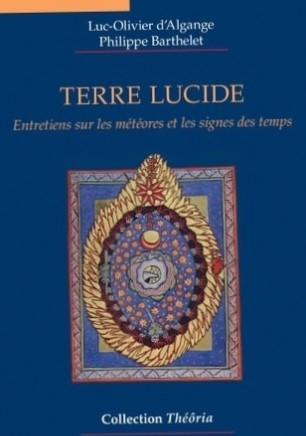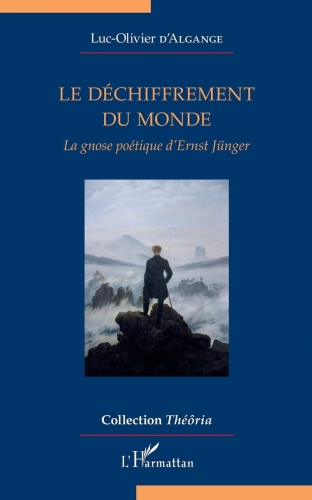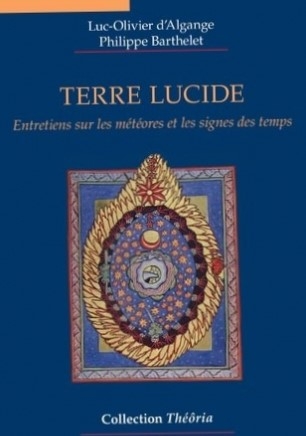EN HOMMAGE A DOMINIQUE DE ROUX

Ode au Cinquième Empire
« Le Mythe est le rien qui est le tout »
Fernando PESSOA
Ombres claires, jardins d'or, de quel désert bleu, tendu
Entre ces êtres et ces apparences ma mémoire en ces temps frissonnait !
C'était un battement des ailes de la victoire, un chant d'astres immobiles
Dans la profonde ténèbre de l'azur: comment ne point croire
A ces bras d'Océanides, ces pointes d'écume et de rocs
Et leurs traits de fierté sur les chemins des fantômes !
Tout reviendra, je le sais, dans ce Lointain, dans cette blancheur.
Armures du deuil, prunelles étoilées, sagesses perdues aux confins
De la mer dont les cieux tordent les couleurs comme des vaisseaux.
Nous sentions sur notre joue l'éther grandiose, son libre essor
Vers les oliviers pâles du rivage, son reflet de ciel, ses larmes étouffées
Et son sourire d'où renaissent les consolations au bord des cils
Comme une brume d'exil. J'en porte le témoignage pour ceux-là mêmes
Qui ne veulent rien entendre, pour cet ouragan immobile du matin, du plus
Haut bonheur, si tant est que l'on puisse encore dire en ce monde.
J'en porte témoignage sous le manteau de la nuit si claire à qui sait voir,
Sous le manteau de l'oubli de la Mer, sous le manteau du souffle éperdu
Où marche le souvenir de douceur et de feu des rois dont l'âme verdoie !
Est-ce fuir que de céder à ces beautés pensives ? Est-ce trahir que d'entendre
Les abeilles d'Orphée tournoyer dans l'admiration de l'ébauche du monde ?
Tel était notre bonheur que chaque seconde nous fut une cosmogonie.
Point de sommeil mais une secrète fureur de joie
Composant des siècles de pourpre avec les agrafes d'or de l'instant...
Tes lèvres douces revivaient une fable vermeille, un songe immobile
Sur l'abîme, sur la coupe visible de l'aurore
Encore endormie dans l'aile magnanime du dieu !
Que l'âpre beauté nous soulève, qu'elle nous dise
Nous serons ces cœurs brûlants jusqu'aux huées, nous serons
Les traces de son langage disparu et, s'il le faut, son haïssable mélancolie !
Forces célestes, fournaises bleues, triomphe pour la gloire
D'une innocence infaillible lorsque de toutes parts se hâtent
Les souffles étésiens, que scintillent dans les verres les vins
Parfumés de résine dans la grande trêve apollinienne de l'Empire !
Nous n'étions point étrangers à ces frontons, à cette emprise
De la Connaissance pure où s'éternisent à la fois
Les Hauteurs sans visage et les racines des oliviers !
Nous vaincrons le courroux de ces escaliers sablonneux
Et d'une pensée pure nous fleurirons d'une blancheur immobile
Comme l'instant de cette tempête adorée... Libations aux confins du monde,
Ivresses légères qui éveillent la douceur des pêches mures
Et la splendeur septentrionale des ombres du Soir,
De l'autre côté de la naissance des mondes...
De l'autre côté du temps, de l'autre côté du vent, quelque Songe
Elargit nos pupilles au ressouvenir de ces Lois excellentes...
Sites de la lumière chantante: des noms divins naissent des bronzes de la voix.
Les hymnes enseignent à la musique son propre secret
Qu'elle ne divulgue point, sinon dans la procession des regards
Qui passent, équanimes, sur les rives, entre les pins et les genévriers
Qui passent en s'attardant à peine vers l'éternité et les Mystères !
Que le dieu lumineux tende les voiles, qu'il avive le chatoiement
Des vêtements sacrés et ne nous détourne point de la face invisible de la Mer !
Nous serons fidèles entre les fidèles, dans le secret et dans l'évidence du Temps.
Fidèles en quelque lieu et en quelque temps que nous nous trouvions,
Fidèles dans la vérité de la brise qui porte le Chant et fidèles
Au sillage qui porte le Don de la mort vaincue, fidèles à Ce moment-là,
Fidèles dans le silence et dans le vacarme des dieux, fidèles
Aux pailles qu'allège la Terre et que Ciel embrase d'une image immense,
Fidèles aux ruisseaux pierreux, aux ruches cuivrées et aux expériences
Du silence et du jour éternel. Fidèles à la voix limpide qui scintille
De batailles subtiles. Voici les réverbérations messagères ! Voici le chemin précis
Dans l'immensité, voici les traces, voici les empreintes du dieu
Dont le sceau rivalise avec la douce coupole du Printemps
Pour nous faire comprendre la limite et l'illimité
Et la sagesse de l'Empire que l'on devine devant une fenêtre claire
Dans le pressentiment des cieux profonds et des mers chaudes
Que voilent à notre souvenir les siècles de vanités et de mensonges !
Quel regard de Pallas, à la pointe de l'instant où l'éternité se divise !
Que de brûlures et de fraîcheurs, dans nos veines et sur notre peau !
Les vignes et le miel, l'eau et le vent polissent notre aveugle matière.
La lumière innombrable couronne le murmure des sources, les buissons
Embaument le Grand-Oeuvre du Cosmos. Le passé, le présent et l'avenir
Se détaillent sur les feuilles et dans le vol des aigles.
Comment croire encore en la Séparation
Devant cette volupté puissante dont l'image nouvelle
Vient d'éclore dans l'air où tremble encore un parfum d'eau de pluie !
Voici la voix humaine et voici le silence, voici la bonté de la terre
Et voici les vases d'argile, comme une volonté surhumaine précédant,
Les plaines qui vont chuchotantes vers le soir. Voici l'Orbe du Temps !
Et qu'est-ce que le Temps, qu'il nous accable ou resplendisse,
Peu importe ce n'est pas lui qui passe, mais nous seuls, déjà flammes
Dans le bannissement de l'imminence, dans le secret de l'étoile au front
Dans les Formes de l'univers, les Symboles augustes que les quadriges de nos sens
Ouvrent à la connaissance des antiques tablettes d'Erato perdues
Sous le rugissement des flots ! Perdues et retrouvées comme un amour humain
Dans ses recueillements de rires, de beautés, d'acanthes prophétiques...
Qu'est-ce que le Temps, qu'il nous accable ou resplendisse
Que nous ne puissions étreindre contre notre cœur
Comme le parfum du Soir, comme une prière délaissée,
Comme une épaule nue dans une roseraie, un front empourpré ?
Qu'est-ce que le Temps s'il ne se courbe sous notre regard
Comme un horizon prosterné ? Il existe des secrets. Le Temps,
Ce promontoire, cette lance dans l'air vibrant ou comment le dire,
Peut-être ce sable chaud où nous nous endormons côte à côte,
Le Temps n'est rien, qu'il nous accable ou resplendisse, le Temps
N'est qu'un silence universel ! Notre grandeur sera d'avoir courbé aux Lois
De la douceur d'être tout ce néant tumultueux ! Notre grandeur, notre sagesse !
Grandes voiles tendues jusqu'au gémissement céleste ! Métaphores vivantes
Des peuples et des heures, nous reviendrons aussi vers la grandeur
Avec nos carènes solides, nous reviendrons jusqu'aux temples en ruines
Porter la crinière de l'air marin et des ressouvenances de labeur et d'adoration !
Nous reviendrons lavés et forts, chaque aspect de notre entendement
D'une clarté presque aveuglante annonçant que la victoire humaine est illusoire.
Nous reviendrons avec nos dieux enroulés autour des mâts, nos dieux peuplant
La grande voile, nos dieux forts comme des cordages.
Quel beau règne pour cette Terre que le règne de notre retour !
Tout recommence car le Temps n'est rien et que la brûlure de la fidélité
Plus profonde que le cri orne de son signe sacré, de son passage ailé
Le ciel fécond d'enseignements à qui sait lire... Tout recommence, Chœur
Infini, premier voile de l'Apparue disant "je te trouve enfin".
Et nous avions tant attendu Ce moment-là, avec une telle ferveur
Et une telle patience qu'une brume de chaleur montait vers nous,
Que les eaux tremblaient à nouveau,
Après tant de batailles, de fatigues, cette salutation enfin
Changeait un cœur, et l'étincelante obscurité se renversait
Comme une corbeille de fleurs sur l'orgueil aérien de la conquête.
Tout recommence, Chœur infini, car le Temps, qu'il accable ou resplendisse
Ne passe point. La Terre élève ses senteurs pour notre triomphe venu de la mer.
L'Ode enclot un prodige d'ordre étincelant. Point d'outrage à cet horizon
Que la proue de mon Chant et point d'oraison d'une plus haute innocence .
Une soif ardente fond dans le sommeil comme un oiseau de proie !
Dans quelle apparence cette lumière descendante me charme !
Ne rien dire à la voile de ce péril et vivre ! Tout entière à cet autel
Où meurt et renaît l'accord innombrable du Temps, ta bouche parfumée
Enonce le prodige. La voie, les degrés, le marbre, ô fille des astres,
Seront ces stations d'immortalité, où le dieu allège de toute sa force
Nos pas l'un après l'autre sculptés, nos pas l'un après l'autre perdus
Dans le marbre que travaille l'abîme ! Légère cette force vers le haut !
Légère et toute figurée d'être et de puissance. L'Empire compose d'immortalités
Ces générations innombrables de pas sur les marches du Temple.
Quelle abondance d'oubli comme une pulpe enracine notre savoir
Dans la profonde saveur d'une pureté qui allonge les ombres
Et que nous suivons pas à pas ! S'approche ainsi le Toit de l'intercesseur.
Le Soleil, l'Air, Dieu s'accordent à l'ombre que j'endure
A l'ouvrage des vigne et des puits, aux mille figures
De notre consolation nouvelle, à la volupté inconnue.
Ce ressouvenir fut l'onde parnassienne suspendue sur l'augure
Dont la beauté semblable à sa Ressemblance oubliée
Disparaît dans la couronne du Soleil, de l'Air et de Dieu.
Haute la nef, soulevée, dans la clameur, dans le péril !
Haute dans le prodige des vagues anciennes et mélodieuses,
Et plus haute encore dans la mémoire virgilienne de l'Esprit !
Rien n'égale cette beauté qui ressuscite, qui s'élève
Dans la louange d'un écho éternel et dans la justice du destin !
Rien n'égale la joute suprême d'une grandeur où tremblent nos mains,
Dans la ferveur de la victoire qui dilate la poitrine et hante
La vertu des songes et des dieux, le sel des cités disparues
Dans la solennité d'un Soir où nous retrouvons nos visages
Sous les casques brillants de la bienveillance du Soleil, de l'Air et de Dieu !
Lucide est l'âme accourue vers la lumière de l'être, oeuvre immense.
Lucide est la louange de la voile latine, la louange ingénue
Dont nous retrouverons l'augure dans la bruissement de la cigale
Dans ce travail secret du Jour, dans la fraternité des nuages
Et des racines, dans la concordance haute du Soleil, de l'Air et de Dieu.
Sous ce ciel de signes ardents, les collines, sœurs de l'aube et de l'oubli
Déroulent leurs rumeurs et leurs parfums. La douceur obscurcie
Penche le front sous les feuillages comme un repos divin.
La royauté se retrouve dans ce « Toujours ! » que disent les jeunes arbres.
Le jardin se referme dans sa lumière inexorable. Beauté semblable
Et qui protège ! Beauté que portent pour la fête d'Artémis
Les jeunes filles qui disent l'or flottant, vive beauté !
Sous le ciel des signes ardents et des vents fougueux,
Nous serons délivrés et comme une onde notre orgueil
Se perdra dans la royale voile radieuse qu'elle élève
Comme signe plus haut dans le ciel ardent,
Comme le signe du Soleil, de l'Air et de Dieu.
Qu'elles soient, les très-belles, les gardiennes du labyrinthe de nos pensées
Et de la profondeur des grèves, et du Soleil du Soleil, Logos intérieur
Embrasant l'Air de l'Air jusqu'aux profondes mémoires de l'éther,
Jusqu'à ce silence de Dieu qui chante dans le Cœur de Dieu...
Qu'elles soient, ces jeunes filles d'Artémis, les flammes
Du redoublement des Formes, dans l'intarissable secret
Dont la beauté subjugue le spectacle immense de l'aube
Où nous retrouvions enfin les ombres claires et le jardin d'or.
Que d'ombres pour les hommes dans ce devenir de soleil
Que d'attentes, pour les cieux où chante la divine confusion des astres !
La Forme demeurait comme une promesse dans l'aube immense
Et toute chose naissait de cette flamme comme un théâtre murmurant !
Beauté et sagesse, légèreté et désinvolture précédaient notre entendement
De leur sillage clair sur les eaux. Les songes étaient des acclamations.
Le ciel se tendait dans la solennité du bleu. A la proue, l'ombre se divisait
Comme une voix orphique. Car le Chant est ici et ailleurs. Il s'élève
Dans le mystère et plonge dans l'éblouissement de la profondeur.
Nous frappons notre parole sur des murailles de silence et l'écho
Invente des contrées étincelantes dans nos âmes !
S'élèvent dans l'air les songes maritimes ! Le cœur bat dans l'or du sang
Et nos prunelles brûlent d'adoration et de conquête. La mélodie veinée
De bleu de l'univers enchante l'arbre d'or de nos poumons. Le vent
Violente les voiles immenses et fragiles. La vigueur nous entraîne et la joie !
A l'aube de l'Idée sont les naissances du destin ! Que j'entende les voix
De la toile et du bois, que je goûte les saveurs de sel de l'air qui brûle,
Et voici que la mémoire du monde s'éveille de sa léthargie !
La mémoire du monde entre en miroir avec l'Empire désiré !
Car je garde la mémoire d'Ulysse dans l'estuaire du Tage,
Arborescence d'âmes vives sauvées des eaux et revenues
Alors que le Temps, par d'innombrables détours nous ment,
La Vérité scintille sur la proue et dans nos prunelles: l'être
Débute dans ce recueillement de la mémoire: Ulysse reviendra
Comme un ressouvenir dans la voix de notre allégresse,
Comme un chant de triomphe et de péril s'adressant
Au ciel avec ses clameurs et son grand silence d'été
Qui précède l'entrée du navire dans sa destinée surhumaine !
Apparition dans l'estuaire, mystérieuse beauté ! Le silence
Joue de cette image du Soleil que nous gardons dans la mémoire
Telle une prévision inclinée dans la brume sourde où tremblent
Les générations tressées des roses divines sur la voile du Soleil !
Ainsi, l'immense nouveauté du destin lance l'onde sur l'envers
Du monde où revivent les mythologies du monde comme une voile gonflée,
Entraînant les nerfs de chanvre, de bois et de métal du navire qui est un songe,
Avec la douceur infaillible du messager - sa volonté
Scrutant l'espace avec la sûre ténacité des Anciens,
Et son âme d'ouragan et d'incendie, son âme subtile comme la syllabe
Douce enclose dans la strophe méditée et dans son espérance
Persistante ! Tout cela fut inscrit comme un feuillage sur le bouclier.
De quelles sources lointaines s'abreuve notre Mer ? De quels confins ?
De quelles hauteurs ? De quelle glace translucide ? La limite
Est dans la réponse refusée à l'énigme et dans l'assentiment au silence.
Nous apercevrons, au-delà de la réponse refusée, quelque flamme
Céleste éclairant les contrées de notre orgueil et les plaines
Où Zeus, père du Jour, ordonne une bataille silencieuse
Entre notre hardiesse et la juste méditation de l'univers !
J'honore cette aube, ces colonnes, ce faîte où repose le chant
Dont le sens se perd dans l'éternité et dont s'abreuve notre nostalgie.
Rien n'est perdu. Tout se tient dans l'apaisement immense.
Comme la goutte de rosée à la pointe du brin d'herbe,
Les mondes invisibles rassemblent leur limpidité à la pointe
De notre entendement. Le dieu se diffuse dans le soir versicolore.
Tout se tient: la sagesse et le nom, la lumière et la chevelure
De l'Aimée comme le sourire et le geste qui l'invente
Sur le visage. Tout se tient. Le soleil se tient dans la prunelle.
La Grandeur est dans le regard. L'Empire est dans l'instant.
Et le ciel à notre front s'accorde. Les écumantes constellations
Frémissent dans le battement de nos cils, et toutes les saisons
Vivent et meurent sous nos paupières. La douce chaleur de l'automne
S'évanouit entre nos lèvres fécondes comme des vergers. L'hiver
S'immobilise comme un chœur de pierre dans notre cœur
Et le printemps fait éclater cette rosace minérale avant l'été
Qui fait glisser comme dans un songe léger le navire d'Ulysse...
Tout se tient dans cet estuaire du Tage: le souvenir de la déréliction
Et, dans la tremblante douceur, celui de la lumière étonnée.
Apaisement du souffle dans l'Immense, j'acquiers le puissant espace
Alors même que la déclive destinée humaine ne pourvoit point à ma patrie.
Elle fut cette frondaison de fleurs sur l'horizon inconnu...Apaisement
Du front, apaisement du Temps. L'Olympe résonne de cet appel,
Homme qu'un entendement adamantin fourvoie dans la bataille lumineuse !
L'Apaisement triomphe ! Dans ces hautes trames de l'espace-temps,
L'Apaisement triomphe et nous en sommes les témoins.
Tisseuse de profondes Imminences est la parole de l'Apaisement.
Car les éléments rugissent dans L'Apaisement dont je parle et qui n'est point l'abandon des forces
Mais leur apogée dans la gloire d'une discordance vaincue.
Sur les tablettes de la nuit une voix écrit des signes vaporeux.
Invisible est le signe mais présent dans l'agitation de l'esprit.
Tel est l'Apaisement qui s'en élève, tel est le vaste accord
De l'Apaisement... La brindille qui ploie sous le souffle en témoigne.
Le bruit sourd de l'eau sur la pierre. Lentement nos paumes se tournent vers le ciel
Est-ce pour le sommeil ou pour une prière ? Notre âme
Est la conque bruissante de l'abîme. Notre âme est la louange.
Tel est l'Apaisement, une mélodieuse gratitude. L'âme connaît l'été.
Elle triomphe dans l'oscillation des feuilles, dans l'allégresse
De l'été dont nous atteignîmes la cime par la sérénité !
Sourdre ainsi du cœur de silence d'une saison ! L'Apaisement
Est cette verte limite ! L'Apaisement dis-je, point l'inertie. L'Apaisement
Est cette alacrité des forces dominantes et charnelles qui fleurissent
En Idées, comme surent les célébrer Virgile et Porphyre !
L'Apaisement gît dans le secret de la roche dorée platonicienne.
L'Apaisement est le Don des dieux. L'Apaisement est une claire fanfare
Qui se répercute dans le Silence comme le soleil vermeil
Derrière les paupières. Nous feignons de dormir, mais voici
Que sur la table de l'esprit brûlent les aromates et montent
Vers les ondes impétueuses du ciel qui reviennent et m'envahissent !
L'Apaisement est de s'épandre dans quelque lumière
Tombée de Haut. L'Apaisement est d'entendre la bouillonnante
Harmonie résonner dans les formes parfaites du rêve
Qui pose sa tête sur notre épaule lorsque nous feignons de dormir,
Lorsque derrière nos paupières nous devinons l'efflorescence vermeille du monde.
Dans toutes nos oeuvres, l'Apaisement nous attendait.
Dans la violence, dans la tristesse, dans l'étonnement, l'Apaisement
Veillait. Attendant son heure. Levant l'ancre
Avant même que nous ne fussions éveillés. L'Apaisement amplifiait
La nuit et le jour, de sorte que nous ne pouvions en percevoir les limites.
L'Apaisement gardait l'orgueil de sa frontière infaillible. De cercles
En cercles, et de plus loin, l'Apaisement veillait sur nous
Pour nous conduire vers l'émerveillement et les richesses inconnues
Du matin d'or. Mes amis, gardez mémoire du bas-relief égyptien
Qui montre la déesse Hathor accueillant le Roi Séthi premier
Car dans le geste de sa main s'éveille l'Apaisement.
Comment dire la paix de l'âme. Est-elle cette lumière d'Or
Où nous voulons nous ensevelir au terme de l'exigence
D'une pure pensée, ou vive, dans l'occulte allégresse d'un vin
L'ardente soif que seule comble une soif nouvelle ? Comment dire
Cette moisson des puissances devant le portique des tourbillons ?
La terre pareillement fut-elle cette nombreuse beauté vers l'Occident désert
Comme le cours du temps dont un mensonge nous sauva ?
La paix de l'âme est-elle dans la vérité ? Mais quelle ?
Elle divise la fontaine de notre orgueil. Elle songe, vagabonde,
Elle brille dans la tourmente auguste, recueillie, perdue,
Retrouvée dans la perdition de toute évidence du cœur,
Mais visible, ô Merveille, dans l'intelligence nuancée ! Quelle Vérité ?
Celle qui ne cesse point d'être dans l'attente d'elle-même,
Celle qui prodigue les promesses, les méandres, trame frémissante
De l'aube, et chacune de nos pensées vient à son appel
S'instruire à sa mémoire mystérieuse, s'égarer délicieusement
Et se retrouver... Quelle vérité ? Mais la Seule qui dise
La patience et l'autorité, la seule qui chante la divine temporalité
De la rencontre des regards ! La Seule dont la voix est couleur de houle.
Il y eut de ces prodiges, des roues étincelantes dans le ciel !
Luc-Olivier d'Algange
Extrait du Chant de l'Ame du monde, éditions Arma Artis.