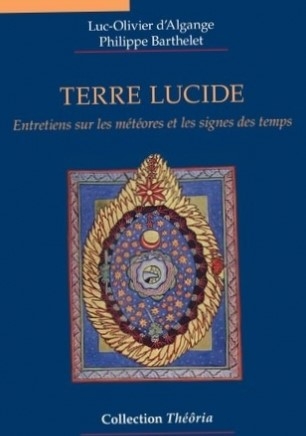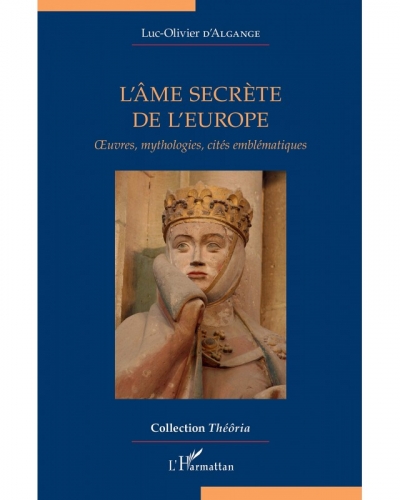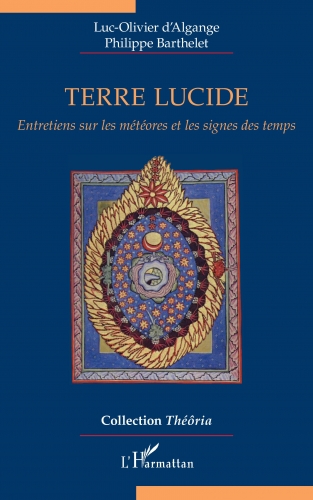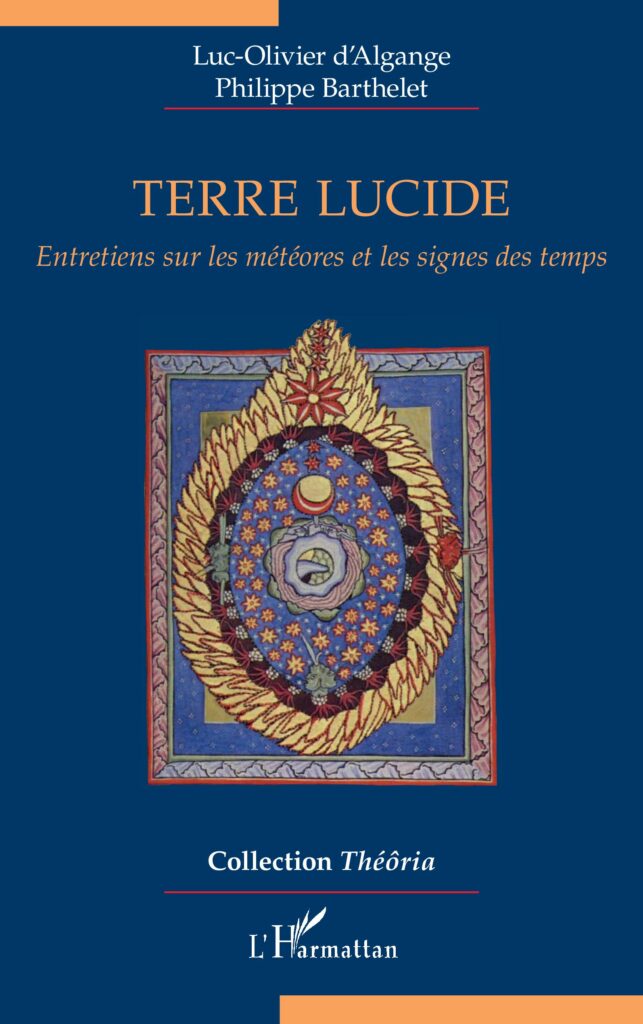Dans Terre Lucide. Entretiens sur les météores et les signes des temps, réédité chez L’Harmattan (coll. Théôria), les écrivains Luc-Olivier d’Algange et Philippe Barthelet s’abandonnent au fleuve créateur de la conversation autour d’une question fondamentale : quelle forme peut prendre une écriture rebelle qui ne soit pas une littérature contraire, mettant en péril le geste créateur de l’écrivain, mais le contraire de la littérature, où la création, libérée de la vanité prolifique de l’industrie littéraire et communicante, serait restituée aux sources authentiques de l’inspiration ?
Le fleuve de cette série de onze entretiens littéraires sourd de la fameuse sentence de Joseph de Maistre : « que ce qu’il faut faire c’est non pas une révolution contraire, mais le contraire de la révolution ». S'il est vrai que Luc-Olivier d'Algange n'est pas insensible à la mystique royale de Henry Montaigu, nos deux écrivains ne se donnent pas pour ambition de dialoguer sur l’idéal monarchique du Comte. Ils prennent pour base cette formule pour la regarder, plutôt, comme l’équation de toute entreprise d’opposition véritable, positive et féconde : on ne supprime pas une négation en affirmant quelque chose contre elle, mais en niant sa négativité. Negatio negationis : la négation d’une négation produit une affirmation. Si, par ses offenses répétées au goût et à la puissance édifiante des mots, la littérature est devenue négatrice, comme la Révolution le fut, selon l’auteur des Soirées de Saint-Pétersbourg, non par ce qu’elle accomplissait de providentiel dans la marche du monde, mais par son ferment de désordre et de mort, alors « ce qu’il faut écrire, c’est non pas de la littérature contraire mais le contraire de la littérature. » Au-delà même du devoir, Luc-Olivier d’Algange nous fait pressentir la nécessité de cette entreprise : « il n’y a plus que des mots pour lutter contre les mots idolâtrés ». La littérature, poison et remède de la littérature : l’écriture est ce pharmakon indispensable à la réouverture des mots à l’être, dont l’accès est obstrué par leur vaine prolifération. Dénoncer l’absence cacophonique de sens et en transmettre un nouveau ne peut se tenter que par une confiance retrouvée dans la signification des mots, ne fût-ce que pour nous inviter au silence.
Écouter en silence le récit du monde
« Ce monde mondialisé est exactement un monde décomposé ; plus rien ne s’y distingue, et, par voie de conséquence, plus rien ne tient ensemble ». L’harmonie du monde nous est dérobée par la saturation des signifiants dont la prolifération en altère jusqu’à la perception même des signifiés : témoin, comme doit l’être à sa manière tout bon écrivain, Julien Gracq, qui « faisait remarquer à quel point le monde d’un lycéen d’avant-guerre était silencieux, à côté de celui d’un lycéen de maintenant ». Nous vivons en effet à l’heure du « vacarme organisé comme norme acoustique », véritable industrie de « dépravation psychique » où le Dernier Homme vient remplir de bruit le tonneau percé de son existence désorientée. Ainsi fuient ce silence où l’on se confronte à notre humaine condition, ces cadres et ces entrepreneurs qui festoient « dans une boîte de nuit – où une oreille normalement constituée ne peut tenir plus de trois minutes ». Pareillement vont ces artistes, étudiants ou citadins abîmer leur précieuse légèreté dans « les rave parties encadrées par la force publique, [ces] messes noires de masse proposées comme divertissements à la jeunesse, sous le contrôle de l’État ». Ainsi vont enfin les consommateurs de tout horizon, ravager leur attention dans « le zapping perpétuel et la distraction en chaîne ». Dans un tel monde où tout conspire contre les révélations du silence, le livre semble représenter le seul sanctuaire où l’âme peut fixer son attention hors des bruits addictifs.
Le péché propre de la littérature est pourtant l’introduction du bruit dans le silence des pages. Le miracle du livre n’est-il pas de nous parler un langage qui n’interrompt pas le silence mais se marie avec lui, s’y unit comme le divin s’unissant à l’humain, comme une duplication discrète du mystère hypostatique ? « Un livre, note Luc-Olivier d’Algange, qui n’est pas n’importe quel livre, un livre choisi, qui échappe à la rumeur médiatique ou à l’obligation universitaire, ou “citoyenne”, reste ce beau bloc de silence, cette temporalité repliée, enroulée, qui ne parle que si on l’ouvre. Et souvent même, par ce qu’il requiert d’attention, par ce qu’il brûle d’écorces mortes, il rétablit le silence autour de nous. Cet objet silencieux, qui se feuillette comme le temps lui-même, comme les oignons, comme la plupart des phénomènes naturels, possède cette politesse exquise de ne pas s’imposer. » Pourtant, la critique littéraire abolit ce miracle lorsque, inversant l’ordre du sujet et de l’attribut, devenant littérature critique, idolâtre les mots et tombe dans « la superstition du texte » : « il y aurait, commente à ce propos Philippe Barthelet, une science amusante à fonder, qu’on pourrait appeler “paratextologie”, qui rassemblerait leurs plus belles perles pour la désopilation des jeunes esprits : ainsi de Gazier, l’éditeur de La Fontaine (…), qui se croit obligé de mettre une note au Chêne et le roseau : “Cependant que mon front, au Caucase pareil…” : “Exagération manifeste”, souligne ce professeur à la Sorbonne et éminent philologue : “Le mont Elbrouz, au Caucase, a 6341 mètres”… »
De silencieux qu’il est censé être pour être sensé, le livre devient assourdissant quand une « débauche d’érudition », moins excessive que mal-à-propos, vient autopsier le livre pour voir un texte à la place d’une œuvre : « les œuvres, remarque Luc-Olivier d’Algange, comme toute chose qui existe, sont uniques et parfaites, toujours ; elles sont un rayonnement, un frémir, comme l’eût dit Aragon avec sa façon de donner à tous les mots du poème la force du verbe et aux verbes la réalité tangible des noms ». Or, que vaut une critique qui, objectivant ce qui est le lieu même de la parole d’un sujet inspiré, le lieu même d’une lyrophanie, d’une manifestation poétique, empêche au contraire son destinataire de frémir à sa lecture ? « Les œuvres (n’en déplaisent aux critiques dont les gloses ne sont que les phases préparatoires à leur mise au rebut) demeurent des appels. Elles sont des vocations. Et comme le dit le Coran, elles s’adressent “aux frémissants”. » En nous introduisant à ce qui, dans l’existence, échappe à la perception obtuse de notre vie ordinaire, l’œuvre doit nous faire frémir dedans l’être, comme frémit le feu dedans l’âtre.
Nominalismes
La littérature dont nos écrivains recherchent le contraire n’est donc pas l’héritage des œuvres qui interpellent le lecteur au détour inattendu d’une librairie ou dans le gracieux égarement d’un regard sur le rayon d’une bibliothèque. La littérature à combattre, c’est la somme des textes : la parole déchue en abstraction, le symbole déchu en métaphore ou, en résumé, toute tentative de faire divorcer le verbe et l’être. « Il y a chez les critiques une extrême compulsion à ramener la chose vue à celui qui voit alors que pour celui qui voit seule importe la chose vue », note Luc-Olivier d’Algange. Ainsi Roland Barthes accomplit-il dans la littérature le projet nominaliste déjà parvenu avant lui, dans la modernité, à vaincre la réalité désignée par les mots. Dans « l’article “Léon Bloy” du Tableau de la littérature française, tome troisième, apparu aux éditions Gallimard en 1974 », le célèbre critique littéraire excuse son admiration très bourgeoise pour le plus anti-bourgeois des écrivains, Léon Bloy, en désamorçant le contenu polémique des saillies de l’auteur catholique. Pour ce faire, il décrète comme étant des « “illusions” ses “contenus” (“choix, croyances, etc.” – et tant pis si lui-même semblait y tenir un peu) pour ne retenir comme “réalité” que ses “mots” », ce qui, nous en conviendrons avec Philippe Barthelet, fait déchoir l’appréciation de la parole auctoriale dans un « vague onanisme cérébral » qui n’est finalement qu’un « aveu d’impuissance assez pathétique ». Et Luc-Olivier d’Algange d’ironiser : « Imaginons l’Appel du 18 juin traité par les adeptes du “travail du texte”, ils se fussent attardés, sans doute, sur la syntaxe, pour dénoncer l’irréalisme du propos ! »
Le nominalisme, qui théorise la séparation des mots d’avec les choses, représente ainsi une décadence littéraire autant qu'une décadence philosophique en organisant le vain théâtre des discours creux, des belles figures séparées des formes vraies, le divorce de l’esthétique et de l’eidétique. Seulement, la contre-littérature ne peut pas être le redoublement de la querelle philosophique du nominalisme et du réalisme, car la littérature, ce n’est pas la diction (vraie) du monde, mais la création des mondes : « la querelle [en question] n’a rigoureusement pas de sens pour un créateur […] : j’oserais dire que pour lui, le mot et la chose, c’est la même chose… C’est parce qu’il est exclusivement réaliste, qu’il n’a en vue que la seule réalité, que l’écrivain sera évidemment nominaliste, puisque cette réalité, il ne l’atteint que par les mots. » Une littérature contraire serait une littérature jouant le réalisme contre le nominalisme, tandis que la contre-littérature ne peut être qu’une œuvre ou une parole susceptible de dépasser les clivages explicatifs du sens des choses en atteignant leur cime créative.
Dans la création, l’alternative entre le faux et le vrai est abolie dans une réalité nouvelle. Il n’y a pas de sens à dire d’un récit qu’il est vrai ou qu’il est faux : il est. Que nous importe que Gulliver ait rencontré ou non des Struldbruggs à Luggnagg ? L’important n’est-il pas ailleurs, dans cette révélation merveilleuse que la tragédie de l’existence, ce n’est pas la mort, mais l’impossibilité de passer, dont la mort – la bonne mort –, heureusement, nous garde ? Luc-Olivier d’Algange raconte ainsi : « Une dame à l’esprit implacablement acéré […] m’avait dit que mon attitude à l’égard des œuvres littéraires lui faisait songer à celle d’un petit garçon qui, après avoir entendu raconter le Petit Chaperon rouge, décrocherait son fusil en demandant quand on partirait à la chasse au loup… Je vous avoue que je ne saurais mieux dire : toute œuvre qui ne donne pas envie de partir à la chasse au loup ne mérite pas d’avoir été écrite. »
Converser dans la lumière
Si contre-littérature il doit y avoir, elle ne peut pas être un discours, théorie ou mouvement, qui viendrait de nouveau s’interposer entre notre conscience et le monde : « le “contraire de la littérature” n’est nullement un discours théorique […] mais “théorie” peut-être au sens étymologique de contemplation (théôria en grec), c’est-à-dire le contraire d’une “théorie” ». « Il n’y a pas d’un côté la littérature et de l’autre, le “contraire de la littérature”, il me semble, de même qu’il n’y a pas d’un côté l’ordre et de l’autre l’insurrection », car la rébellion dont il s’agit est une recouvrance, « et la recouvrance se fait, non à partir de ruines et de vestiges », celles-ci étant mortes et passées (et il faut, avons-nous dit, consentir à passer), « mais à partir de rien », condition sine qua non d’une création, qui n’ajoute pas une forme sur un espace qui en est déjà saturé, qui ne moissonne pas ce qui fut déjà moissonné, mais qui sème une floraison nouvelle.
Ce « rien qui n’est pas le néant » mais qui est tout, ce « rien du tout », comment le rencontrer ? Par la conversation, cet art très français qui est le propos de tout le « Troisième entretien » du livre qui en donne le tempo. « L’entretien suggère un sujet », remarque Luc-Olivier d’Algange, entretien qui ne va pas sans rappeler « la banalité dialectique-journalistique [qui] nous a blasé des mots ». Au contraire, « la conversation naît d’un mouvement, d’une émotion ; son charme est d’ignorer où elle va, elle divague, sans sujet, ni objet précis ; c’est une sorte de transhumance sans sujet et sans objet, une “randonnée céleste” pour reprendre l’image taoïste où nous oublions d’être seulement nous-mêmes, tournés vers ce qui advient, avec exactitude ». La conversation, en faisant éclore par son propre cheminement imprévisible ses sujets d’élection, que les interlocuteurs rencontrent comme l’on rencontrerait un ange ou un sourire, représente ainsi le modèle de la contre-littérature. Un modèle sans thème, qui restitue au verbe, aux mots, à la parole, selon Philippe Barthelet, leur liberté féconde : « la grande leçon de la conversation, c’est qu’on ne sait jamais à qui l’on parle […] ; au lieu que faire la classe, c’est s’adresser à un public captif, [à] des interlocuteurs d’élevage. […] Nous aurons peut-être compris que notre baleine blanche, cette “littérature” qui serait le contraire de la littérature, n’est sans doute rien autre chose que la tentative d’être fidèle, par écrit, à l’esprit de la conversation ». La contre-littérature est par conséquent le projet d’une écriture de l’indétermination qui, à l’instar de la conversation, n’impose pas vainement à la page blanche un sujet pour servir une entreprise d’écrivain lucratif, mais laisse place à l’inspiration. La contre-littérature ne prête pas le flanc au kitsch, cet « esthétisme qui ne s’inquiète plus » ni du goût ni du bon, selon Philippe Barthelet. Attentive ésotériquement aux secrets murmures de l’existence, derrière les illusions de la vie ordinaire, la contre-littérature est le désir de rétablir le silence au cœur de l’écriture pour rendre possible le silence de la lecture. Ne cherchant pas à « faire sens » dans un monde qui en serait privé, elle acquiesce au contraire à son ordre, à son agencement divin, à son sens religieux et théophanique, aux messages des météores et aux signes des temps, pour capter « la lumière qui vient de plus loin qu’elle-même pour aller ailleurs, à travers la prunelle du lecteur. » La contre-littérature n’est autre que l’espérance du poète contre l’illisibilité d’un monde sans Dieu et sans présages, rendu virtuel à force de transparence et d’uniformité.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.