18/03/2022
La langue française est un roman:

23:23 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
13/03/2022
Entretien sur l'Ame secrète de l'Europe:

Photographie de Ingalill Snit
Luc-Olivier d'Algange
Entretien sur L'Ame secrète de l'Europe
Anna Calosso: On discerne dans presque toutes les pages que vous écrivez une sorte de filigrane sacré, tantôt chrétien, dans Lux Umbra Dei, et tantôt païen, dans Le Songe de Pallas, ou dans vos poèmes du Chant de l'Ame du monde, et parfois l'un et l'autre, comme dans L'Ombre de Venise, qui vient d'être republié, avec de nombreux inédits, dans L'Ame secrète de l'Europe (éditions de L'Harmattan, collection Theôria).
Luc-Olivier d'Algange: Allons en amont... Nous vivons dans un Purgatoire mais le Paradis s'entrevoit par éclats. Dans ces éclats le temps se rassemble puis vole au-dessus de lui-même, dans l'éther où vivent les dieux. Dans la tradition européenne le paganisme et le christianisme s'enchevêtrent, moins en théorie qu'en pratique, dans les rites, les légendes et les œuvres qu'elles soient poétiques, picturales ou architecturales. Est-il même possible, depuis le Moyen-Age, pour ne rien dire de la Renaissance, d'être chrétien sans être quelque peu païen, et à l'inverse ? Souvenons-nous simplement que le Versailles du « Roi Très-Chrétien » fut un temple apollinien.
Les « monothéistes » purs et durs le savent qui considèrent le catholicisme comme « associationniste », autrement dit comme un paganisme, voire comme une mécréance. Allons plus loin... Il me semble qu'il est même possible d'être catholique, ou païen, sans croire, en laissant simplement s'éprouver en nous le sens du surnaturel, du Temps au-delà du temps. Ce qui s'éprouve n'est-il pas plus profond que ce que l'on croit ?
Au demeurant, la croyance, comme l'opinion, sont affaires subjectives, souvent superficielles et étroites. On se demande pourquoi les hommes sont si attachés à leurs croyances: ils aiment l'étroitesse, ils s'y croient à l'abri, - grave illusion. Ils croient pour n'avoir pas à éprouver. La citerne croupissante leur semble préférable à la source vive... Et moins ils éprouvent et plus ils veulent faire croire, imposer leurs croyances qui ne reposent alors que sur leur incommensurable vanité.
La « gnôsis », qui dépasse la « doxa », ne se réduit pas au « gnosticisme », qui serait une autre croyance, mais une nouvelle profondeur, la profondeur de l'immédiat, la profondeur du sensible: telle couleur qui nous vient en transparence, tel silence entre les notes de Debussy ou de Ravel. La pensée ne vaut qu'anagogique, en vol d'oiseau. Certes la pensée s'exerce, mais elle se saisit au vol. Elle est un commerce avec l'impondérable qui nous vient de loin... Ce beau, ce vaste lointain est la profondeur de la présence.
A force de s'identifier à une croyance, la croyance elle-même se perd, devient écorce morte, revendication hargneuse. Cela se voit, hélas, tous les jours. Le ressentiment s'ensuit contre tout ce que nous aimons, la liberté d'allure et de propos, Villon, Rabelais, Musset, la musique, les cheveux au vent... Un grand défi se pose à l'honnête homme: ne pas être gagné lui-même par le ressentiment contre le ressentiment. Pour cela, cependant, il faut bien connaître ses ennemis, et plus encore, ses amis. Honorer ce qui nous est amical. L'air du matin qui nous délivre des songes moroses, les amants heureux de Valery Larbaud, les grains de pollen de Novalis, la bienveillance pleine de courage de Nietzsche, les rameaux, les rameaux d'or...
Toujours garder en mémoire : se garder du pathos et de l'outrance, et de ceux qui les propagent, et être, à cet égard, d'une intransigeance parfaite et limpide... Ne pas céder, tant qu'il est possible, sur nos vertus, nos légendes héritées, d'autant qu'européennes, elles sont arborescente, pleines de rumeurs et légères. Réciter en soi, de temps à autres, quelques noms, Homère, Pindare, Villon, Dante, Rabelais, Montaigne, Hölderlin, Shelley, Nerval…
Ce qui nous en vient n'est pas un dogme, un système, un goût peut-être, un savoir qui est saveur, une possibilité de traverser la vie, moins chagrine, moins vengeresse, moins stupide. Ces noms, comprenons bien, désignent des œuvres, et ces œuvres sont des évènements d'une bien plus grande importance, Horace le savait déjà, que les événements dits historiques ou politiques. Chacun de ces événements de l'âme est un avènement, l'entrée dans un Temps secret qui a tout à nous dire, à chaque instant. Si nous devions formuler un vœu, ou une prière, ce serait: Que chaque instant soit l'éclat de son Paradis !
Anna Calosso: Vos ouvrages récemment parus sont de préoccupations et de tons forts divers. Notes sur l'Eclaircie de l'être est consacré à Heidegger, Intempestiva Sapientia sont des propos, des formes brèves, proches de Joseph Joubert, Apocalypse de la beauté est une méditation sur la philocalie et la lumière émanée des icônes. Quel unité fonde ces diverses approches, s'il en est une ?
Luc-Olivier d'Algange: La réponse la plus simple, ce serait l'auteur. Mais sans doute ne suffit-elle pas pour un auteur auquel il semble assez souvent avoir pratiqué, comme une diététique, voire comme un exercice spirituel, une certaine « impersonnalité active », pour reprendre la formule de Julius Evola, elle-même issue de la philosophie stoïcienne. Au demeurant, je serais enclin à penser que, d'une certaine façon, toute activité créatrice nous impersonnalise dès lors que l'art n'est plus seulement, pour nous, l'expression de notre « moi » mais un véhicule, un vaisseau, un instrument de connaissance.
Enfin, les thèmes que vous indiquez ne sont pas si éloignés qu'il semblerait aux spécialistes de l'un ou de l'autre. C'est bien dans une éclaircie de l'être que surgissent et scintillent les formes brèves de Joseph Joubert. Les épiphanies qu'évoque la Philocalie orthodoxe, sont, elles aussi, surgissement. La beauté, enfin, est notre Haut Désir.
Anna Calosso: Si l'on vous en croit, la beauté mène un combat contre la laideur, la laideur de ce monde, la laideur moderne....
Luc-Olivier d'Algange: Ou peut-être, serait, dans l'autre sens, la laideur qui mène un combat contre la beauté... Il me semble parfois assister au spectacle d'une volonté planificatrice de la laideur, avec ses stratégies, ses machines de guerre, la télévision, l'architecture de masse etc... Il y a dans la beauté comme une ingénue, une inconsciente présence de l'être. La beauté est-elle combative ? Elle est une victoire à chaque fois qu'elle advient. Elle se suffit à elle-même, d'où le sentiment de plénitude qu'elle nous apporte, elle est, comme la rose d'Angélus Silésius, « sans pourquoi ». La laideur, elle, est un mouvement de destruction concerté, elle est le « quoi » du pourquoi, un ressentiment, une représentation; c'est la grimace de la jalousie à laquelle cependant toujours échappe ce qui est.
Le vaste enlaidissement de tout ne doit pas nous dissimuler que la beauté demeure, et l'enlaidissement même, dans sa planification, dans sa volonté, témoigne de la souveraineté de la beauté qui sera humiliée, recouverte, insultée mais jamais défaite. Le brin d'herbe perce le goudron.
On accuse souvent les amants de la beauté d'être des esthètes, et « l'esthète », il va sans dire, dans la bouche de ces moralisateurs, est un méchant homme. Mais est-il un plus généreux acte de bonté que de vouloir répandre la beauté, l'honorer et tenter de faire vivre nos semblables en sa compagnie ? Que serait une bonté qui serait laide ? Nous le savons par les meurtrières utopies, ces maîtresses du kitch. On voudrait alors pouvoir respirer, repousser les fanatiques, les « arriérés de toutes sortes », selon la formule de Rimbaud, les obtus, les puritains, pour élargir l'espace et le temps, laisser venir à nous des confins d'or et d'azur. C'est ainsi que l'idée d'une défense de la beauté redevient pertinente. Elle se fera par touches exquises, par intransigeances transparentes, par nuances, « sur des pattes de colombe », autant dire de la façon la plus aristocratique possible, - ce qui ne veut pas dire que chacun n’y soit pas convié. La beauté est ce qui ne passe pas. Au contraire des mœurs, elle demeure elle-même dans ses manifestations. Le temple de Delphes, les fresques de Piero de la Francesca sont aussi beaux pour nous qu'ils le furent pour leurs contemporains. Voici bien l'approche du Temps au-delà du temps, l'effleurement de son aile...
Anna Calosso: Tel pourrait bien être le cœur de vos écrits, dire le Temps au-delà du temps, dire le cœur du temps, l'éternité de l'Instant, et je songe, en particulier à ce poème, Le Sacre de l'Instant.
Luc-Olivier d'Algange: L'activisme planificateur nous assigne à une temporalité, laquelle nous pousse en avant à toutes fins utiles, mais n'oublions pas qu'en avant, c'est la mort, et non la mort toute nue, vouée aux vautours ou au feu, mais la mort profitable. Cette mort profitable, c'est la vie, toute la vie assignée au temps du travail et de l'usure... Je ne vois guère d'autre objet à la pensée, et précisément à une pensée qui résiste et se rebelle, que d'œuvrer à la révélation, à la réactivation d'autres temporalités secrètes, transversales ou latérales. J'en dis quelques mots dans un essai récent, Les dieux, ceux qui adviennent... Au discours du temps utilitariste, profane et profanateur, du discours qui nous sépare de nous-mêmes et du monde, opposons la fidélité à un autre cours, une rivière enchantée, un Lignon, dont Honoré d'Urfé savait qu'il traverse une géographie sacrée.
Toute géographie, au demeurant, est sacrée, mais nous l'avons oublié. Qui n'a observé que selon les lieux où nous nous trouvons, nos pensées changent de cours ? Une qualité particulière à tel lieu nous imprègne. ce que nous sommes est dans cet accord, dans cet échange magnétique, à la fois intime et impersonnel, par notre façon de nous y mouvoir, de même que la musique, à chaque note, désigne le silence pur où elle se pose, le révélant par ses interstices.
Anna Calosso: Il semblerait que dans votre éloge de l'accord entre l'homme et son paysage, il y eût une implicite critique du « cosmopolitisme », tel, du moins qu'il se revendique parfois aujourd'hui.
Luc-Olivier d'Algange: Votre précision est importante : tel qu'il se revendique aujourd'hui. La critique, implicite ou explicite, en l'occurrence, porte bien davantage sur la globalisation, et la mondialisation, qui ont pour conséquences les communautarismes les plus obtus, les plus incarcérés, que sur le « cosmopolitisme », mot grec qui désigne une pratique spécifiquement européenne. On doute fort que ces grands cosmopolites à leur façon, que furent Fernando Pessoa, Valery Larbaud, Paul Morand, Mircea Eliade, et, plus en amont, Goethe ou Frédéric II de Hohenstaufen, eussent éprouvés la moindre sympathie pour l'actuelle globalisation. Le cosmopolite, l’habitant du cosmos, de l’ordre, est enraciné et peut s'enraciner, et il peut aussi éprouver le sens de l'exil, qu'évoquaient Hölderlin ou, plus proche de nous dans le temps, Dominique de Roux... Le cosmopolite goûte le charme de la découverte, de la mission de reconnaissance. Le globalisé, lui, est partout chez lui dans le nulle part. Le cosmopolitisme appartient, dans son ambiguïté même, à la tradition européenne. Le globalisé n'appartient à rien, sinon aux outrances de sa subjectivité. Dans ce monde déchu, qui est celui de la séparation, du diaballein, la pire séparation est celle qui règne dans le monde globalisé; chacun y étant le geôlier de soi-même. Autant le cosmopolitisme était le luxe de ceux qui s'inscrivent dans un tradere, autant la globalisation est la misère, fût-t-elle cossue et bancaire, des renégats.
Anna Calosso: L'adversaire, si je vous suis, est donc l'uniformisation...
Luc-Olivier d'Algange: oui, elle, et la schématisation, la simplification, la généralité et l'abstraction, choses plus ou moins équivalentes en la circonstance. La liberté n'est possible que dans un monde complexe et même profus, mais d'une profusion, non point numérique mais concrète. Si tout est plat, on nous tire à vue. Il faut, pour être libre, des espaces secrets, des labyrinthes, des passages vers d'autres mondes et d'autres temps. Tanizaki écrivit un Eloge de l'ombre, dont je conseille la lecture. Ceux auxquels on colle volontiers l'étiquette « anarchistes de droite » aiment le secret, les abbayes de Thélème, les Ermitages aux buissons blanc, les « mondes flottants », comme on dit au Japon. Le monde ante-moderne excellait à ces désordres féconds qui obéissaient à un ordre supérieur, invisible. Voyez une cité médiévale, ses recoins, ses surprises, son harmonie qui semble improvisée, voyez encore Venise et comparez les aux productions des architectes et urbanistes modernes conçues rigoureusement pour travailler, vendre et surveiller. Quelques architectes modernes eurent même l'idée de supprimer les rues, où l'on se promène, et de créer un dispositif où les hommes, parqués selon leurs catégories professionnelles, iraient directement de leur appartement à leur lieu de travail, avec pour seules stations intermédiaires le garage collectif et le supermarché. Nous sommes là aux antipodes de ce que Pasolini nommait la société des arcades où les castes se mêlaient dans la recherche des conversations, des saveurs et des plaisirs, dans le goût de l'otium. L'étymologie dit bien que c'est le negotium qui est la négation de l'otium. On voit aussitôt de quel côté est le nihilisme.
Anna Calosso: Le nihilisme est quelque chose qui doit être surmonté nous dit Nietzsche...
Luc-Olivier d'Algange: Surmonté est le mot juste. Tout homme de ce temps est contraint à la traversée du nihilisme. Que voit-il dans ce parcours ? Les murs qui l'enserrent de plus en plus ou la lueur au loin, celle des « aurores » védiques ? La critique de la modernité est souvent perçue comme le fait de « réactionnaires », - mais nombre de ceux que l'on nomme ainsi ne le sont guère. Ce ne sont pas les formes anciennes qu'ils veulent restaurer mais perpétuer les forces, l'imagination créatrice qui les firent naître. Ce qui est tout autre chose.
Anna Calosso: J'hésite enfin à vous poser cette question, un peu trop courue: êtes-vous optimiste ou pessimiste ?
Luc-Olivier d'Algange: La grande espérance, la plus lumineuse, nous vient lorsque tout est à désespérer. Peut-être même y a-t-il quelque chose de providentiel dans le détachement auquel nous sommes obligés, et dont nous serons peut-être les obligés. Une réduction à l'essentiel s'opère, un feu de roue alchimique. Les œuvres qui ne sont plus enseignées publiquement deviennent un secret, dont naît une discipline de l'arcane. La beauté perdue au milieu de la laideur devient éperdue. La destruction des formes visibles nous livre au « séjour auprès de l'invisible invulnérable » pour reprendre la formule de Heidegger. L'hostilité du monde renforce l'amour entre quelques-uns. Les temps prochains seront aux Calenders.

20:34 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
12/03/2022
Le courage d'être heureux selon Joseph Joubert:
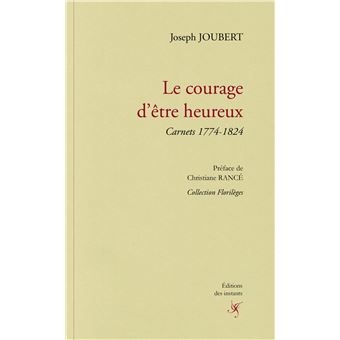
Luc-Olivier d'Algange
Le courage d'être heureux selon Joseph Joubert
Nos temps sont à l'outrance. Les moralisateurs univoques sévissent. En guise de contre-poison, les éditions des Instants nous offrent, sous le titre Le courage d'être heureux, les Carnets 1774-1824 de Joseph Joubert, avec une très-belle préface de Christiane Rancé, - laquelle est la descendante de l'Abbé dont Chateaubriand, qui fut l'ami et le divulgateur de Joseph Joubert, fit un livre.
« La littérature respire mal » disait Julien Gracq de celle de son temps. Dans le nôtre, elle s'essouffle parfois d'indignations, feintes plus ou moins, et de complaisances en de réelles tristesses. Le courage d'être heureux n'est plus guère la chose du monde la mieux partagée.
Ce courage, Joseph Joubert nous l'enseigne, non par des propos édifiants ou des recettes, à la façon navrante du « développement personnel », mais par des exemples, des signes d'intelligence, saisis au vif de l'instant. « Il faut, écrit Joseph Joubert, plusieurs voix ensembles dans une voix pour qu'elle soit belle. Et plusieurs significations dans un mot pour qu'il soit beau ». D'une seule phrase, il nous donne ainsi un art de vivre et un art poétique. Rien, en effet, n'est si monocorde que la tristesse ; et se connaître, se reconnaître, c'est entendre la choeur des voix qui se sont tues mêlé de voix vivantes. Nous connaissons mieux un homme par les inflexions de sa voix que par son visage et mieux encore une œuvre par ses secrets, par ce qu'elle se dispense de nous dire, que par les convictions qu'elle affirme.
La lucidité, pour Joseph Joubert, est une forme supérieure de la bienveillance ; si matinale, si heureuse nous apparaît-t-elle en ces temps fuligineux traversés de cris de vindicte : « Porter en soi et avec soi cette indulgence qui fait fleurir les pensées d'autrui ». Quelles étendues anonymes nous séparent désormais du monde de Joseph Joubert, et par quelles passerelles le rejoindre ? La réponse est toute donnée dans ses pensées cueillies au fil des jours : par la langue française dans son usage le plus précis, le plus nuancé, le plus naturellement élégant.
Dans ces carnets Joseph Joubert nous donne à visiter ses jardins, qui sont de ceux « où le Maître peut se montrer ou se cacher à sa guise ». Son ambition est humble et immense : nous parler comme à des amis, passer les étapes intermédiaires d'un propos pour en éviter le tour didactique qui ferait insulte à notre intelligence, et enfin, laisser vivre dans sa faveur le repos de notre âme, le calme qui est la clef des mystères et des merveilles : « Les âmes en repos sont toutes en harmonie entre elles ».
Ce n'est point sans doute de cette façon, en nos temps spectaculaires, que l'on comprend la gloire (« Néant de la Gloire, dit Joubert, Dieu même est inconnu ») mais plutôt que le resplendissement péremptoire, et parfois accablant, sinon aveuglant, le lecteur trouvera dans ces pensées une autre lumière, une lumière filtrée par les feuillages des peupliers de France, une lumière qui joue au bord des rivières, une lumière spirituelle que l'on ne voit pas, mais qui révèle tout ce qu'elle touche.
Aux antipodes des manuels de « pensées positives», comme aux antipodes du nihilisme qui joue sa partition pour les déçus et les craintifs, et plus loin encore de tous les donneurs de leçon, Joseph Joubert ravive le goût, lequel, par excellence, alerte l'intelligence. Sans goût, l'intelligence - qui veut tant avoir raison qu'elle la perd - est insipide ou monstrueuse, de même que « l'esprit », s'il est malveillant, est le ridicule de celui qui croit en user au dépend des autres.
Joseph Joubert ne veut rien démontrer. Il veille à la fine pointe de la pensée qui vient d'éclore. Le bien lui est léger, et quant à lui marquer sa préférence, il lui convient de ne le faire que légèrement, et d'éviter « la fureur d'endoctriner, et de mêler la bave de son propre esprit à tout ce qu'il enseigne ». Mélancolique à ses heures Joseph Joubert sut, mieux que d'autres , se défendre contre l'aigreur, qui est une faute de goût. S'il faut choisir dans quelque difficile discord, prenons alors pour guide, sans comédie ni tartarinade, la meilleure de nos inclinations naturelles: « Il n'y a de bon dans l'homme que les jeunes sentiments et les vieilles pensées ».
Philosophe, et même métaphysicien, Joseph Joubert l'est au suprême - mais non de cette façon discursive héritée des épigones de la philosophie allemande qui veulent faire des pensées « novatrices » avec de vieux sentiments. Joseph Joubert ne se veut point novateur, ou révolutionnaire, mais juste, si possible, de façon immémoriale. Son ambition est plus grande que de soulever le monde par l'abstraction, et son souci est plus humble : il ne veut point séparer le sensible de l'intelligible.
Souvent comparé aux Moralistes du dix-septième siècle, il se distingue d'eux par la métaphysique. S'il désabuse, comme eux, les hommes de leurs fausses vertus, c'est pour mieux nous inviter à quelque méditation. Frontalier entre deux mondes, comme son ami Chateaubriand, sa nostalgie est discrète et ses pressentiments sans drame. Sur l'orée, il exerce sa vertu majeure, dont il n'attend pas d'être sauvé ni perdu : l'attention.
« Ne confondez pas ce qui est spirituel et ce qui est abstrait » Et ceci encore : « Je n'aime la philosophie (et surtout la métaphysique) ni quadrupède, ni bipède, je la veux ailée et chantante ». L'étymologie est bonne conseillère. Chez Joseph Joubert, tout est pur, c'est à dire feu. Que nous faut-il ? « Du sang dans les veines, mieux du feu, et du feu divin. »
22:05 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
11/03/2022
Note à propos d'un livre de Philippe Barthelet, éditions Pierre-Guillaume de Roux.

Luc-Olivier d'Algange
Fou forêt de Philippe Barthelet
(éditions Pierre-Guillaume de Roux)
Ce qui est ennuyeux dans le monde de la culture tel qu'il se présente actuellement à nos yeux, et à nos oreilles, - pour ne pas dire à notre intelligence, - faculté oubliée ou reléguée de longtemps par les ratiocineurs et les moralisateurs de toute espèce qui ont usurpé le beau nom d'intellectuels que leur attribuaient des adversaires mal avisés, - c'est qu'on y cherche en vain quoique ce soit d'amusant ou de vraiment profond.
Ni la virtuosité joueuse, ni l'aperçu métaphysique ne trouvent grâce chez ces puritains austères. La beauté à fleur de peau comme les beautés intelligibles semblent exclues de ces activités moroses (dites "culturelles") et souvent vindicatives où le moindre semi-cultivé est requis à endosser contre des confrères plus doués et plus libres, l'habit du procureur. L'ensemble répugne et ne manque d'incliner l'homme de goût à n'importe quelles autres fréquentations.
Si bien qu'il est bel et bon de savoir, de temps à autres, et de recevoir cette bonne nouvelle comme un hôte tout autant désiré qu'attendu, que cette zone médiocre où l'on s'ennuie et où l'on travaille, où l'on croit se "cultiver", où l'on traite des "problèmes de l'époque", où l'on est, enfin, si effroyablement sérieux, certains auteurs s'en passent aisément: la nuit et le soleil sont dans leurs phrases, et de folles forêts en surgissent à l'euphonique faveur d'un feu follet.
Fou Forêt de Philippe Barthelet est un de ces livres rares inventés par la désinvolture supérieure qui consiste à parler de l'essentiel.
"Parler du langage, écrit Philippe Barthelet, c'est parler du monde". Voici donc un livre avec lequel le lecteur qui a décidé de ne pas s'ennuyer peut entrer en conversation, comme il entrerait en conversation avec le monde, le cosmos et ses étymologies secrètes que sont les fées et les Muses.
Si pour d'autres, qui sont désormais légion, le monde est un écran, pour Philippe Barthelet, le monde demeure le monde, avec ses rivières, ses arbres, ses oiseaux, et les oeuvres des hommes qui savent les blasonner avec bonheur. La langue française garde cette mémoire seconde, et vivace. Au lieu d'enseigner, ou pire encore, de "communiquer" par elle, l'auteur la prend comme maîtresse, qui enseigne et qui ravit.
La romance de la langue française est un chant continu, comme d'une rivière, que l'on entend mieux loin du bavardage des machines et des hommes. Les Muses sont devenues discrètes, dissimulées, farouches devant les fracassantes convictions des "musophobes", pour reprendre le mot de Milan Kundera, qui arpentent notre terre pour en chasser les merveilles.
Les chapitres dont se composent cet ouvrage nous adviennent comme des rituels légers pour mériter à nouveau, de ces belles Impondérables, une confiance jamais lassée depuis la nuit des temps, et leur intimité profonde, qui nous oblige.
Si nos temps sont infidèles et absurdes, ce n'est point tant par de mauvais penchants gouvernés par des forces drues que par faiblesse grammaticale et pauvreté des mots. La pureté n'est point puriste, encore moins puritaine, elle est, comme le diamant, ce qui laisse voir, dans sa taille, le secret des couleurs de la lumière.
Les Modernes ne semblent tenir à rien, sinon à quelques généralités tyranniques, - mais, à la vérité, c'est que rien ne tient à eux, pas même l'instant où ils se tiennent. Leurs divagations sont tristes et leurs conflits sans honneur. Il s'acharnent avec une âpreté démentielle à fausser les instruments dont ils héritent, pour, égotistes achevés, être sûr de ne rien laisser qui ne soit défaillant ou funeste. Leur temps n'est plus le Temps mais une durée tout amenuisée à quelque finalité précaire, laborieuse ou distractive. Pour combattre ces "musophobes", il ne suffit pas d'emprunter telles convictions, qui leur sont habituellement les plus étrangères ou les plus contraires, à quoi s'emploient, avec une persistance digne d'éloge, les écrivains "réactionnaires". Une physique et une métaphysique sont requises, - à l'oeuvre précisément dans l'ouvrage dont nous parlons.
La plus commune erreur du sérieux est de croire que la fin justifie les moyens; il ne cesse ainsi, par des moyens divers, de nous distraire de ce qui pourrait être une fin adorable si elle n'était éloignée, rendue hors d'atteinte par les moyens qui prétendent y conduire. Ce qui distingue le livre de Philippe Barthelet de ces ouvrages édifiants, qu'ils soient progressistes ou réactionnaires, se tient en la simple raison qu'il est ce qu'il dit.
Ontologique, le moyen, la langue, y est sa fin, dévoilant peu à peu les arcane de l'être et du monde. Nous sommes déjà ce vers quoi nous volons comme les Oiseaux de Farid-Ud-Dîn Attar. La langue française est le Simorgh vers lequel volent ces chroniques françaises.
La sapience n'est pas un but lointain, dont on planifie l'atteinte, mais ce qui est déjà là et que, dans nos agitations, nous troublons ou méconnaissons. L'exercice s'apparente à une oraison de l'attention. Que disons-nous et quelle connaissance nous est donnée par le dire de la chose dite dans ce cheminement amoureux qui va du sens acquis et profane au sens intérieur, étymologique et secret, - là où gisent les images immémoriales et les ressources les plus limpides.
Philippe Barthelet traque, en chasseur subtil ceux qui défigurent la langue française, qui restreignent son usage ou l'ahurissent en réduisant le monde nommé, le seul qui existe pour nous, à des stéréotypes ou des schémas. Confucius plaçait au plus haut, ce qu'il nomme "la science des justes dénominations". Nous apprenons, avec Philippe Barthelet que les dénominations sont justes par ce qu'elles sont fertiles. Elles se refusent à nous laisser dans la représentation que nous avons d'elles. Muses, elles nous ravissent vers des contrées lointaines qui soudain se révèlent être, distantes seulement par l'oubli que nous avions d'elle, notre humble et sainte Patrie.
19:35 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
02/03/2022
Les dieux, ceux qui adviennent:

Luc-Olivier d'Algange
Les dieux, ceux qui adviennent
Définir le paganisme sans se fonder sur le point de vue de ses principaux adversaires n'est pas chose aisée. Depuis un peu plus de deux millénaires, le « païen » existe d'abord comme appellation réprobatrice dans le discours de ses ennemis, de ceux-là même qui se sont évertué à éradiquer ses rites, ses coutumes et ses symboles et à rendre impensables ses idées, sauf à les plier à leurs propres théologies.
Ce qui oppose le païen au monothéiste n'est pas tant ce qui oppose le multiple à l'un, sinon peut-être dans le culte rendu. Sans Aristote ou Platon, la théologie chrétienne eût été une coquille vide (ce qui n’exclut pas le souffle de l’esprit, entendons bien, ces pages ne sont pas d'un “néopaïen” ou d'un adorateur de l'immanence). Toutefois si, par une de ces chances impondérables de l'intelligence qui sont au principe de toutes les œuvres vives, nous parvenions à penser l'Un et le Multiple non comme une opposition, un dualisme, mais comme une diffraction (le Multiple diffracté de l'Un) nous nous approcherions déjà de ce que put être une métaphysique païenne fondée sur le consentement poétique à la multiplicité des aspects du monde.
Ce consentement exige une force d'âme qui semble s'être perdue. La faiblesse, nous le savons depuis Nietzsche, emprunte les voies du ressentiment, de la vengeance et de la technique elle-même, « arraisonnement du monde », selon la formule de Heidegger, qui est la première des formes de l'esprit de vengeance contre la diversité diffractée du monde.
Dans ses formes les plus récentes, le monothéisme le plus agressif, par la terreur, issue de la vengeance, et par l'argent uniformisateur, montre assez qu'il n'est plus du tout une théologie, et moins encore une métaphysique, mais la simple application d'une Loi du ressentiment, contre tout ce qui, pour un esprit libre, est aimable: les cheveux au vent, la musique, l'intelligence librement exercée, et contre l'âme elle-même des individus et des peuples.
En politique internationale, nous assistons à la mise-en-place d'un dispositif où de faux ennemis s'avèrent être de véritables alliés dans la fabrication d'une machine de guerre destinée à faire disparaître la profondeur du temps. Les massacres, les statues détruites, les manuscrits brûlés ne sont que la part visible d'un projet d'aplatissement du réel qui suppose la destruction ou l'oubli du palimpseste du temps.
Dans quel temps vivons-nous ? La question se pose à chacun, et à chaque peuple. Est-ce le temps de l'abolition des temps antérieurs ou le temps de la reconnaissance, avec la décisive nuance de gratitude qui s'attache à ce mot ? Ce que l'on nomme, faute de mieux, le paganisme, renait dans la reconnaissance, qui est à la fois gratitude, mission de reconnaissance, initiation à ces temporalités qui échappent à l'usure et nous donnent la chance, selon la formule d'Hölderlin, d'habiter en poètes un monde dont, ainsi que le rappelle Heidegger, nous ne sommes qu'une part, - avec le ciel, la terre et les dieux.
Le paganisme, s'il fut banni, parfois non sans brutalité, des campagnes et des cités, ne s'en est pas moins perpétué dans le cœur des poètes, c'est dire dans les langues européennes elles-mêmes, lorsqu'elles ne se sont point asservies aux seuls jargons utilitaristes, et nous relient, du seul fait de la grammaire et de l'étymologie, à notre plus lointain passé.
Loin de n'être qu'un folklorisme, une néo-attitude, une déférence muséale, le ressouvenir des dieux fut, en poésie, un rappel de cet autre temps, ce temps sacré, ce temps historial par lequel nous échappons au temps des banques, au temps numérique, au temps administratif.
La parole revient au poème, c'est-à-dire au cœur du réel, hors des abstractions despotiques. Le soleil et le vent, les forêts et la mer, l'amour et l'ivresse sont des déesses et des dieux. Dans ce temps-là, dans ce temps spacieux et ondoyant, l'intériorité ne se distingue pas de l'extériorité, une circulation s'établit, en forme de ruban de Moebius, entre nous et le monde, - circulation, orbe nocturne et solaire, qui interdit que nous puissions vouloir planifier ce qui nous entoure et le soumettre à la seule vision narcissique que nous nous faisons de nous-mêmes.
Le paganisme, à cet égard, est une humilité, un « sens de la terre » pour reprendre la formule de Nietzsche, et cette terre est sous un ciel, qui n'a rien d'abstrait, un ciel qui approfondit nos yeux et nos poumons. Le païen se rend à cette évidence: nous avons des poumons parce qu'il y a de l'air, des yeux parce qu'il y a de la lumière. Notre corps, notre peau, notre cerveau, sont des instruments de perception. Notre subjectivité n'est qu'une réalité seconde, une représentation, un relent.
Demeurer fidèles aux bonheurs qui nous advinrent quand bien même il n'en subsiste que des traces presque indiscernables, runes couvertes de mousse dans la profondeur des forêts; sauvegarder le souvenir, dans le ciel vide, d'une escadre d'oiseaux qu'aruspices de la minute heureuse nous déchiffrâmes; voir les crépuscules, comme dans les tableaux de Caspar David Friedrich, détenir de secret de l'aurore, - telle est, par la longue mémoire qui fait du présent une présence, l'égide protectrice que nous offre la profondeur du temps.
Da-sein, être là, c'est refuser de se laisser chasser de là où nous sommes, physiquement et métaphysiquement, au nom d'une universalité qui est la plus radicale négation de l'Un diffracté. L'atteinte portée à la langue française par les forces conjointes des politiques, du pédagogisme, des animateurs et publicistes divers, est l'essence même, vengeresse, du projet d'aplatissement qui n'a d'autre fin que la disparition même du réel. Cependant, quand bien même uniformiserait-t-on tous les aspects de notre environnement et de nos styles de vie, les dieux demeurent, en puissance, tant que nous pouvons les nommer.
Notre langue irrigue nos pensées, la porte plus loin, gardant le souvenir de la source, lumineuse fraîcheur, jusqu'à l'estuaire où elles s'abandonnent à l'océan du monde et des autres hommes. On chercherait en vain, dans ce monde devenu abstrait, enracinement plus profond ailleurs que dans le cours des phrases, - et mieux encore qu'un enracinement, une source, une ressource de notre intelligence, - de cette intelligence que nous avons avec ce qui nous environne, et qui nous regarde et nous reconnaît.
Nommer les dieux, c'est être d'intelligence, non pas avec l'ennemi, mais dans l'amitié des aspects divers du monde. Ce vent, Eole, ce soleil, Hélios, cet Océan nous parlent, nous regardent, et nous pouvons leur adresser nos louanges, nos imprécations ou nos prières. Les dieux disent, en existant, la relation qui opère entre le monde et nous, entre l'immense et l'infime, entre le mortel et l'immortel. Ainsi, la vision que nous avons du temps ne se réduit pas à la seule temporalité des mortels que nous sommes, et nous pouvons ainsi servir ce qui est plus haut et plus grand que nous; condition nécessaire à toute fondation, à toute civilisation.
Le grand souci politique de toutes les épopées et Chansons de Geste, tient en une définition de la noblesse. Qu'est-ce qu'être noble ? De quelle nature est l'areté homérique ou la vertu héroïque ou chevaleresque des romans arthuriens ? Sa nature est d'être, précisément, la réverbération d'une surnature et l'approche d'une Merveille. Elle est d'être de ce monde sans lui appartenir entièrement; elle est de fonder, en mortel, ce qui doit nous survivre.
Nous, modernes, méconnaissons la chance de recevoir. Nous préférons rompre avec ce qui exigerait de nous une reconnaissance ou une gratitude, une admiration, sans savoir à quel point ces beaux sentiments peuvent être, lorsqu'on s'y abandonne, légers, - légers comme d'une ivresse légère, une dansante dionysie. Sans doute la plus triste, la plus morose des souffrances humaines est-elle cette illusion funeste de n'avoir rien, ni personne, à remercier. Le nihilisme se fonde sur cette arrogante illusion que meut, comme l'automate d'un cauchemar expressionniste, cette volonté de puissance retournée, inversée, et rendue infirme, qu'est la volonté de vengeance, non plus contre des ennemis, ou, comme dans l'Odyssée, d'abusifs prétendants, mais contre la simple dignité des êtres et des choses.
Proches et lointains sont les dieux. Ce lointain si proche, cette proximité si lointaine sont la nature surnaturelle des dieux. Dans la vastitude qui nous surplombe comme dans l'interstice que nous devinons, leur secret est d'advenir, d'être, selon la formule grecque, « ceux qui adviennent », et qui adviennent par notre art et notre ferveur à les nommer.
A écouter Hésiode et Pindare, Homère et Virgile, les dieux qu'ils évoquent et dont ils disent les advenues, les dieux qu'ils invoquent et qu'ils racontent, nous nous apercevons soudain que ces dieux, depuis la nuit des temps de notre mémoire, nous accompagnent, et que nos destinées s'accomplissent sous leurs égides menaçantes ou protectrices.
Intercesseurs du tragique et de la joie, ils sont, approfondissant l'espace et le temps, ombres et lumières entretissées, frontières frémissantes, orées impondérables, et rien, sinon une interdiction que nous faisons à nous-mêmes, valant ignorance, ne nous interdit d'en recevoir, hic et nunc, les messages.
Cette proximité lointaine, ce lointain si proche, cette distance immanente et transcendante, tendue comme un arc entre le temps et l'éternité, définit un rapport au monde où les contraires s'avivent, ourdissent ensemble un grand dessein, lors que les dualismes sont frappés d'inconsistance.
Il est une façon « païenne » d'approcher du vrai, du beau et du bien, ni scolastique, ni systématique. Dans un monde où les dieux sont les résonances du possible, le réel ne se donne point à administrer, à diviser, ou à planifier. On remarquera à quel point, chez les philosophes grecs, qu'ils soient ante ou post- socratiques, ce mode la pensée, l'Opinion, la doxa, si despotique de nos jours, est, sinon absent, du moins immédiatement mis en perspective. L'esprit critique, - qui naît de la philosophie grecque et de nulle autre, fonde, dans le raisonnement, la précellence de l'objectivité.
La doxa corrigée par la gnosis de la philosophie platonicienne et néoplatonicienne, de Plotin, jusqu'à Marsile Ficin ou Pic de la Mirandole succède à la doxa livrée et éprouvée par le paradoxe d'Héraclite ou de Zénon. La pensée grecque, mesurée à l'objectivité des dieux qui nous délivrent de la subjectivité outrancière de la croyance réduite à une monologie, demeure cette flèche paradoxale qui ne devrait jamais toucher sa cible alors même qu'elle la frappe. Les dieux et cette façon grecque de s'entretenir avec les dieux, ne sont pas étrangers à cette pensée spéculative toute d'audace, d'élans et de surprises.
Pour les Grecs, les théophanies ne sont pas des causes ou des conséquences d'une croyance mais une expérience que l'on éprouve, - sauvegardant ainsi le sens étymologique du mot expérience, ex-perii, traversée d'un péril. Ce qui s'éprouve n'est pas affaire d'opinion, de croyance, mais de connaissance. Ces dieux qui nous regardent sans nous juger, qui interviennent de façon contradictoire ou paradoxale dans nos destinées, ces dieux qui nous guident et nous déroutent, nous enchantent ou nous terrifient, prédisposent nos pensées à des vigueurs qui font paraître ineptes ces dualismes si reposants, quel que soit le côté vers lequel ils nous inclinent, pour mieux nous déchoir.
Entourés d'Aphrodite, de Dionysos, d'Apollon, ou d'Athéna, comment pourrions-nous reposer notre pensée dans une représentation, comment pourrions-nous administrer cette représentation et, par elle, vouloir planifier la réalité des hommes et du monde ?
L'opposition de la croyance et du scepticisme, de la nature et de la surnature, du corps et de l'esprit, du sensible et de l'intelligible ( que l'on accuse à tort Platon d'avoir promue, alors qu'il nous dit, entre les deux, non la rupture mais « la gradation infinie »); l'opposition entre le singulier et le collectif, entre le destin individuel et la communauté de destin, - ces oppositions scolastiques, universitaires, puis, hélas, journalistiques, sont devenues si familières aux esprits formés par la dualisme qu'elles sont devenues comme intrinsèques à presque tous les discours idéologiques de notre temps, - alors qu'elles n'eurent, sans doute, pour les Grecs, entourés de la polyphonie concordante des dieux, aucun sens.
Entre l'individualisme de masse et le collectivisme planificateur, une tierce voie demeure possible qu'illustre le voyage odysséen. Cette voie, encore que généralement oubliée, n'a jamais cessé d'être fréquentée. Fénelon, dans son Voyage de Télémaque, y invita celui qui devait devenir notre Roi-Soleil, et Versailles, ce temple apollinien du Roi Très-Chrétien, en témoigne.
Si arrogantes qu'eussent été les prétentions des sectateurs, de ceux qui coupent et qui divisent le temps, de ceux qui eussent voulu nous séparer de notre passé, celui-ci, précisément parce qu’il fut déplacé hors de la temporalité qu'on voulut nous imposer, nous revient, si l'on ose dire, quand il lui plaît.
La formule des physiciens présocratiques, « rien ne se crée, rien ne se perd » se transpose aisément dans l'ordre des idées, au sens où les idées ne sont pas des abstractions, mais des formes, et des formes formatrices. Qu'elles soient hors de la doxa, proscrites, dénigrées, exclues du monde social, voire jugées illégales, ces formes qui nous forment et forment le monde demeurent, fussent-elles inapparentes, car clandestines, et ressurgissent dans l'advenue des dieux qui les figurent.
Là où l'abstraction ne règne plus adviennent les dieux; là où la nature n'est plus un spectacle ou une zone d'exploitation, les épiphanies surgissent, et point n'est nécessaire d'y croire pour les éprouver. Dans un monde peuplé de dieux, la dissociation entre ce qui serait de l'esprit et ce qui serait du corps n'a aucun sens, car c'est de l'âme que nous viennent les dieux, âme humaine dans l'éclat de la prunelle et Ame du monde, - celle qui figure, dans Virgile, sur le bouclier de Vulcain.
Entre le sensible et l'intelligible, entre l'extériorité énigmatique et l'intériorité mystérieuse, les dieux sont intercesseurs. Le propre de leurs messages est qu'ils ne sont jamais entièrement délivrés; ils demeurent en suspens, et attendent de nous un déchiffrement sans fin à la ressemblance de l'attente amoureuse ou du voyage en haute-mer.
La haine du paganisme fut peut-être avant tout une haine de l'Eros, un ressentiment contre la joie. Dans son cours puissant, dévastateur, cette haine de l'Eros est devenue aussi une haine du Logos. Dans la mythologie grecque, il n'est point rare que les déesses se laissent étreindre par des hommes. Mais l'étreinte la plus ardent, la plus nuptiale, est celle qui unit l'Eros et le Logos, et dont naissent les Epopées et les chants. L'inimitié du Mythe et du Logos, sur laquelle insistent parfois Messieurs les professeurs, est des plus relatives: il n'est que de voir l'importance des Mythes platoniciens.
Dans les Hymnes homériques, dans la Théogonie d'Hésiode, dans la poésie de Pindare, le Logos embrasse et s'embrase d'Eros. Au consentement tragique répond le consentement à la joie, à la jouissance. Etre aimé d'une déesse donne une haute idée de l'amour, fort éloigné du puritanisme et de son envers pornographique, - qui ne sont l'un et l'autre que deux aspects de cet utilitarisme moralisateur dans lequel Théophile Gautier, dans son admirable préface à Mademoiselle de Maupin, voyait la pire menace contre l'art, le plaisir, le goût et la civilisation elle-même.
Entre la maussaderie et la dérision hargneuse, les Modernes semblent mal disposés au combat allègre, savant et léger auquel Théophile Gautier nous convie, - où furent cependant engagés, dans un magnifique « tous pour un » des écrivains puisant aux sources les plus hautes, tels que Gérard de Nerval, Marcel Schwob, Pierre Louÿs ou Paul Valéry, - dont la traduction des Géorgiques de Virgile donne à la langue française un autre texte sacré.
Or ce puritanisme, ce moralisme, cette complaisance, voire cette obédience, à l'égard de ce qui veut nous détruire, que sont-ils sinon les écorces mortes d'une détestable fatigue ? Tout en ce monde moderne conjure à nous épuiser, à nous distraire, à nous culpabiliser, à nous anémier, à nous uniformiser et à nous faire oublier l'Aphrodite aux mille parfums.
Repoussé hors du réel, exproprié de nos terres et de nos traditions, chassé de nos paysages et rendus sourds à l'esprit des lieux, au palimpseste des légendes, aux bruissement des sources sacrées, nous sommes devenus ce troupeau aveugle dirigé vers les lotissements de l'abstraction, là où, en place vivre dans la tragédie et dans la joie, nous serons figés en statues de sel devant des écrans auxquels nous servirons d'intercesseurs lucratifs. Ainsi, avec le réel, disparaissent le Mythe et le Logos, et par eux, la voie d'accès avec ce qu'il y a de réel en nous, c'est-à-dire, de souverain et de différencié.
Plus encore que par les religions qui s'y substituèrent (et gardèrent souvent de secrètes révérences à l'égard des symboles plus anciens), la vue-du-monde portée par les dieux antérieurs est niée par le règne de l'abstraction pour lequel il n'est plus de rites opératoires ni de symboles qui relient le visible à l'invisible: abstraction par laquelle le monde est vide de toute présence et de toute puissance qui ne soit humaine et utilisable par l'humain.
Lorsque l'action se réduit à être strictement utilitaire dans un temps linéaire qui est le temps de l'usure, elle cesse d'être en corrélation avec la contemplation. Or ce qui ne se donne pas à contempler disparaît tôt ou tard de notre regard et de la vie elle-même, cette polyphonie de forces concordantes et contradictoires.
Les dieux peuplent les mers, les forêts, les prairies, les clairières, les glaciers, l'abord des rivières, car il y eut des regards d'homme pour s'y attarder, pour les considérer d'un autre œil que celui de la rentabilité. Pour qu'un dieu advienne, il faut que le regard approfondisse en lui le paysage qui sera son voile et son dévoilement. Le dieu, ou la déesse, surgit là où nous l'attendons.
La grande erreur morose, la grande erreur de la lassitude, la grande erreur du renoncement, est de croire que tout a déjà été vécu. Mille nuances sont en attente. Nous ne reviendrons pas aux dieux comme vers un passé, ou pire encore, un Musée; ce sont les dieux qui reviendront en nous, à l'impourvue, - dès lors qu'abandonnant comme de trop humaines vénités, nos trajectoires scolastiques, didactiques, discursives ou linéaires, nous consentirons à laisser nos pensées emprunter la forme des constellations, des concrétions minérales, des fleurs de givre, du vol des hirondelles, de l'étoilement.
Les formes, les dieux, les idées, - au sens étymologique, - sont à la fois une liberté conquise et une limite. Rien cependant n'est pire prison que l'informe, dont nul ne peut s'évader car il n'a pas de frontières. Perdus dans le nulle part, nous sommes livrés sans défenses et sans contredits possible à la servitude et au déterminisme le plus immédiat. Toute liberté exercée suppose la protection d'une forme, d'une idée ou d'un dieu qui libère et définit l'aire où nous pouvons agir. L'utopie de la liberté absolue conduit à la dictature absolue. Défions-nous des « libérateurs » dont le premier projet est de nos inventer, et surtout de nous vendre, de nouvelles servitudes. Ainsi chaque innovation technique se présente comme une liberté nouvelle, de se déplacer, de « communiquer », alors même qu'elle nous ôte une aptitude, nous soumet à son véhicule et nous fait dépendre de son objet.
La limite de la forme est une frontière que nous gardons la liberté de franchir, en toute connaissance de cause, et qui nous garde aussi de nous dissoudre, de nous évanouir, et de perdre ainsi, dans l'indélimité, le sens même de notre souveraineté.
Ces dieux qui demeurent et que, parfois, notre attention ravive dans la profondeur du temps, veillent sur notre civilisation dont ils disent les puissances, les paradoxes et les détours, - et ce Dit, cette Dichtung, nous protège de la société qui travaille à la liquidation, à la table rase, à la solderie de tout et de tous. L'apparence de vérité de la théorie du « choc des civilisations » cède devant l'évidence de cette guerre plus profonde, plus radicale et plus impitoyable qui oppose désormais la société, régie par l'argent, suprême liquidité, et le palimpseste des civilisations.
Qu'attendons-nous ? Dans quels temps attendons-nous ? De quelles attentions honorons-nous le monde, et dans quelles attentions divines, à l'exemple d'Ulysse, sommes-nous ? Lorsque les hommes sont attentifs aux dieux et les dieux attentifs aux hommes, cet autre temps, qui n'est plus le temps de l'usure, se déploie et devient un espace de réminiscences et de pressentiments. Les signes deviennent symboles et rappels. On songe à ce poème platonicien de Théophile de Viau: « Au seul ressouvenir d'avoir couru les eaux/ Nos rapides pensers volent dans les étoiles/Et le moindre instrument qui sert à des vaisseaux/ Nous fait ressouvenir des cordages et des voiles. »
La profondeur n'est pas dans la seule direction du passé; elle environne l'instant d'un beau cosmos miroitant, dans toutes les directions. Lorsque les dieux apparaissent ou interviennent, le temps n'est plus seulement une ligne, qui va du passé vers un futur en abolissant le présent, mais une roue solaire, un feu de roue comme disent les alchimistes, qui changera en or, en ensoleillement intérieur, en épiphanie héliaque du Logos, le plomb du temps accumulé.
La théophanie est l'instant qui fait éclore le cœur du temps. Au temps passé, au temps futur s'ajoutent d'autres temps, latéraux ou transversaux, selon des modalités non plus discursives mais rayonnantes. « La musique creuse le ciel » disait Baudelaire. Les dieux et leurs légendes creusent le temps, - et ce n'est point vers un passé momifié que nous allons mais vers l'eau la plus fraîche, qui sourd des profondeurs, la claire fontaine du temps perdu qui est l'éternité même ainsi que nous le disent la Feuille d'Or d’Hipponion :
« Ceci est l’œuvre de la mémoire, quand tu seras sur le point de mourir.
Tu iras dans la maison bien construite d’Hadès. Il y a une source à droite, et dressée à côté d’elle un blanc cyprès : descendue de là les âmes des morts se rafraîchissent. De cette source ne t’approche surtout pas ! Mais plus avant tu trouveras une eau qui coule du lac de Mnémosyne ; devant elle il y des gardes. Ils te demanderont, en sûr discernement, ce que tu viens chercher dans les ténèbres de l’Hadès obscur : Dis : Je suis fils de Terre et de Ciel étoilé. »
De tels écrits situent ce que nous sommes, le cœur secret de nos songes et de nos actions, dans un présent qui est présence parfaite à ce qu'il y a de plus archaïque, de plus originel. Ces phrases ne se donnent pas à entendre comme un témoignage anthropologique ou historique, mais s'offrent au déchiffrement, à l'herméneutique ardente, amoureuse, comme la trame sur laquelle s'incurvent, ici et maintenant, la conscience de notre finitude et notre espérance d'immortalité. En ce qu'elles sont un péristyle de l'au-delà, et peut-être par cela même, elles peuvent aussi se comprendre comme une vue-du-monde, une légende de nos œuvres ici-bas, de nos songes et de nos combats.
L'autre monde, l'autre temps, dans la vision antique du monde, n'est pas donné, il est conquis. L'éternité est conquise par l'attention, ainsi que la vie elle-même qui ne resplendit jamais aussi bien que lorsque nous savons, avec Platon, que « temps est l'image mobile de l'éternité », et qu'il nous vient ainsi, naturellement et surnaturellement, à servir plus grand que soi.
Chacun perçoit plus ou moins obscurément que deux mondes s'opposent, celui de la réglementation abstraite et celui des libertés réelles. Ces deux mondes s'opposent, au demeurant, en nous tout autant qu'autour de nous. A cet égard, nous sommes, que nous le voulions ou non, doublement impliqués dans leur discord. Le comble de l'abstraction est l'Argent. De même qu'il y a une nature naturante, une idée idéatrice, une forme formatrice ou génétique, il y a cette abstraction abstractive, si l'on ose dire, en ce qu'elle tend à faire de toute chose une quantité abstraite.
Quiconque a vu mourir l'un des siens a vu aussitôt s'affairer autour du défunt un grouillement de banquiers, de notaires et de parasites divers, dont l'Etat. Dans le monde moderne, le disparu n'est pas « fils du Ciel étoilé » selon la formule orphique mais une chose immédiatement monnayable. Rien de bien surprenant, puisque selon l'atroce devise en vigueur, « time is money », la vie elle-même est destinée à être soumise à cette réduction de la qualité à la quantité. Le temps quantifié n'est plus ce « temps perdu », ce temps qui précisément nous reviendra en reconnaissances, en réminiscences, comme le Graal de Wolfram von Eschenbach qui nous enseigne que le Graal perdu est le Graal trouvé, mais un temps détruit.
Au temps détruit, le temps des dieux oppose le temps fécond, printemps de l'âme, temps des advenues, des surgissements ravissants ou terribles, le temps de la tragédie et de la joie.
Cette titanesque machine uniformisatrice que nous voyons à l'œuvre, outre l'esprit de vengeance et de ressentiment, a pour moteur la peur du tragique et le dédain de la joie qui lui est corrélative. Le sentiment tragique de la vie naît de cette certitude que rien, aucune situation, aucune personne, aucun peuple, aucun paysage, aucune œuvre, aucun combat ne sont interchangeables. Leur essence et leur génie fleurissent et meurent avec eux. Rien ne peut les remplacer. Les œuvres peuvent en prolonger la mémoire, en perpétuer les gloires mais rien, à jamais, ne pourra s'y substituer. La joie la plus intense brûle ainsi de la flamme tragique: elle sera à jamais sans ressemblances. Ce constat est si cruel que, pour le fuir, les hommes en vinrent à se vouloir interchangeables dans un monde uniformisé et désirer être ces « derniers des hommes » qu'évoquait Nietzsche.
Or cette utopie funeste, quand bien même la société du contrôle lui donne quelque apparence de succès, n'en demeure pas moins, comme les sociétés disciplinaires du début du siècle précédent, vouée à l'échec (mais après quels ravages !) et d'un échec qui sera plus cruel que la cruauté qu'elle voulut fuir, car le tragique alors lui retombera dessus alors même que toute joie sera éteinte.
Les dieux viennent de la profondeur du temps, ils nous adviennent afin de nous détacher des écorces mortes, des représentations, des ombres sur les murs de la caverne. Une plus haute et plus impondérable fidélité est requise dans leur advenue. Les dieux nous reviennent, intacts, comme au premier matin du monde, lorsque tout est dévasté. Ils nous reviennent afin que nous apprenions à distinguer ce qui passe de ce qui demeure, les formes vides, les écorces mortes et les formes formatrices, les attachements qui asservissent et les fidélités qui libèrent, les choses mortes et les causes créatrices, la source du Léthé et la source de Mnémosyne.
Mnémosyne n'est pas la source de la remémoration morose, du ressassement, des commémorations, de la repentance, ces frelatées friandises modernes. Mnémosyne nous abreuve du souvenir de ce que nous n'avons jamais appris, elle nous relie non à une identité administrative mais à un tradere qui est ressource venue de la nuit des temps.
Ce monde dans lequel nous vivons et qui n'exige rien de nous, sinon la répétition psittaciste de l'opinion dominante et le paiement des factures, est la platitude même, et le « réalisme », dont parfois il se vante, est le plus grand déni possible du réel, en latitudes et longitudes, en hauteur et en profondeur. Là seulement où il y a une hauteur et une profondeur adviennent les dieux qui sont les noms des hauteurs et des profondeurs qui nous regardent.
Il n'est rien qui soit moins « du passé » qu'une épiphanie ou une théophanie puisqu'en elles se rassemblent, en un point d'incandescence, toutes les puissances présentes du présent. Ces forêts, où nous nous égarons, sont pleines de dieux, ce fleuve que nous avons longé en repensant cruellement ou tendrement toute notre vie, certes, est un dieu; toutefois ces dieux ne sont pas seulement, comme le pensaient certains anthropologues, des « représentations des forces de la nature » mais la nature elle-même en tant qu'elle est une réverbération du Logos, un miroir de l’âme et des puissances sympathiques, magnétiques, qui se manifestent, en même temps, en nous et dans le monde.
Qu'ils soient généralement oubliés n'ôte rien à la présence des dieux, lesquels, - contemporains perpétuels d'une philosophie qui pense le monde sans commencement et sans fin, - ne meurent jamais, mais s'éloignent et se rapprochent, et ne s'absentent qu'aux regards de ceux qui vivent dans un temps sans profondeur et dans un espace purement quantitatif. Les dieux, ceux qui adviennent ; rien n'advient jamais que dans le présent. Les dieux sont ce qui soulève, ce qui fait advenir dans le présent (que notre inattention eût distrait) une présence attentive, une présence qui exige d'être dite et chantée, à notre façon, française et européenne, afin qu'elle devienne ou redevienne, une présence au monde, un ensoleillement de l'être.
Extrait de L'Ame secrète de l'Europe, Oeuvres, mythologies, cités emblématiques, éditions de L'Harmattan, collection Théôria.
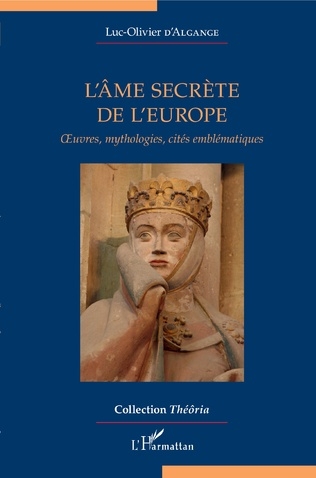
13:40 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
01/03/2022
Lettre sur la pauvreté et l'honneur:
Publiée il y a une vingtaine d’années dans la revue Alexandre, mais toujours, hélas, d’actualité :
Luc-Olivier d'Algange
Lettre sur la pauvreté et l'honneur.
Le Printemps arrive, avec ses arbres en fleurs dont les couleurs tranchent sur le ciel gris, et d'autres contrastes, moins aimables. Certains partent en villégiature, d'autres sont expulsés... Nous vécûmes donc ces temps étranges où la Gauche, devenue la défenderesse exclusive des classes moyennes laissa aux bons soins d'un abbé maurrassien, la mission de revendiquer en faveur des pauvres et de réclamer, d'ailleurs en vain, l'application d'un décret gaulliste concernant la mise à disposition de certains habitations inemployées pour les sans-abri ! Autant l'avouer sans ambages, les récriminations des employés de la S.NC.F, soucieux de mettre leur longue retraite à l'abri du besoin d'une voiture nouveau-modèle, me laissent assez froid. Je pense, avec une compassion qui n'est point exempte d' une conscience politique plus aiguë, à ces hommes et ces femmes qui marchent du matin au soir dans la ville, hagards d'épuisement et de désespoir et qui se trouvent dans cette situation non pour avoir commis des crimes abominables mais par malchance, faiblesse, insouciance, ou éloignement de ces tribus qui dans chaque ville et chaque village font dépendre les sinécures, ou des emplois plus ou moins utiles, de la servilité politicienne ou du népotisme le plus éhonté.
L'honneur politique eût été de prendre parti pour les misérables au lieu de s'empresser à se hausser d'une bourgeoisie moyenne à quelque autre supposée plus « grande ». Mais que pouvions-nous attendre de ces hommes et de ces femmes « de Gauche », oublieux de Péguy, de Proudhon et de Bernanos, mais qui n'en persistaient pas moins à traquer l'intellectuel supposé « de droite », l'antidémocrate affreux, le dandy coupable d'hostilité au progrès et au triomphe de l'homme moyen. L'honneur eût été d'être moins sourcilleux envers les esprits libres et plus exigeant envers soi-même et plus généreux envers les pauvres. Il est vrai que les pauvres, les vrais pauvres n'ont guère le sens de l'histoire. Et lorsque je parle des pauvres, je ne parle point de ceux qui ne sont « pas riches », catégorie vaste et pour ainsi dire universelle, les moins nécessiteux n'étant pas les moins plaintifs et les moins cupides, - mais de ceux qui sont pauvres au point que les « pas riches » en viennent à les considérer comme une race à part, marquée par une sorte de malédiction. L'attitude d'un « pas riche » à l'égard d'un vrai pauvre est quelque chose de terrible ! J'en vois chaque jour de ces hommes (que le travail de leurs parents a sortis de la misère et qui sont assurés d'un emploi et d'une retraite) témoigner d'attitudes infiniment offensantes pour les vrais pauvres.
Dans ce monde « démocratique », dans ce monde saisi par le « progrès », la vénalité est devenue la véritable norme morale. De la sorte, il est naturel que le pauvre soit jugé plus ou moins coupable et que la pauvreté soit considérée comme un châtiment. Etrange focalisation d'un sentiment religieux qui paraît s'être évanoui partout ailleurs ! Désormais, le Bien, le Beau et le Vrai sont mesurables, c'est l'Economie qui nous le dit. Observons le mépris avec lequel sont considérées toutes les activités non-vénales. Entre la condescendance et la haine, la réprobation morale module son adoration de l'Argent-Dieu. Celui qui n'est pas payé, celui qui ne parvient pas à réduire son activité en argent est infâme: telle est la morale moderne, beaucoup plus simple et déterministe que les morales anciennes où intervenaient le Ciel, l'Enfer, le Libre-arbitre, l'Esprit Saint, la Grâce en des entrecroisements complexes que seuls pouvaient désenchevêtrer le Pardon, le souverain Pardon qui restitue aux êtres et aux choses leur simple dignité de créature de Dieu.
Pour le Moderne, tout est simple immédiatement. Le vil est celui qui ne se vend pas et la justice immanente est là pour le châtier, pour faire de lui un « pauvre » avec, s'il le faut le concours objectif d'une société particulièrement habile à faire de la bienfaisance un spectacle. Car l'utilitarisme du moderne ne désarme jamais. Ces pauvres, châtiés par leur incurie, encore faut-t-ils qu'ils servent au spectacle de la bonne conscience que les « pas riches » se donnent à grands frais !
Loin de nous Péguy, et Proudhon, et Bakounine ! Et plus loin de nous encore Villiers de l'Isle-Adam qui eut l'audace magnifique d'opposer aux potentats égalitaires l'aristocratie ultime de celui qui n'a rien. Or, ce qui importe alors, ce qui s'élève dans l'âme comme une promesse immense, ce n'est point de ne rien avoir mais d'être, à la pointe de l'exigence la moins réductible, dans cette excellence du cœur que rien, ni personne ne peut sérieusement contester.
Sans doute faut-il pour pouvoir juger de ces questions de philosophie politique, et sans être suspect de partialité, s'être trouvé alternativement du côté de ceux que jalousent les médiocres et du côté de ceux qu'ils méprisent. On est alors en mesure de comprendre ce qu'est une véritable rébellion contre l'iniquité. Où sont les hommes de Gauche qui se soucient davantage des plus pauvres qu'eux qu'ils ne passent de temps à envier les plus riches ? Sans doute faut-il savoir ne pas s'offusquer du luxe pour être à même de comprendre que la pauvreté n'est pas infâme. L'égalité abstraite n'a aucun sens. Les Droits de l'Homme sont un leurre. Seules importent les jurisprudences. Démosthène la savait déjà: « Or cette force des lois, en quoi consiste-t-elle ? Est-ce à dire qu'elles accourront pour assister celui d'entre vous qui, victime d'une injustice, criera à l'aide ? » Le pauvre dans sa famine et dans sa froidure se soucie bien de savoir qu'il est, en théorie, l'égal du Médiocre qui est assuré de vivre toute sa vie dans le même confort et la même ignorance comme d'une jouissance toute naturelle, de tous ces biens élémentaires dont le pauvre est privé. L'écart entre un simple employé et un homme à la rue est infiniment plus grand que l'écart entre ce même employé et le milliardaire le plus faramineux, car pour la beauté et l'intensité de la vie, la fortune y est pour peu de chose: tout se joue dans la luminosité de l'entendement. C'est l'Intellect, quoiqu'on en dise, qui préside à ces merveilles. Celui qui riche ou médiocre se traîne dans la vie comme un esclave sans cœur et sans colère trouve fort juste qu'il y ait des plus malheureux que lui, surtout s'ils eussent été, ces plus malheureux, en des circonstances moins défavorables, des rares heureux, à faire pâlir de jalousie !
Pour la majorité de nos contemporains, le bonheur d'autrui ne brille point, le bonheur d'autrui n'est pas une lumière désirée. La profondeur du bonheur de l'élu comme la profondeur du malheur du misérable se joignent et s'offrent à la même réprobation, mais le ressentiment prescrit d'œuvrer plus promptement à la disparition de la profondeur du bonheur qu'à celle de la profondeur du malheur. Certes, lorsque l'on voit à quoi s'occupent les hommes et les femmes qui ont échappé, parfois de peu, à la misère, avec quel soin jaloux ils s'en tiennent au moindre effort et à la moindre générosité, avec quel dédain et quelle suspicion ils accueillent les expressions de la beauté et de l'intelligence, il faut bien reconnaître que certains beaux combats sociaux paraissent comme frappés d'inanité. Ainsi serait-ce pour que de tels gens vivent comme ils vivent que d'autres naguère ont haussé parfois leur militantisme jusqu'au sacrifice chevaleresque ? L'ignominie « libérale » n'en demeure pas moins patente et persistante, dans le cœur de quelques-uns, l'Idée qu'une morale purement dispendieuse nous fait une vie plus belle que la morale utilitaire.
La pauvreté et l'honneur, pas davantage que la richesse et l'honneur ne sont exclusives l'une de l'autre. Tous les états sont honorables, mais il existe une façon d'être, à la fois veule et revendicative qui chasse devant soi l'honneur comme pour faire place nette à l'ignominie. Cette ignominie ne cesse de nous enjoindre, par séductions et menaces, à cesser d'être. Ainsi parle l'Ignominie: « Vous qui êtes français, qui entretenez quelque subtil commerce avec les dieux anciens, avec les métaphysiques d'Aristote ou de Platon, avec la Symbolique romane, avec, Dante, avec Baudelaire, avec Valery Larbaud, cessez d'être ! Conformez-vous, c'est-à-dire renoncez à votre forme, à votre ingénuité et à votre science, à vos façons d'êtres rares ou singulières, à vos fêtes et à vos oisivetés. » L'antienne est captée par toute les antennes et reproduite à l'envi. Vos voisins et vos proches s'évertueront à vous faire entendre qu'il fait bon vivre dans un monde sans honneur.
17:25 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook


