16/11/2025
Luc-Olivier d'Algange et la transparence de la mémoire, par Gabriel Arnou-Laujeac:
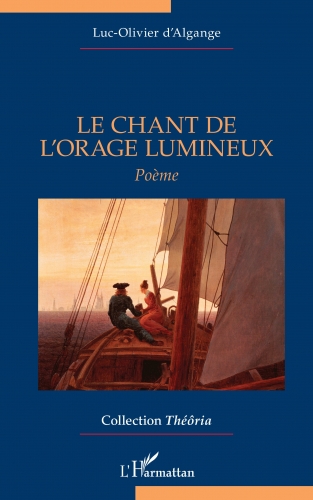
Luc-Olivier d'Algange et la transparence de la mémoire :
note sur Le Chant de l'orage lumineux.
par Gabriel Arnou-Laujeac
______________________________
Le Chant de l'orage lumineux de Luc-Olivier d’Algange déploie une prose visionnaire dont la ferveur éclairée renoue avec la grande tradition des poètes métaphysiques. Le texte se tient à la frontière du haut lyrisme et de l’oracle : une méditation sur la lumière première, l’Aube essentielle, le Principe non comme phénomène mais réalité souveraine qui précède et transfigure le monde.
Ce qui saisit d’abord, c’est la pureté du ton : une clarté grave, où affleure une « haute sa-gesse lumineuse » qui, chez l’auteur, n’est ni concept ni abstraction, mais une présence plus que vive. L’écriture, ample et respirante, rappelle l’essor de Hölderlin ou certaines effusions de Milosz, avec ce même enchantement de l'âme devant l’infini.
Si le poète évoque cités englouties, orages d’été ou « jardins inventés dans la pâleur d’écume », ce n’est jamais pour le décor : la nature y devient cosmologie vivante, espace où l’être se révèle dans sa très pure essence.
Le texte progresse par élévations successives, comme autant d’épiphanies révélant la patrie secrète de toute chose. Le mouvement en est presque orphique : les vers, dans leur union, semblent vouloir rejoindre le chant premier d’où tout découle. Dès les premières pages, la révélation se fait pressante :
« Quelle douce nuit s'inclinait
sur la terre brillante ! Quelle douce Apparence
devant laquelle notre orgueil enfin
pouvait capituler car enfin le ciel immense
traversait notre pauvreté, notre attente
et déchirait ces nuages et ces ombres. Enfin.
Je recueillais en moi cette miséricordieuse lumière,
cette transparence
de la mémoire
que je désirais.»
Luc-Olivier d’Algange excelle dans l’art d’évoquer ce qui se situe au-delà du langage, avec la transparence du plein jour. Le Chant devient alors principe de délivrance contre les aveuglements du siècle, rendant au lecteur l’antique liberté d’habiter le monde dans la splendeur intacte de l’être. Chaque image — ramure ouverte, mer qui respire, nuits éparses, clartés suspendues — devient le lieu d’une réminiscence plus ancienne que la mémoire. La poésie cesse d’être ornement : elle devient vision du réel transfiguré par l’intuition de l’Origine.
Certaines pages touchent au seuil du sacré, comme lors de cette communion — cum-munus, le partage d’un même don, l’accord salvateur du monde avec sa source, où l’horizon et la verticale s’épousent en une noce intérieure unissant le ciel et la terre :
« Les forêts étaient émues à son approche,
– et la terre et les abîmes et les oiseaux.
Dans nos poitrines, nos cœurs battaient plus fort
d’entendre ce langage céleste qui nous délivrait
de la tutelle des Titans. »
S’inscrit alors une méditation profonde sur l’Anamnēsis, entendue comme retour vers un principe antérieur au temps, comme cette « transparence de la mémoire » où beauté et nuit se rejoignent jusqu’à l’extase. Sous la voix du poète, c’est toute l’antique aspiration humaine qui se relève :
« Car dans le secret du cœur nous avions gardé le souci de l’immortalité
et l’espérance de l’éther silencieux.
Et cette espérance
nous ennoblissait dans l’approche des prairies désirées
où veille la jeune raison d’être
de toute chose graciée et souveraine. »
La force du texte tient aussi à son affirmation de la Joie — non pas la petite joie au pâle horizon, mendiée au hasard de plaisirs sans profondeur, mais cette forme supérieure de la réjouissance qui naît d’une réconciliation intime avec le mystère de l’Être, sur lequel toute théorie glisse sans le saisir. Une joie grave, féconde, d’où surgit, par éclairs, la réminiscence de l’éternité — la magnificence retrouvée :
« Et nous retrouvions en elle
toutes les splendeurs perdues de la nuit des temps,
scintillement d’éternité
à la crête des vagues,
regards sombres et brillants
de la jeune amante. »
Par endroits, l’écriture atteint une grandeur quasi liturgique ; mais cette élévation demeure humaine au sens le plus noble, ancrée dans la respiration du poète, dans son colloque avec l’invisible, dans la périlleuse traversée des souffles qu’il chevauche avec ivresse. C’est là que le texte trouve sa vérité.
Puis vient l’instant où l’entière vérité du Chant s’ouvre — saisissement limpide et serein, où l’être se tient dans sa clairvoyance originaire :
« Car nous fûmes saisis,
et transportés
dans une sérénité que d’autres eussent confondue avec la tristesse
tant elle faisait trembler en nous des feuillages inconnus
où passaient,
comme un apaisement paradoxal,
les révélations fraîches de l’air… »
Le poème de Luc-Olivier d’Algange rappelle — avec autorité, sans emphase — que la poésie peut encore être un acte de connaissance, une ascèse lumineuse, un chemin où le Tout Autre se révèle être Soi. Il retrouve la voix intérieure du poète, cette voix qui n’appartient plus à l’homme seul :
« Jamais il ne fut aussi bien lui-même
et avec tant de beauté et d’intensité que dans le cœur
de la seconde salvatrice qui l’arrache à lui-même.
Par sa bouche alors parlent les dieux. »
Enfin, bien que profondément enraciné dans ses terres européennes — orphiques, virgiliennes, méditerranéennes — d’Algange rejoint, par d’autres voies, ce que les poètes, les voyants de l’Inde védique célèbrent dans leurs chants inspirants : la proximité du Réel dans la simple hospitalité de la Présence.
Chez lui, cette Présence affleure dans la pluie qui ruisselle, dans le soir qui respire, dans un vent qui passe comme un héraut invisible ; elle se donne avec cette gravité visionnaire qui rappelle les hymnes à l’Aurore, aux souffles errants, aux couleurs du ciel qui précèdent toute rumeur de séparation.
Ainsi Le Chant de l’orage lumineux, en percevant dans chaque beauté — même la plus fragile — l’ouverture d’un arrière-monde qui allège le voile plutôt qu’il ne l’épaissit, rejoint une intuition qui traverse les continents et les âges même les plus sombres : la Beauté comme voie de connaissance, l’éclair brut comme brèche vers l’Origine, l’instant clair comme une figure de l’infini.
En somme, Le Chant de l'orage lumineux est un texte rare : une invitation à retrouver l’éclat premier du réel, le centre, l’essentiel. Peu d’œuvres contemporaines osent cette hauteur — et encore moins la soutiennent avec une telle aisance.
______________________________
Le Chant de l'orage lumineux,
Luc-Olivier d'Algange,
éditions l'Harmattan, collection Théôria, 2025.
19:54 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook


