26/03/2023
Luc-Olivier d'Algange, Léon Bloy l'Intempestif, suivi d'une traduction en espagnol:

Luc-Olivier d’Algange
Léon Bloy l'Intempestif
« Il est indispensable que la Vérité soit dans la Gloire. »
Léon Bloy
A mesure que les années passent, avec une feinte ressemblance dans leur cours de plus en plus désastreux depuis la première parution du Journal de Léon Bloy, l'écart n'a cessé de se creuser entre ceux qui entendent cette parole furibonde et ceux qui n'y entendent rien. Certes, on ne saurait s'attendre à ce que les rééditions des œuvres de Léon Bloy fussent accueillies comme des événements ou des révélations par un milieu « culturel » qui ne cesse de donner les preuves de sa soumission à l'Opinion, de son aveuglement et de son mépris pour toute forme de pensée originale. Une sourde hostilité est la règle et je lisais encore des jours-ci un folliculaire récriminant contre « le douloureux labyrinthe narcissique » que serait à ses yeux le Journal de Léon Bloy. Certes, labyrinthiques et préoccupés de l'Auteur, tous les journaux le sont par définition, mais au contraire du fastidieux et potinier Journal de Léautaud, devant lequel maints critiques modernes pratiquèrent une ostensible génuflexion, le Journal de Bloy est d'une vivacité électrique. L'humour ravageur, les flambées de colère, les fulgurantes intuitions mystiques, un style d'une densité et d'une musicalité prodigieuse font de ce Journal un chef d'œuvre de la forme brève, aphoristique ou illuminative. Que lui vaut donc cette disgrâce où nous le voyons ? Sans doute la pensée qui s'y affirme et s'y précise sous la forme d'une critique radicale du monde moderne, dans la lignée de Barbey d'Aurevilly et de Villiers de L'Isle-Adam.
« Tout ce qui est moderne est du démon », écrit Léon Bloy, le 7 Août 1910. C'était, il nous semble, bien avant les guerres mondiales, les bombes atomiques et les catastrophes nucléaires, les camps de concentration, les manipulations génétiques et le totalitarisme cybernétique. En 1910, Léon Bloy pouvait passer pour un extravagant; désormais ses aperçus, comme ceux du génial Villiers de L’Isle-Adam des Contes Cruels, sont d'une pertinence troublante. L'écart se creuse, et il se creuse bien, entre ceux qui somnolent à côté de leur temps et ne comprennent rien à ses épreuves et à ses horreurs, et ceux-là qui, à l'exemple de Léon Bloy vivent au cœur de leur temps si exactement qu'ils touchent ce point de non-retour où le temps est compris, jugé et dépassé. Léon Bloy écrit dans l'attente de l'Apocalypse. Tous ces événements, singuliers ou caractéristiques qui adviennent dans une temporalité en apparence profane, Léon Bloy les analyse dans une perspective sacrée. L'histoire visible, que Léon Bloy est loin de méconnaître, n'est pour lui que l'écho d'une histoire invisible. « Tout n'est qu'apparence, tout n'est que symbole, écrit Léon Bloy. Nous sommes des dormants qui crient dans leur sommeil. Nous ne pouvons jamais savoir si telle chose qui nous afflige n'est pas le principe de notre joie ultérieure. »
Cette perspective symbolique est la plus étrangère qui soit à la mentalité moderne. Pour le Moderne, le temps et l'histoire se réduisent à ce qu'ils paraissent être. Pour Bloy, le temps n'est, comme pour Platon et la Théologie médiévale, que « l'image mobile de l'éternité » et l'histoire délivre un message qu'il appartient à l'écrivain-prophète de déchiffrer et de divulguer à ses semblables. Pour Léon Bloy, le Journal, loin de se borner à la description psychologique de son auteur a pour dessein de consigner les « signes » et les « intersignes » de l'histoire visible et invisible afin de favoriser le retour du temps dans la structure souveraine de l'éternité.
Pour Léon Bloy, qui se définit lui-même comme « un esprit intuitif et d'aperception lointaine, par conséquent toujours aspiré en deçà ou au-delà du temps », la fonction de l'auteur écrivant son journal n'est pas de se soumettre à l'aléa de la temporalité, du passager ou du fugitif, mais tout au contraire « d'envelopper d'un regard unique la multitude infinie des gestes concomitants de la Providence ». Le Journal, - tout en marquant le pas, en laissant retentir en soi, et dans l'âme du lecteur ami, la souffrance ou la joie, plus rare, de chaque jour, les « nouveautés » menues ou grandioses du monde, ne s'inscrit pas moins dans une rébellion contre le fragmentaire, le relatif ou l'éphémère. Ce Journal, et c'est en quoi il décontenance un lecteur moderne, n'a d'autre dessein que de déchiffrer la grammaire de Dieu.
Là où le Moderne ne distingue que des vocables sans suite, de purs signes arbitraires, Léon Bloy devine une cohérence éblouissante, et, par certains égards, vertigineuse et terrifiante. Léon Bloy n'est pas de ces dévots qui trouvent dans la foi et dans l'Eglise de quoi se rassurer. Ces dévots modernes, bourgeois au sens flaubertien, Léon Bloy les fustige ainsi que la « société sans grandeur ni force » dont ils sont les défenseurs. Il est fort improbable, quoiqu'en disent les journaleux peu informés qui voient en Bloy un « intégriste », que l'auteur du Désespéré et de La Femme Pauvre se fût retrouvé du côté de nos actuels, trop actuels « défenseurs des valeurs », moralisateurs sans envergure ni générosité,- et par voie de conséquence, sans le moindre sens de la rébellion. Or s'il est un mot qui qualifie avec précision la tournure d'esprit de cet homme de Tradition, c'est rebelle !
Pour Léon Bloy, quel que soit par moment son harassement, le combat n'est pas fini, il y retourne, chaque jour est le moment décisif d'une guerre sainte. Léon Bloy est un moine-soldat qui va son chemin d'écrivain, non sans donner ici et là quelques coups de massue, pour reprendre la formule évolienne. Ainsi le sport, objet, depuis peu, d'un nouveau culte national est-il, pour Léon Bloy « le moyen le plus sûr de produire une génération d'infirmes et de crétins malfaisants ». Quant à la Démocratie, bien vantée, elle lui suggère cette réflexion : « Un des inconvénients les moins observés du suffrage universel, c'est de contraindre des citoyens en putréfaction à sortir de leurs sépulcres pour élire ou pour être élus. » Cette outrance verbale dissimule souvent une intuition. Tout, dans ce monde planifié, ne conjure-t-il pas à faire de nous une race de morts-vivants, réduits à la survie, dans une radicale dépossession spirituelle. Que sont les Modernes devant leurs écrans ? Quel songe de mort les hante ? Les rêveries du Moderne ne sont-elles pas avant tout macabres ? Non, la religion de Léon Bloy n'est pas faite pour les « tièdes ». C'est une religion pour ceux qui ressentent les grandes froidures et qui attendent l'embrasement des âmes et des esprits. Le modèle littéraire de Léon Bloy ce sont les langues de feu de la Pentecôte.
Léon Bloy s'est nommé lui-même « Le Pèlerin de l'Absolu ». Chaque jour qui advient, et que l'auteur traverse comme une nouvelle épreuve où se forge son courage et son style, le rapproche du moment crucial où apparaîtront dans une lumière parfaite la concordance de l'histoire visible et de l'histoire invisible. Cette quête que Léon Bloy partage avec Joseph de Maistre et Balzac le conduit à une vision du monde littéralement liturgique. L'histoire de l'univers, comme celle de l'auteur esseulé dans son malheur et dans son combat, est « un immense Texte liturgique. » Les Symboles, ces « hiéroglyphes divins », corroborent la réalité où ils s'inscrivent, de même que les actes humains sont « la syntaxe infinie d'un livre insoupçonné et plein de mystères. »
Cette vision symbolique et théologique du monde en tant que Mystère limpide, c'est à dire offert à l'illumination (« l'illumination, lieu d'embarquement de tout enseignement théologique et mystique ») est à la fois la cause majeure de l'éloignement de l'œuvre de Léon Bloy et le principe de sa proximité extrême. Pour le moderne, la « folie » de Léon Bloy n'est pas dans sa véhémence, ni dans son lyrisme polémique, mais bien dans cette vision métaphysique et surnaturelle des destinées humaines et universelles. Pour Léon Bloy, qui n'est point hégélien, et qui va jusqu'à taquiner Villiers pour son hégélianisme « magique », les contraires s'embrassent et s'étreignent avec fougue. La nature porte la marque de la Surnature, mais par un vide qui serait l'empreinte du Sceau. De même, l'extrême pauvreté engendre le style le plus fastueux. C'est précisément car l'écrivain est pauvre que son style doit témoigner de la plus exubérante richesse. La pauvreté matérielle est ce vide qui laisse sa place à la dispendieuse nature poétique. Car la pauvreté, pour Bloy, n'est pas le fait du hasard, elle est la preuve d'une élection, elle est le signe visible d'un privilège invisible qu'il appartient à l'Auteur de célébrer somptueusement. La richesse verbale de Léon Bloy est toute entière un hommage à la pauvreté, à sa profondeur lumineuse, à la grâce qu'elle fait à la générosité de se manifester. Celui qui donne se sauve. Le mendiant peut donc, à bon droit être « ingrat ». Son ingratitude rédime celui qui pourrait s'en offenser. Mais qu'est-ce qu'un pauvre, dans la perspective métaphysique ? C'est avant tout celui qui récuse par avance toute vénalité. Or qu'est-ce que le monde moderne si ce n'est un monde qui fait de la vénalité même un principe moral, une cause efficiente du Bien et « des biens » ? Pour le Moderne, celui qui parvient à se vendre prouve son utilité dans la société et donc sa valeur morale. Celui qui ne parvient pas, ou, pire, qui ne veut pas se vendre est immoral.
Contre ce sinistre état de fait, qui pervertit l'esprit humain, l'œuvre de Léon Bloy dresse un grandiose et intarissable réquisitoire. Or, c'est bien ce réquisitoire que les Modernes ne veulent pas entendre et qu'ils cherchent à minimiser en le réduisant à la « singularité » de l'auteur. Certes Léon Bloy est singulier, mais c'est d'abord parce qu'il se veut religieusement « un Unique pour un Unique ». La situation dans laquelle il se trouve enchaîné n'en est pas moins réelle et la description qu'il en donne particulièrement pertinente en ces temps où face à la marchandise mondiale le Pauvre est devenu encore beaucoup plus radicalement pauvre qu'il ne l'était au dix-neuvième siècle. La morale désormais se confond avec le Marché, et l'on pourrait presque dire que, pour le Moderne libéral, la notion d'immoralité et celle de non-rentabilité ne font plus qu'une. Refuser ce règne de l'économie, c'est à coup sûr être ou devenir pauvre et accueillir en soi les gloires du Saint-Esprit, dont la nature dispensatrice, effusive et lumineuse ne connaît point de limite.
Contre le monde moderne, Léon Bloy ne convoque point des utopies sociales, ni même un retour au « religieux » ou à quelque manifestation « révolutionnaire » ou « contre-révolutionnaire » de la puissance temporelle. Contre ce monde, « qui est du démon », Léon Bloy évoque le Saint-Esprit, au point que certains critiques ont cru voir en lui un de ces mystiques du « troisième Règne », qui prophétisent après le règne du Père, et le règne du Fils, la venue d'un règne du Saint-Esprit coïncidant avec un retour de l'Age d'Or. Lorsqu'un véritable écrivain s'empare d'une vision dont la justesse foudroie, peu importent les terminologies. Sa vision le précède, elle n'en précède que mieux les interprétations historiographiques. « Aussi longtemps que le Surnaturel n'apparaîtra pas manifestement, incontestablement, délicieusement, il n'y aura rien de fait. »
Léon Bloy, el Extemporáneo
“Es indispensable que la Verdad esté en la Gloria.” Léon Bloy.
“Todo lo moderno pertenece al demonio”, escribe Léon Bloy el 7 de agosto de 1910. Fue, según nos parece, mucho antes de las guerras mundiales, las bombas atómicas y las catástrofes nucleares, los campos de concentración, las manipulaciones genéticas y el totalitarismo cibernético. En 1910, a Léon Bloy se lo podía tomar por un extravagante; hoy en día sus vislumbres, como los del genial Villiers de L’Isle-Adam de los Cuentos crueles, son de una pertinencia turbadora. Aumenta, y cada vez más, la distancia entre los que dormitan al margen de su época y no comprenden nada de las pruebas y los horrores a los que nos somete, y los que, a ejemplo de Léon Bloy, viven tan precisamente en el centro mismo de su época que alcanzan ese punto de no retorno en el que se la comprende, se la juzga y se la supera. Léon Bloy escribe a la espera del Apocalipsis. Todos esos acontecimientos, singulares o característicos, que se producen en una temporalidad aparentemente profana, Léon Bloy los analiza en una perspectiva sagrada. La historia visible, que Léon Bloy está lejos de desconocer, sólo es para él el eco de una historia invisible.
“Todo es pura apariencia, todo es puro símbolo”, escribe Léon Bloy. “Somos durmientes que gritan durante el sueño. Nunca podemos sabes si algo que nos aflige no es el principio de nuestra dicha ulterior.”
Esta perspectiva simbólica es la más ajena posible a la mentalidad moderna. Para el Moderno, el tiempo y la historia se reducen a lo que parecen ser. Para Bloy, el tiempo sólo es, como para Platón y la teología medieval, “la imagen móvil de la eternidad”, y la historia comunica un mensaje que al escritor-profeta le toca descifrar y divulgar entre sus semejantes. Para Léon Bloy, el Diario, lejos de limitarse a la descripción psicológica de su autor, tiene por objetivo el de dejar registrados los “signos” y los “intersignos” de la historia visible e invisible, a fin de favorecer el retorno del tiempo en la estructura soberana de la eternidad.
Para Léon Bloy, que se define a sí mismo como “un espíritu intuitivo y de apercepción lejana, y, por consiguiente, siempre arrastrado más acá o más allá del tiempo”, la función del autor al escribir su diario no es la de someterse a la temporalidad fugitiva sino, muy por el contrario, la de “abarcar con una mirada única la multitud infinita de los gestos concomitantes de la Providencia”. El Diario —al mismo tiempo que marca el paso, dejando resonar en sí mismo, y en el alma del lector amigo, el sufrimiento o la dicha, menos frecuente, de cada día, las “novedades” modestas o grandiosas del mundo— no deja de inscribirse en una rebelión contra lo fragmentario, lo relativo o lo efímero. Este Diario, que en esto desconcierta a un lector moderno, no tiene otra finalidad que la de descifrar la gramática de Dios.
Allí donde el Moderno sólo distingue vocablos inconexos, puros signos arbitrarios, Léon Bloy intuye una coherencia deslumbrante y, en ciertos aspectos, vertiginosa y aterradora. Léon Bloy no es uno de esos devotos que encuentran en la fe y en la iglesia con qué tranquilizarse. A esos devotos modernos, burgueses en el sentido de Flaubert, Léon Bloy los fustiga al igual que a la “sociedad sin grandeza ni fuerza” que defienden. Es altamente improbable, digan lo que digan los periodistuchos poco informados que ven en Bloy a un “integrista”, que el autor de El desesperado y de La mujer pobre hubiese estado en el mismo campo de nuestros actuales, demasiado actuales “defensores de los valores”, moralizadores sin envergadura ni generosidad —y, por consiguiente, sin el menor sentido de la rebelión. Ahora bien, si hay una palabra que define con precisión la mentalidad de este hombre de Tradición, esta palabra es “rebelde”.
Para Léon Bloy, por más extenuado que esté por momentos, el combate no ha terminado, vuelve a él, cada día es el momento decisivo de una guerra santa. Léon Bloy es un monje soldado que sigue su camino de escritor, no sin dar acá y allá algunos mazazos, para emplear la expresión de Julius Evola. Así es como el deporte, objeto, desde hace poco, de un nuevo culto nacional, es para Léon Bloy “el medio más seguro de producir una generación de inválidos y de cretinos dañinos”. En cuanto a la Democracia, tan ensalzada, le sugiere esta reflexión: “Uno de los inconvenientes menos observados del sufragio universal es el hecho de obligar a ciudadanos en estado de putrefacción a salir de su sepulcros para elegir o ser elegidos”. Esta desmesura verbal a menudo disimula una intuición. ¿Acaso no conspira todo, en este mundo planificado, para hacer de nosotros una raza de muertos vivos, reducidos a sobrevivir en una radical desposesión espiritual? ¿Qué son los Modernos delante de sus pantallas? ¿Qué sueño de muerte los posee? ¿Las Ensoñaciones del Moderno no son, ante todo, macabras? No, la religión de Léon Bloy no está hecha para los “tibios”. Es una religión para quienes sienten los grandes fríos y esperan el incendio de las almas y los espíritus. El modelo literario de Léon Bloy son las lenguas de fuego de Pentecostés.
Léon Bloy se llamó a sí mismo “El Peregrino del Absoluto”. Cada día que llega, y que el autor atraviesa como una nueva prueba en que se templan su coraje y su estilo, lo acerca al momento crucial en que aparecerán con perfecta claridad la concordancia entre la historia visible y la historia invisible. Esta búsqueda, que Léon Bloy comparte con Joseph de Maistre y Balzac, lo conduce a una visión del mundo literalmente litúrgica. La historia del universo, tanto como la del autor aislado en su desdicha y en su combate, es “un inmenso Texto litúrgico”. Los Símbolos, esos “jeroglíficos divinos”, corroboran la realidad en que se inscriben, así como los actos humanos son “la sintaxis infinita de un libro insospechado y lleno de misterios”.
Esta visión simbólica y teológica del mundo como Misterio límpido, es decir, alcanzable por la iluminación (“la iluminación, punto de embarque de toda enseñanza teológica y mística”), es, al mismo tiempo, la causa principal de lo alejado de la obra de Léon Bloy y el principio de su cercanía extrema. Para el moderno, la “locura” de Léon Bloy no reside en su vehemencia ni en su lirismo polémico, sino precisamente en esta visión metafísica y sobrenatural de los destinos humanos y universales. Para Léon Bloy, que no es en absoluto hegeliano, y que hasta llega a burlarse de Villiers de l’Isle-Adam por su hegelianismo “mágico”, los contrarios se abrazan y se estrechan con ardor. La naturaleza tiene la impronta de la Sobrenaturaleza, pero por medio de un vacío que fuese la marca del Sello. De igual modo, la extrema pobreza engendra el estilo más fastuoso. Es precisamente porque el escritor es pobre por lo que su estilo debe dar testimonio de la riqueza más exuberante. La pobreza material es el vacío que le cede el lugar a la dispendiosa naturaleza poética. Ya que la pobreza, para Bloy, no es el resultado del azar: es la prueba de una elección, es el signo visible de un privilegio invisible que le incumbe al Autor celebrar suntuosamente.
La riqueza verbal de Léon Bloy es toda ella un homenaje a la pobreza, a su profundidad luminosa, al favor que le hace a la generosidad permitiéndole manifestarse. El que da, se salva. El mendigo puede entonces, con toda razón, ser “ingrato”. Su ingratitud redime al que podría tomarla como una ofensa. Pero ¿qué es un pobre, en la perspectiva metafísica? Es, ante todo, aquél que rechaza de antemano toda venalidad. Ahora bien, ¿qué es el mundo moderno sino un mundo que hace de la venalidad misma un principio moral, una causa eficiente del Bien y de “los bienes”? Para el Moderno, el que logra venderse prueba su utilidad en la sociedad y, por lo tanto, su valor moral. El que no logra o, peor aún, no quiere venderse, es inmoral.
Contra esta siniestra situación de hecho, que pervierte el espíritu humano, la obra de Léon Bloy lanza una grandiosa e inagotable acusación. Ahora bien, es precisamente esta acusación lo que los Modernos no quieren oír y tratan de minimizar, reduciéndola a la “singularidad” del autor. Por cierto, Léon Bloy es singular, pero esto es, en primer término, porque elige ser, religiosamente, “un Único para un Único”. La situación en que se encuentra encadenado no es por esto menos real, y la descripción que da de ella es particularmente pertinente en estos tiempos en que, ante la mercancía mundial, el Pobre se ha vuelto aún mucho más radicalmente pobre de lo que lo era en el siglo XIX. La moral, ahora, se confunde con el Mercado, y casi podríamos decir que, para el Moderno liberal, la noción de inmoralidad y la de no rentabilidad no son más que una y la misma. Rechazar este reino de la economía es, con toda seguridad, ser o volverse pobre, y acoger en uno mismo las glorias del Espíritu Santo, cuya naturaleza dispensadora, efusiva y luminosa no conoce límite alguno.
Contra el mundo moderno, Léon Bloy no llama a ninguna utopía social, ni siquiera a un regreso a lo “religioso” o a alguna manifestación “revolucionaria” o “contrarrevolucionaria” del poder temporal. Contra este mundo, “que pertenece al demonio”, Léon Bloy invoca al Espíritu Santo, hasta el punto de que algunos críticos han creído ver en él a uno de esos místicos del “Tercer Reino” que profetizan, para después del Reino del Padre y del Reino del Hijo, el advenimiento de un reino del Espíritu Santo que coincidirá con un retorno a la Edad de Oro. Cuando un auténtico escritor se apodera de una visión de exactitud fulminante, poco importan las terminologías. Su visión le precede y, por lo mismo, mejor aún precede a las interpretaciones historiográficas. “Mientras lo Sobrenatural no se muestre de modo manifiesto, indiscutible, delicioso, nada estará hecho.”
Traducción de Carlos Cámara y Miguel Ángel Frontán.
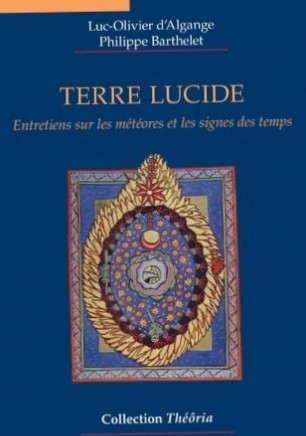
19:49 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
19/03/2023
Luc-Olivier d'Algange, Maurice Magre, fidèle de Mélusine:

Luc-Olivier d'Algange
Maurice Magre, fidèle de Mélusine
« Je percevais dans l’air des forces en suspens »
Maurice MAGRE
De Maurice Magre, on serait tenté de dire, les oxymores seuls pouvant définir les êtres entiers, qu’il fut un hédoniste spiritualiste (ou un spiritualiste hédoniste), espèce qui fut moins rare jadis que naguère et qui devient, par les temps qui courent, rarissime. De nos jours, les spiritualistes sont, en général, d’austères pions et les hédonistes, des gorilles. Il demeure cependant dans nos civilisations, et ailleurs, de merveilleux dispositifs, tels que la philosophie plotinienne ou le premier Romantisme allemand, celui de Schlegel ou de Novalis, conjuguant le frémissement sensible et l’ardeur de la connaissance, le bouleversement à fleur de peau et l’audace à franchir « les portes de corne et d’ivoire qui nous séparent du monde invisible » (Nerval)
Avant de désirer la vie éternelle, à laquelle Maurice Magre croyait en toute liberté, c’est-à-dire en dehors de tous les dogmes, encore faut-il, selon la formule de Pindare, traduite par Valéry, « épuiser le champ du possible ». Cette vie si passagère, si troublée, si incertaine que nous traversons est un appel à la plénitude, une convocation, ainsi que l’écrivait Montaigne, à « jouir loyalement de son être ». Or, nos temps sont à la restriction ; ils ne supportent plus ces alliances subtiles, ces noces philosophales entre le souffre et le mercure, la volupté et la sagesse, entre ce qui flambe dans les hauteurs et disparaît et ce qui roule et se divise dans le miroitement de l’immanence.
Le puritanisme s’est substitué aux ascèses et la pornographie aux jeux de l’Eros : triomphe de la marchandise sur la gratuité heureuse qui n’est autre que la part divine dans un monde humain, trop humain. Maurice Magre célèbre ainsi d’un même mouvement l’ascèse et le plaisir, la quête d’une transcendance, d’un Idéal, et le consentement à la beauté féminine, la recherche de la grandeur et l’amour des humbles. Son sens du grand art, subtil et savant, ne lui interdit pas de faire sienne la juste revendication des pauvres. Ses premières œuvres, comme la Prière au Soleil appartiennent à la tradition du socialisme français, d’inspiration libertaire, unanimiste et païenne :
« Un esprit Fraternel frémissait dans chaque herbe ;
Les Vieux arbres avaient des voix d’êtres aimés ;
Et nous sentions le soir assis parmi les gerbes
La poussière des morts mêlée au sol sacré. »
Proche, à cet égard, de Péguy, Maurice Magre sut dire, au-delà de l’éminente dignité des pauvre, « l’éminente pauvreté des dignes », dont il fut l’un des premiers : « J’ai voulu écrire la chanson des hommes d’aujourd’hui, de ceux que font souffrir l’affaissement des énergies, la pauvreté du cœur, toutes les misères morales et matérielles. » Loin de l’orienter vers un rigorisme aux inclinations totalitaires, cette révolte anti-bourgeoise le conduisit jusqu’aux frontières mêmes de l’invisible, qui n’est point l’abstraction, mais la puissance d’une âme libre, l’au-delà de l’orée qui enchante toutes les apparences du monde :
« Le monde est un secret que soudain je comprends :
Notre corps est léger et notre esprit fidèle »
Ce prosateur qui connaît l’art des longues périodes et de la « rhétorique profonde » fut particulièrement sensible à l’éclat de la soudaineté, qu’elle soit dans l’emportement de la compassion, dans la conversion ou la rencontre des regards. Les « choses vues » lui sont des Symboles, les Cités qu’il habite ou parcourt lui deviennent peu à peu emblématiques, tels le Londres de Thomas de Quincey, dont il partagea le goût de l’Opium, ou l’Ispahan des poètes persans dont les « jardins d’émeraude », suspendus entre le sensible et l’intelligible, sont familiers à ses voyages intérieurs. Ses spéculations et ses rêveries se lovent également dans les lieux de gloire ou de misère. Ses amantes sont haussées au rang de déesses ; ses rares amis lui apparaissent comme des héros ou des saints. De ses ennemis, il ne garde que le souvenir de l’inaccomplissement. Maurice Magre est de ces auteurs sur lesquels la médiocrité n’a aucune prise, quand bien même il s’en accuse, et par cela même. Loin de se croire parfait, ce qui est précisément le propre de la médiocrité forte de son nombre, Maurice Magre mesure, avec autant de précision que possible, l’écart entre son vœu et sa réalisation ; et cet écart n’est autre que l’espace même de son œuvre. Ses regrets ne sont pas moralisateurs : ils sont le secret de la musique des mots, non point contrition mais persistance amoureuse, consentement au « beau secret ».
Ses Confessions sur les femmes, l’amour, l’opium, l’idéal, disent cette soudaineté du secret, cette pointe exquise où le plaisir et la sapience se ressemblent, cette légèreté du corps (car, pour Maurice Magre, c’est bien le corps qui est dans l’âme et non l’âme qui est dans le corps), cette fidélité de l’esprit à l’émotion de ses premières épreuves et de ses premiers émerveillements. Rien ne lui est plus étranger que le reniement ou cette versatilité du consommateur, qui se croit libre pour brûler le lendemain ce que la veille il adora. Ses Confessions s’achèvent sur des « Remerciements à la destinée », d’une hauteur goethéenne, et qui ne sont point sans évoquer, aussi, l’émouvant « Bonsoir aux choses d’ici-bas » qui furent les derniers mots de Valery Larbaud : « Je remercie la loi qui préside à la destinée. Elle a placé mon enfance dans une maison de banlieue toulousaine, dans un jardin où il y avait un pin, un buis et une île de noisetiers… »
Par le don de la gratitude, devenu si rare, toute beauté devient frissonnante. Ni l’habileté technique « qui se manifeste par la glorification du laid », ni les cités industrielles « qui remplacent les antiques cités de pierre qui abritaient jadis des bonheurs paisibles et lents, où les hommes avaient la possibilité de pratiquer la rêverie et l’étude » ne donnent, ou plutôt, ne restituent, à la beauté du monde ce que nous lui devons. Le monde moderne apparaît à Maurice Magre comme « ces pyramides dressées par les esprits du mal ». Or, rien ne nous interdit, sinon quelque mauvais sort jeté à grands renforts de puissance et d’argent, de saisir la seconde heureuse, de retrouver le resplendissement de ce qui est :
« Un frisson de beauté circule une seconde.
Je sens qu’un beau secret dans l’atmosphère passe.
Un bal mystérieux s’éveille dans les choses. »
L’œuvre de Maurice Magre se propose ainsi comme un viatique contre la tristesse et le nihilisme qui nous privent à la fois de la vérité sensible et de la beauté intelligible. Cet hérésiarque de belle envergure, qui trouve son bien chez les gnostiques albigeois, non moins que dans le néoplatonisme des ultimes résistances païennes (qui lui inspira l’admirable roman intitulé Priscilla d’Alexandrie) n’a d’autre ambition que de nous nous enseigner une liberté dont l’apogée serait la fidélité même. Fidélité aux premières rencontres, aux premiers amours, aux premières lectures et aux premières ivresses ; fidélité aux moments d’intensité et de grâce. Priscilla d’Alexandrie, publiée en 1925, qui se situe dans l’Egypte tourmentée entre le christianisme et la paganisme, du quatrième siècle, nous invite, et c’est un genre d’invitation qui ne se refuse pas, à fréquenter les philosophes d’Alexandrie, tel Olympios, ermite néoplatonicien, ou Aurélius qui accomplira un pèlerinage « à l’ombre de l’arbre bodhi ». Priscilla qui sera la réincarnation d’Hypathie, après avoir participé à sa lapidation, médite, en compagnie de ses amis philosophes sur l’accord possible entre la volupté et la sagesse, entre l’assentiment au monde sensible et l’aspiration au monde invisible. Le sceau et l’empreinte, ce qui symbolise et ce qui est symbolisé ne sont-ils pas une seule et même réalité ? « Toute la nature avec ses soleils et ses nuits douces ne serait alors qu’un vaste piège pour empêcher l’homme, par le réseau des désirs, de parvenir à la plus haute spiritualité. Ce n’est pas possible. Il doit y avoir une conciliation entre la splendeur de la matière et le règne de l’esprit. Il doit existe une sagesse qui aime, une vérité qui a du sang ».
On songe à cet autre livre, de Mario Meunier, qui fut un éminent traducteur de Platon et de Sophocle, Pour s’asseoir au Foyer de la Maison des Dieux : « Etre volupteux : c’est entendre en son sang bouillonner tous les vins ; c’est aimer le besoin de multiplier ses amours, ses sympathies et ses admirations ; c’est participer à l’infini de l’Etre, collaborer à son éternité et aimer la vie jusqu’au désir de souffrir pour mieux vivre, et de mourir pour changer et revivre. » Pas davantage que le sensible ne s’oppose à l’intelligible, le multiple ne s’oppose à l’Un, ni le provincial à l’universel : « Ne te scandalise donc pas de la multiplicité des dieux. Si les morcellements de la divinité ne nous apprennent rien sur la vérité de son être insondable, ils affirment néanmoins, en tous temps et partout, sa souveraine présence (…) Une des plus nobles activités de l’esprit est de surprendre, en chacun des dieux des nations, la parcelle d’infini qu’il contient. En cette interminable théorie de déités, ma pensée reconnaît et adore les rayons divers d’un soleil identique. »
Libertaire, par goût de la légèreté, hostile aux pomposités et au puritanisme bourgeois, dont il se moque sans amertume mais avec une sereine ironie, Maurice Magre demeure avant tout fidèle à l’esprit des lieux. L’esprit des lieux, comme toutes les choses difficiles à définir et qui échappent aux ensembles abstraits (dont certains voudraient nous voir dépendre exclusivement) exerce sur nous une influence profonde. Simone Weil évoquait la persistance d’une science romane, d’une gnose occitanienne, Raymond Abellio, Joë Bousquet vinrent à la rencontre du reste du monde à partir de Toulouse, cette Thulée cathare. Il en fut de même pour Maurice Magre. Ne méprisons point le sens de l’universel, mais sachons qu’il n’est jamais que la fine pointe d’une réalité provinciale, d’un cheminement à partir d’un lieu, d’une méditation sur une configuration historique et sensible, d’une tradition dont on ne saurait s’exclure à moins de saccager en nous le Logos lui-même.
Nous existons à parti d’un lieu, et qu’importent nos pérégrinations ou nos errances, une fidélité demeure inscrite dans notre langage même, dans le ressouvenir de nos rencontres, dans la lumière. L’esprit des lieux est un composé de culture et de nature ; le cosmos et l’histoire y ourdissent ces admirables conjurations où nous trouvons nos raisons d’être. L’auteur du Sang de Toulouse et du Trésor de Albigeois donne le sens de son cheminement par l’incipit, cher au cœur des toulousains évoquant le second âge d’or de la cité palladienne : « Par les quatre merveilles de Toulouse, par la beauté de ses clochers et la jeunesse de ses jardins ; par Clémence Isaure, la virginale et la protectrice, par Pierre Goudoulin aux beaux chants, par l’hôtel d’Assezat aux belles sculptures… ».
Ainsi débute la quête du Graal pyrénéen, par cette voix qui s’adresse une nuit de septembre à son héros Michel de Bramevaque : « Lève-toi ! Marche dans le pays toulousain, Retrouve le Graal qui est caché et les hommes seront sauvés ! » La quête du héros sera de retrouver les descendants des quatre chevaliers « portant sous leur manteau l’héritage de Joseph d’Arimathie, l’émeraude en forme de lys ». Ne divulguons pas davantage de ce roman, sinon qu’il y figure une « Nuit des loups » qui est l’un des hauts moments de la littérature fantastique. Evoquons encore, parmi les innombrables romans de Maurice Magre, Jean de Fodoas, qui fut réédité sous le titre La Rose et l’Epée où, ainsi que l’écrit Robert Aribaut, dans son ouvrage sur Maurice Magre, « la fleur royale n’est plus offerte au héros par quatre cavaliers noirs mais par Inès de Saldanna, sœur du vice-roi de Goa ! ». C’est bien la profonde méditation sur le « sang de Toulouse », qui circule d’un mouvement invisible dans l’architecture de la Cité ; c’est bien l’accord du promeneur avec les rues de sa ville, où les temps se superposent et transparaissent les uns dans les autres, qui donne sa vertu poétique à sa conquête du monde, à son amour baudelairien des cartes et des estampes, à sa nature prodigue et accueillante aux merveilles de l’étrange et du lointain.
Dans cette œuvre immense, d’une imagination vive, colorée et voyageuse, où l’art d’écrire n’est ni trop ostensible ni trop caché, où la beauté consent à se manifester, mais comme sous une injonction supérieure dont l’auteur ne serait que l’intercesseur, les romans d’aventures, tels Les Aventuriers de l’Amérique du Sud ou Les Frères de l’or vierge, les récits de voyage aux Indes, alternent avec les romans poétiques ou initiatiques tels Mélusine, où, sous l’égide des Lusignan, et de la reine Chypre, qui hantent aussi un célèbre poème de Gérard de Nerval, Maurice Magre annonce, en le précédant de quelques années, l’Arcane 17 d’André Breton : « Avec quel incommensurable amour étaient attentifs les êtres vivants de la terre et de l’air. Il flottait une pureté que je n’avais jamais ressentie. Elle était dans le dessin des nervures des feuilles, la cristallisation des gouttes de rosée, la fluidité de l’air pénétré par la prescience du soleil levant… ». C’est vers cette « fille de l’air et des songe » que va l’ultime passion de Maurice Magre. « Mélusine, notera Michel Carrouges, est en relation intime avec les forces de la nature et par conséquent avec l’inconscient ; mais elle a des ailes et par là elle est aussi en communication avec les mondes supérieurs, ceux d’où elle s’envole selon la légende ». Symbole de ce spiritualisme hédoniste, que nous évoquions plus haut, de ce supra-sensible concret qui appartient au monde imaginal, la Mélusine de Maurice Magre est la divulgatrice de l’enchantement des apparences, l’amie de ces « créatures messagères » que sont les grillons et les rossignols, elle qui fait de notre âme, non plus cet espace insolite, restreint, carcéral mais une nuit de Pentecôte peuplée de lucioles, de signes d’or, messagers d’une «connaissance cosmologique », à l’instar de ces « paroles profondes » qui étendent le royaume du secret et transfigurent le monde. A l’orée de sa mort, dans ses derniers écrits, Maurice Magre ne demandera plus au monde que d’être lui-même, mais en beauté : « Des milliers de petites gouttes de rosée, invisibles jusqu’alors, devenaient brillantes, s’allumaient comme les lampes d’une féerie minuscule, mais répandue à l’infini. Sortant du bain mystérieux de la nuit, le jardin émergeait, rajeuni et purifié. La lumière cependant continuait à naître d’elle-même. »
21:52 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook
11/03/2023
Luc-Olivier d'Algange, Notes sur l'oeuvre de Juilen Gracq:

Luc-Olivier d’Algange
L'Envers de la vague
Notes sur l'œuvre de Julien Gracq
« Couchés au raz de l'eau, ils voyaient accourir de l'horizon le poids régulier des vagues, et dans un capiteux vertige il leur semblait que tombât tout entier sur leurs épaules et dût les écraser - avant de faire au-dessous d'eux un flux de silence et de douceur qui les élevait paresseusement sur un dos liquide , avec une sensation exquise de légèreté »
Julien Gracq, Au Château d'Argol
La solennité quelque peu funéraire des récits de Julien Gracq s'ouvre, pour certains d'entre nous, sur un printemps sacré.
Si la phrase de Gracq porte son charroi de métaphores crépusculaires et automnales; si la note lancinante d'une sorte de désespoir universel, comme la froidure d'une goutte de poison, ne cesse, au milieu du faste même, de faire entendre son consentement à la déréliction; si le désengagement, l'exil, le retrait, voire, pour user d'un mot naguère quelque peu galvaudé, le « pessimisme » semblent donner le ton à l'attente et au tragique qui blasonnent son œuvre, - ces majestueuses mises au tombeau d'un monde n'en demeurent pas moins traversées de pressentiments et ne rendent jamais leurs dernières armes au nihilisme ou au désenchantement.
Ce sont d'abord les paysages et leurs saisons, le palimpseste du merveilleux géographique, la puissance soulevante, de la nature elle-même qui nous apparaissent comme d'impérieuses requêtes, comme des portes battantes. Ce monde déserté de toute activité humaine, figé dans une arrière-saison éternisée, cet abandon, loin d'éteindre la beauté du monde en révèle les puissances jusqu'alors dédaignées. Ce qui meurt dans les romans de Julien Gracq, ce qui s'éteint, ce qui s'étiole n'est jamais que l'industrie humaine. Les personnages se trouvent jetés dans l'immensité d'une oisiveté, d'une attente qui seuls, en dignité, sont destinés à survivre à la vanité des commerces humains. La chapelle des abîmes d'Au Château d'Argol, les « journées glissantes, fuyantes de l'arrière-saison » d’Un Beau Ténébreux, définissent d'emblée le domaine que l'œuvre ne cessera de parcourir, un domaine où le Temps hiératique règne sans disputes sur les temporalités subalternes, où la société ne survit plus que par d'anciens apparats, où toute appartenance ne vaut et ne brille que de son obsolescence dans un monde d'après la fin.
Du Surréalisme, Julien Gracq ne retiendra ni l'automatisme, ni l'idéologie révolutionnaire, mais peut-être une subversion plus radicale: le refus catégorique et fondateur d'une humanité réduite aux seules raisons du travail et de la consommation. Si loin qu'il soit des enseignements de l'humanisme classique ou des Lumières, ce refus n'en fonde pas moins une façon d'être humain, un humanisme par-delà l'humanisme, relié aux puissances ouraniennes et telluriques, aux éclatantes preuves de l'être. La « liberté grande » sera d'abord, pour Julien Gracq la liberté d'être, le rayonnement de l'être dans la contemplation. Aussi délaissées que soient les grèves, elles s'ouvrent sur un « Grand Oui » et demeurent étrangères au nihilisme et à la « littérature du non », autrement dit à la littérature du travail, du soupçon et du ressentiment. La subversion, pour Julien Gracq, est affirmative; elle est une approbation à la beauté des choses laissées à elles-mêmes, comme engourdies, abandonnées, mais qui s'offrent, dans ce délaissement, à une vérité plus profonde: « J'ai vécu de peu de choses comme de ces quelques ruelles vides et béantes en plein midi qui s'ensauvageaient sans bruit dans un parfum de sève et de bête libre, leurs maison évacuées comme un raz de marée sous l'écume des feuilles. »
Le refus de Julien Gracq, où scintillent les dernières armes jamais rendues avant la mort, est bien le contraire du « non »: « Ce qui me plaît chez Breton, écrit Julien Gracq, ce qui me plaît dans un autre ordre chez René Char, c'est ce ton resté majeur d'une poésie qui se dispense d'abord de toute excuse, qui n'a pas à se justifier d'être, étant précisément et tout d'abord ce par quoi toutes choses sont justifiées. » Seules méritent que l'on s'y attarde les œuvres qui ne s'excusent pas d'être, qui consentent à la précellence du mouvement dont elles naissent, qui témoignent de cette « participation » de l'homme au monde par l'intermédiaire du Logos, soleil secret de toutes choses manifestées, « sentiment perdu d'une sève humaine accordée en profondeur aux saisons, aux rythmes de la planète, sève qui nous irrigue et nous recharge de vitalité, et par laquelle, davantage peut-être que par la pointe de la lucidité la plus éveillée, nous communiquons entre nous. »
Restituer à la littérature sa respiration, cette alternance de contemplation et d'action, n'est-ce pas retrouver le sens même, par étymologie réactivée, du mot grec désignant l'écrivain: syngrapheus, qui signifie littéralement, « écrire avec » ? Ecrire non point seul face au monde, ou seul dans le « travail du texte » mais écrire en laissant le monde s'écrire à travers nos mots et nos phrases qui, au demeurant, font aussi partie du monde, comme une pincée de cendres, un givre, un pollen.
Suivre selon le mot de Victor Hugo, « la pente de la rêverie », c'est écrire avec l'être: « Dans la rêverie, il y a le sentiment d'y être tout à fait, et même beaucoup plus que d'habitude. Pour ma part je la définirais certainement - plutôt qu'un laisser-aller - un état de tension accrue, le sentiment d'une circulation brusquement stimulée des formes et des idées, qui jouent mieux, qui s'accrochent plus heureusement les unes aux autres, facilitent le jeu des correspondances ». Syngrapheus est l'écrivain qui accorde à ce qui survient, à l'imprévisible, sa part royale; il est aussi celui qui s'y accorde, qui ne dédaigne point la « leçon de choses » que le réel, et plus particulièrement dans les zones frontalières entre la veille et le sommeil, prodigue avec une inépuisable générosité.
Julien Gracq se rapproche ainsi de nous en s'éloignant. Ce goût du lointain, qui caractérise son œuvre, s'est éloigné de notre temps qui affectionne les rapprochements, la maitrise de l'espace, le village planétaire, les communications instantanées. Mais ce lointain, ce lointain vertigineux, ce lointain d'abysses ou de hautes frondaisons, ce lointain de landes, de lointain de précipices, ce lointain disponible jusqu'à l'effroi, ce lointain voilé, ce lointain antique et alcyonien qui suscite ces « sensations purement spaciales logées au cœur de la poitrine », par « sa foncière allergie au réalisme », sa profusion de forêt mythologique, que semblent avoir fréquenté également Shakespeare et Perrault, ce lointain, par un sentiment d'imminence propre à la guerre, présente et voilée dans presque tous ses récits, nous détache des soucis économiques et domestiques pour nous précipiter dans la pure présence des choses menacées de nous quitter à chaque instant. Ce lointain redevient une nostalgie, un appel, une présence ardente.
Ces « grèves désolées », ces rivages hantés, ces ruines dont les crêtes semblent percer l'atmosphère pour atteindre à un éther immémorial nous apparaissent comme une vocation: elles rendent présentes à notre conscience (qui cesse alors d'être seulement conscience des choses représentées) un monde, que, nous autres modernes, ne percevions plus, une géographie mystérieuse, une géo-poétique, si l'on ose le néologisme, qui, pour s'être tue durant des générations, nous revient comme un chant de la terre, un langage profus, un entretien lourd de beauté à la fois concrètes et spectrales.
Dans sa hâte, dans son volontarisme obtus, le moderne ne voit rien. Il passe à côté des êtres et des choses, glisse sur les surfaces. Cependant l'oeil garde mémoire, - une sorte de mémoire héraldique, ancestrale, et les récits de Julien Gracq semblent témoigner de cette mémoire seconde, de cette réalité d'autant plus dense qu'ordinairement dédaignée. « Reste cependant, écrit Bernard Noël, à l'intérieur même de l'œil, un rond de ténèbres, oui, ce moyeu de nuit autour duquel il voit. Pupille, le puit noir, tour d'ombre renversée vers quelque ciel de tête. » Ces grandes houles de ténèbres concrètes, cette vaste nuit renversée déferlent à travers le monde, filtrent une lumière hors du temps, une lumière d'en haut, une lumière de vitrail... Cette requête du cosmos nous précipite dans un outre-monde dont seul nous sépare, selon le mot de Henry Miller, un « cauchemar climatisé ». Ce heurt des ténèbres er de la lumière rougeoie. Ce heurt est de feu et de sang. La nature servie par une prose qui consent à la lenteur révèle sa vérité; elle est le Graal, la coupe du ciel renversée sur nos têtes ! L'écriture accordée à ce drame de ciel, de mer, de forêts et de vent devient alors elle-même la rencontre d'Amfortas et de Parsifal: « Et, passant outre à une sacrilège équivalence, comme dans le délire d'une infâme inspiration, il était clair que l'artiste, que sa main inégalable n'avait pu trahir, avait tiré du sang même d'Amfortas, qui tachait les dalles de ses flaques lourdes, la matière rutilante qui ruisselait dans la Graal, et que c'était de sa blessure même que jaillissaient de toutes parts les rayons d'un feu impossible à tarir... ».
« Le monde de Julien Gracq, écrit Maurice Blanchot, est un monde de qualités, c'est-à-dire magique. Lui-même par la bouche de son héros: le Beau Ténébreux (deux adjectifs) reconnait dans la terre une réalité fermée dont il espère mettre en mouvement, par une espèce d'acuponcture tellurique, les centre nerveux, des points d'attaches à la vie ». Les réserves dont Maurice Blanchot, par ailleurs, témoignera à l'égard de Gracq (auxquelles répondront les réticences de Gracq à l'égard de Blanchot), tiennent tout autant à une question de style qu'au dessein même de l'œuvre. Sans voir directement, entre Gracq et Blanchot, l'affrontement de deux vues du monde irréconciliables, force est de reconnaître que Blanchot (héritier de Maurras pour le style et de Kafka pour la pensée) se trouve du côté d'une décantation classique, d'une clarté des lignes, - dussent-elles ouvrir les croisées à des vertiges métaphysique ! - alors que Julien Gracq, plutôt celte que roman ( avec de certaines inclinations romantiques et wagnériennes) s'acharne à forer et à forger la langue française dans le sens d'un continuum que l'incandescence de la vision soude en un métal baroque non dépourvu de volutes et d'efflorescences, mais dures, parfois, et tranchantes. Autant Blanchot répugne aux adjectifs, qu'il n'est loin de tenir de superflus, autant Gracq construit sa phrase pour les accueillir. Les adjectifs ne viennent pas, dans l'œuvre de Gracq, à la rescousse de la structure ou de l'idée, mais, outrepassant en importance les noms et les verbes, apparaissent comme l'essentiel de la chose à dire.
« La langue française, écrit Blanchot, où les adjectifs ne sont pas à leur aise, signifierait non seulement la volonté de bannir l'accident et de s'en tenir à ce qui compte, mais aussi la possibilité d'atteindre la vérité des choses en dehors des circonstances qui nous la révèle. » L'observation pertinente frôle ici, comme chez Maurras, un jugement de valeur plus général, et peut-être abusivement général. Le génie de la langue française n'est-il pas assez grand pour s'exercer avec un égal bonheur dans la maxime sèche de Vauvenargues, dans la profusion coruscante de Rabelais, les énigmes aigües de Mallarmé, les cabrioles félines de Colette ou les suavités violentes de Barrès, - où les adjectifs ne semblent point si déplacés ? Mais peut-être la question est-elle bien plus philosophique qu'esthétique ? Blanchot n'eût sans doute pas contredit à ce philosophe de l'altérité pure qui écrivait: « Médire de la technique au nom de la poésie de la nature est une barbarie ». Dans cette perspective, une défiance morale, sinon moralisatrice, est sans doute possible à l'égard de l'œuvre de Julien Gracq, défiance pour les sortilèges pour les enchantements jugés coupables de dissoudre la conscience humaine... Sinon que depuis Au Château d'Argol, Un Beau Ténébreux, Le Rivage des Syrtes, les temps ont changés et que les sortilèges obscurs, les noirs ensorcellements qui menacent l'intégrité de la conscience humaine, les fascinations funestes où la raison périclite, où la barbarie redevient possible, se trouvent bien davantage dans les modernes techniques de communication, de contrôle et de destruction que dans la contemplation des forêts bretonnes, des « nuits talismaniques » ou des écumes sur les grèves.
Le monde vivant, le monde tellurique et météorologique ayant été déserté, ce n'est plus devant son règne jadis peuplé de dieux que cède la conscience humaine, si jamais elle céda, mais bien dans ce vide crée par son absence. « Là où il n'y a plus de dieux, disait Novalis, règnent les spectres. » Autrement dit l'abstraction, la planification et les « réalités virtuelles ». Si bien que le mot d'ordre classique (« Déteste les adjectif et chéri la raison »), ne vaut plus dans un monde où les pires déroutes de la raison sont la conséquence de la raison, où le « technocosme » est devenu un sortilège, une féérie dérisoire, certes, mais dont on ne peut d'évader, où le vide des qualités, corrélatif d'un appauvrissement du langage, est lui-même devenu une immense métaphore obstinée.
La « dissolution brumeuse et géante » évoquée par Julien Gracq est tout autant une expérience qu'une mise-en-demeure. Par ce monde arraché, in extremis, aux planificateurs, par ce monde effondré qui nous laisse face au retentissement de l'effondrement, nous nous trouvons désillusionnés d'une raison qui ne s'interroge plus sur sa raison d'être, d'une civilisation lisse et fuyante, qui nous maintient sans cesse en-deçà de nos plus hautes possibilités. Dans l'œuvre de Julien Gracq, nous voyons ce monde se défaire, mais cette défaite qui nous emporte comme un ressac nous révèle l'envers de la vague, l'envers du langage, la vérité étymologique, la réverbération antérieure aux mots et aux choses. La puissance de cette réverbération est une menace, mais une menace salvatrice.
•
Deux ouvrages de Luc-Olivier d'Algange, parus dans la collection Théôria, aux éditions de L'Harmattan, abordent certains thèmes évoqués dans l'article ci-dessus: Le Déchiffrement du monde, la gnose poétique d'Ernst Jünger; L'Ame secrète de l'Europe.
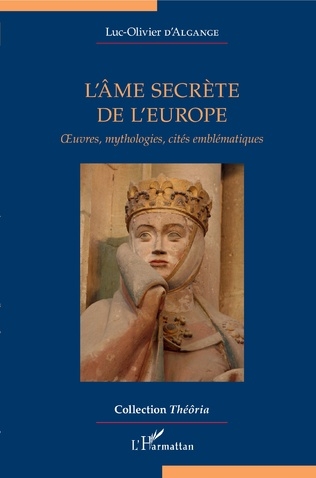
21:04 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook
Facebook


